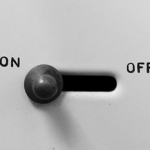Classement de Shanghai et marchandisation de l’université. Un extrait du livre de H. Harari-Kermadec
Évaluer la recherche, évaluer l’enseignement, évaluer l’université… L’évaluation est partout, comme l’ombre portée du néolibéralisme. Appliquée au système universitaire pris dans une concurrence internationale qui se cristallise dans le classement de Shanghai, cette maladie évaluative est un des dispositifs de marchandisation du savoir et de production d’un Capital humain.
Dans son ouvrage, qui vient de paraître aux éditions Le Bord de l’eau, Hugo Harari-Kermadec révèle les enjeux de la mise en nombre de l’université et ses effets à moyen terme. Nous en publions ici la conclusion.

Hugo Harari-Kermadec, Le classement de Shanghai. L’université ubérisée, Editions Le Bord de l’Eau, 2019, 160 p., 18 euros.
***
Conclusion : impossible contre-quantification ?
Est-il possible de construire des statistiques ou des indicateurs sur l’Université qui ne produisent pas des effets d’abstraction et d’aliénation ? Qui ne s’inscrivent pas dans une dynamique de marchandisation ? Il est clair que la mesure du travail et de ces produits en équivalent monétaire, du moins dans le présent contexte néolibéral, est à exclure dans cette optique. Le contexte est également propice à ce que toute mesure accédant à une certaine légitimité s’impose et produise une vision unidimensionnelle de l’Université. Pour Alain Caillé (2012, p. 32), il est illusoire de chercher à refuser toute quantification, mais « il convient de déterminer dans chacun des secteurs et dans chacune des activités ordinaires la part de ce qui doit être objectivé et mesuré (ce qui n’est pas la même chose), et la part de ce qui ne peut pas et ne doit pas l’être ». Cette entreprise requiert une approche multi-dimensionnelle : « la juxtaposition, sans fusion possible, d’indicateurs monétaires et d’indicateurs faisant état de la qualité de situations sociales et des ressources est une condition de l’amélioration de la connaissance que nous en avons » (Harribey, 2013, p. 345).
Une première réponse consiste à proposer des indicateurs statistiques répondant à d’autres formes de gouvernement que celle de l’époque néolibérale. Les statistiques de l’Université pourraient ainsi s’inscrire naturellement dans un régime d’Etat-providence (Desrosières, 2008a, p. 39-56) plus compatible avec l’éthique de service public. D’un point de vue économique, le travail y serait donc producteur de valeur non marchande et son expression monétaire traduirait uniquement les intrants, la valeur de la force de travail affectée à l’Université. Si l’on retient la proposition d’Aurélien Casta (2017) de verser un salaire aux étudiant·es, il viendrait alors naturellement gonfler la part de l’Université dans le PIB. Avec ou sans la prise en compte de l’activité des étudiant·es, cette forme de quantification monétaire ne dirait rien de la production, en terme de qualité ou de quantité.
A contre-courant de la quantification néolibérale (Cusso et D’Amico, 2005), il faudrait également refuser les classements pour privilégier les mesures répétées et cohérentes permettant un suivi de la mise en œuvre des politiques d’enseignement supérieur et de recherche plutôt qu’une mise en concurrence. Dans le cas français, un indicateur d’équité de l’enseignement supérieur permettrait de mettre en lumière les effets polarisants des évolutions néolibérales et de les mettre en débat, qu’elles émanent de décisions politiques, d’initiatives de chefs d’établissement ou de l’insertion dans le marché mondial de l’enseignement supérieur. Il s’inscrirait dans une optique d’Etat-providence compatible avec les valeurs universitaires : égalité, homogénéité et régularité pour les usagers, continuité sur le territoire, mais aussi coopération et complémentarité plutôt que compétition entre les universitaires et entre les établissements. Sur le modèle de l’indice de Gini, on pourrait se contenter d’une mesure des inégalités dans la répartition des moyens à différentes échelles (nationale, entre filières, au niveau d’une COMUE et même au sein d’un établissement), ce qui permettrait d’identifier des mécanismes de concentration à l’œuvre ; on peut penser aux pôles d’excellence mais aussi à des disparités plus fines sur le modèle de l’évitement scolaire (François et Poupeau, 2004). Une seconde dimension ayant pour objet le capital scolaire (par exemple sur la base des résultats au bac) pourrait venir compléter cette cartographie et rompre avec la monétisation.
S’il y a de nombreuses proximités entre les valeurs universitaires et l’Etat-providence, l’autonomie universitaire est en partie contradictoire avec la vision d’un État protecteur mais surplombant. En plus d’une transformation des indicateurs, il faut donc en réduire l’importance, ou plutôt les inscrire dans un processus de prise de décision collective, comme le présente Paradeise (2012, p. 90) : « il est un autre usage possible que celui mécaniste des indicateurs : offrir une approximation des traits d’un objet ou d’un être individuel ou collectif dans sa variété, avec pour objectif d’éclairer une décision respectueuse de la diversité des significations de son activité. [… Cette démarche réflexive partagée] peut faire barrage au sacrifice des missions de service public sur l’autel des régulations quasi marchandes ». Plutôt qu’une mesure synthétique unique, qui produit de l’autorité et prépare la monétisation puis la marchandisation, une multiplicité d’indicateurs toujours partiels peut être utile à des processus de délibération collective.
Dans ce texte, l’approche retenue autour de la production plutôt que du marché permet de rendre visible le point de vue des producteur·trices de l’Université (y compris les étudiant·es comme individus et non comme investisseurs), mais réduit sans doute celui des usager·ères indirect·es, qui sont moins parties prenantes de l’Université comme institution autonome du reste de la société. Les forums hybrides (regroupant des représentants du monde universitaire et des citoyens tirés au sort, par exemple) sont une piste naturelle pour associer les citoyens à la définition d’indicateurs alternatifs de l’Université, et inclure l’Université dans son environnement à partir d’une logique délibérative plutôt qu’économique. Ces deux premières pistes de quantification, Etat-providence ou forum hybride, ont pour limite de ne pas penser la question du pouvoir à même de les mettre en œuvre. S’il est envisageable de construire de tels indicateurs avec une petite équipe de recherche, le contexte contemporain dans l’Université française laisse peu d’espoir pour qu’ils suscitent beaucoup d’effet : « le fait que les comptabilités nationales privilégient à travers le PIB les activités monétaires n’est pas dû à une hiérarchie provenant de la conception de ces comptabilités, mais il reflète les structures de la société elle-même et la hiérarchie que l’organisation sociale commande » (Harribey, 2013, p. 441). Une quantification alternative et émancipatrice doit donc d’emblée participer d’une remise en cause des positions et des structures sociales.
On peut alors adopter une autre approche alternative à la quantification néolibérale, moins défensive. En effet, si la quantification participe de l’exercice d’un pouvoir, il est possible d’imaginer qu’elle s’inscrive dans la construction d’un contre-pouvoir : « quantifier, c’est produire du savoir, donc acquérir du pouvoir. C’est donc une arme précieuse dont nous pouvons nous ressaisir ». Les effets de redéfinition propres à la quantification sont alors consciemment mis en œuvre par celles et ceux sur laquelle la quantification s’exercent dans une démarche performative auto-appliquée. Ainsi « le collectif qu’il construit [peut devenir] un sujet politique, doté d’intérêts et de volonté propres. […] cette subjectivation est possible statistiquement » (Didier et Tasset, 2013, p. 125 et 132). S’il est peu probable que la démarche embrasse l’intégralité du groupe, la production d’une légitimité et même la production de nombres en elle-même est conditionnée à un certain degré d’adhésion des individus concernés par la quantification. Plusieurs tentatives de classements alternatifs à celui de Shanghai ont ainsi vu le jour : celui d’Amiens classant les universités françaises suivant la composition sociale des populations étudiantes (Brusadelli et Lebaron, 2012 ; Avouac et Harari-Kermadec) et celui de Toulouse classant les cent premières universités du classement de Shanghai suivant leur budget par étudiant·e et les frais d’inscription (Berné, 2018).
Dans un autre contexte, la sociologue Pauline Delage (2014, p. 452-453 ; Cavalin, 2013) a étudié comment la construction de statistiques sur les violences conjugales ont participé de l’émergence de ce phénomène comme problème public. Dans le cadre d’une pratique féministe, les constructions statistiques des violences faites aux femmes légitiment l’action des associations et s’inscrivent dans leur pratique. Lorsque le problème acquiert une reconnaissance et devient un objet de recherche et de préoccupation publique, l’optique féministe de la quantification de ces violences est concurrencée par d’autres conceptions dont certaines nient les asymétries de pouvoir entre hommes et femmes. La reconnaissance et l’inscription dans le droit et dans les politiques publiques se traduisent par la production de statistiques officielles qui doivent davantage « tenir » (Desrosières, 2008a, p. 12-13). On assiste alors à un passage d’une expérience statactiviste vers une situation stabilisée, au moins temporairement, et donc une institutionnalisation.
Le monde universitaire dispose de nombreux atouts à mobiliser pour se doter de statistiques alternatives reflétant son activité à partir d’une auto-définition, dans une démarche redonnant du sens au travail et au collectif. Hazelkorn (2011, p. 205) invite ainsi les établissements à faire leurs statistiques eux-mêmes. Mais c’est sans doute ignorer les rapports de pouvoir qui traversent les établissements : les chefs d’établissements, les directeurs d’unité, les jeunes chercheur·ses précaires et les étudiant·es ne définiront vraisemblablement pas leur indicateurs de la même façon. Dans le passé récent, les mobilisations ont souvent reposé soit sur des alliances entre les enseignant·es-chercheur·ses statutaires et précaires (avec de très rares chefs d’établissement malgré le caractère électif de cette responsabilité dans les universités) soit sur les étudiant·es. La précarité a d’ailleurs été l’objet d’une enquête à la suite des mobilisations de 2004 et 2009, menée par l’intersyndicale de l’enseignement supérieur et de la recherche avec pour finalité de rendre visibles les précaires de l’Université. Plutôt qu’une définition de la précarité partant des catégories du droit du travail (par exemple, Soulié, 1996), c’est l’échantillon formé par les répondants qui produit une définition de la précarité, une auto-définition par le fait de s’être considéré comme concerné par l’enquête. Il apparaît ainsi que le personnel administratif et technique est également fortement touché par la précarité.
Une analyse poussée de cette enquête permettrait de comparer les effets produits par une quantification autour d’un phénomène mobilisateur comme la précarité dans l’enseignement supérieur et la recherche avec ceux de la quantification néolibérale. On peut attendre d’un tel processus qu’il produise peu d’effet d’abstraction : la mobilisation nécessaire à la mesure répond à un contexte spécifique. Dans un contexte (institutionnel, géographique, temporel) différent, il est peu probable que l’enquête obtienne la participation nécessaire à la production de statistiques. Dès lors, si les données restent localisées dans le temps et l’espace, leur usage est limité, parce qu’elles ne représentent que ceux qui ont participé à l’enquête et que toute extrapolation serait facilement contestable sur le fond, mais aussi parce qu’elles ne se prêtent pas à des opérations probabilistes. L’échantillon obtenu ne correspond ni à un sondage aléatoire ni à un recensement. Il s’agit donc d’une forme de quantification avec très peu de commensuration. A moins que la mobilisation ne perdure, la campagne de recueil s’interrompt et aucune mise en série ne permet de dégager une évolution, par exemple. Enfin, la difficulté de la répétition de la mesure dans ce type d’opération non ou peu institutionnalisée interdit une anticipation de celle-ci, ce qui réduit l’effet normalisateur, le pouvoir performatif. La fragilité de la quantification qui en résulte est intéressante parce qu’elle maintient au premier plan l’engagement les acteur·rices.