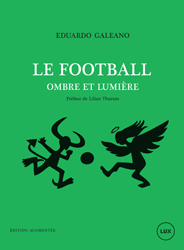
À lire : un extrait de « Le football, ombre et lumière » d’Eduardo Galeano
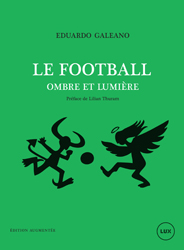
Eduardo Galeano, Le football, ombre et lumière, Montréal, Lux éditeur, 2014.
Le Mondial 2006
Comme d’habitude, les avions de la CIA hantaient les aéroports européens, faisant comme chez eux, sans autorisation ni avoir averti personne ni rien, et transféraient des prisonniers vers les salles de tortures réparties à travers le monde.
Comme d’habitude, Israël envahissait Gaza, et pour récupérer un soldat kidnappé kidnappait, à feu et à sang, la souveraineté palestinienne.
Comme d’habitude, les scientifiques annonçaient que le climat devenait fou et que tôt ou tard — tôt, en réalité — les pôles fondraient et les mers dévoreraient ports et plages, mais ceux qui rendaient fou le climat, ceux qui empoisonnaient l’air, restaient, comme d’habitude, sourds.
Comme d’habitude, on mijotait une fraude pour les proches élections au Mexique, où la base de données pour le décompte officiel des bulletins avait saintement été conçue par le beau-frère du candidat de la droite.
Comme d’habitude, des sources bien informées de Miami annonçaient la chute de Fidel Castro, qui n’était plus qu’une question d’heures.
Comme d’habitude, on avait la confirmation qu’à Cuba on violait les droits de l’homme : à Guantánamo, base militaire nord- américaine en territoire cubain, trois des nombreux prisonniers enfermés sans accusation ni jugement étaient retrouvés pendus dans leurs cellules, et la Maison-Blanche expliquait que ces terroristes s’étaient suicidés pour attirer l’attention.
Comme d’habitude, on criait au scandale quand Evo Morales, premier président indigène de la Bolivie, nationalisait le pétrole et le gaz, commettant ainsi l’impardonnable crime de faire ce qu’il avait promis de faire.
Comme d’habitude, la guerre continuait ses massacres en Irak, pays coupable d’avoir du pétrole, tandis qu’en Californie la société Pandemic Studios annonçait le lancement d’un nouveau jeu vidéo où les héros envahissaient le Venezuela, autre pays coupable d’avoir du pétrole.
Et les États-Unis menaçaient d’envahir l’Iran, pays coupable d’avoir du pétrole, parce que l’Iran voulait la bombe atomique, et que du point de vue du pays qui avait lancé les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki cela constituait un danger pour l’humanité.
Bruno aussi était un danger. Bruno, ours sauvage, s’était échappé d’Italie et batifolait dans les forêts germaines. Bien qu’il ne semblât pas du tout s’intéresser au football, les agents de l’ordre conjurèrent la menace en l’exécutant à coups de fusil en Bavière, peu avant l’inauguration de la dix-huitième Coupe du monde.
***
Trente-deux pays, de cinq continents, disputèrent soixante-quatre matchs dans douze stades imposants, beaux, fonctionnels, de l’Allemagne unifiée : onze stades de l’Ouest et à peine un de l’Est. Ce Mondial fut marqué par les slogans que les sélections arborèrent, au début des parties, contre le fléau universel du racisme. Le sujet était brûlant. À la veille du tournoi, le dirigeant politique français Jean-Marie Le Pen avait proclamé que la France ne se reconnaissait pas dans ses joueurs, parce qu’ils étaient presque tous noirs et que leur capitaine, Zinedine Zidane, plus algérien que français, ne chantait pas l’hymne national; le vice-président du Sénat italien, Roberto Calderoli, lui avait fait écho en proférant que les joueurs de la sélection française étaient des Noirs, des islamistes et des communistes qui préféraient L’Internationale à La Marseillaise et La Mecque à Bethléem. Quelque temps plus tôt, l’entraîneur de la sélection espagnole, Luis Aragonés, avait traité le joueur français Thierry Henry de « nègre de merde », et le président perpétuel du football sud-américain, Nicolás Leoz, avait présenté son autobiographie en disant qu’il était né « dans un village où vivaient trente personnes et cent Indiens ».
Un peu avant que le tournoi ne s’achève, presque à la fin de la finale, Zidane, qui faisait ses adieux au football, se jeta sur un adversaire qui lui avait dit et répété quelques-unes de ces insultes que les énergumènes hurlent depuis les tribunes des stades. L’insulteur s’étala de tout son long et Zidane, l’insulté, reçut un carton rouge de l’arbitre et les huées du public qui allait l’ovationner, et il s’en alla à tout jamais.
Mais ce Mondial fut le sien. Il fut le meilleur joueur du tournoi, en dépit de ce dernier acte de folie ou de justice, selon le point de vue où on se place. Grâce à ses belles actions, grâce à son élégance mélancolique, il nous fut permis de croire que le football n’est pas irrémédiablement condamné à la médiocrité.
***
Lors de ce dernier match, peu après l’expulsion de Zidane, l’Italie battit la France aux tirs au but et fut sacrée championne.
Jusqu’en 1968, le sort des parties qui se terminaient sur un score d’égalité se décidait à pile ou face. Depuis cette date, il se joue aux penalties, ce qui ressemble assez au hasard. La France avait dominé l’Italie, mais quelques secondes prévalurent sur deux heures de jeu. Il était arrivé la même chose, auparavant, avec le match où l’Argentine, supérieure à l’Allemagne, avait dû rentrer à la maison.
***
Huit joueurs du club italien de la Juventus atteignirent la finale à Berlin : cinq jouaient pour l’Italie, et trois pour la France. Et il se trouve que la Juventus était l’équipe la plus compromise dans les magouilles qui furent dévoilées à la veille du Mondial. Des « mains propres » aux « pieds propres » : les juges italiens constatèrent toute une collection d’embrouilles, d’achat d’arbitres, d’achat de journalistes, de falsification de contrats, d’adultération de bilans, de distribution de charges, de manipulation de la télévision… Parmi les clubs impliqués se trouvait l’AC Milan, propriété du virtuose Silvio Berlusconi, qui avait pratiqué avec une fructueuse impunité la fraude dans le football, dans les affaires et au gouvernement.
***
L’Italie remporta sa quatrième Coupe et la France termina à la deuxième place, suivie par l’Allemagne et le Portugal, ce qui peut aussi se traduire en disant que Puma triompha d’Adidas et de Nike.
Le meilleur marqueur fut Miroslav Klose, joueur de la sélection allemande, avec cinq buts.
L’Amérique et l’Europe se retrouvèrent à égalité : chaque continent avait remporté neuf mondiaux.
Pour la première fois dans l’histoire, le même arbitre, l’Argentin Horacio Elizondo, donna le premier et le dernier coup de sifflet, lors du match inaugural et de la finale. Il démontra aussi qu’il avait été bien choisi.
Il y eut d’autres records, tous brésiliens. Ronaldo, gros mais efficace, fut le meilleur marqueur de l’histoire des mondiaux, Cafu le joueur ayant remporté le plus de matchs et le Brésil devint le pays ayant marqué le plus de buts, rien de moins que deux cent un, et remporté le plus de victoires consécutives, rien de moins que onze. Pourtant, ce Mondial 2006 exista, mais ne se vit pas. Ronaldinho, la superstar, n’offrit ni buts ni fulgurances, et la colère populaire transforma sa statue, qui mesurait sept mètres de haut, en un tas de cendres et de ferraille tordue.
***
Ce tournoi finit par se transformer en Coupe d’Europe, sans Latino-Américains, ni Africains, ni aucun joueur non européen lors de la phase finale.
Excepté la sélection équatorienne, qui pratiqua un beau jeu mais n’alla pas loin, ce fut un Mondial sans surprises. Un spectateur sut le résumer ainsi :
— Les joueurs ont une conduite exemplaire. Ils ne fument pas, ne boivent pas, ne jouent pas.
Les résultats consacrèrent ce qu’on appelle aujourd’hui le sens pratique. On ne vit guère d’imagination. Les artistes firent place aux souleveurs de fonte et aux coureurs olympiques, qui au passage shootaient dans la balle ou dans un adversaire.
Tout le monde derrière, presque personne devant. Une muraille de Chine défendant les buts et un Indien des plaines attendant la contre-attaque. Il y a quelques années encore, les avants étaient au nombre de cinq. Il n’en reste plus qu’un, et au train où vont les choses, il n’y en aura bientôt plus aucun.
Comme l’a constaté le zoologue Roberto Fontanarrosa, l’avant et le panda sont des espèces en voie d’extinction








