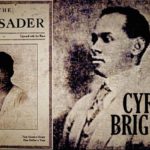À lire un extrait de Une histoire populaire du sport aux États-Unis, de D. Zirin
Dave Zirin, Une histoire populaire du sport aux États-Unis, traduit de l’anglais par Arianne Des Rochers et Alex Gauthier, 2017, Lux.
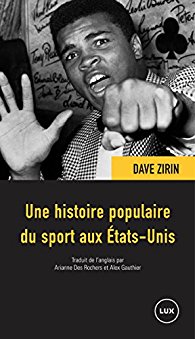
Ça chauffe à Los Angeles
En 1992, les vestiges de l’ère Reagan ont refait surface lorsque Los Angeles a connu le soulèvement urbain le plus important de l’histoire des États-Unis. Les émeutes étaient telles que même le monde du sport professionnel s’est vu contraint de les remarquer : des équipes de Los Angeles ont dû annuler leurs matchs, y compris celui qui opposait les Clippers et les Jazz de l’Utah en huitième de finale du championnat de la NBA, et un match important entre les Dodgers et les Phillies de Philadelphie au baseball.
La vague de protestations à Los Angeles a été déclenchée lorsqu’un jury – exclusivement blanc – a acquitté quatre agents de police qui avaient tabassé sans pitié Rodney King, un travailleur de la construction sans emploi. L’attaque, qui avait été filmée, a fait le tour des stations de télévision partout dans le monde. Le procès a causé d’innombrables d’émeutes, en particulier dans le quartier South Central de Los Angeles, durement affecté par la crise économique qui avait débuté en 1990 – et qui allait représenter le plus long ralentissement économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Le chômage chez les jeunes Noirs de la ville dépassait les 45 %. La pauvreté extrême, combinée à la corruption de la police et au racisme du système de justice, avait créé un profond sentiment de désespoir et de colère.
Voilà d’ailleurs qui explique le fait que les révoltes de Los Angeles étaient menées non seulement par des Noirs, mais aussi par des Latinos, des Blancs et des Asiatiques. Le maire de Los Angeles Tom Bradley, lui-même noir, a dit à l’époque que « la plupart des gens qui étaient impliqués dans les actes de violence sont de jeunes Blancs[1] ». Cela étant dit, 52 % des gens qui ont été arrêtés pendant les émeutes étaient des Latinos, contre 38 % de Noirs et seulement 10 % de Blancs.
Les émeutes ont également révélé que l’élection d’un maire noir n’avait pas amélioré l’état de misère dans lequel vivait la communauté afro-américaine à Los Angeles – pas plus qu’à New York, Chicago, ni Atlanta d’ailleurs, où les maires étaient également noirs. Dans la plupart des cas, les conditions des Afro-Américains s’étaient même détériorées plutôt qu’améliorées[2].
La rébellion a démontré à quel point le président de l’époque, George H.W. Bush, était déconnecté de la réalité. Celui qui n’avait aucune idée du prix d’un litre de lait – celui qui était né, pour reprendre la célèbre citation d’Ann Richards, « avec un pied en argent dans la bouche » – ne pouvait vraisemblablement pas comprendre la colère et l’insatisfaction qui ont forcé la Garde nationale à protéger une succursale du magasin Frederick’s of Hollywood en Californie[3]. Donc Bush, qui profitait d’un taux d’approbation qui frôlait les 90 % à la suite de sa victoire lors de la guerre du Golfe en 1991, s’est retrouvé au beau milieu d’une lutte pour sa survie politique tandis que l’économie était en chute libre. La conjoncture a donc joué en faveur d’un gouverneur méconnu de l’Arkansas.
En effet, la crise économique et les émeutes de Los Angeles ont livré les élections américaines de 1992 à Bill Clinton sur un plateau d’argent. Celui-ci s’est servi des soulèvements en Californie pour attaquer le président Bush et pour soutenir sa propre campagne. Clinton s’est rendu dans les rues de South Central, à Los Angeles, pour proclamer sa haine envers Bush tout en fustigeant les « pilleurs », dont les enfants « grandissaient dans une culture étrangère à la nôtre, sans famille, sans voisinage et sans religion, sans un soutien quelconque ». La solution, celle qu’allait marteler Clinton à répétition pendant huit ans, était celle de la « responsabilité personnelle ».
Les leaders politiques noirs appuyaient Clinton, attribuant les émeutes de Los Angeles aux politiques de Bush tout en soutenant la rhétorique de la « responsabilité personnelle ». Pendant la présidence de Clinton, toutefois, le nombre de prisonniers aux États-Unis s’est multiplié de façon astronomique. À la fin de 1990, les Noirs, qui représentaient seulement 13 % de la population américaine, comptaient pour 50 % de la population carcérale. En 2000, 791 600 hommes noirs étaient derrière les barreaux, contre 603 032 sur les bancs des universités. En revanche, en 1980, les hommes noirs inscrits à l’université étaient trois fois plus nombreux que ceux qui se trouvaient en prison.
Comme promis, la « responsabilité personnelle » est devenue la priorité à l’ordre du jour, et Clinton a adopté un programme républicain visant à démanteler le système d’aide sociale. Trois mois avant les élections de 1996, il a approuvé le Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act, qui allait sonner le glas de l’aide publique telle qu’on la connaissait à l’époque. Le projet de loi fut accueilli favorablement, car il retirait l’aide sociale à plus de 2,5 millions d’Américains ; mais personne ne s’est demandé ce qui allait arriver à tous ces gens qu’on laissait tomber. La désindustrialisation, la sous- traitance et le boom des prisons ont, mis ensemble, créé un contexte où les programmes sportifs dans les villes ont vite dépéri.
Tout cela a bien sûr eu un impact considérable sur le monde des sports. Jusque là, le quartier South Central de Los Angeles avait été le berceau du baseball noir, produisant des joueurs exceptionnels comme Eric Davis ou Darryl Strawberry. Ce ne fut plus le cas, et pour des raisons avant tout économiques. Comme le joueur des ligues majeures Royce Clayton l’a dit, « de nombreuses familles noires ne peuvent se permettre d’acheter les gants, les balles, les bâtons, les uniformes, bref tout l’équipement requis pour jouer au baseball, pas plus qu’elles ne peuvent payer pour l’entretien des terrains[4] ».
En effet, le prix d’un équipement de base – bâton, balle, souliers à crampons, gant – coûte au minimum 75 dollars, tandis qu’un ballon de basketball ou de football ne coûte que 20 dollars et peut servir à toute une équipe. Ensuite, il y a la question de l’entretien des terrains et des ligues par les municipalités. À Washington D.C., les terrains de baseball publics font pitié. Ils sont souvent couverts d’éclats de verre brisé, de déchets et de rats[5]. Les propriétaires des grandes équipes de baseball auraient pu y remédier n’importe quand au cours des trente dernières années, en investissant modestement dans les programmes pour les jeunes et dans l’entretien des terrains. Mais ils ne l’ont pas fait, car les ligues majeures de baseball engraissaient maintenant grâce à joueurs « à bas prix » en provenance d’Amérique latine.
À ce sujet, Harry Edwards a eu ce commentaire :
« Je suis convaincu que la prolifération des joueurs latinos ne s’explique pas par le fait que, du jour au lendemain, les dirigeants des ligues se sont découvert un amour pour eux. C’est une question d’argent. […] Je suis convaincu, comme Michael Corleone le disait, que ce n’est pas une question personnelle. C’est une question d’affaires, point à la ligne[6]. »
Aujourd’hui, quelques tentatives tardives visent à développer des programmes dans les centres urbains, notamment dans le quartier South Central de Los Angeles, où on a ouvert une « usine » à joueurs. Mais ces initiatives sont insuffisantes et arrivent trop tard. Comme Edwards disait à propos de ces programmes : « C’est comme si on essayait d’insuffler de l’oxygène dans les poumons d’un homme mort. Ce dont il a besoin, c’est de vie, pas d’oxygène[7]. »
Byron Jones, un entraîneur de la Little League à Gary, en Indiana, m’a confié :
Ça me brise le cœur. Nos lanceurs, y compris mon propre fils, sont obligés de contourner d’énormes trous dans le sol pour ne pas se casser les chevilles. Oui, c’est vraiment l’argent qui place les Afro-Américains aux marges du sport. On entend beaucoup parler de telle entreprise ou telle équipe des ligues majeures qui a construit ou réaménagé un terrain, mais ces initiatives sont une goutte dans l’océan. Même à petite échelle, la bataille est perdue d’avance. Il suffit de penser au stade des Railcats de Gary. Les Railcats, et c’est tout à leur honneur, ont créé la fondation Homefield Advantage, qui a joué un rôle considérable pour la pratique du baseball à Gary. L’an dernier, les Railcats ont donné 50 000 dollars à l’organisme Gary Youth Baseball, un don qui a certainement été bénéfique. Mais les Railcats jouent dans un stade qui a coûté 50 millions de dollars. Pour une équipe des ligues mineures. Pensons-y un moment… 50 millions ! Avec seulement 1 % de cette somme, on aurait pu construire un complexe de baseball et de softball pour tous les jeunes de la ville. De les voir jouer dans un tel luxe tandis que nous, on baigne dans la boue et on joue sur des terrains vieux comme le monde, ça me laisse un goût amer. Notre seul objectif, au fond, c’est d’offrir à nos jeunes un endroit décent où ils pourront apprendre à jouer au baseball, ce sport que j’aime et que j’estime. On veut seulement donner à nos jeunes les mêmes chances qu’à tout le monde[8].
La fin des temps
La lune de miel de Bill Clinton avec le peuple s’est vite terminée lorsqu’il a renoncé à accorder l’asile politique à des réfugiés haïtiens séropositifs, chose qu’il avait promise pendant sa campagne électorale. Quelqu’un a toutefois combattu cette injustice jusqu’à ses tout derniers jours : Arthur Ashe, un ancien joueur de tennis qui allait succomber au sida. À la fin de la présidence de Bush, malgré sa santé extrêmement affaiblie, Ashe avait soutenu publiquement les réfugiés haïtiens, allant jusqu’à se faire arrêter devant la Maison-Blanche. Ses gestes ont d’ailleurs inspiré quelqu’un d’autre à passer à l’action. Deux mois après la mort d’Ashe, le joueur de la NBA Olden Polynice a manifesté devant le centre de détention Krome à Miami, afin de protester contre les conditions de détention des réfugiés haïtiens. Polynice est devenu plus actif politiquement après avoir vu Arthur Ashe, menotté, qui protestait contre les politiques du gouvernement Bush à l’égard de Haïti :
« C’est vraiment ça qui m’a convaincu de faire quelque chose, a-t-il dit. Sur le plan émotionnel, je ressens un lien fort avec les Haïtiens parce que je suis l’un d’entre eux. Arthur Ashe, lui, ne les connaissait pas. […] C’est ce qu’on appelle le don de soi[9]. »
Ashe a mentionné, dans un de ses derniers discours : « Vivre avec le sida n’est pas le fardeau le plus lourd que j’ai eu à porter dans ma vie. Le fardeau le plus lourd, c’était d’être noir. » Lors de son dernier discours, une semaine avant sa mort, il a dit : « Le sida a tué mon corps, mais le racisme a fait pire. Le racisme a tué mon âme. » Avant de s’éteindre à l’âge de 49 ans, Ashe s’est confié à un ami :
« On en vient à réaliser que la vie est courte, et qu’il faut se lever. Ne sois pas triste pour moi. On attend beaucoup de choses de ceux qui sont forts[10]. »
Jordan inc.
On attend aussi beaucoup de ceux qui ont du pouvoir. Malgré cela, un des athlètes qui détenaient le plus de pouvoir dans les années 1990 a aussi été celui qui en a fait le moins usage : Michael Jeffrey Jordan.
Dans les années 1990, la commercialisation des sports a gagné encore plus de terrain. La chute du mur de Berlin a signifié l’ouverture de nouveaux marchés et la création de nouveaux produits à vendre. En règle générale, les athlètes n’osaient pas revendiquer quoi que ce soit, de peur de devenir le prochain Craig Hodges. Comme l’a dit le joueur étoile de basketball Chris Webber :
« Les gens s’inquiètent tellement de l’impression qu’ils vont donner, ils ont peur que leurs commanditaires les laissent tomber. Ces jours ci, la règle d’or consiste à ne pas sortir du rang. Aujourd’hui, l’attitude privilégiée est : “Je ne veux pas qu’on m’observe. Ne me mettez pas à part, ne vous occupez pas de moi.” Je me suis moi-même senti de la sorte à quelques reprises – ce n’est pas sain. On a tellement d’infl uence ; je pense qu’on ne sait même pas à quel point[11]. »
À l’époque, le héros de tous les athlètes – en particulier les athlètes afro-américains – était le joueur de basketball Michael Jordan. Son curriculum vitæ est une hyperbole en soi. Il a été nommé meilleur joueur de la saison régulière à cinq reprises, et meilleur joueur des finales du championnat de la NBA à six reprises. Il est également le joueur ayant marqué le plus de points par match de tous les temps, en plus d’être le seul joueur de plus de 40 ans à se targuer d’une moyenne de 20 points marqués par match. La chaîne sportive ESPN et le New York Times le considèrent comme l’athlète du xxe siècle, bien avant Muhammad Ali. Alors que ce dernier brillait par sa conscience sociale éclairée, Jordan a brillé à titre d’homme d’affaires prospère[12].
Si la citation la plus emblématique de Muhammad Ali est « Je n’ai rien contre les Viet-Congs », celle de Jordan est sans doute la réponse qu’il a donnée lorsqu’on lui a demandé, en 1990, pourquoi il n’appuyait pas le démocrate afro-américain Harvey Gantt dans sa campagne électorale contre le républicain Jesse Helms, ouvertement raciste : « Les républicains achètent des chaussures de sport, eux aussi[13]. »
Michael Crowley, journaliste au Boston Pheonix, a écrit :
« Que la personnalité de Muhammad Ali éclipse à ce point celle de Michael Jordan n’est peut-être pas si surprenant, au fond. Peut-être que Jordan refl ète notre époque aussi bien qu’Ali a reflété la sienne. Comme celui-ci a été un vecteur du chaos social et de la libération spirituelle de son temps, Jordan symbolise l’apathie politique et la superficialité culturelle du nôtre. Ali, un rebelle incendiaire et passionné, était l’archétype des années 1960. Michael Jordan, un nom de marque neutre et apolitique, est l’archétype des années 1990[14]. »
En 2000, le magazine Forbes a évalué la valeur commerciale de Jordan à 43,7 milliards de dollars américains. En mars 1995, lorsque la rumeur voulait qu’il fasse un de ses nombreux retours au jeu dans la NBA, la valeur des actions des entreprises qui le commanditaient a grimpé de 3,84 milliards au total. Jordan a été l’image de Nike, Coke, McDonald’s, Hanes, Ball Park, et d’à peu près toutes les entreprises imaginables, sauf peut-être les fabricants de cigarettes menthol. De fil en aiguille, il a été le premier athlète à devenir un véritable homme d’affaires – à l’instar de Magic Johnson à la même époque. Aujourd’hui, les avoirs nets de Jordan sont évalués dans les neuf chiffres, il a essayé à maintes reprises d’acheter une équipe de la NBA, et il dirige sa propre ligne de chaussures Nike : Jumpman23[15].
Malgré tout, ses efforts pour projeter une image d’homme d’affaires moderne et pour éviter les enjeux sociaux et politiques lui ont attiré une certaine dose de critiques. Plusieurs athlètes professionnels très connus – notamment Jim Brown, Hank Aaron et le défunt Arthur Ashe – ont reproché à Jordan son silence. « Il préfère polir son image et signer des contrats de chaussures de sport plutôt que d’aider sa communauté », a dit Brown en 1992[16].
Ce qui agaçait les athlètes et les militants comme Brown, c’était que Jordan avait un pouvoir incommensurable qu’il aurait pu utiliser pour une bonne cause, si seulement il l’avait voulu. Lorsque les pratiques de l’entreprise Nike dans ses ateliers de misère en Asie du Sud-Est ont été révélées au public, une conférence de presse de Jordan aurait véritablement pu faire toute la différence. Jordan a plutôt préféré dire que cela ne le concernait pas. Puis, en 1997, il a changé de cassette, disant au Sporting News : « J’ai entendu beaucoup d’avis divergents sur la question. […] La seule chose que je puisse faire, c’est aller moi-même en Asie au mois de juillet et voir de mes propres yeux ce qui se passe là-bas. S’il y a un problème, […] si les conditions de travail y sont mauvaises, [les dirigeants de Nike] devront rectifier le tir. » Michael Jordan n’a jamais fait ce voyage en Asie[17].
Pour se défendre, Jordan a dit :
« Je pense que je n’ai pas assez de vécu pour faire entendre toutes ces opinions. […] Je crois que les gens veulent connaître mon opinion simplement parce qu’on a fait de moi une image, un modèle. Mais ça ne veut pas dire que j’ai vécu toutes ces choses[18]. »
Le journaliste sportif William Rhoden a souligné l’ironie de la situation de Jordan :
« S’il avait dit de sauter, s’il avait dit de protester, la plupart des athlètes auraient sauté, la plupart d’entre eux auraient protesté. […] Son droit de demeurer silencieux, il l’a gagné. Jordan n’était pas obligé de se prononcer sur les injustices raciales, mais il en a eu l’occasion comme personne avant lui[19]. »
Abdul-Rauf, l’anti-Jordan
Si les athlètes étaient à la recherche d’un modèle dans les années 1990, celui que Jordan proposait était certainement plus alléchant que celui de Mahmoud Abdul-Rauf. Né Chris Jackson à Gulfport, au Mississippi, Rauf a joué pour l’équipe de basketball de la Louisiana State University. C’était un arrière imbattable de 1,85 mètre de haut, et son tir en suspension était si rapide qu’on aurait dit qu’il tirait au lance-pierre. Lorsqu’il jouait pour les Nuggets de Denver dans la NBA, Abdul-Rauf refusait systématiquement de se tenir debout pendant l’hymne national au début des rencontres, prétextant que cela allait à l’encontre de ses croyances musulmanes.
Les médias lui ont demandé comment il pouvait faire cet affront au drapeau américain, qui était pourtant un symbole de liberté et de démocratie. Il leur a répondu que même si c’était sans doute le cas pour certains, le drapeau américain, dans de nombreux pays, était un symbole de tyrannie et d’oppression. Le 12 mars 1996, la NBA a suspendu Abdul-Rauf pour son refus de participer à l’hymne national, mais la suspension n’a duré qu’un seul match. Deux jours plus tard, la ligue, voulant à tout prix faire taire les premières pages incendiaires des journaux, a conclu avec Abdul-Rauf une entente selon laquelle il devait se tenir debout pendant l’hymne, mais qu’il pouvait fermer les yeux et pencher la tête vers le bas. Par la suite, il a souvent profité de ce moment pour faire une prière musulmane[20].
À Denver, les réactions ont été pour le moins hostiles. La tête penchée d’Abdul-Rauf était accueillie par les huées de la foule. Des animateurs de la radio KBPI de Denver ont été reconnus coupables de délits mineurs après s’être introduits dans une mosquée au Colorado en chantant l’hymne national en réponse à la controverse d’Abdul-Rauf[21].
Abdul-Rauf a changé d’équipe à quelques reprises avant de quitter la NBA. En 2001, à Gulfport au Mississippi, sa maison a été incendiée et réduite en cendres :
« En ce qui me concerne, ça m’a tout l’air d’un crime haineux, a dit Abdul-Rauf. Que quelqu’un ne puisse pas construire une maison sur le terrain qui lui appartient, c’est absurde. Ça prouve à quel point les gens ont des préjugés et de la haine à revendre. »
Pendant la reconstruction de la maison, les lieux ont été vandalisés avec des graffitis du Ku Klux Klan (KKK), et l’entrepreneur a reçu des menaces de mort par téléphone. Et Abdul-Rauf de poursuivre : « J’avais prédit, avant qu’on emménage ici, que la maison serait incendiée. Cette histoire n’est qu’un exemple, je crois, de tout le travail qu’il nous reste à faire en matière de relations humaines dans ce pays[22]. »
Notes
[1] Keeanga Taylor, « Ten Years After the Los Angeles Rebellion : No Justice, No Peace ! », 26 avril 2001, www.socialistworker.org/2002-1/404/404_08_LARebellion.shtml.
[2] Ibid.
[3] Le détaillant de lingerie féminine Frederick’s of Hollywood de Los Angeles, qui comprenait un musée doté de sous-vêtements portés par des vedettes de l’époque, a été pillé durant les émeutes. [NdT]
[4] Taylor, « Ten Years After the Los Angeles Rebellion », loc. cit.
[5] Dave Zirin, What’s My Name, Fool ? Sports and Resistance in the United States, Chicago (IL), Haymarket Books, 2005, p. 73.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Entrevue de l’auteur avec Jones.
[9] William C. Rhoden, « Dunking and Fasting for Principle », New York Times, 20 février 1993.
[10] Vivian Chakarian, « Arthur Ashe : Tennis Champion and Civil Rights Activist », Voice of America, 18 septembre 2005, http://learningenglish.voanews.com/a/a-23-2005-09-18-voa1-83125987/124762.html.
[11] William Rhoden, Forty Million Dollar Slaves : The Rise, Fall, and Redemption of the Black Athlete, Danvers (MA), Three Rivers Press, 2007, p. 183.
[12] Fred Kiger, « Air Supreme », Sports Century, http://espn.go.com/sportscentury.
[13] Ira Berkow, « Looking over Jordan », New York Times, 31 janvier 1999.
[14] Michael Crowley, « Hot Air : The Case Against Michael Jordan », Boston Phoenix, 25 janvier 1999.
[15] Zirin, What’s My Name, Fool ?, op. cit.
[16] Crowley, « Hot Air », loc. cit.
[17] Ibid.
[18] Rhoden, Forty Million Dollar Slaves, op. cit., p. 200.
[19] Ibid., p. 199.
[20] Jason Diamos, « Abdul-Rauf Is Calm In Face of Controversy », New York Times, 21 mars 1996.
[21] « Disk Jockeys Will Apologize for Mosque Incident », New York Times, 31 mars 1996.
[22] Fire Engulfs Abdul-Rauf Home », CBC Sports, 30 juillet 2001, www.cbc.ca/sports/story/2001/07/30/abdul-rauf010730.html.
Illustration : Photo d’Arthur Ashe.