
Football et théorie critique
Le football oscille entre mythologie et fait social total. Dans son nouvel ouvrage, Luis Martinez Andrade, docteur en sociologie et spécialiste de la théologie de la libération, envisage ce sport à partir du premier terme. Ce sont les mythologies du football qu’il explore en vingt-huit courts textes, qui nous font traverser périodes, pays et problèmes du ballon rond. Nous publions, avec l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur, quelques extraits de cet ouvrage (L’Harmattan, collection « Hispanoamericana. Essais et littérature »).
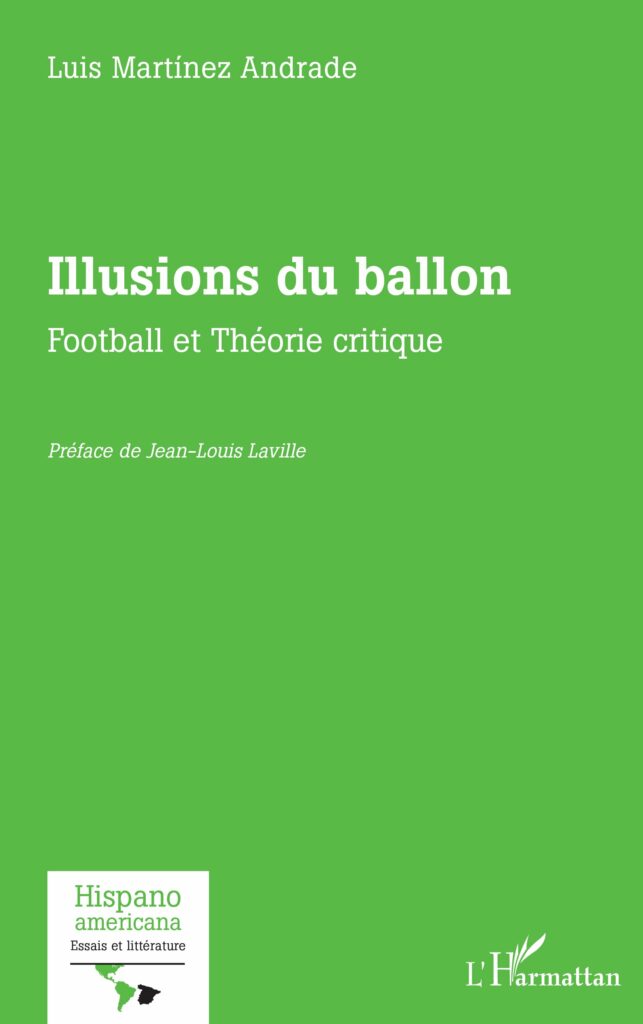
Ma relation avec le football a traversé différentes phases. Dans mon enfance, elle était empreinte d’une profonde vénération. Dans ma jeunesse, paradoxalement, elle était marquée par un intérêt voilé et un rejet conscient de sa marchandisation. Aujourd’hui, dans ma maturité, je peux dire qu’il s’agit d’une cohabitation saine. Comme la plupart des garçons, et aujourd’hui de nombreuses filles, en Amérique latine, j’ai rêvé de devenir footballeur. J’ai encore en mémoire les affiches sur les murs des chambres de mes amis avec l’image de l’astre argentin Diego Armando Maradona, du Mexicain Hugo Sánchez et du Colombien Carlos « Pibe » Valderrama. Il était également fréquent de trouver des affiches du Real Madrid, des Chivas de Guadalajara ou du club mexicain América.
À l’âge de huit ans, j’ai eu la chance de voir l’équipe de ma ville, el Puebla de La Franja, remporter le titre de champion et la Coupe 1989-1990 et ainsi obtenir le blason de Champion des champions. Je me souviens encore de cette soirée du 26 mai 1990 lorsque mon équipe Puebla de La Franja, sous la férule de Manuel Lapuente, a conquis le deuxième titre de champion de son histoire en battant les Leones Negros de l’Université de Guadalajara. Ces événements ont laissé une empreinte mnémonique, une représentation du passé qui sculpte notre expérience collective, comme l’aurait dit l’historien des religions Jan Assmann[1].
Pendant mon adolescence, mon horizon éthico-politique a été influencé par le mouvement néo-zapatiste du sud-est du Mexique et, bien sûr, par la perspective marxiste. Je me souviens encore de l’après-midi où mon ami, le poète Alí Calderón, nous a parlé du livre Principes fondamentaux de philosophie du penseur hongrois Georges Politzer. Notre sympathie pour le philosophe hongrois s’est accrue lorsque nous avons appris qu’il avait fait partie de la Résistance contre le nazisme. En 1942, Politzer a été arrêté, torturé, et ensuite fusillé par les nazis. On raconte que, devant le peloton d’exécution, ses derniers mots furent : « Je vous fusille tous ! »
En 1997, le premier tournoi de Fútbol La Franja a été organisé dans ma ville. Avec un groupe d’amis, nous avons décidé d’y participer. Le nom de notre équipe était Atlético Bolchevique. Au-delà de l’hilarité que cela peut provoquer chez le lecteur ou la lectrice de cette époque, il est important de mentionner qu’à ce moment-là, le consensus néolibéral dominait, et pour nous, c’était une façon de ne pas céder à l’ordre social.
Au fil du temps, mon intérêt pour le football, du moins pour celui promu par l’industrie culturelle, a considérablement diminué. Bien que j’aie parfois assisté à un match, par exemple, je suis allé en 2009 au stade Maracana pour le grand classique du football brésilien, le match entre Flamengo et Fluminense, j’avoue que j’ai cessé d’aller au stade. Ce n’est que lorsque je voyage au Mexique que je me rends au stade Cuauhtémoc, mais plus par nostalgie que par passion. D’ailleurs, depuis plus de trente ans, el Puebla de La Franja n’a pas réussi à gagner à nouveau la Coupe.
Par ailleurs, mon séjour en Europe m’a permis de constater le mépris de certains intellectuels envers le football. Cependant, dès mon adolescence, grâce aux écrits d’Eduardo Galeano et de Manuel Vázquez Montalbán, j’ai été immunisé contre le mépris que le football suscite dans certains milieux. Il est vrai que depuis son origine, le football, comme d’autres expressions culturelles, a été instrumentalisé par les classes dirigeantes pour imposer leurs projets sociopolitiques et leurs valeurs compétitives. Dans ses mémoires, le critique littéraire Terry Eagleton affirme que, pour le bien de la cause socialiste, il proposerait l’abolition du sport, car il détourne les gens de l’action politique[2]. Le fondateur de la théorie critique du sport, le sociologue français Jean-Marie Brohm[3], fait le même diagnostic. Cependant, le philosophe britannique et supporter du Liverpool, Simon Critchley, observe le soupir de la créature opprimée provoqué par le football :
« Mais les supporters savent aussi que, ne serait-ce qu’un instant, lorsque ce moment des moments arrive, il peut y avoir quelque chose de plus, un quelque chose que j’ai essayé de décrire dans ces pages, qui ne sont pas consacrées à la victoire mais à l’accomplissement de ce que l’on pourrait appeler une splendeur. Dans ces moments, magiques et irresponsables, la transe et le ravissement surgissent, la forme du football brille sur sa matière, une figuration dynamique pleine de beauté, l’expressivité dramatique du jeu, un mouvement de libre association entre les joueurs et aussi entre les supporters, l’envoûtement d’une extase sensorielle. Dans ces moments-là, nous retenons notre souffle. Quelque chose de différent, de merveilleux, se présente à nous. Mais il s’en va. Nous expirons. Et le spectacle de l’horreur suit son cours[4]. »
De même, l’anthropologue brésilien Roberto DaMatta a identifié le miracle de la transformation de la vie et du monde que le football produit chez les gens. Il est vrai que le football peut alimenter et consolider le discours raciste dans la société, mais il peut aussi servir à le combattre. Même à partir d’une herméneutique de l’histoire, les théologiens Rubem Alves et Denis Müller ont souligné la sémantique de la solidarité sociale inhérente au football.
Au-delà du football moderne, le ballon a également fait partie du processus de conscientisation des travailleurs et de l’organisation d’initiatives populaires en tant qu’alternative à la société de marché. Des premiers clubs formés au début du XIXe siècle par des militants anarcho-syndicalistes et communistes aux projets de résistance communautaire tels que le projet « Football pour la paix » dans la ville troublée de Medellín ou le championnat Barbosa à Rio de Janeiro, en passant par l’expérience de la Ligue créée par la Fédération des travailleurs de l’imprimerie du Chili (FOIC) dans les années 1930, nous reconnaissons les possibilités qui a le ballon de contribuer non seulement à la configuration d’une autre société, mais aussi à réenchanter le monde[5].
En m’inspirant, d’une part, de la Dialectique de la Raison de Max Horkheimer et de Theodor W. Adorno et, d’autre part, de la méthode micrologico-marxiste de Walter Benjamin, les réflexions qui suivent portent sur les illusions du ballon et du sujet abstrait, elles tentent de dévoiler, dialectiquement, les illusions de la modernité et les apories du football. Il ne s’agit pas d’un ensemble de thèses à défendre devant un tribunal académique ou de chroniques journalistiques pleines de détails et de statistiques (ces dernières exprimant l’esprit quantitatif de la modernité), mais d’images dialectiques, au sens benjaminien du terme, qui surgissent comme des éclairs dans l’histoire.
Tout en examinant le rôle du football-marchandise dans le processus de réification sociale, je reconnais également les moments magiques où le ballon nous fait supporter un monde sans âme et rend ainsi la vie plus supportable. Si, comme le disait Karl Marx, la critique de la religion est, en germe, la critique de cette vallée de larmes, alors la critique du football en tant que marchandise est une tâche nécessairement politique pour tous ceux d’entre nous qui ont un jour vibré au rythme du ballon. Nous ne devons plus permettre aux puissants de s’enrichir grâce au football. De la même manière que nous les exproprierons des moyens de production, nous leur arracherons le ballon des pieds. […]
Le dernier des Mohicans
Si, dans l’histoire de la science, la numérologie était essentielle pour comprendre la relation entre les êtres humains et les forces extraterrestres, elle ne joue aujourd’hui un rôle important que dans la culture de masse[6]. Elle a ainsi une importance dans les décisions prises par les individus dans les jeux de hasard (roulette ou loterie), c’est-à-dire dans les activités où l’aléa est le principal protagoniste, car ce qui importe vraiment n’est pas de vaincre l’adversaire (agôn) mais de vaincre le destin. Dans le monde du football, le joueur portant le numéro 10 incarne le personnage du héros, car c’est lui qui possède les compétences qui lui permettent d’accomplir des exploits extraordinaires. Le numéro 10 remporte un quart de finale clé lors d’une Coupe du monde (Diego Armando Maradona), porte son équipe sur ses épaules (Gheorghe Hagi), produit à la fois des moments magiques sur le terrain (Zinedine Zidane) et des coups d’éclat (Juan Roman Riquelme) et, surtout, est le principal orchestrateur de l’équipe (Enzo Francescoli ou Roberto Baggio). Comme tout héros, le joueur portant le numéro 10 doit se battre contre lui-même et contre l’adversité.
Pour sa part, le philosophe allemand Hartmut Rosa propose, sur la base d’une théorie de l’accélération, une redéfinition sociologique de la modernité. Dans le sillage de la Théorie critique, ce philosophe met l’accent sur les transformations du régime spatio-temporel de ce qui a été nommé « modernité tardive », « modernité réflexive » ou « post-modernité ». Au-delà de l’eurocentrisme que l’on peut déceler dans certains de ses postulats, nous pensons que l’idée avancée dans son travail est d’une grande valeur pour comprendre non seulement la mutation du football mais surtout la métamorphose du joueur qui porte le numéro 10. Si, comme le souligne Hartmut Rosa, l’expérience de la modernisation est l’expérience de l’accélération[7], la présence de formes et de figures non-contemporaines exprime la tension entre différentes temporalités. Par ailleurs, si, d’un côté, certains membres de la société ont un accès croissant à la communication et à l’information, au sens de Niklas Luhmann, paradoxalement, les êtres humains souffrent de l’expérience d’avoir de moins en moins de temps. En d’autres termes, les promesses du progrès, exprimées par l’utilisation de nouvelles technologies et de moyens de transport vertigineux, ont changé à la fois le rythme de la vie et le monde de la vie (Lebenswelt). Si Hartmut Rosa relève trois types d’accélération (l’accélération des technologies, l’accélération des rythmes de vie et l’accélération de la vitesse des transformations sociales et culturelles), il note aussi le poids de la « cage d’acier » (Stahlhartes Gehäuse) de la dynamique bureaucratique de la modernité capitaliste. Paradoxe inouï : d’un côté, la fluidité des échanges financiers, de l’information en direct et de la communication, et de l’autre, la consolidation de la cage de la domination.
Il est devenu courant d’entendre les commentateurs sportifs parler de statistiques : le temps de possession d’une équipe ou la vitesse d’un joueur. Des termes tels que « transitions rapides » ou « séquences offensives » font désormais partie du vocabulaire spécialisé du monde sportif. C’est pourquoi les journalistes Raphaël Cosmidis, Philippe Gargov, Christophe Kuchly et Julien Momont se sont penchés sur la métamorphose du numéro 10. À travers une série de commentaires de diverses personnalités du monde du football, ces chercheurs ont recueilli un certain nombre de termes qui indiquent la spécificité du numéro 10, par exemple : la fantaisie, le meneur du jeu, le trequartista (el enganche) ou l’orchestrateur[8]. Cependant, la marchandisation du football moderne et le fétichisme des statistiques ont sacrifié l’aspect ludique au profit de la dimension commerciale et spectaculaire du jeu. Cette dimension avait déjà été analysée et dénoncée à la fin des années 1980 par l’économiste français Philippe Simonnot lorsqu’il avait suggéré que l’Homo Sportivus remplacerait l’Homo Economicus[9].
La rationalité technique des clubs de football atteint son paroxysme lorsqu’ils recourent à l’automatisation des joueurs. C’est le cas du département d’analyse du jeu du Paris Saint-Germain ou du FC Barcelone, ce dernier, avec une équipe d’ingénieurs de l’Université de Lisbonne, travaille avec un programme basé sur des algorithmes pour déterminer la meilleure orientation du corps du joueur[10]. Le lien entre big data et football est évident dans l’utilisation faite par le club anglais FC Brentford pour le transfert de ses joueurs (contrats de travail basés sur la performance physique) sur le marché sportif. Considéré comme un visionnaire, le propriétaire de l’équipe Matthew Benham a combiné l’analyse des statistiques et l’examen minutieux des pourcentages avec les décisions tactiques, techniques et sportives du club. On voit ainsi que l’indispensable accélération — élément crucial de la modernisation — s’inscrit dans la dynamique productiviste de notre formation sociale. On peut se demander si les joueurs qui ont déjà porté le numéro 10 et qui présentent certaines caractéristiques physiques (l’Argentin Diego Armando Maradona, le Français Michel Platini, le Péruvien Teófilo Cubillas, le Colombien Carlos « Pibe » Valderrama ou le Chilien Jorge « Mortero » Aravena) auraient leur place dans les schémas sophistiqués des équipes d’aujourd’hui. Comment expliquer le peu d’opportunités que le joueur argentin Juan Román Riquelme (peut-être le dernier numéro 10 dans l’histoire du football) a eu lors de son passage au Barça après que celui-ci ait payé près de 13 millions de dollars à Boca Juniors pour le recruter pour la saison 2002/2003 ? Les experts affirment que le style de Riquelme ne correspondait pas au style de jeu offensif, vertical et efficace du Néerlandais Louis van Gaal. Il est vrai que Riquelme était un non-contemporain dans une phase de transformation du football-spectacle et, par conséquent, il a reçu d’Eduardo Galeano le surnom de « Le dernier des Mohicans » du football. Combien de hanches de ses adversaires Riquelme aura-t-il bousillées avec ses spectaculaires cassures de la taille ? Combien de traumatismes de défenseurs aura-t-il causés par ses dribbles et, surtout, lorsqu’il conduisait le ballon au milieu du jeu ? Comment placer un numéro 10, plus proche du héros mythologique que du pseudo-code du langage informatique, dans les schémas tactiques contemporains ?
Dans son ouvrage de 1935, Héritage de ce temps, Ernst Bloch présente sa théorie du « non-contemporain » (Ungleichzeitigkeit) pour révéler l’existence de temporalités multiples au sein d’un temps de référence, c’est-à-dire de tonalités ou de rythmes différents dans le monde. Si, comme l’affirme le philosophe colombien Aníbal Pineda, la figure du leader et prédicateur paysan allemand Thomas Münzer a agi dans l’œuvre de Bloch comme un « dispositif littéraire » pour exalter la non-contemporanéité de la tradition révolutionnaire[11], pour notre part, nous soutenons que la figure de Juan Román Riquelme exprimerait la non-contemporanéité de la rébellion contre l’obsolescence du numéro 10 dans les schémas tactiques de notre époque. Ce n’est pas un hasard si l’entraîneur Argentin Jorge Valdano a déclaré que « pour aller d’un point A à un point B, tout le monde prendrait l’autoroute à six voies et arriverait le plus vite possible. Tout le monde sauf Riquelme. Il choisirait la route de montagne sinueuse, qui prend six heures, mais qui vous remplit les yeux de scènes de paysages magnifiques. »
En effet, à une époque où le poids des big data noie la spontanéité, l’improvisation et la liberté des footballeurs (principalement celui du numéro 10) dans les « eaux glacées du calcul », nous assistons au désenchantement progressif du monde (Entzauberung der Welt), au sens wébérien du terme, où le processus de rationalisation de la vie définit la civilisation capitaliste industrielle moderne. Ainsi, la marche effrénée des choses et le désir productiviste de la modernité capitaliste conduisent non seulement à la disparition des spécificités humaines, puisqu’ils nous transforment en simples exécutants des fonctions du système, mais contribuent également au déséquilibre de la biosphère. Le choc avec les limites biophysiques de la planète est une réalité de plus en plus palpable. Si nous sommes d’accord avec Hartmut Rosa lorsqu’il affirme qu’il faut faire un diagnostic critique des structures temporelles pour s’opposer aux tendances immanentes de l’ordre social, nous ne sommes pas d’accord avec lui lorsqu’il indique qu’il ne faut pas partir des conditions de production (point de départ de la première Théorie critique). Au contraire, c’est précisément l’analyse de la matérialité négative qui reste le point de départ de toute Théorie critique anticoloniale[12], et donc la critique des conditions de production reste cruciale pour dévoiler la logique sacrificielle de notre formation sociale.
La lutte infatigable contre le racisme
Peu de footballeurs ont réussi à concrétiser l’objectif de cet adolescent argentin aux cheveux frisés qui rêvait de « disputer une Coupe du monde et de devenir champion ». Mais plus rares encore sont ceux qui ont troqué leurs chaussures de foot contre un stylo. Originaire de Guadeloupe, un petit archipel des Antilles, Lilian Thuram a vu le jour le 1er janvier 1972. Son premier contact avec le ballon se fait sur les terrains d’Anse-Bertrand. Comme il le raconte dans son livre autobiographique, sa mère Mariana a dû émigrer dans la capitale française pour des raisons matérielles. En septembre 1981, la famille Thuram s’installe définitivement en banlieue parisienne et c’est là qu’il découvre le racisme[13].
Les premiers clubs dans lesquels Lilian Thuram a joué (l’équipe des cadets nationaux de Melun et le Racing Club de Fontainebleau) étaient situés dans la ville de Fontainebleau, ce qui lui a permis de connaître de près les problèmes sociaux des habitants de la banlieue parisienne. Au printemps 1989, après un essai au centre de formation de l’A.S. Monaco, Thuram est engagé par le club monégasque. Entre 1990 et 1996, Thuram a joué pour l’A.S. Monaco et en août 1994, il a rejoint l’équipe nationale française. Ses qualités footballistiques l’ont amené à Parme. Aux côtés de l’Italien Fabio Cannavaro et du Colombien Faustino « Tino » Asprilla, Lilian Thuram remporte les Coupes d’Italie 1998 et 1999 ainsi que la Supercoupe d’Italie 1999. Entre 2001 et 2006, il est transféré à la Juventus, où il remporte deux championnats de première division italienne. Enfin, en 2006, Thuram est recruté par le FC Barcelone. C’est là qu’il fait définitivement ses adieux au football professionnel.
Il a fait partie d’une équipe composée de Fabien Barthez, Zinedine Zidane, Christian Karembeu et Didier Deschamps. C’est avec cette équipe que Thuram a remporté la Coupe du monde 1998. Mais ce qui est encore plus inoubliable, c’est sa performance du 8 juillet 1998 lorsque, lors du match de demi-finale contre la Croatie, Thuram a marqué les deux buts qui ont permis à la France de se qualifier pour la finale. L’équipe croate était composée de Zvonimir Boban (le joueur qui, huit ans plus tôt, avait donné un coup de pied à un policier lors de la bagarre entre le Dinamo Zagreb et l’Étoile rouge de Belgrade), Robert Prosinecki et Davor Suker. Trois ans après la signature des accords de Dayton, qui divisent administrativement la Bosnie-Herzégovine en Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska, la Croatie participe pour la première fois à la Coupe du monde. Après avoir battu l’équipe allemande 3-0 en quart de finale, la Croatie rencontre l’équipe française en demi-finale. À la 46e minute, Davor Suker donne l’avantage aux Croates, mais une minute plus tard, Lilian Thuram égalise. À la 69e minute, Thuram marque le but de la victoire d’un formidable tir.
Bouleversé par les effets du racisme, d’abord en France puis en Italie[14], Lilian Thuram collabore aujourd’hui non seulement avec des associations et des organisations (par exemple Amnesty International et la fondation Lilian Thuram-Education contre le racisme) pour lutter contre ce fléau social, mais il contribue également à la décolonisation du savoir en promouvant des figures importantes de la culture africaine et afro-descendante. Dans la lignée des écrivains caribéens tels qu’Aimé Césaire et Frantz Fanon, penseurs universellement connus pour leurs positions anticoloniales, Lilian Thuram prend la plume – avec la même passion et talent que le ballon sur la pelouse – pour dénoncer les séquelles de la colonisation : le racisme, la discrimination et la stigmatisation. Dans son ouvrage Mes étoiles noires, l’ancien défenseur du Parme présente les contributions de plusieurs personnages (Sojourner Truth, Addi Bâ, Mongo Beti, Mumia Abu-Jamal, pour n’en citer que quelques-uns) qui ont été occultés par l’eurocentrisme. Je suis personnellement frappé par la référence aux travaux de l’anthropologue haïtien Joseph Anténor Firmin[15].
En effet, peu apprécié dans la discipline anthropologique et inconnu de nombreux anthropologues, Joseph Anténor Firmin (1850-1911), sympathisant du parti libéral mulâtre haïtien, devient membre de la Société d’anthropologie de Paris en 1884. Fondée en 1859 par le médecin, anatomiste et anthropologue français Paul Broca, cette association scientifique avait pour objectif l’étude naturelle de l’Homme. Appareil idéologique colonial, cette société justifiait, par des méthodes de mesure, l’inégalité physique, l’existence d’une supposée hiérarchie naturelle entre les différentes « races humaines ». Dans cet environnement raciste, il était difficile d’expliquer la présence d’un Noir comme Firmin. D’ailleurs Arthur Bordier, membre de l’association, propose à Firmin de passer un test pour savoir s’il avait des « ancêtres blancs » et résoudre ainsi le mystère de son intelligence. Entre 1853 et 1855, le diplomate et écrivain français Joseph Arthur de Gobineau publie en quatre volumes son Essai sur l’inégalité des races humaines, dans lequel il jette les bases scientifiques du racisme. Heureusement, écrit René Depestre, il existait au XIXe siècle en Haïti une « intelligentsia organique d’hommes noirs » qui, par leur production intellectuelle, littéraire et scientifique, ont réhabilité la race noire. Anténor Firmin, Emmanuel C. Paul, Louis-Joseph Janvier et Hannibal Price ont lutté contre le sophisme pseudo-scientifique de « l’inégalité des races humaines »[16]. En 1885, Anténor Firmin publie son livre De l’égalité des races humaines, en opposition aux thèses racistes d’Arthur de Gobineau. L’ouvrage de Firmin fut l’expression d’une résistance épistémologique d’envergure qui n’a pas craint pas de combattre les thèses racistes de l’eurocentrisme de son époque. Il va sans dire qu’au XXe siècle, l’œuvre d’Arthur de Gobineau a été très bien accueillie par le régime national-socialiste d’Hitler, tandis que, de son côté, l’œuvre d’Anténor Firmin a été une source d’inspiration politico-intellectuelle tant pour le mouvement de la négritude que pour le marxisme caribéen.
Si en 1998, les actions sportives de Lilian Thuram ont été déterminantes pour la victoire de l’équipe de France en Coupe du monde, aujourd’hui, ses réflexions historiques et politiques (le rôle de la traite négrière dans le capitalisme international ou le rôle du Code noir, le rôle des zoos humains dans l’imaginaire culturel et raciste) sont précieuses dans la lutte contre le discours raciste en général et, surtout, contre le racisme structurel français en particulier[17].
Alors que certains footballeurs ont choisi de devenir des marionnettes des grandes entreprises (Coca-Cola, Adidas, Nike) ou des proches collaborateurs des personnalités politiques les plus rétrogrades (Pelé et le général Emílio Garrastazu Médici ou Ronaldinho Gaúcho et Jair Bolsonaro), Lilian Thuram a préféré se ranger du côté des déshérités de l’histoire pour poursuivre son combat.
Notes
[1] Jan Assmann, Moïse, l’Égyptien, Paris, Aubier, 2001[2] Terry Eagleton, El Portero: Memorias, Barcelone, Debate, 2004, p. 94.
[3] Jean-Marie Brohm, Sociologie politique du Sport, Paris, Jean-Pierre Delarge, 1976.
[4] Simon Critchley, En qué pensamos cuando pensamos en fútbol, Madrid, Sexto Piso, 2018, p. 152.
[5] Miguel Fernández Ubiria, Fútbol y Anarquismo, Madrid, Catarata, 2020.
[6] Theodor W. Adorno, Bajo el signo de los astros, Barcelone, Laia,1986.
[7] Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, Paris, La Découverte, 2010, p. 36.
[8] Raphaël Cosmidis, Philippe Gargov, Christophe Kuchly et Julien Momont, L’Odyssée du 10. Gloire et déboires du meneur du Jeu, Paris, Solar, 2019.
[9] Philippe Simonnot, Homo Sportivus. Sport, Capitalisme et Religion, Paris, Gallimard, 1988.
[10] Raphaël Cosmidis, Philippe Gargov, Christophe Kuchly et Julien Momont, L’Odyssée du 10, op. cit. pp. 238-241.
[11] Aníbal Pineda Canabal, Le Concept de non-contemporanéité dans la philosophie d’Ernst Bloch, Hildesheim, Editorial Georg Olms Verlag, 2021.
[12] Luis Martínez Andrade, Dialectique de la modernité et socialisme indo-américain. Essais d’histoire intellectuelle, Paris, L’Harmattan, 2023.
[13] Lilian Thuram, 8 juillet 1998, Paris, Éditions Anne Carrière, 2004, p. 31.
[14] « A cette même époque, j’ai découvert également les insultes racistes dans les stades : ‘Sale Noir, retourne chez toi !’ ou ‘Sale Portugais…’ Une scène m’a marqué à tout jamais, celle de spectateurs lançant des peaux de banane au gardien du but camerounais Joseph-Antoine Bell. Cela, je ne l’oublierai jamais ». Lilian Thuram, 8 juillet 1998, op. cit., p. 104.
[15] Lilian Thuram, Mes étoiles noires. De Lucy à Barack Obama, Paris, Philippe Rey, 2009, pp. 139-146.
[16] René Depestre, Buenos días y adiós a la negritud, La Habana, Casa de las Américas, 1986, p. 22.
[17] Lilian Thuram, La Pensée blanche, Paris, Philippe Rey, 2020.




