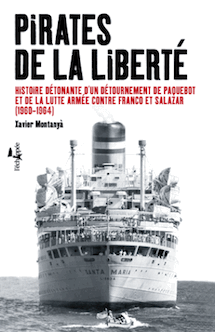
À lire : un extrait de « Pirates de la liberté » de Xavier Montanyà
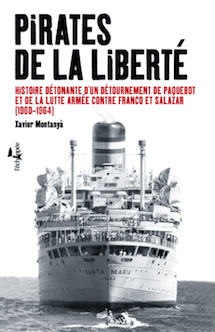
Xavier Montanya, Pirates de la liberté. Histoire détonante d’un détournement de paquebot et de la lutte armée contre Franco et Salazar (1960-1964), Paris, L’échappée, 2016.
Défense intérieure
C’est donc lors du IIe congrès intercontinental de la CNT espagnole en exil célébré à Limoges, en août 1961, que la réunification est approuvée et que l’organisation clandestine Défense intérieure (DI) est créée afin de relancer la lutte armée contre le régime. La structure est définitivement constituée début 1962 et ses membres, issus des trois organisations CNT, FAI et FIJL, sont nommés. Il s’agit de Cipriano Mera, Joan Garcia Oliver, Germinal Esgleas, Vicente Llansola, Acracio Ruiz, Juan Jimeno et Octavio Alberola. Différentes tendances et générations sont donc représentées, ce qui semble alors positif, mais engendre peu à peu un retour à la dynamique antérieure et une entrave à son bon fonctionnement, puis la disparition définitive de DI au Congrès de Montpellier en 1965. En réalité DI ne bénéficie déjà plus d’aucune aide ni d’aucun contact avec la CNT dès octobre 1963. Et le IIIe congrès des fédérations locales de la CNT, qui se tient à Toulouse, nomme à la direction du SI (Secrétariat intercontinental) Esgleas et Llansola, démissionnaires de DI. Les Jeunesses libertaires continuent alors la lutte pour leur propre compte, en totale clandestinité et avec un degré d’efficacité peut-être plus élevé qu’avant.
On peut distinguer trois figures clés ayant œuvré à la relance de l’action armée au sein de DI : Cipriano Mera, Joan Garcia Oliver et Octavio Alberola. Au-delà des divisions et du marasme organisationnel de l’exil, un pont générationnel qui semblait impossible peu de temps auparavant est tout de même rétabli, ces trois personnages en sont un bel exemple. Pour la première fois depuis 22 ans d’exil, l’espoir de pouvoir agir de manière décisive renaît, grâce à l’union de la sagesse et de l’expérience des plus anciens avec la force et l’engagement total des plus jeunes. Mais le franquisme et les secteurs les plus immobilistes de l’exil ne sont pas disposés à laisser fructifier cet espoir, comme les États-Unis et les démocraties européennes d’ailleurs, dont les projets pour l’Espagne sont autres : ces derniers tremblent à l’idée qu’un jour, en Espagne, l’expérience socialiste révolutionnaire initiée par les anarchistes dans les années 1930 puisse se répéter.
En 1961, Cipriano Mera Sanz (1897-1975), vit à Paris et gagne sa vie comme maçon, comme il l’avait pronostiqué au front : « Quand la guerre sera fini, le lieutenant-colonel Cipriano Mera rendra les armes et reprendra la truelle. » Mera est une des figures emblématiques de la guerre civile. Dirigeant anarcho-syndicaliste madrilène, il est emprisonné le 18 juillet 1936 pour avoir participé à un comité de grève. Libéré par ses camarades le lendemain, il combat ensuite sur tous les fronts possibles : Alcalà de Henares, Guadalajara, Conca, Madrid… Lors de la constitution de l’armée populaire il est nommé commandant de la 14e division, principalement composée d’anarcho-syndicalistes, et contribue à d’importantes victoires pour le camp républicain, comme celles de Jarama, de Guadalajara ou de Brunete. Il est élevé au rang de lieutenant-colonel du 4e corps d’armée en raison de ses mérites de guerre et résiste jusqu’à la chute de Valence.
Mera est ensuite interné dans un camp de concentration en Algérie. Le général pétainiste Charles Noguès, commandant en chef des forces françaises dans les colonies d’Afrique du Nord, accepte de le remettre à Franco sous une condition : qu’il ne soit pas exécuté. Franco s’y engage et le général français le fait extrader. Mera est jugé en conseil de guerre et condamné à mort, mais sa peine est finalement commuée en détention à perpétuité.
En 1946 il obtient une liberté conditionnelle. Il reprend alors ses contacts clandestins, mais se sentant observé il traverse les Pyrénées à pied, passe par Toulouse et s’installe finalement à Boulogne-Billancourt, à côté de Paris. Il refuse les diverses aides financières provenant des fonds administrés par les exilés et gagne sa vie en travaillant dans le bâtiment. Mera rejoint DI en 1962 et essaye de faire profiter les plus jeunes de son expérience et de ses conseils dans l’élaboration des plans d’action.
Joan Garcia Oliver (1901-1980) est un des grands héros de l’anarcho-syndicalisme espagnol. Il arrive en France en 1962 en provenance du Mexique, où il s’était exilé, afin de s’intégrer à DI. Là, il se lie immédiatement avec le jeune Octavio Alberola, dont le rôle est fondamental dès ce moment. Tous deux, avec leurs propres expériences et perceptions des choses, ont une grande confiance dans les événements à venir, logiquement influencés par l’espoir insufflé par la révolution cubaine et la chute du dictateur vénézuélien Marcos Pérez Jiménez. À Caracas d’ailleurs, parallèlement à l’activité du DRIL, la CNT exilée, conduite, entre autres, par l’enseignant Joan Campà et l’ancien résistant Floreal Barberà, avance aussi dans un processus de réunification. Garcia Oliver et Alberola font quelques voyages dans la capitale vénézuélienne afin de participer aux discussions sur les divers plans de réactivation de la lutte en Espagne. Le commandant anarcho-syndicaliste Antonio Ortiz, charpentier de métier, qui dirigeait la colonne Ortiz lors de la campagne d’Aragon et avait occupé les villages d’Alcanyis (Teruel) et de Casp (Sarragosse) au début de la guerre civile, vit aussi au Venezuela. Il a d’ailleurs entraîné à Caracas des groupes de jeunes syndicalistes vénézuéliens impliqués dans la lutte contre la dictature de Jiménez. Mais malgré la présence de ces nombreuses personnalités, la tentative de réactiver la lutte depuis Caracas ne se concrétise pas. Floreal Barberà tente de poursuivre le projet qu’il avait initié avec d’autres camarades en 1947, avec la promesse d’aide, jamais concrétisée, du Gouvernement de la République en exil : organiser une résistance clandestine à l’intérieur du pays inspirée de la Résistance française et indépendante de l’organisation afin de ne pas s’exposer aux luttes internes. Mais une fois encore le projet n’avance pas. Ils parviennent tout de même à créer une émission de radio diffusée en Espagne et à réaliser d’autres activités plus directement politiques ou liées à la diffusion de propagande. À partir de ce moment, Garcia Oliver et Alberola portent donc leurs espoirs sur la France.
L’influence de Garcia Oliver au sein du monde libertaire est très grande et sa disposition à soutenir les envies de lutte des plus jeunes sera importante. Il vient justement de l’action directe et de sa tendance la plus radicale, celle qui dans les années 1920 opta pour la lutte armée afin de se défendre du terrorisme que les pistoleros du patronat et les groupes para-policiers pratiquaient alors contre les anarcho-syndicalistes. Il a créé avec Buenaventura Durruti et Francisco Ascaso les groupes d’actions armés Nosotros et Los Solidarios. Il est aussi membre fondateur de la FAI en 1927 et un des leaders les plus actifs et les plus populaires de la CNT-FAI durant la République. Après le 18 juillet, il intègre le Comité des milices antifascistes de Catalogne puis, le 4 novembre 1936, il accepte d’intégrer le gouvernement de Francisco Largo Caballero en compagnie de ses camarades Joan Peiró, Frederica Montseny et Juan López. Garcia Oliver y assume le portefeuille de la Justice, fait qui suscite de nombreuses réactions de tous ordres, y compris dans le milieu libertaire : c’est la première fois, et probablement la dernière, qu’un anarchiste partisan de l’action directe est ministre de la Justice.
Les événements de mai 1937, la lutte dans les rues de Barcelone entre les militants anarcho-syndicalistes et du Parti ouvrier d’unification marxiste (POUM) contre les communistes soutenus par les éléments d’État catalan et de la Gauche républicaine, mettent fin au gouvernement de Largo Caballero et poussent les quatre ministres anarchistes à la démission. L’influence soviétique grandissante fait éclater l’affrontement entre deux stratégies différentes : la guerre avant la révolution, ou la révolution et la guerre simultanément. Même si Garcia Oliver joue un rôle clef dans la pacification de Barcelone durant ce mois de mai, l’accession à la présidence de Juan Negrín ainsi que le poids soviétique dans la guerre et les affaires gouvernementales l’éclipsent de la scène publique. Après la déroute, il vit en exil en France, en Suède, au Venezuela et au Mexique, où il meurt en 1980. La mission de Garcia Oliver au sein de DI est de collaborer à l’élaboration stratégique de la campagne d’actions à venir, mais aussi d’utiliser son prestige et son influence pour tenter de récolter de l’argent parmi les organisations antifascistes et syndicales, et plus particulièrement auprès du SAC, syndicat anarcho-syndicaliste suédois avec lequel il maintient de très bonnes relations depuis son séjour en Suède. Selon Marcelino Boticario, malgré son intelligence et son expérience, Garcia Oliver arrive en France peu en phase avec les réalités : il veut relancer la lutte armée et parvenir à ce que toutes les organisations politiques de l’exil s’y impliquent. Cependant, lors d’une première réunion avec les socialistes et les ugétistes à Toulouse, l’échec est total. Garcia Oliver en sort indigné, un sentiment qui selon Octavio Alberola s’ajoute à la déception de voir que le militantisme à la CNT ne suit pas et que le SI en exil s’implique peu. Ce qui le décidera à retourner au Mexique. Il interviendra toutefois sur la planification des premières actions et DI restera active après son départ.
Octavio Alberola (Alaior, Minorque, 1928), l’unique représentant de la FIJL au sein de DI, occupe une place-clé dans la planification, la coordination et la direction des actions, un rôle déterminant pour stimuler et perpétuer la lutte initiée par la génération de Durruti. Sa famille avait gagné l’exil mexicain à bord du navire Ipanema après avoir traversé la frontière enneigée des Pyrénées, comme un demi-million de républicains espagnols, mal accueillis et maltraités en France, internés dans des camps de concentration et méprisés pour leur statut de rouges espagnols. Un traitement plus humain aurait mis la France dans une situation délicate vis-à-vis de Franco et de Hitler. Les républicains espagnols ont été victimes de la supposée « neutralité » française, des peurs et des divisions internes des Français : la France comporte alors d’importants secteurs conservateurs et bourgeois ouvertement fascistes.
Au Mexique, où réside un important noyau d’exilés espagnols, Alberola se lie avec les jeunes de sa génération qui poursuivent la lutte de leurs parents, ainsi qu’avec les légendaires rescapés du groupe de Durruti : Joan Garcia Oliver et Aurelio Fernandez. L’engagement dont ont hérité Alberola et ses camarades se consolide dans les luttes latino-américaines des années 1950 et 1960 : entre Durruti et le Che, entre la guerre d’Espagne et la révolution cubaine, existe en effet une continuité historique dont Octavio Alberola est l’exemple le plus marquant. Son père, José Alberola, est né en Aragon la même année que Durruti : 1896. Figure très respectée de la FAI, il est incarcéré avec ce dernier et Garcia Oliver à la prison Modelo de Barcelone en 1932. Professeur de rationalisme, il est membre du premier Conseil régional de défense de l’Aragon créé en octobre 1936 à Fraga, dans la zone alors contrôlée par les milices anarchistes. Son président est Joaquin Ascaso, cousin de Francisco Ascaso, mort le 20 juillet 1936 à Barcelone pendant le siège de Drassanes. José Alberola y occupe le poste de conseiller d’instruction publique. Un autre professeur qui deviendra une figure importante de la résistance contre les nazis, Francisco Ponzan, y occupe le poste de chargé des transports et du commerce.
Avant la création de DI, l’activité politique d’Octavio Alberola est déjà intense : alors étudiant à la faculté d’ingénierie de l’université nationale autonome du Mexique, il est incarcéré en 1950 en compagnie de trois filles d’exilés espagnols et d’un Mexicain pour avoir organisé les Jeunesses libertaires mexicaines. Ils passent un mois de « redressement » au sein d’une prison privée du ministère de l’Intérieur et sont libérés après avoir signé un document dans lequel ils s’engagent à ne plus se mêler de la vie politique mexicaine. En 1956, Octavio Alberola entre en contact avec les exilés cubains du Directoire révolutionnaire étudiant et du Mouvement du 26 juillet, dont certains ont participé à la tentative infructueuse d’assaut de la caserne de la Moncada. Il rencontre alors Fidel Castro et Ernesto Che Guevara peu avant leur départ vers Cuba à bord du Granma. Tandis que les révolutionnaires cubains luttent dans la Sierra Maestra, il organise depuis le Mexique, en compagnie notamment de la petite sœur de Fidel,des manifestations de solidarité avec les exilés cubains. Il organise aussi divers voyages en coucou au-dessus de la Sierra Maestra pour parachuter du matériel aux révolutionnaires avec un camarade aragonais, un pilote spécialisé dans l’épandage qui se trouve être un ancien élève de son père. Il participe en même temps à la fondation du Front de la jeunesse antidictatorial latino-américain, formé de jeunes de divers pays exilés au Mexique qui s’engagent à s’entraider dans leurs luttes respectives. Après la chute du dictateur Pérez Jiménez, les vénézuéliens respectent leurs engagements et donnent des armes et un million de dollars aux Cubains ; ce que ces derniers ne feront pas lorsqu’il s’agira d’aider les libertaires espagnols…
En 1959, Alberola est un des fondateurs du Mouvement espagnol 59 (ME59) qui réunit les jeunesses républicaines, socialistes, libertaires et communistes. Ce groupe mène alors quelques actions antifranquistes au Mexique et met en œuvre des pratiques de guérilla, avec l’espoir, bientôt frustré, de les poursuivre à Cuba. À cette période, Garcia Oliver l’assure de son soutien au cas où la CNT déciderait de relancer la lutte antifranquiste. En 1960, tous deux seront en contact régulier et se rendront au Venezuela à plusieurs reprises. La participation d’Alberola et de son camarade Floreal Ocana à un attentat contre Franco à Saint-Sébastien est même envisagée, jusqu’à la suspension du projet à cause de la préparation du Congrès de réunification de 1961 à Limoge, congrès auquel assiste Alberola en tant que délégué de la CNT au Mexique.
Lors de son voyage en France, Alberola essaye, comme cela avait été le cas au Mexique avec les exilés du Front de la jeunesse antidictatorial latino-américain, d’obtenir la promesse d’une aide cubaine pour la cause antifranquiste. Sur l’initiative de Liberto Sarrau (1920-2001), ex-combattant de la colonne Durruti qui promouvait alors un groupe appelé Mouvement populaire de résistance (MPR), il s’entretient avec l’ambassadeur cubain à Paris afin que ce dernier l’aide à obtenir un visa d’entrée à Cuba pour rencontrer Fidel Castro et lui demander son soutien. L’ambassadeur lui assure qu’il aura son visa quelques jours plus tard à Madrid, par où il doit passer clandestinement avant de retourner au Mexique. Après quinze jours d’attente, le visa n’est toujours pas arrivé à l’ambassade cubaine de Madrid, et ce alors que de nombreuses arrestations de cénétistes surviennent dans la capitale espagnole. Alberola choisit de ne pas attendre davantage. À son retour, il apprend que les communistes espagnols ont opposé leur veto à son entrée sur l’île : malgré les engagements pris dans l’exil mexicain, le Cuba de Castro ne voudra jamais collaborer avec les anarchistes espagnols dans la lutte armée antifranquiste.
Stratégie de DI et définition des actions
Au cours de la première année d’existence de DI, ses membres se consacrent à nouer des contacts, à planifier la stratégie et à poser les bases des premières actions. En avril 1962, Alberola voyage clandestinement à travers l’Espagne, le Portugal et le Maroc, où il renoue les liens avec les exilés libertaires espagnols et explore les possibilités de collaboration avec eux. Au Portugal, il discute avec des partisans de la résistance antisalazariste et des membres de la FAI, de composition ibérique, comme le DRIL. C’est pourquoi les actions planifiées par DI seront signées Conseil ibérique de libération (CIL). Dans les faits, le CIL n’existera jamais en tant qu’organisation : il s’agit uniquement d’un sigle avec lequel seront revendiquées les actions antifranquistes et antisalazaristes impulsées par DI.
Encouragée par l’expérience du DRIL et nourrie de l’histoire de la guerre de guérilla anarchiste, DI concevra ses plans sur une ligne similaire, tant en ce qui concerne les objectifs que dans l’utilisation des médias ou encore dans l’expérimentation de formes et de styles de lutte innovants et créatifs. La méthode d’action se décline sur deux fronts bien définis. Tout d’abord, il s’agit de poser des gestes symboliques en plaçant des explosifs de faible puissance dans des lieux stratégiques afin d’obtenir une couverture médiatique qui rappelle au monde entier à la fois l’existence de la dictature de Franco et celle d’un mouvement de résistance décidé à la combattre de chaque côté des frontières. Ces actions doivent aussi servir à mobiliser l’opinion publique de l’intérieur et de l’exil, ainsi qu’à faire savoir aux prisonniers politiques, chaque jour plus nombreux, qu’ils ne sont pas seuls, qu’il y a quelqu’un à l’extérieur qui continue le combat et les soutient. Il s’agit dans le même temps de s’attaquer aux intérêts touristiques, aux grandes entreprises ou encore aux organismes internationaux qui apportent leur soutien à la dictature et contribuent à sa légitimation sur le plan international. L’objectif global de cette stratégie de lutte est de mobiliser la population contre Franco et de provoquer la chute du tyran par les effets conjugués de la pression populaire et de la guérilla, comme cela s’est passé à Cuba et au Venezuela.
Un principe fondamental de DI est de ne pas causer de victimes innocentes. Cette règle sera strictement respectée, à l’exception d’un cas accidentel, en juillet 1963 : suite à une erreur dans le réglage d’un détonateur, une bombe éclate avant l’heure et fait plusieurs blessés au bureau des passeports de la direction générale de la Sécurité de Madrid. Une seule personne doit mourir : Francisco Franco. Parallèlement aux actions symboliques, les libertaires tenteront d’attenter à sa vie. Son régime est dans une situation délicate, aucun successeur n’a été nommé et les conflits pour le pouvoir sont constants entre les diverses factions franquistes : l’Église catholique, la Phalange, les militaires, les monarchistes, les « rénovateurs », l’Opus Dei, etc. De leur côté, les organismes internationaux recherchent uniquement la stabilité économique du pays. En cas d’élimination physique du dictateur, il est raisonnable de penser que le régime s’effondrerait tel un château de cartes, et ce serait le début d’une nouvelle ère dans laquelle les forces progressistes clandestines et exilées auraient un rôle à jouer.
DI connaît cependant des problèmes suite à la division du mouvement anarchiste. Par exemple, alors que la Commission de défense, composée de militants des trois organisations, lui accorde une aide de dix millions d’anciens francs (cent mille nouveaux francs) pour financer l’acquisition d’armes, d’explosifs et le maintien de la structure clandestine, les sombres manœuvres menées par le tandem Germinal Esgleas Frederica Montseny, leaders de la CNT de Toulouse et opposants de longue date à la lutte armée, sabotera cet accord. DI ne touchera finalement, durant toute son existence, que cent mille anciens francs, soit l’équivalent de mille nouveaux1. Sa situation économique sera toujours extrêmement précaire. Son armement proviendra des stocks dissimulés par les anarchistes espagnols après leur engagement dans la Résistance française contre les nazis, ainsi que des quelques dons de sympathisants du FLN algérien, qui consistent essentiellement en plastic et détonateurs à effet retardé qu’ils ont souvent construits de leurs propres mains.
DI ne possédera jamais de structure militaire organisée : tous ceux qui participent le font de façon désintéressée et volontaire et s’organisent pour chaque action de façon autonome. En accord avec le SI, DI se fixe le principe, appliqué à la lettre, de ne pas impliquer les militants de l’intérieur dans les actions et de les utiliser uniquement à des fins de logistique et de propagande. Ce qui n’empêchera pas certains d’entre eux d’être arrêtés et condamnés à de longues peines pour des actes qu’ils n’ont pas commis.
Il nous faut aussi rappeler la participation et l’engagement de jeunes français, anglais et italiens dans cette relance de la lutte antifasciste en Espagne : l’esprit moderne et internationaliste est la base de ce type de combat et certains militants européens, déterminés à combattre le fascisme, s’y engagent sans réserves. C’est le cas, par exemple d’Alain Pecunia, Bernard Ferry et Guy Batoux, qui sont arrêtés en Espagne au printemps 1963, jugés en conseil de guerre et condamnés pour des attentats à l’explosif, même si seulement deux d’entre eux, Pecunia et Ferry, étaient réellement impliqués dans les faits. C’est aussi le cas de l’anarchiste écossais Stuart Christie, qui passe trois ans derrière les barreaux pour sa collaboration à une tentative d’attentat avortée contre Franco en 1964. Cette résurgence de l’esprit des Brigades internationales, présent dans la critique politique des mouvements de gauche en Europe – en particulier du communisme orthodoxe – est un aspect de l’histoire européenne injustement oublié et par ailleurs annonciateur de Mai 68.
Les exilés politiques espagnols et les émigrants économiques qui se politisent dans leurs pays d’accueil conjointement aux jeunes révolutionnaires européens sont les artisans de cet activisme libertaire. La plupart d’entre eux travaillent ou étudient, ce qui complique leur activité clandestine et leur capacité à pénétrer en Espagne pour y mener à bien leurs missions. C’est pourquoi les week-ends, les vacances scolaires et l’été sont les moments de plus forte activité. Les périodes d’affluence touristique sont par ailleurs plus appropriées pour voyager et disparaître quelque temps sans éveiller de soupçons dans l’entourage proche.
Les explosifs qu’ils utilisent sont d’une grande puissance, mais ils choisissent des charges légères et peu volumineuses : la plupart ne dépassent pas la moitié d’un paquet de tabac. L’objectif est avant tout de faire du bruit. La presse clandestine, les armes et les explosifs sont introduits en Espagne dissimulés sous les habits, ou collés à même la peau si c’est possible. Et lorsque le volume ne le permet pas, le matériel passe dans des voitures aménagées à cet effet qui traversent la frontière en compagnie de vacanciers. Il est alors caché en différentes parties du moteur, comme le radiateur, ou encore à l’intérieur des portes : la précarité des moyens doit être compensée par une forte dose d’ingéniosité et d’imagination. Même si ce fonctionnement est très rudimentaire, plus proche des méthodes de la Résistance française que de celles d’un groupe armé moderne des années 1960, cela n’affecte ni le contenu ni le résultat des actions : l’efficacité du mouvement sera en effet bientôt un nouveau problème pour les policiers de la BPS.
à voir aussi
références
| ⇧1 | Stuart Christie, « My granny made me an anarchist », The Christie File, part 1, 1946-1964, Christiebooks, 2003. |
|---|



![Portugal : de la dictature salazariste à la Révolution des oeillets (partie 1) [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/salazar-1-150x150.jpg)





