
« L’exil en héritage ». Écritures de la révolution et de la guerre d’Espagne
Geneviève Dreyfus-Armand et Odette Martinez-Maler (coord.), « Écritures de la révolution et de la guerre d’Espagne », Exil et migrations ibériques aux XXe et XXIe siècles, n°9-10 (nouvelle série), Riveneuve éditions, hiver 2018/Été 2019.

À la fin de la guerre d’Espagne et durant les années noires qui l’ont suivie, plus d’un demi-million d’hommes et de femmes porteurs de projets d’émancipation sociale sont venus chercher asile en France. Un magnifique numéro double de la revue Exils et migrations ibériques aux XXe et XXIe siècles rassemble les récits et les témoignages de vingt-six descendants de ces exilés.
Nous présentons ici le texte écrit par Geneviève Dreyfus-Armand et Odette Martinez-Maler en introduction de cet ouvrage qu’elles ont coordonné, ainsi que le récit de Daniel Pinós Barrieras, intitulé « Impasse de la Quarantaine ».
***
Introduction : Récits personnels et écritures de la guerre d’Espagne
En 2019, quatre-vingts ans après la Retirada, comment les fils et filles de républicains espagnols exilés entendent-ils transmettre les mémoires intimes d’événements, pour eux si fondateurs ? Comment ont-ils reçu, réinterprété et reformulé, au fil du temps, les récits des expériences particulières autrefois vécues par leurs parents ? Quels lieux, quels mots, quelles traces ont forgé –de façon unique – leurs représentations de ce passé ? Et quelles expériences singulières ont-ils faites eux-mêmes, au sein de leur famille, de cette transmission d’expériences historique ?
Telles sont les questions que nous avons posées à vingt-six d’entre eux, nés en Espagne ou bien en France – entre 1933 et 1958 – et dont nous présentons ici, les récits croisés.
Ces enfants d’exilés ont répondu à notre invitation avec une générosité et une sincérité inouïe, en livrant – et certains pour la première fois – des fragments de leurs mémoires sensibles. Leurs témoignages forment ainsi une mosaïque inédite et émouvante dont la richesse est pleine d’enseignements. Ils évoquent, en effet, une diversité de trajectoires qui met à l’épreuve l’idée même de mémoire commune de l’exil républicain. Ces récits croisés attestent la pluralité de l’exil.
Cette diversité tient d’abord à la pluralité des expériences sociales et politiques décrites : en premier lieu, celles de leurs parents dont ils racontent – de façon subjective – l’histoire. Les vies minuscules des pères et des mères, évoquées au fil de leurs textes, s’inscrivent, dans les contextes très différents d’un temps long qui s’étend des années 1930 à la fin de la dictature franquiste. L’élan réformateur de la Seconde République et les Missions pédagogiques, la révolution sociale et ses collectivités, la Guerre civile, l’exode de 1939, les camps d’internement du Sud de la France, les camps de concentration nazis, la participation à la Résistance, la lutte armée dans les guérillas antifranquistes en Espagne même : autant de temporalités spécifiques, autant de fragments de mémoires distincts que la narration polyphonique, ici recueillie, articule et met en perspective. Car, par-delà les différences, ces fils et filles de républicains ont en commun de relier explicitement la guerre et l’exil vécus par leurs parents aux projets d’émancipation sociale que ceux-ci défendaient. Et loin de réduire l’évocation de la guerre d’Espagne à la séquence du conflit armé proprement dit (1936-1939) et à celle de l’exode désastreux qui a immédiatement suivi ce dernier, ils transmettent non seulement la mémoire des combats mais aussi, en amont et en aval de ces derniers, celles des idéaux et des espérances qui ont nourri les engagements de leurs proches. Or la diversité des parcours des républicains de la première génération – telle qu’elle est ici rapportée par la mémoire de seconde main de leurs descendants – tient aussi aux divergences de projets qui ont inspiré les engagements, du côté antifranquiste. Les auteurs qui témoignent ici sont majoritairement issus de familles socialistes, communistes ou anarchistes. Si d’un texte à l’autre reviennent des lieux de mémoire commun et des valeurs partagées – en particulier l’attachement à l’éducation populaire et à la culture pour tous – les dissonances et les discordances sont clairement perceptibles : aussi bien en Espagne durant le Front populaire et la Guerre civile que dans l’exil, sur fond de guerre froide et de politique stalinienne. Ces évocations plurielles rendent compte des clivages qui ont historiquement divisé le camp républicain et de la conflictualité de ses mémoires que l’emploi de certaines catégories telles que « l’anti-franquisme » ou « l’antifascisme » risquent quelquefois de neutraliser. Nous aurions voulu que l’éventail des cultures politiques soit plus ouvert, mieux représenté. Manquent ainsi, à notre grand regret, des témoignages qui auraient attesté d’autres héritages, en particulier ceux qui sont liés aux courants de la gauche du Parti socialiste, à Izquierda republicana – le parti du président de la République, Manuel Azaña – et aux autres partis républicains, comme aux mouvements issus des minorités régionales. Ce recueil de témoignages est un chantier ouvert qui n’a évidemment aucune prétention à l’exhaustivité.
Mais si la diversité des trajectoires renvoie à l’histoire racontée des parents, elle tient aussi à la pluralité des expériences des auteurs eux-mêmes : à commencer par celle de la transmission mémorielle qu’ils ont directement vécue et qu’ils retracent, pour nous, à la première personne. Une pluralité qui contredit l’idée d’homogénéité sociale et politique sous-tendue par l’expression consacrée – et sans doute simplificatrice – de « seconde ou troisième génération des républicains espagnols ». Au-delà des particularités individuelles, cette pluralité est d’abord liée à l’âge variable des auteurs : quoi de commun, en effet, entre le parcours d’un « enfant de la guerre » né en 1933, à Madrid et celui d’un enfant de l’exil, né en 1958 à Toulouse ou à Paris ? Aussi confuses que soient les impressions reçues dans la petite enfance, le rapport à l’évènement et à sa mémoire sont évidemment bien distincts. Que dire de l’impact des déterminations sociales et culturelles sur les mises en récit léguées, empêchées ou reléguées de ce passé ? Et surtout du rôle joué par la nature des épreuves traversées ? Si toutes les souffrances des acteurs de l’histoire évoqués ici sont égales en dignité, sont-elles pour autant semblables ? La mémoire d’une résistance armée – en Espagne ou en France – et celle de la déshumanisation radicale dans un camp de concentration sont-elles identiques ? Et leurs empreintes dans l’imaginaire familial sont-elles comparables ? Toutes ces questions mémorielles sont ici posées à vif et en acte, à travers ces histoires intimes de la guerre d’Espagne[i]. Or, là où une vision surplombante tendrait à uniformiser les expériences vécues et à figer les paroles des témoins – comme celles de leurs descendants – ces récits personnels mettent au contraire en évidence leur grande variété.
Au-delà de la particularité des trajectoires, des styles et des registres, ils mettent en lumière ce qui fait, d’une façon générale, l’historicité des témoignages : celles de leur formation, celle de leur énonciation et celle de leur réception. Ces « témoins des témoins » de la guerre d’Espagne et de ses suites prennent, en effet, la parole à un moment précis de l’histoire des mémoires des républicains espagnols, en France et en Espagne. Une histoire dont ils ont été et restent encore des acteurs. À l’image de beaucoup d’autres descendants de républicains, ils ont, pour beaucoup d’entre eux, individuellement, accompagné, traduit, publié ou filmé les témoignages de leurs proches[ii]. Et, depuis le milieu des années 1990, au-delà de ce rôle de passeur de mémoires individuelles et familiales, ils sont engagés – pour la plupart – au sein de mouvements ou de collectifs associatifs qui militent contre l’impunité des crimes franquistes et se mobilisent dans l’espace public, de façon transfrontalière pour la reconnaissance et l’expression des mémoires des vaincus de la guerre d’Espagne[iii]. De surcroît, loin de cultiver un repli identitaire, beaucoup d’entre eux, incarnent une mémoire exemplaire[iv] en défendant, par-delà la référence au pays d’origine de leurs parents, des valeurs humanistes et internationalistes.
Ces récits croisés attestent ainsi d’états de mémoire présents – et sans doute provisoires – en partie modelés par des cadres sociaux et des emprunts à d’autres constructions mémorielles. Quoi qu’il en soit, ils sont un contrepoint aux mises en scène publiques et médiatiques de ce passé telles qu’elles se manifestent de chaque côté des Pyrénées. Ils sont, en cela, des documents inédits et précieux sur la transmission contrastée des mémoires de l’exil républicain. Et ils constituent aussi, en eux -mêmes, des évènements de parole[v] et, en tant que tels, des objets d’histoire. Les travaux de la mémoire, tels que nous essayons de les présenter ici ne sont pas de simples attestations soumises au travail des historiens : ils sont eux-mêmes partie prenante de l’histoire.
Nous avons choisi de relier, dans une seconde partie, ces récits personnels à des récits réflexifs d’écrivains et de cinéastes – issus ou non de familles de réfugiés espagnols – qui montrent comment les récits de leurs proches ou des témoins de la guerre d’Espagne ont nourri leur imagination et façonné leur rapport à cette histoire. Leurs auteurs expliquent, dans leurs textes, comment les archives privées, les silences et les paroles de ces acteurs directs de la révolution et de la guerre d’Espagne sont devenus, pour eux, les matériaux de leur propre écriture romanesque ou filmique. Ils exposent la genèse de leurs œuvres et posent les questions esthétiques auxquelles les a confrontés leur engagement artistique autant que politique : le réemploi d’images, l’usage poétique de l’archive au-delà de sa fonction documentaire ou encore la mise en scène et en fiction des témoignages[vi].
Le rapport aux archives privées est omniprésent dans tous ces récits personnels. Il apparaît dans les textes et à l’intérieur de ces derniers, à travers la publication de fac-similés d’archives, insérés et commentés de façon personnelle : lettres manuscrites, paroles rapportées, photographies extraites d’albums familiaux, grigri, fétiches, autant de lieux où travaille la mémoire vive, celle qui donne accès à la présence sensible du passé, plus qu’à la reconstruction militante ou savante de ce dernier. L’un des apports de ce volume est ainsi de présenter non seulement des témoignages nouveaux mais aussi des archives privées inédites, familiales et personnelles, dont la valeur évocatrice et affective est très impressionnante. Deux textes d’historiens, dont le propos est de présenter des fonds d’archives bien identifiés, complètent à leur façon le recueil des mémoires. L’un est un fonds d’archives privées remarquable sur la révolution sociale : celui de René Lamberet, certes déposé à l’Institut français d’histoire sociale, mais assez peu exploité eu égard à sa richesse. L’autre est un fonds d’archives également privées, celles de l’Unitarian Service Committee, éclairées par des archives publiques émanant des Renseignements généraux. Faire émerger des matériaux documentaires méconnus participe de l’écriture de l’histoire qui s’accompagne nécessairement d’une critique interne des sources et de leur confrontation. L’archive, en effet, informe autant sur l’évènement qu’elle évoque que sur l’instance qui la produit. Tout comme il est nécessaire de s’interroger sur la fabrication et la modélisation des témoignages. Pour clore le volume, deux analyses – émanant d’une historienne et d’une hispaniste –, se proposent d’apporter un éclairage historique et un regard à la fois littéraire et profondément impliqué sur les récits croisés inédits publiés ici.
Geneviève Dreyfus-Armand et Odette Martinez-Maler
***
Impasse de la Quarantaine
Ni el árbol ni la piedra
sienten piedad
de un cielo despiadado
Árbol y piedras
contra el eterno entorno
desgarrado,
hacia no saber nunca
dónde renace el mar
muere la tierra.
Monegros (José Antonio Labordeta)
Le 26 mars 1938, la légion Condor bombarda Sariñena. Quatre escadrilles de trois avions Heinkel-111 détruisirent les 70 % du village aragonais dans lequel vivait ma famille. La bourgade fut dévastée alors que les troupes républicaines avaient abandonné la localité la veille et qu’une partie de la population avait quitté le village. Il y eut de nombreux morts. Le lendemain, le 27 mars, une division de soldats marocains du Rif ayant combattu aux côtés du général Francisco Franco occupa Sariñena.
Durant le mois de mars en Aragon, trente terribles bombardements furent menés sur des ponts, des routes et des villages par l’aviation franquiste Hispana, l’aviation légionnaire italienne et la légion Condor allemande. Ce fut la plus grande offensive militaire ayant eu lieu sur le territoire de la République espagnole.
Les bombes allemandes venaient de réduire en cendres les rêves d’une génération entière de jeunes habitants de la région des Monegros. Les Monegros c’est un plateau ouvert au cierzo, un vent sec et froid venant des Pyrénées. Pour ma famille c’est un lieu de mémoire où, comme le chantait le compositeur aragonais José Antonio Labordeta, « ni l’arbre ni la pierre n’ont de compassion pour un ciel impitoyable ». Une terre où s’est enracinée mon histoire, celle de ma famille et l’Histoire avec un grand H qui porta tant de rêves émancipateurs, mais aussi la tragédie d’une Espagne mise à sac par les troupes du général Franco.
Le 19 juillet 1936, à Sariñena, le chef-lieu de canton des Monegros, souffla le grand vent libérateur de la révolution. Les muchachas et les muchachos, les jeunes libertaires de la CNT étaient majoritaires dans le Comité révolutionnaire, comme ils l’étaient dans toutes les provinces d’Aragon. Ils décrétèrent la collectivisation des terres et exproprièrent les grands domaines avec toutes les machines agricoles. L’argent fut aboli et un système d’échange de bons, basé sur les besoins de chaque famille, fut mis en place. Comme ailleurs, les titres de propriété furent détruits et l’église du village devint un garage et un entrepôt pour stocker les marchandises gérées par le comité. L’utopie était en marche et les paysans monegrinos participèrent avec enthousiasme à la révolution sociale. Une nouvelle vie commença, le communisme libertaire longtemps rêvé se confrontait enfin à l’épreuve des faits aux premières heures d’un monde nouveau.
Mon père partit combattre le fascisme sur le front du Levant en avril 1937. Trois mois plus tard, fin juillet, les troupes de Lister, général de l’armée républicaine, détruisirent par la force un grand nombre de collectivités aragonaises, avec le désir furieux de restaurer l’ordre républicain et celui des propriétaires terriens. Le stalinisme avait déployé dans toute l’Espagne sa branche armée et Líster en était un des principaux généraux.
La révolution n’était plus qu’un rêve avorté, la sale guerre, où le militarisme a fini par s’emparer des esprits, devint une réalité. Trois de mes oncles ont combattu sur les fronts républicains d’Aragon et d’Andalousie. C’est à Pozo Blanco, sur le front de Cordoue que l’un d’entre eux, Valero, le frère de ma mère, perdit la vie à l’âge de 19 ans. À Gandia, sur le front levantin, mon père et ses compagnons se battaient pour que leurs rêves de libération ne soient pas anéantis. Le visage sinistre du fascisme était de l’autre côté de la tranchée, mais la lutte était si inégale et l’enthousiasme initial, cette force qui secouait les montagnes, fut écrasé.
Valence, 1937. Debout, au centre, Eusebio Pinós avec ses compagnons de combat).
En novembre 1938, après des mois de silence et de séparation, mes parents se réunirent brièvement près de Gérone pour le long voyage de l’exil : la Retirada. Mon père traversa la frontière française, par le col du Perthus, le 9 février 1939. Un combattant anonyme parmi des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants marchant dans une procession funèbre où ne retentissait, entre deux bombardements de la légion Condor, que le silence des vaincus. À ce moment-là, mon père était probablement loin d’imaginer qu’il ne reverrait jamais les terres de sa jeunesse.
L’exil espagnol fut principalement une humiliation. Mon père et ses deux frères furent détenus dans le camp de concentration d’Argelès-sur-Mer.
- Eusebio Pinós au camp d’Argelès.
Un autre de mes oncles, le frère de ma mère fut détenu dans le camp de Bram. Les exilés espagnols furent marqués pour toujours par l’accueil de cette France qu’ils pensaient être la terre des droits de l’homme. Ils n’oublièrent jamais ce qu’ils ont vécu dans les camps de concentration français : le sentiment de dégradation, la perte de toutes les valeurs morales qu’ils avaient défendues, le goût amer du pain de farine mélangé à de la sciure, la tramontane, le vent froid et vif qui laissait les corps meurtris sur les plages de sable où rien n’était prévu pour abriter les hommes, la mort, l’arenitis, la maladie mentale que générait la captivité insupportable des sables du Roussillon. La France n’a jamais exprimé de repentir pour cette atteinte aux principes « liberté, égalité, fraternité » écrits sur le fronton de ses mairies, la sainte trilogie républicaine que ses élites piétinèrent et continuent à piétiner.
Une fois de plus séparée par l’histoire, ma famille se réunifia au cours de l’été 1940 en Savoie.
Aime, Savoie, 1940. Les bûcherons de l’entreprise Trézalet. Au centre en bas, Eusebio Pinós. En haut à gauche, Gabriel Pinós. En haut au centre José Barrieras.
En 1943, comme pour de nombreux républicains espagnols, pour mon père et mes deux oncles, l’heure de la revanche contre le fascisme allait sonner. Ils participèrent à la Résistance française dans les rangs du groupe FTP la Vapeur en Savoie et au sein d’un groupe de guérilleros espagnols des maquis pyrénéens.
En exportant au-delà de la frontière la guerre de libération, ils pensaient que le régime franquiste avait ses jours comptés. Ils passèrent les meilleures années de leur vie les armes à la main, afin que des générations comme la nôtre puissent vivre dans la paix et la liberté.
Ils ne comprirent pas tout de suite le cynisme des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale lorsque ceux-ci trahirent leur engagement d’aider les Espagnols à se libérer du fascisme sur leur propre terre. L’exil dura encore trente ans. L’odyssée de ma famille s’est terminée en 1950, dans la ville de Villefranche-sur-Saône, dans un lieu symbolique pour des exilés : l’Impasse de la Quarantaine. Je suis né en 1953, trois ans après la fin du voyage. C’est une histoire faite d’enthousiasme et de déceptions, l’histoire d’hommes et de femmes qui ont porté les rêves et les trahisons sur leurs épaules toute leur vie.
« Je n’ai jamais travaillé avec autant d’enthousiasme, sans être payé et sans vacances, pour une si belle cause ! ». C’est ainsi que témoignait ma mère, une petite paysanne de Sariñena ayant souffert de malnutrition et de rachitisme durant son enfance. Juliana, la petite paysanne des Monegros, n’avait que 22 ans lorsque les événements se sont précipités et l’Espagne est entrée dans une folie collective s’achevant par une guerre civile atroce et sanglante. Elle vécut le drame, la terreur et la guerre, mais aussi le bref été de l’anarchie. Le sommet de son existence, son printemps personnel, le phare qui illumina toute sa vie. En juillet 1936, elle quitta avec perte et fracas la maison bourgeoise où elle faisait le ménage depuis le plus jeune âge pour s’enrôler au service du Comité révolutionnaire et travailler au restaurant populaire de Sariñena. Elle croyait aux lendemains qui chantent et à la jeunesse du monde. Durant un été radieux, elle découvrit le bonheur de la liberté et de l’amour. Au sein du Comité révolutionnaire du village elle rencontra mon père, le delegado de abastos y de hacienda, le délégué au ravitaillement et au logement de la collectivité, et l’administrateur du restaurant populaire. La jeune Juliana découvrit la vie et l’amour, elle aima follement mon père, un jeune monegrino, qui lui fit un enfant avant de rejoindre le front du Levant.
Ma mère parlait un savoureux mélange de français et d’espagnol, le « frañol », un sabir formidable. Quand j’étais enfant, elle donnait corps grâce à cette langue nouvelle à de longs récits sur la manière dont les idées nouvelles bouleversèrent l’ordre établi dans un village à l’existence réglée par le calendrier liturgique de l’Église catholique, où des jeunes gens se mirent à lire des auteurs comme Proudhon, Bakounine, Ferrer i Guàrdia, Lorenzo et où les plus hardis d’entre eux rêvèrent de supprimer l’argent, collectiviser les terres et partager le pain. Ma mère vécut cette parenthèse libertaire, ce temps suspendu où les pauvres ont pu relever la tête, avant que la rébellion ne soit écrasée dans le sang par les phalangistes et les militaires fascistes. À vingt-cinq ans, elle traversa à pied les Pyrénées encadrée par la 11e division de l’armée républicaine pour rejoindre la France, mon frère aîné, son bébé d’un an contre sa poitrine et sa jeune sœur de dix ans accrochée à ses jupes.
Quand je pense à ma mère et à son histoire, je ressens des sentiments de nostalgie, de bonheur, de mélancolie et de colère. Je pense aussi à toutes ces femmes de l’exil qui ont vécu dans la douleur l’arrachement à leur terre et à leur espoir. L’histoire est écrite par les vainqueurs et elle a presque toujours été écrite par des hommes. Ils ont, malheureusement, trop longtemps oublié les noms des femmes combattantes dans le cadre de Mujeres libres, des milices ouvrières, des comités révolutionnaires et des organisations syndicales.
Elles ont été persécutées pendant la guerre et sous le régime franquiste. Les femmes étaient dangereuses car elles dénonçaient les problèmes liés au patriarcat et aux inégalités sociales. Comment ne pas se rappeler de ces femmes libres qui participèrent à la libération de tant de villes et de villages espagnols, au coude-à-coude avec leurs compagnons, et à qui on donna l’ordre de quitter les tranchées pour servir à l’arrière-garde comme cuisinières, infirmières et ouvrières, parce que, selon les autorités républicaines d’alors, la place d’une femme n’était pas en première ligne ? Toutes ces femmes n’avaient-elles plus leur place parmi les damnés de la terre sur un strict pied d’égalité avec les hommes ?
Tant de souvenirs m’assaillent aujourd’hui, j’ai essayé de les transmettre dans mon livre de mémoire : Ni l’arbre ni la pierre. L’odyssée d’une famille libertaire espagnole[vii].
La mémoire nous joue parfois des tours, elle mélange, elle télescope, elle brouille les pistes et par l’intermédiaire d’un livre, on essaye d’y remettre un peu d’ordre, de transmettre par devoir et par conviction. Je l’ai fait par fidélité pour les miens, pour leurs idées émancipatrices, pour ne pas laisser notre histoire au bord du chemin. (…) Ma volonté au départ en écrivant ce livre était de mettre en évidence l’histoire singulière de ces milliers de républicains espagnols qui ont vécu le rêve et le cauchemar, la joie et la tristesse. Une génération entière de femmes et d’hommes que l’histoire officielle a trop longtemps oubliée (…).Je me souviens des déplacements que nous effectuions en autocar avec toutes les familles de la CNT, lorsque j’étais enfant dans les années cinquante et soixante, pour nous rendre aux meetings dans les Bourses du travail de la région, à Vénissieux, Villeurbanne, Saint-Fons, Roanne… Dans les familles libertaires espagnoles, les enfants étaient rois, pour nous, chaque voyage était une fête, nous qui avions peu d’occasions de sortir. À chaque meeting, la journée se déroulait de la même manière : le matin, place était laissée aux orateurs, les ténors de la CNT se succédant pour évoquer la Revolución de leur jeunesse et la nécessité de soutenir le combat mené « à l’intérieur » par les valeureux compañeros de la CNT. À la fin de la réunion, la salle entière entonnait avec émotion les yeux remplis de larmes Hijos del pueblo et A las barricadas, les hymnes de la FAI et de la CNT.
Une table de presse mettait à disposition des militants les journaux et les revues éditées par la CNT, la FAI et la FIJL[viii], de même que des ouvrages politiques et aussi des romans, des pièces de théâtre ou des recueils de poésie. Je me souviens que, lors d’un meeting à Saint-Fons, mon père fit l’acquisition de trois drames paysans de Federico García Lorca en espagnol : Yerma, La Maison de Bernarda Alba et Noces de sang. Quelques années plus tard, alors adolescent, ils me permirent de découvrir Lorca. La culture était une préoccupation constante dans les publications libertaires de l’exil qui naquirent à partir de 1945. La littérature, le théâtre, le cinéma et les arts plastiques avaient une place prépondérante dans les journaux et les revues de l’exil.
Le repas fraternel était souvent servi dans un restaurant populaire proche de la salle où avait lieu le meeting ; c’était l’occasion de se retrouver entre compagnons et d’évoquer le paradis perdu, les souvenirs de 1936, l’actualité du jour au-delà des Pyrénées, la dernière naissance, les études des enfants à l’école française. L’après-midi, tout s’achevait par un festival, un spectacle où les attractions étaient constituées de chanteurs, de musiciens, de danseurs, de comédiens de l’exil. Ces artistes, souvent talentueux, mettaient en scène des danses du folklore espagnol comme la jota, la sardane ou le flamenco et des œuvres théâtrales comme celles de Calderón de la Barca, Cervantes ou Lorca. Pour nous les enfants, c’était une fête et une récréation, nous arpentions la salle de concert, déambulions dans les allées, les escaliers, le balcon et le hall d’entrée. Le bonheur que nous lisions dans les yeux de nos parents nous rendait joyeux et fiers d’appartenir à notre communauté de l’exil, si loin et si proche de l’Espagne. Nous avions, bien sûr, d’autres occasions de nous retrouver, lors des giras, nom de rencontres héritées des libres-penseurs et des naturistes du siècle dernier quand ceux-ci célébraient la mère nature et la liberté. De même que lors des meetings de la CNT, nous nous déplacions en autocar vers un lieu à la campagne, un champ ou un bois où un repas champêtre était organisé. L’asado, la viande était cuisinée à la parrilla, au barbecue, comme en Espagne. Les Espagnols aiment chanter et l’on chantait beaucoup lors des giras, où l’on s’accompagnait de guitares ; pendant ce temps, los críos, les enfants, faisaient les quatre cents coups dans la campagne environnante.
En 1968, à 15 ans, j’étudiais en deuxième année de chaudronnerie dans un CET (Collège d’enseignement technique) de Villefranche-sur-Saône. Mon père militait à la CGT dans une usine d’impressions textiles, l’usine Gillet-Thaon. De nombreux anarchistes espagnols adhérèrent à FO par rejet de l’influence des communistes au sein de la CGT, mais FO n’existant pas dans son usine mon père adhéra à la CGT.
Quand Mai-68 est arrivé, je fréquentais les jeunes de mon quartier, parmi lesquels se trouvait un groupe de militants maoïstes. À l’époque, mes sources d’inspiration étaient les romans de Lorca, Zola, Hugo, Tolstoï, Sartre, Molnar, Kafka découverts dans la bibliothèque de mon père. Les anarchistes espagnols donnaient beaucoup d’importance à la culture en tant qu’instrument de « conscientisation ». Un véritable attachement à l’identité ouvrière existait alors, le fait de porter un bleu de travail était un signe de reconnaissance pour refuser l’ordre usinier, ses contraintes et ses hiérarchies. Dans mon collège, une assemblée générale fut organisée par les étudiants de troisième année. Ça ne s’était jamais produit dans un établissement technique, nous étions beaucoup moins libres de nous exprimer qu’au lycée d’enseignement général, le poids de la hiérarchie étant très fort. La grève fut votée et un comité de lutte fut créé.
Au lendemain du déclenchement de la grève à Villefranche, une manifestation et un meeting à la Bourse du travail eurent lieu. Nous nous sommes retrouvés dans la rue avec les ouvriers des usines en grève et les lycéens. Les travailleurs de presque toutes les usines étaient là, y compris les petits ateliers de confection, très nombreux dans la ville. Complètement bouleversé, manifestant au coude-à-coude avec les ouvriers et les lycéens, pour la première fois de ma vie, je partageai une lutte sociale avec mon père… (…) En mai, j’ai aussi découvert la presse anarchiste espagnole imprimée en France, puis introduite clandestinement en Espagne. Des journaux auxquels mon père était abonné : Le Combat syndicaliste et Tierra y Libertad… Alors que je ne les lisais pas auparavant, ces journaux me sensibilisèrent à la question sociale. Je me souviens du numéro de juin du Combat syndicaliste qui titrait : « En mai fais ce qui te plaît ! ». Et voyant la réalité à travers le regard des anarchistes, je me sentis très vite proche d’eux. Ils parlaient de la grève générale et expliquaient pourquoi un combat était nécessaire, un combat qui conduirait au changement social et à la fin du capitalisme. (…)
À 15 ans, Mai-68 fut pour moi un baptême du feu vécu aux côtés de mes parents et de mes amis. Dans les années qui suivirent, j’ai tenté de vivre l’utopie à travers un engagement militant total. Ce fut une plongée dans le chaudron libertaire de ma famille, une manière de continuer un combat qui commença au-delà des Pyrénées.
Daniel Pinós Barrieras.
Notes
[i] Pour reprendre le titre du livre de Patrick Pépin Histoires intimes de la guerre d’Espagne, Paris, Nouveau Monde, éditions, 2009.
[ii] C’est le cas ici de plusieurs auteurs de notre ouvrage qui ont réalisé un travail d’édition des témoignages de leurs proches. Mais aussi d’auteurs comme Myrtille Gonzalbo et Vincent Roulet qui ont créé, avec le site des Giménologues, un remarquable espace de transmission des mémoires libertaires ; c’est aussi le cas de Marí Carmen Rejas dans son ouvrage 1936, itinéraire d’un enfant espagnol. Paco, l’impossible oubli, Paris, Société des écrivains, 2015 ; ou encore de Mélodia Sirvent avec Le cordonnier d’Alicante Mémoires d’un militant de l’anarchisme espagnol (1889-1948) Paris, Editions CNT-RP, 2017, où elle traduit, introduit et annote le témoignage de son père Manuel Sirvent Romero. Certains fils et filles de républicains à l’image d’Antoine Blanca dans Itinéraires d’un républicain espagnol, reprennent à leur compte le récit de leur père en le fictionnalisant. Ainsi Tomás Gómez Gómez, Amanecer rojo, Sarrión, Muñoz Moya Editores, 2015.
[iii] Voir ¡Caminar!, la coordination pluraliste d’associations au niveau français.
[iv] Tzvetan Todorov, Les Abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1995.
[v] Arlette Farge, Des lieux pour l’histoire, Paris, éditions du Seuil, 1997, ou La Parole comme évènement dans Des lieux pour l’histoire, Paris, Seuil, 1997.
[vi] Certains auteurs, dans la partie précédente, ont réalisé des films (Ariel Camacho, Fernando Malverde, Marta Marin Dòmine, Odette Martinez-Maler) mais ils n’ont pas choisi de parler de leur travail d’écriture ou de réalisation, de même que Jean Ortiz dans la partie consacrée aux archives.
[vii] Daniel Pinós, Ni l’arbre ni la pierre. L’odyssée d’une famille libertaire espagnole, Lyon, Atelier de création libertaire, 2001.
[viii] CNT : Confédération nationale du travail ; FAI : Fédération anarchiste ibérique ; FIJL : Fédération ibérique des Jeunesses libertaires [NDÉ].
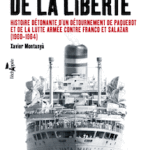



![Combattre le fascisme dans les années 1968 [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/FzNZ0L5X0AAAWKT-150x150.jpeg)

![Comprendre et combattre le fascisme avec Gramsci [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Gramsci-1-150x150.jpg)
![Fascisme : vieux démons et nouveaux monstres [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/734662-150x150.jpeg)

