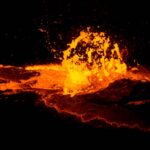Amérique latine : les contradictions du cycle progressiste et les défis de la transformation sociale
Extrait du livre collectif : Gouvernements progressistes en Amérique latine (1998-2018). La fin d’un âge d’or (PUR, 2021), dirigé par Franck Gaudichaud et Thomas Posado.
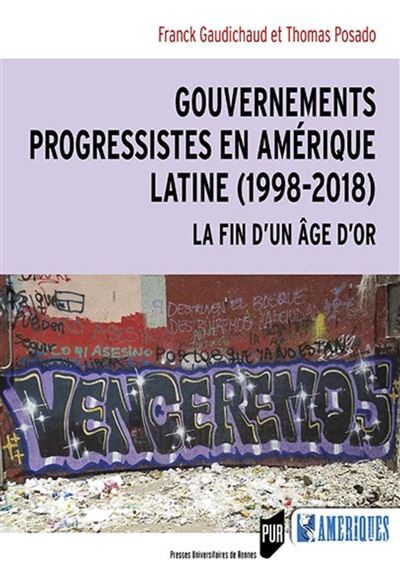
Dans cet ouvrage collectif, Franck Gaudichaud et Thomas Posado ont réuni les contributions de plusieurs spécialistes reconnu.e.s de la région, articulées avec les enquêtes de terrain de jeunes chercheurs, pour proposer une compréhension globale des deux dernières décennies en Amérique latine, au-delà des clichés dont elle est souvent victime. Il est le fruit de recherches, dont certaines avaient été présentées dans un premier temps durant un colloque international organisé à l’Université Grenoble-Alpes en juin 2017.
Le « virage à gauche » de l’Amérique latine a suscité un intérêt à la fois politique et académique. Aujourd’hui, le reflux de ces gouvernements progressistes s’exprime avec maintes contradictions, sans que cette conjoncture ne corresponde d’ailleurs forcément à l’installation sur le long terme des droites ou à l’éviction du champ politique de la gauche ou des « progressismes ». C’est ce que montre le retour des péronistes en Argentine en 2019, la victoire de Andrés Manuel Lopez Obrador (centre-gauche) au Mexique en 2018 ou encore l’échec de la tentative d’enracinement local de Jair Bolsonaro (extrême droite). Ce qui est sûr c’est que ce qui a parfois été considéré comme un « cycle politique », et que les coordinateurs ont choisi de situer dans cet ouvrage comme « un âge d’or » semble achevé.
Cet ouvrage propose ainsi un bilan critique de ces expériences, essentiellement pour la période 1998-2018, et ce à partir d’analyses et y compris de focales multiples, et même parfois en débat entre elles. Au niveau géopolitique, la tutelle étasunienne bousculée est scrutée, ainsi que le rôle de la Chine, montée en puissance. Les politiques économiques qui ont permis une redistribution vers les plus pauvres, mais ont été aussi profondément marquées par la dépendance aux matières premières et à diverses formes d’extractivisme sont aussi au centre de certains textes. L’analyse des mouvements sociaux dans les quartiers, les syndicats ou le champ de l’éducation vient éclairer les mutations en cours.
L’étude des caractéristiques communes de l’évolution de la politique latino-américaine est complétée par une analyse des conjonctures spécifiques : du géant brésilien où les ultra-conservateurs connaissent une dynamique fulgurante à la crise vénézuélienne dont il est difficile d’entrevoir une issue, en passant par la répression menée par Daniel Ortega au Nicaragua, la coalition sociale-démocrate longtemps au pouvoir en Uruguay ou encore la présidence national-populaire d’Evo Morales en Bolivie. Il s’agit d’une invitation à comprendre la région aujourd’hui et à essayer d’envisager vers quels chemins elle pourrait se diriger dans les prochaines années, tout en prenant un recul critique sur les tensions et impasses des « progressismes ».
Avec l’accord des Presses Universitaires de Rennes, ContreTemps propose ici la contribution de la sociologue Miriam Lang, membre de la Fondation Rosa Luxemburg (Quito) et Universitaire à la Universidad Andina Simón Bolívar (Equateur).
***
Au cours des quinze dernières années, l’Amérique latine a été une source d’inspiration et d’espoir pour une bonne partie des mouvements de gauche dans le monde. Les victoires électorales successives (auto)identifiées avec la gauche ou le « progressisme » dans plusieurs pays, depuis la victoire d’Hugo Chávez au Venezuela fin 1998, ont configuré le sous-continent en un espace géopolitique exceptionnel dans un monde sous hégémonie néolibérale. Un espace qui promettait des possibilités de transformation sociale profonde. La simultanéité relative de gouvernements autoproclamés « post-néolibéraux » et les tentatives visant à réorienter l’intégration régionale de l’Amérique latine permettaient même de penser que cette transformation pourrait aller au-delà de l’échelle nationale. Cette constellation historique exceptionnelle fut le résultat de nombreuses luttes qu’avaient entreprises les mouvements sociaux anti-néolibéraux et émancipateurs de la dernière décennie du 20e siècle et durant la première décennie du nouveau millénaire. Après vingt ans d’engagement axé sur la résistance, une partie de ces mouvements cherchait désormais à poursuivre le chemin de la transformation en occupant l’appareil d’Etat par la voie électorale et par l’exercice du gouvernement.
Les propos présentés dans cet article, peut-être provocateurs pour certains, reposent surtout sur l’expérience progressiste équatorienne, et s’inspirent aussi de la bolivienne et la vénézuélienne, qui sont celles que j’ai connues de plus près au cours de la dernière décennie. Ils s’appuient en grande partie sur les débats qui se sont déroulés au sein du groupe de travail permanent « Alternatives au développement » de la Fondation Rosa Luxembourg (Quito), où participent des activistes et intellectuels critiques d’une bonne partie de l’Amérique latine (et aussi quelques européens), groupe fondé en 2011[1].
Ce fut à l’orée du deuxième millénaire que des intellectuels comme Franz Hinkelammert et Edgardo Lander commencèrent à parler d’une crise non seulement du capitalisme, et multidimensionnelle, mais aussi d’une crise du modèle même de la civilisation moderne que l’Occident a imposé au reste du monde – d’abord au nom de la mission de « civiliser », et ensuite au nom du « développement[2] ». Cette crise de civilisation est un point de départ important pour ma réflexion, surtout lorsqu’il s’agit de déterminer de quelle sorte de transformation notre monde a besoin. Quelques-unes de ses dimensions sont la crise économique, de la croissance, des inégalités galopantes, et de l’emploi ; la crise écologique, qui nous a conduit à dépasser les limites de la planète et détruit de manière accélérée les conditions matérielles de notre subsistance (extractivisme) ; la crise politique et de la démocratie ; la crise sécuritaire et les guerres permanentes externalisées à certaines régions du monde ; la récente crise de la migration ; et la crise de reproduction ou des soins (care)[3].
Il s’agit bien d’une crise civilisationnelle parce qu’elle se fonde sur une certaine façon de voir le monde, d’analyser ses problèmes et aussi d’envisager des solutions. C’est ici qu’opère la colonialité du pouvoir et du savoir (selon Anibal Quijano) – qui est à l’origine de notre foi aveugle en la science moderne, en la technologie, et en la consécration des sciences économiques et des chiffres comme les manières soi-disant les plus adéquates pour comprendre et représenter la réalité qui nous entoure.
Face à cette crise de civilisation, et grâce aux importantes luttes qui ont précédé les progressismes, l’Amérique latine a produit certains paradigmes alternatifs au paradigme hégémonique moderne / occidental. Par exemple celui du Buen Vivir, le bien vivre, ou bien celui des droits de la Nature, mais aussi l’idée d’États plurinationaux – qui reconnaissent les peuples indigènes comme nations ancestrales sur le territoire national-, dont les principes ont été inclus dans les constitutions de la Bolivie et de l’Équateur[4]. Au sein du débat bolivien, en outre, les catégories de décolonisation et de dépatriarcalisation de l’État ont atteint une certaine importance, reflétant ainsi le poids des mouvements indigènes et féministes dans ce pays[5]. Tous ces nouveaux paradigmes promettaient d’aller au fond des problèmes, c’est pourquoi des sociologuescomme Boaventura de Sousa Santos ont pu parler d’une « refondation » des sociétés concernées[6].
Ces concepts ont trouvé de nombreux échos de part le monde, en Europe comme dans l’ensemble du Sud global géopolitique. Cependant, sur le terrain, en Amérique du Sud, ils se sont rapidement heurtés aux limites de la Realpolitik et ont, par conséquent, été profondément redéfinis par les gouvernements en place. Le « bien vivre » devint synonyme de « développement » – le paradigme qu’il prétendait justement défier, et les droits de la Nature furent réduits à une formule rhétorique pour promouvoir « l’exploitation minière responsable ». Les déclarations de plurinationalité des États bolivien et équatorien, qui établissaient de nouveaux horizons de transformation en termes de construction d’interculturalité au sein des institutions et au-delà, finirent également par succomber aux logiques inhérentes à ces appareils d’État que, soudainement, il fallait gérer.
Néolibéralisme contre néokeynesianisme ?
Une bonne partie des analystes décrivent les processus politiques « progressistes » comme « post-néolibéraux[7] ». Cette caractérisation se produit cependant dans le cadre d’un discours qui a réduit les marges et les possibilités de transformation sociale à l’opposition binaire « néo-keynésianisme versus néolibéralisme » ; et qui, de plus, se base sur une conception plutôt simpliste du néolibéralisme, le réduisant à ses effets macroéconomiques tout en ignorant ses effets culturels et de subjectivation. Cette réduction de la politique à la relation « État / marché » conduit à éclipser tout un univers d’autres dimensions, de stratégies et d’acteurs possibles et nécessaires de la transformation sociale, telles que les forces du commun et du communautaire, qui pourtant ont joué un rôle très important dans l’histoire de l’Amérique latine[8].
Il est vrai qu’une des plus grandes victoires des mouvements sociaux antérieurs a été celle contre l’hégémonie néolibérale, avec la déroute du projet de Zone de Libre Échange des Amériques (ALCA), en 2005. Une des transformations majeures de l’ère progressiste qui suivit fut le fameux « retour de l’État » et de son pouvoir de régulation face à l’économie de marché, selon les principes néokeynésiens. Mais l’imaginaire collectif qui donna lieu à ce « retour de l’État » commit la grave omission de ne pas se demander quelle sorte d’Etat serait désirable. L’illusion était d’édifier – enfin – un vrai État-providence à la périphérie du système-monde, une copie de ceux qui avaient existé en Europe du Nord pendant les fameuses Trente Glorieuses – en concordance avec la promesse centrale d’un développement « de rattrapage » (catch-up development). Une illusion qui a conduit à omettre les réflexions plus critiques et créatives sur les limitations nécessaires au pouvoir de l’Etat et sur ses relations avec la société organisée, ou sur de possibles structures alternatives.
De plus, la prétention des progressismes de financer la transformation avec les revenus de l’exportation intensifiée de matières premières a mené à un approfondissement du modèle extractiviste, qui a marqué au fer rouge le type d’Etat qu’ils ont déployé par la suite. La distribution centralisée de la rente a de puissantes implications politiques et structurelles : elle favorise une hypercentralisation du pouvoir politique, qui dérive systématiquement en clientélisme et corruption, ainsi qu’en une logique paternaliste, intolérante envers les dissidences et hostile au débat pluraliste – ce qui a sévèrement limité les possibilités de transformation émancipatrice durant la période progressiste[9].
De manière rétrospective, on peut dire aujourd’hui qu’une bonne partie des aspirations de transformation des mouvements sociaux émancipateurs latino-américains a été systématiquement tronquée par les gouvernements progressistes. Il faut aussi noter qu’au sein de ces gouvernements, malgré leur rhétorique de gauche ou révolutionnaire, un large éventail de tendances politiques, y compris des tendances conservatrices, réactionnaires et néolibérales a toujours coexisté[10].
Dans le cadre du néodéveloppementisme extractiviste, durant les quinze années progressistes en Amérique latine, la justice environnementale a été sacrifiée au nom de la justice sociale. Sous prétexte de l’éradication de la pauvreté, les relations sociales prédatrices avec la Nature ont été aggravées au lieu d’être sérieusement remises en question[11]. Ceci est illustré, par exemple, par l’expression récurrente de l’ex-président équatorien Rafael Correa pour justifier l’expansion de la frontière de l’exploitation pétrolière, ou l’introduction de l’exploitation minière à grande échelle dans son pays, quand il déclarait : « la pauvreté ne peut pas faire partie de notre identité. Nous ne pouvons pas être des mendiants assis sur un sac d’or[12]. » Une phrase à laquelle les indigènes Shuar du sud de l’Amazonie équatorienne répondirent en janvier 2017, dans une lettre publique au pays, et au monde entier :
« Ne venez pas nous dire que vous promouvez l’exploitation minière pour nous sortir de la pauvreté. Parce que nous, avec notre mode de vie, nous ne nous sentons pas pauvres ; dites-nous plutôt comment vous pensez nous protéger en tant que peuple et en tant que culture[13]. »
Dans son élan modernisateur, le gouvernement de Rafael Correa n’a jamais su apprécier la diversité culturelle : pour celui-ci, les indigènes existaient uniquement en tant que pauvres, leurs cultures n’étaient que du folklore au service du tourisme, et les « sortir de la pauvreté » impliquait qu’ils s’adaptent enfin aux modes de vie urbains, modernes, capitalistes et occidentaux – précisément les modes de vie qui nous ont mené à la crise civilisationnelle. Ceci est éloquemment exemplifié par les trois cités-modèles « du millénaire » que Correa ordonna d’édifier en pleine Amazonie, avec les revenus pétroliers, sans jamais demander aux futurs habitants indigènes s’ils désiraient vraiment vivre ainsi[14].
Les progressismes sont-ils de gauche ?
Malgré tout cela, aujourd’hui encore, les progressismes latino-américains sont amplement perçus comme une expérience politique « de gauche ». Cela est dû, pour une part, à leur anti-impérialisme affiché vers l’extérieur, mais aussi à leur succès (transitoire) lié à la réduction de la pauvreté et des inégalités, la justice sociale étant l’une des préoccupations traditionnelles et fondamentales de la gauche. Ce succès fut très présent dans le discours officiel des gouvernements, mais aussi confirmé en chiffres par des organismes internationaux tels que la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL).
Cependant, plusieurs auteurs soutiennent que les progressistes ont trahi leur but initial, ou bien qu’en réalité ils ne furent jamais vraiment de « gauche[15] ». Selon nous, si nous partions de l’hypothèse qu’il y a eu « trahison », ou que les progressismes n’étaient pas vraiment de gauche, ceci ne nous impliquerait pas et ne nous permettrait pas d’apprendre, étant donné que cette hypothèse place les erreurs, et donc aussi les apprentissages possibles, dans le champ de « l’autre ».
Certains arguments qui sont donnés pour démontrer que les gouvernements progressistes « ne sont pas de gauche » contiennent précisément des éléments qui proviennent d’un héritage problématique des gauches qui au XXe siècle étaient au pouvoir (dans le bloc soviétique), même si cet héritage s’est sans doute mélangé avec des traditions populistes propres de l’Amérique latine. C’est le cas par exemple avec :
– La concentration du pouvoir politique
– L’utilisation clientéliste de l’appareil d’État (et de la structure des partis gouvernants)
– L’intolérance envers les dissidences et la censure de la pensée critique
– L’intervention étatique au sein des organisations sociales autonomes ou indépendantes
Tout un répertoire de mesures qui se retrouve non seulement dans les stratégies de maintien au pouvoir employées par les gouvernements du bloc soviétique avant 1989, mais aussi au Nicaragua et à Cuba, par exemple[16]. En bonne partie, ces instruments ont été répliqués de façon acritique par les dénommés « socialismes du XXIe siècle » en Bolivie, en Équateur et au Venezuela. Quels sont les facteurs qui empêchent les gauches du monde d’apprendre ? Comment arriver à éviter certaines erreurs qui ont déjà été commises maintes fois ? Comment éviter, dans le cas des progressismes latino-américains, que la leçon apprise se limite une fois de plus à mettre en question l’intégrité personnelle du leader et de vouloir le remplacer par quelqu’un d’autre aux prochaines élections, – au lieu de voir que les problèmes sont plutôt fondamentaux et structurels ?
Politiques sociales et dépossession
Dans ce qui suit, je voudrais explorer les limites que le modèle progressiste a posées à l’émancipation des populations. Je comprends l’émancipation comme la construction progressive d’autonomie, subjective, culturelle et structurelle, individuelle et collective, face aux différentes relations de domination qui conforment la base de la civilisation capitaliste/moderne/occidentale. En Amérique latine, en plus de la lutte classique contre l’exploitation, ceci implique nécessairement la décolonisation des sociétés et leur dépatriarcalisation, ainsi que la construction de relations harmonieuses avec la Nature, – des buts déclarés des luttes sociales durant les décennies 90 et 2000.
Pour montrer les limites que les progressismes ont posées à l’émancipation, mon analyse portera sur leur plus grand succès déclaré qui est la réduction de la pauvreté et des inégalités. Selon la CEPAL, la pauvreté fut réduite de 44 % en 1999 à moins de 31 % en 2010 dans le sous-continent, et encore d’avantage si l’on mesure jusqu’en 2014. Ce n’est qu’après la chute des prix internationaux des matières premières, dans la deuxième moitié de 2014, que cette tendance s’est inversée dramatiquement dans plusieurs pays, ou a, du moins, considérablement ralenti dans d’autres.
La lecture dominante de la réduction de la pauvreté se limite à voir des chiffres, pour en arriver à l’affirmation sommaire que les progressismes auraient « sorti des millions de personnes de la pauvreté ». Les statistiques se centrent, aujourd’hui encore, sur la pauvreté monétaire, c’est-à-dire la quantité d’argent qu’une personne a à sa disposition par jour pour pouvoir consommer. Cependant, dans un continent comme l’Amérique latine, qui a construit sa modernité d’une façon « baroque », comme dirait Bolívar Echeverría, il existe une diversité culturelle importante et des populations qui pratiquent des modes de vie qui ne sont pas totalement imprégnés par les logiques capitalistes modernes. Modes de vie qui, puisqu’ils consomment peu et sont donc peu destructeurs de l’environnement, contribuent à la construction de conditions de vie soutenables pour les générations futures sur la planète – et qui pourraient donc, en quelque sorte, éclaircir le chemin pour affronter la crise civilisationnelle.
Pourtant, un examen critique des indicateurs appliqués par le gouvernement équatorien, que je prends ici comme exemple, afin de mesurer la pauvreté – que ce soit la mesure par revenus, ou bien la mesure multidimensionelle de la pauvreté, conception plus innovatrice -, met en évidence un parti pris : ces indicateurs établissent les modes de vie urbains, modernes et capitalistes comme standard à atteindre, et construisent les modes de vie ruraux, paysans, et surtout indigènes, systématiquement comme pauvres – et donc « à éradiquer ». Ce qui n’est pas sans implications.
Une lecture plus qualitative des politiques sociales progressistes nous montre aussi qu’elles ont contribué à une redéfinition de ce que l’on entend par « justice sociale » ou par « bien-être », une redéfinition qui nous rapproche des logiques du capitalisme et de ses notions particulières du « succès ». Je voudrais seulement mentionner ici quelques exemples :
– Premièrement, la notion de justice, sociale ou environnementale, a été remplacée par la logique de compensation (« je vais détruire ton habitat et ton mode de vie, par exemple pour un projet extractiviste, mais je vais te compenser en argent »).
– Deuxièmement, les transferts conditionnés d’argent aux populations classifiées par les bureaucraties d’Etat comme les plus pauvres ont intensifié leur dépendance à l’argent et les ont transformés en consommateurs de biens et services – tout en marginalisant, en même temps, d’autres formes d’échange ou de convivialité qu’ils pratiquaient. La sociologue Maristella Svampa a appelé ce phénomène la « démocratisation de la consommation ».
– Ceci a conduit, entre autres, a une expansion massive de l’endettement des classes populaires par la « démocratisation» de l’accès au crédit – que l’on pourrait lire également, comme le fait Léna Lavinas[17], comme une expansion des marchés financiers jusque dans les classes les plus modestes, avec des taux de crédit immoraux d’entre 20 et 40 %.
Ces politiques ont donc eu un impact homogénéisant sur la diversité culturelle et de modes de vie. Elles ont marginalisé les modes de vie les plus soutenables écologiquement, centrés sur l’autoproduction et les formes d’échange non-monétaires, tout en privilégiant ceux centrés sur l’économie de marché. Elles ont ainsi contribué à l’expansion des logiques capitalistes, non seulement en termes territoriaux, mais aussi culturels – en assimilant les économies centrées autour de la subsistance et de l’autoproduction, et largement indépendantes des biens et services, à la pauvreté et au « sous-développement ». Par ailleurs, les politiques sociales des États progressistes ont aussi contribué à intensifier les dépendances et la dépossession en termes d’autonomie, d’autodétermination et de capacité d’action populaire : par exemple, en 2013, 19% de la population latino-américaine dépendait d’une ou plusieurs allocations gouvernementales. Elles ont aussi installé l’idée que l’État était l’agent privilégié, sinon le seul légitime, de la transformation sociale, et qu’il fallait voter et attendre. En Équateur, toute forme autonome d’organisation sociale, toute initiative indépendante ou d’autogestion, était vue par Rafael Correa comme une menace envers les forces politiques gouvernantes qui devait être combattue. Après quinze années de progressisme, la notion que tout changement doit forcément venir d’en haut est bien ancrée dans l’imaginaire collectif sud-américain, surtout parmi les jeunes générations. L’antithèse au discours zapatiste, zapatisme qui avait causé un fort impact dans les imaginaires au cours des décennies antérieures, s’est imposée avec les progressismes.
C’est ainsi que de nombreuses initiatives populaires en matière de santé, d’éducation, de construction de logements, de production agricole biologique, inaugurées pendant les années néolibérales de retrait de l’État ou bien dans des territoires où l’État n’avait jamais été très présent, comme en Amazonie, ont été démantelées agressivement par certains progressismes, sans même évaluer si elles servaient leur cause, afin d’être remplacées par des systèmes centralisés, unifiés et régis par l’État central.
L’éducation interculturelle bilingue en Équateur: un exemple de dépossession par l’État
Un exemple éloquent de dépossession par le spectre de l’État-progressiste est la réforme éducative orchestrée par le gouvernement de Rafael Correa, qui généralement est bien vue parce qu’elle a signifié une augmentation importante des dépenses publiques dans ce secteur[18]. En Équateur, un système d’éducation interculturelle bilingue avait été cogéré de façon décentralisée par les organisations indigènes et l’État depuis la fin des années 80. Ce système consistait en un réseau de petites écoles communautaires, où les contenus, les langues enseignées, les méthodes et les matériaux éducatifs étaient adaptés aux différents contextes culturels et aux différents peuples habitant le pays. Bien que leur infrastructure et financement fussent assez déficients, ces écoles jouaient souvent un rôle crucial dans le tissu social des communautés et offraient aux enfants indigènes une éducation libératrice, décolonisatrice, qui avait beaucoup de sens dans leur propre contexte. Les enseignants communautaires jouaient un rôle social beaucoup plus important dans les communautés que simplement celui d’enseigner aux enfants, car ils devaient répondre aux exigences et besoins de l’assemblée du village[19].
Ce système, qui a pourtant été considéré comme un modèle en Amérique latine, fut démantelé par la « révolution citoyenne » et sa nouvelle loi d’éducation de 2011 – qui pourtant nominalement, porte toujours le nom « d’interculturelle ». Cette loi mit en place un système d’éducation publique unique et centralisé, avec un seul programme en langue espagnole pour tous les élèves, ne donnant guère d’importance à la diversité culturelle. De plus, elle laissa sans emploi la grande majorité de professeurs indigènes au nom de la « méritocratie », puisqu’ils ne possédaient pas les titres universitaires qui étaient maintenant exigés. Des professeurs proches des familles et des élèves, profondément insérés dans les communautés, furent donc remplacés par des professeurs externes, certes plus qualifiés formellement, mais qui venaient de n’importe où dans le pays et qui – pour la plupart – ne comprenaient, ni ne supportaient la réalité et les conditions de vie des communautés indigènes, que ce soit dans les Andes ou en Amazonie.
En termes d’infrastructures, des centaines de petits établissements modestes, souvent auto-construits par la communauté, que Rafael Correa a baptisés les écoles « de la pauvreté », ont été fermés. Ils furent remplacés par quelques douzaines d’ « écoles du millénaire », modernes et centralisées, qui accueillent plusieurs centaines d’élèves. Ces nouvelles écoles en béton furent extrêmement bien équipées : laboratoires, ordinateurs, etc. Mais beaucoup d’enfants devaient maintenant venir de loin, ce qui posa souvent un problème de transport. La réforme éducative du gouvernement Correa a été dominée par une vision technocratique, centrée sur l’infrastructure. Elle n’a pas cherché à décoloniser les contenus de l’éducation, ni les méthodes d’enseignement qui portent surtout sur la discipline et l’obéissance, et qui étouffent la pensée critique avant même qu’elle ne puisse naître.
Les résultats : un taux croissant des désertions de professeurs et des élèves. De plus, selon le prêtre salésien José Manangón de la province de Cotopaxi, cette éducation du millénaire « éduque les enfants pour la migration et pour devenir des péons du grand marché et du système, tandis que les élèves des petites écoles interculturelles bilingues antérieures restaient dans leurs villages pour la plupart, et s’investissaient à travailler pour améliorer les conditions de vie locales selon les besoins des habitants[20] ». Les grammaires de l’inclusion progressistes – et des gauches en général – ont eu tendance à privilégier les dimensions matérielles du bien-être (la redistribution de la richesse pensée en termes d’argent) en détriment de ses dimensions relationnelles, sociales et culturelles, qui forment pourtant la base de la dignité humaine.
Finalement, les politiques sociales progressistes ont manqué l’occasion de construire une relation politique et émancipatrice avec « les pauvres » (à l’exception -peut-être ?- du Vénézuéla de Chávez). Les pauvres ont plutôt été perçus comme bénéficiaires passifs et individualisés. Ils ont souvent été utilisés comme clientèle mobilisable et manipulable, obligée de se manifester en faveur des gouvernements dans des moments de tension politique – souvent sous peine de perdre leurs bénéfices ou allocations.
Par conséquent, lorsqu’il s’agit soudain de défendre, par leur propre initiative populaire, un projet politique progressiste ou alternatif contre une vraie offensive des droites et d’extrême-droite, comme au Brésil avec Jair Bolsonaro, cela ne peut avoir lieu avec la force et l‘organisation nécessaires.
Impacts des progressismes sur la culture politique
Finalement, les progressismes n’ont pas eu une influence émancipatrice sur la culture politique. Les partis sur lesquels ils se sont appuyés, pour la plupart, ne furent pas conçus comme des espaces de délibération, mais comme des machines électorales centrées sur un ou une leader. La logique de polarisation, qui fait partie de l’héritage de la guerre froide pour les gauches et qui fut réactualisée par les progressismes, a mené à un appauvrissement significatif du débat politique.
La participation politique a elle aussi subi une redéfinition. Tandis que lors des deux décennies précédentes, elle incluait des formes d’expression de la volonté populaire au moyen de manifestations ou protestations, des modèles de cogestion entre l’Etat et les organisations sociales[21], et surtout des processus de construction autonome, la participation a été réduite par les gouvernements progressistes à une sorte d’acclamation passive et canalisée. Au lieu de poursuivre les promesses de décolonisation et de dépatriarcalisation, les gouvernements progressistes ont préféré bénéficier dans le court terme de la culture politique patriarcale et coloniale préexistante dans la région. Au lieu de la démanteler, ils l’ont re-légitimée et renforcée.
Même dans les États où un bon nombre de femmes ou de représentants indigènes avaient accédé à des postes importants, comme en Bolivie ou en Équateur, leur présence sur ces postes a été strictement conditionnée à la subordination de leurs intérêts politiques propres, notamment féministes ou indigénistes, au projet central du pouvoir exécutif. Par exemple en 2013, des parlementaires féministes qui en Équateur ont défendu simplement la légalisation de l’avortement en cas de viol, ont été sanctionnées par le conseil disciplinaire de Alianza País[22]. De la même manière, les relations entre gouvernants et gouvernés ont été marquées par la tutelle, le paternalisme et la dépendance. Et les attitudes machistes, parfois militaristes et souvent violentes des leaders, ont largement contredit, au jour-le-jour, les efforts législatifs émancipateurs qui eurent lieu dans certains pays, par exemple contre la violence faite aux femmes.
Conclusions
Même s’il est indispensable de reconnaître les progressismes comme une tentative de transformation sociale initiée par les gauches sociales et politiques, celle-ci a été fortement limitée dans son potentiel émancipateur par la prépondérance qu’ont acquises les institutions de l’État dans l’agencement et l’impulsion de cette transformation.
Le discours binaire selon lequel le néolibéralisme devait nécessairement être remplacé par un néokeynésianisme développementiste et centralisé, renforcé par les logiques politiques du modèle extractiviste, a effacé le rôle de la société organisée dans la transformation sociale et exacerbé le rôle de l’État, dans certains cas consacré comme le seul acteur légitime de la transformation. Ceci conduit à de nombreux processus de dépossession dans les territoires où les acteurs sociaux avaient créé des réseaux autonomes, du moins en partie autogérés, pour satisfaire les besoins de la population : plusieurs gouvernements locaux qui avaient construit des processus de démocratie participative depuis des décennies, par exemple dans l’allocation de budgets ; mais aussi des réseaux de santé, d’éducation, de crédit mutuel, de résolution de conflits et d’administration de justice ancestrale indigène, ont été détruits – ou du moins affaiblis – par la prétention de l’État national d’assumer la totalité des compétences « par en haut ».
Dans une perspective qui prend en compte la division internationale existante du travail et d’exploitation de la Nature, il est important d’interroger plus fondamentalement la supposition selon laquelle « l’État-providence » serait généralisable à tous les pays du monde, ou même possible dans la périphérie capitaliste aujourd’hui. Si nous regardons l’histoire, cet État-providence a pris forme seulement sur une très petite partie de la planète – dans les centres capitalistes – et pour une période historique très courte – les Trente Glorieuses –, tout cela dans le contexte très particulier de la guerre froide. Faisant face à une alternative au capitalisme qui semblait viable, le socialisme réel, le capital s’est vu forcé de faire des concessions aux luttes ouvrières. De ce point de vue-là, l’État-providence réellement existant fut une façon de garantir la gouvernabilité et d’éviter qu’encore plus de pays ne passent au camp soviétique. Mais une fois celui-ci écroulé et la relation de forces transformée, l’État-providence n’eut guère de possibilités de subsister – pas même en Europe occidentale, où il a été érodé systématiquement durant les dernières décennies.
Quant à ses possibilités d’être répliqué dans un petit pays du Sud comme l’Équateur, par exemple, il est important de souligner que cet État-providence n’a donc été possible dans les centres capitalistes que grâce à certaines conditions préalables, comme l’appropriation extrêmement inégale des richesses matérielles de la planète par les pays centraux pendant des siècles dans le cadre de la matrice coloniale/impériale ; un approvisionnement apparemment infini en énergie très bon marché ; et, finalement, le cadre géopolitique spécifique de la guerre froide. Aucune de ces conditions ne peut être répétée pour l’ensemble des pays de la planète. Cependant, la promesse de développement, toujours très présente dans les imaginaires collectifs du Sud géopolitique, suggère précisément que les Trente Glorieuses contiennent la recette pour ce développement. Le poids du dispositif développementiste au sein des courants progressistes latino-américains se manifeste dans leur tendance aux mégaprojets centralisés, aux grandes constructions en béton, à l’industrialisation de l’agriculture, aux rêves d’introduire par exemple la sidérurgie, l’industrie lourde, voire le nucléaire, etc. – qui rappellent effectivement l’imaginaire des années soixante et soixante-dix en Europe, bien qu’aujourd’hui on connaisse parfaitement les effets négatifs, et parfois même catastrophiques, de ces politiques.
Comment l’Amérique latine pourrait-elle tenir compte de ces apprentissages et se libérer du dogme du développement de rattrapage ? Si la transformation ne repose pas centralement sur l’État, comment donc l’imaginer ? Nous pouvons puiser dans les nombreuses expériences communautaires et d’administration des communs (des biens communs) qui existent sur la planète, et aussi aux Amériques[23].
Dans le contexte progressiste, le retour de l’État s’est traduit par le fait de gouverner le plus possible, alors qu’en matière d’émancipation sociale, il faudrait probablement faire précisément le contraire : gouverner le moins possible et laisser les organisations sociales développer leurs responsabilités dans la gestion de leurs territoires respectifs. Non pas pour laisser toute liberté aux forces du marché capitaliste ou à l’impérialisme, bien entendu – mais pour créer les conditions idéales, face aux pressions extérieures de ces forces de marché mais aussi à l’intérieur des pays, pour que la société organisée puisse déterminer ses besoins de façon autonome, décentralisée et contextualisée ; afin que la transformation puisse se faire du bas vers le haut, dans la diversité nécessaire; pour que les municipalités et les organisations sociales puissent développer leurs moyens propres et capacités de construire des territoires prospères, partiellement autosuffisants et solidaires entre eux[24].
Il s’agit enfin que la créativité populaire et l’action des populations concernées donnent forme à de multiples formes de bien vivre, capables de s’enrichir mutuellement, et d’établir des relations écologiquement durables avec la Nature dans chaque territoire. C’est en renforçant ces pratiques de démocratie directe ainsi que toutes les expériences d’auto-détermination, en laissant place à l’action collective et aux modes de vie des habitants des quartiers périphériques des grandes villes, des communautés indigènes ou de descendance africaine, que les logiques verticales, coloniales et patriarcales pourront être marginalisées et faire place réellement à l’émancipation.
Notes
[1] Voir [www.rosalux.org.ec/grupo].
[2] Lander Edgardo, « Estamos viviendo una profunda crisis civilizatoria », Aportes. Revista de la facultad de economía, XIV, 41, 2009, p. 197-200.
[3] Lander Edgardo, « Crisis civilizatoria, límites del planeta, asaltos a la democracia y pueblos en resistencia » in Miriam Lang, Claudia López y Alejandro Santillana (Eds.), Alternativas al capitalismo/colonialismo del siglo XXI, Quito, Abya Yala – Fondation Rosa Luxemburg, 2013, p. 27-62 ; Fernández Nadal Estela et Silnik Gustavo David, « Entrevísta a Franz Joseph Hinkelammert », Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano, n° 43, CLAC 50, juin 2011.
[4] Acosta Alberto, « Derechos de la Naturaleza y Buen Vivir: Ecos de la Constitución de Montecristi », Pensamiento Jurídico, N° 25, p. 21-27, 2009 ; Schavelzon Salvador, Plurinacionalidad y vivir bien/buen vivir: dos conceptos leídos desde Bolivia y Ecuador post-constituyentes, Quito, Abya Yala, 2015.
[5] Prada Raúl, Descolonizar la transición, Quito, Abya Yala, 2014.
[6] De Sousa Santos Boaventura, Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur, Lima, Programa Democracia y Transformación Global, 2010.
[7] Cf. par exemple : Sader Emir, Posneoliberalismo en América Latina, Buenos Aires, CLACSO – CTA Ediciones, 2008; Brito Gisela, Lewit Agustín (eds.), Cambio de época. Voces de América Latina, Quito, CELAG – El perro y la rana, 2016.
[8] Lang Miriam, ¿Erradicar la pobreza o empobrecer las alternativas?, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Abya Yala, 2017.
[9] Meschkat Klaus, « Los gobiernos progresistas y las consecuencias políticas del neoextractivismo » in Lang Miriam, Cevallos Belén, LópezClaudia (Eds.), ¿Cómo transformar? Instituciones y cambio social en América Latina y Europa, Quito, Fundación Rosa Luxemburg – Abya Yala, 2015, p. 77-92.
[10] Gago Verónica, Sztulwark Diego, « The temporality of social struggle and the end of the progressive cycle in Latin America », South Atlantic Quarterly, n° 115, 2016, p. 606-614.
[11] Gudynas Eduardo, Extractivismos: Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza, Cochabamba, Centro de Documentación e Información Bolivia CIDOB; Centro Latinoamericano de Ecología Social CLAES, 2015.
[12] Voir par exemple [http://www.andes.info.ec/es/actualidad/9675.html].
[13] [https://www.servindi.org/printpdf/60496].
[14] Bayón Manuel, « La urbanización de la Amazonía como estrategia continua de la acumulación por despojo capitalista-extractiva », Derecho a la ciudad, 2016, [https://derechoalaciudadflacso.wordpress.com].
[15] Modonesi Massimo, Svampa Maristella, « Post-progresismo y horizontes emancipatorios en América Latina », ALAI, agosto 2016, [https://www.alainet.org/es/articulo/179428].
[16] Lang Miriam, Santillana Alejandra (Eds.), Democracia, participación y socialismo, Quito, Fundación Rosa Luxemburg, 2010.
[17] Lavinas Lena, « La asistencia social en el siglo XXI », New Left Review, n° 84, 2014, p. 7-48.
[18] . Torres Rosa María, « Educación: una ‘revolución’ sobrevalorada », mayo 2017, [http://gkillcity.com/articulos/10-anos-rafael-correa-el-balance/educacion-revolucion-sobrevalorada]
[19] Lang Miriam, ¿Erradicar la pobreza o empobrecer las alternativas?, op. cit.
[20] Commentaire dans le cadre de la défense de thèse de Sebastián Granda sur l’institutionnalisation de l’éducation interculturelle en Cotopaxi, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 1 juin 2017.
[21] Le système d’éducation interculturelle bilingue ou aussi le Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU – l’institution gouvernementale pour les femmes cogérée par les organisations féministes (avant sa dissolution par l’administration de Correa) ne sont que deux exemples pour l’Équateur.
[22] cf. [https://www.eluniverso.com/noticias/2013/10/18/nota/1598441/presidente-correa-pide-sanciones-ap-sus-asambleistas-que].
[23] Lang Miriam, Cevallos Belén, López Claudia (Eds.), ¿Cómo transformar?, op. cit.; Zibechi Raúl, Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias, Bogotá, Ediciones desde abajo, 2015.
[24] Gutiérrez Aguilar Raquel, Horizontes comunitario-populares. Producción de lo común más allá de las políticas estado-céntricas. Madrid, Traficantes de sueños, 2017.