
L’économie post-keynésienne en bonne voie…
L’ouvrage collectif qui vient de paraître, L’économie post-keynésienne, Histoire, théories et politiques[1] est un événement dans le paysage de la théorie économique contemporaine. Rassemblant trente-trois auteurs sous la direction d’Éric Berr, Virginie Monvoisin et Jean-François Ponsot, auxquels s’ajoutent le préfacier James K. Galbraith et le postfacier Alain Parguez, il propose aux lecteurs français une synthèse des apports les plus importants du courant de pensée s’inscrivant dans la continuité de John Maynard Keynes.
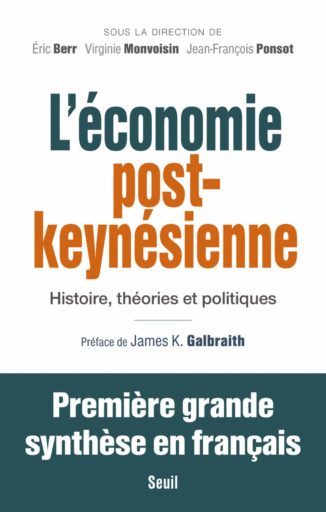
Les six premiers chapitres présentent les fondateurs de ce courant et leurs principaux enseignements. Viennent ensuite dix chapitres consacrés aux concepts et méthodes et sept chapitres aux propositions politiques. Il est impossible de résumer la totalité de cet ouvrage dont on devrait recommander la lecture à tout économiste, quel que soit son bord, et à tout étudiant. Il peut même être considéré comme un manuel de premier plan face à la suprématie des manuels orthodoxes en vigueur un peu partout à l’Université. Il y va du pluralisme indispensable à toute science sociale comme de la possibilité de penser des politiques alternatives au néolibéralisme. Vu l’ampleur de l’ouvrage, je me limiterai à aborder quelques aspects essentiels qui fondent le post-keynésianisme et à commenter quelques éléments qui font écho à la problématique dans laquelle je me situe.
1. Les fondateurs
Le premier mérite de cet ouvrage est de présenter les auteurs qui ont, dès l’entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale, dressé un cadre théorique opposé à la théorie néoclassique. Bien sûr, Keynes est le plus connu d’entre eux avec sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, mais il n’est pas inutile de rappeler les principaux points qu’il exposa dans les années 1930 de crise, tellement l’enseignement mainstream les a galvaudés, puis récusés. C’est Marc Bousseyrol qui ouvre la présentation : au fondement de la macroéconomie, il y a selon Keynes le fait que les agents économiques ne savent rien de l’avenir et que l’adoption de conventions permet de compenser quelque peu cette incertitude radicale. La rationalité n’est donc pas celle du marché mais celle qui conduit à adopter ce que l’on croit être la majorité des opinions. Keynes a compris l’importance des déterminants psychologiques découverts par Freud : « l’individu abandonne son idéal du moi et l’échange contre l’idéal de la foule » (p. 20). Aussi, concernant une économie monétaire de production telle que le capitalisme, deux points théoriques sont décisifs. D’une part, la préférence pour la liquidité est « un symbole de possession […] pour masquer l’angoisse de mort qui est en chacun de nous » (p. 21) ; le taux d’intérêt est alors le prix qui équilibre cette préférence et l’offre de monnaie disponible. D’autre part, le moteur de la dynamique économique est la décision d’investir prise par les entrepreneurs en fonction de leur anticipation de la demande, dite demande effective. De cette décision découlent le niveau de l’emploi, la production et les revenus, et, au final, l’épargne qui est une conséquence du processus productif et non pas une condition de l’investissement comme le croient les théoriciens classiques et néoclassiques. Il résulte de ces deux points de théorie deux propositions : la politique monétaire est active et la socialisation de l’investissement « comble le vide laissé par les investisseurs privés » (p. 31) et « permet de lutter contre le déficit budgétaire » (p. 32).
Keynes n’est pas seulement le théoricien de l’emploi à l’échelon national. Il fut et il reste l’auteur de la seule proposition concrète qui pourrait encore avoir une pertinence pour servir de base de discussion à une réforme de l’architecture financière internationale et établir une « monnaie internationale avec un pouvoir libératoire » (p. 408), comme le soutiennent Claude Gnos, Jean-François Ponsot et Sergio Rossi. Ce qui supposerait de remettre en cause la libre circulation des capitaux (p. 411), un problème politique avant tout. Comme quoi, le keynésianisme, dès Keynes, est un appel à faire de l’économie… politique. C’est dans cet esprit qu’il faut sans doute comprendre les continuateurs de Keynes.
1) Deux grands oubliés
Combien d’économistes aujourd’hui, passés par la moulinette néoclassique dominante, ont, au cours de leurs études, entendu parler longuement de Michal Kalecki et de Joan Robinson ? Très peu. Pourtant, ces deux auteurs peuvent être considérés parmi les meilleurs du XXe siècle. On doit à Kalecki, économiste polonais contemporain de Keynes, une « percée intellectuelle fulgurante » (p. 37), nous dit Michaël Assous. Kalecki relie la formation d’un équilibre macroéconomique à une analyse de la croissance et des cycles économiques, à partir des schémas de la reproduction élargie de Marx. Il en tire une conclusion sur les profits capitalistes qui se fixent, sur le plan macroéconomique, à hauteur des dépenses des capitalistes (citation de Kalecki p. 320). Kalecki est donc original car il établit un lien entre la croissance économique et la répartition des revenus, ce qui sera l’un des fils conducteurs les plus importants du post-keynésianisme. Il n’y a alors qu’un pas à franchir pour voir dans la marche du capitalisme l’effet des rapports sociaux et de la lutte des classes. S’étonnera-t-on que Kalecki ait pratiquement disparu de l’enseignement traditionnel de l’économie à l’université ?
Le même sort a été réservé peu ou prou à Joan Robinson, qui est, avec Rosa Luxemburg, l’une des deux femmes théoriciennes éminentes du capitalisme. Robinson se situe dans la même veine que Kalecki, tirant parti à la fois de Marx et de Keynes, pour démolir férocement la théorie néoclassique. Ses premiers travaux hétérodoxes s’intéressent à la concurrence imparfaite, menés en grande proximité avec ceux de Kalecki, Chamberlin et Sraffa. Et son œuvre majeure porte sur au moins trois points décisifs. D’abord, elle sort vainqueur de la célèbre controverse des « deux Cambridge » qui l’opposa notamment à Samuelson : il est impossible de mesurer le capital car, résume Louis-Philippe Rochon, « pour calculer la valeur du stock de capital, il est nécessaire d’en connaître le prix pour obtenir une valeur monétaire ; mais ce prix dépend de la détermination du taux de profit, qui est lui même calculé en fonction du stock de capital. L’argument est parfaitement circulaire, c’est un sophisme. » (p. 57). Sans parler de l’impossibilité d’agréger des éléments de capital hétérogènes. La fonction de production, que l’on ingurgite aux étudiants économistes, est donc un non-sens. Ensuite, Robinson forge les prémices de ce qui deviendra pour tous les post-keynésiens la théorie de la monnaie endogène. « La monnaie est créée à travers le besoin de financer la production et est fortement reliée à la création de dette » (p. 61), thème que reprendront notamment les circuitistes. Enfin, Robinson déborde Keynes parce qu’elle ouvre à une analyse de long terme, alors que la Théorie générale « est d’abord et avant tout consacrée à l’explication de l’emploi et de la production à court terme » (p. 58). Selon elle, la demande effective n’est pas seulement déterminante pour le court terme, mais aussi pour le long terme. Comme Kalecki, elle relie la croissance à la répartition des revenus car « le taux d’accumulation est inversement relié au salaire réel » (p. 59). C’est la raison pour laquelle les post-keynésiens aujourd’hui, comme Keynes en son temps, considèrent que trop d’inégalités est économiquement et socialement néfaste.
2) De la croissance vertueuse à l’instabilité chronique
Nicolas Kaldor est peut-être le plus connu des fondateurs du post-keynésianisme, parce qu’il a contribué à la discussion sur la théorie de la croissance économique au cours des années 1950, initiée par Harrod. Pour ce dernier, la croissance est nécessairement instable à long terme à cause d’un décalage entre « le taux de croissance garanti » par l’accumulation du capital et le « taux de croissance naturel » de la force de travail et de sa productivité. Alors que Solow pense que le capital peut se substituer au travail et ainsi remédier à cette asynchronie et garantir une croissance stable conforme à l’accroissement de la population, pour Kaldor l’asynchronie en question a un impact sur la répartition des revenus et par conséquent sur l’accumulation. Dans le chapitre qui lui est consacré, André Lorentz rapporte que, selon Kaldor, le taux d’investissement dépend, d’une part, de la répartition des revenus entre capitalistes et salariés qui « définit la propension à épargner au niveau macroéconomique » (p. 71) et, d’autre part, du taux de profit qui évolue en sens inverse de l’accumulation : si l’accumulation est trop rapide, « la chute du de profit réduit les rentes des capitalistes et limite l’investissement » (p. 71).
Mais la croissance ne se joue pas seulement à l’échelle de chaque entreprise parce que le progrès technique génère des rendements d’échelle croissants à l’échelle macroéconomique. Ainsi se trouve démentie l’hypothèse néoclassique de « rendements décroissants et de coûts unitaires croissants » (p. 224), que Keynes avait reprise à tort : celui-ci « avait admis que sa démonstration eût été plus simple si, comme Kalecki, il avait adopté l’hypothèse de coûts marginaux constants – du moins tant que le taux d’utilisation des capacités de production reste en deçà de la pleine capacité » (p. 224).
La « croissance cumulative est vertueuse » lorsque les composantes de la demande effective (consommation, investissement et exportations) inter-réagissent en stimulant la productivité et la production. Mais Kaldor doute de la capacité des politiques à atteindre les quatre objectifs de son « carré magique » : le plein emploi, l’équilibre de la balance des paiements, la croissance économique et la stabilité des prix. Aussi, il préconise d’enclencher l’enchaînement vertueux par le seul côté de la demande qu’il pense autonome : la relance par les exportations. On peut s’interroger sur la faisabilité de la chose si tous les partenaires potentiels sont eux aussi en crise. C’est ce que confirmeront plus loin « les modèles post-keynésiens stock-flux cohérents en économie ouverte et change fixe » (p. 273). « La politique keynésienne [qui] redécouvre le protectionnisme » (F. Poulon, p. 142) pourrait être alors prise en défaut.
Enfin, prolongeant les intuitions de Robinson, Kaldor théorise la monnaie endogène à l’encontre de la conception monétariste de Friedman, « véritable fléau » (p. 82). Selon Kaldor, « la relation causale entre le revenu monétaire et le stock de monnaie est inversée [par rapport à l’idée monétariste] : le stock de monnaie répond aux échanges au sein de l’économie et est donc défini par le niveau d’activité. L’inflation trouve ses sources dans la sphère réelle. » (p. 82).
Déjà bien connues aux États-Unis, c’est la crise financière de 2007 qui a permis aux idées d’Hyman Minsky de franchir véritablement l’Atlantique, notamment en France avec la traduction de Stabiliser une économie instable[2]. Alors que les néoclassiques continuaient de se ridiculiser avec l’efficience des marchés, l’allocation optimale des ressources et la stabilité financière, Minsky développait l’hypothèse d’une instabilité financière chronique du capitalisme qui tient au fait que la nécessité pour celui-ci d’investir tend inexorablement vers un endettement « à la Ponzi ». Les banques cherchent à faire du profit en accroissant leur levier financier. L’euphorie débouche alors sur la cassure et la récession, ce qui révèle la contradiction suivante : le crédit est nécessaire à l’accumulation, mais trop de crédit tue la dynamique économique. Les choses s’aggravent si les autorités monétaires durcissent leur politique en voulant stopper l’inflation stimulée par la fuite dans l’endettement. D’où la marche du capitalisme qui alterne périodes de boom et périodes de ralentissement ou même de crise. Minsky se distingue de certains autres post-keynésiens parce qu’il considère que le comportement des banques empêche que la banque centrale puisse fixer le taux d’intérêt au niveau que celle-ci souhaite. Dans son chapitre, Éric Nasica indique : « L’évolution de ce taux dépend en effet fortement de la succession de phases de stabilité et d’instabilité institutionnelle induite par les comportement innovateurs des banques commerciales. » (p. 99). Le taux d’intérêt ne serait alors « pas totalement exogène au sein d’une approche endogène de la monnaie » (p. 100). La nécessité de stabiliser l’économie « exige la présence d’un gouvernement influent (big government) menant une politique budgétaire très sensible aux variations des profits globaux » (p. 95). Et, si la crise est trop profonde, il faut « se tourner, de manière complémentaire, vers un second type de « mécanisme institutionnel stabilisateur » : le rôle de la banque centrale en tant que prêteur en dernier ressort » (p. 95). Tous les post-keynésiens considèrent que les fluctuations de l’économie sont endogènes, mais Minsky insiste sur l’importance de la structure financière des entreprises et sur le rôle des ratios d’endettement qu’elles choisissent.
2. Le post-keynésianisme ouvre des portes
Le lecteur pourra découvrir les différentes typologies du courant post-keynésien qui ont été établies et que rapportent, pour terminer la première partie de l’ouvrage, Marc Lavoie et Jean-François Ponsot (ch. 5). La pluralité des rapprochements et des différences entre les auteurs de ce courant atteste sa vitalité. Les nuances ne sont pas toujours minces ; cela montre que l’on peut ouvrir de nombreuses discussions autour et à partir du post-keynésianisme. J’aborderai ici seulement trois choses : le problème de l’emploi et du travail ; son articulation avec la monnaie ; et la question de la soutenabilité du développement.
1) Pour l’emploi, mais où est le travail ?
S’il est un thème omniprésent chez tous les post-keynésiens, c’est bien celui de l’emploi dont le niveau dépend des anticipations des entreprises. Depuis Keynes, cela n’a jamais varié et tous les auteurs présents dans cet ouvrage s’y réfèrent. Dans le circuit de F. Poulon (ch. 7), les modèles de croissance et de répartition d’A. K. Dutt et de D. Lang (ch. 11), dans les modèles de détermination de l’emploi décrits par M. Lavoie et D. Lang (ch. 12), dans les enjeux d’une politique budgétaire précisés par É. Berr, O. Costantini, M. Llorca, V. Monvoisin et M. Seccareccia (ch. 17), jusqu’à l’employeur en dernier ressort repris de Keynes, Lerner et Minsky par Q. Dammerer, A. Godin et D. Lang (ch. 18), le plein emploi est une préoccupation permanente. Posons à cette problématique trois questions.
Tout d’abord, si l’emploi est tenu pour dépendre de la demande globale, peut-on considérer que cette relation est invariante du court au long terme ? Marc Lavoie et Dany Lang écrivent :
« Le principal déterminant de l’emploi est la demande globale qui s’exerce sur le marché des biens et par suite sur le marché de l’emploi. Le taux d’emploi dépend alors fortement de la demande globale, autant à court terme qu’à long terme. » (p. 223).
Or cette relation n’est vraie que sous conditions : si la variation de la productivité du travail n’excède pas celle de la production ; si le temps de travail individuel ne varie pas (pourtant évoquée p. 231), sinon sa variation entraîne une différence entre l’évolution de la productivité individuelle du travail et celle de la productivité de l’unité de temps de travail (l’heure par exemple) ; et si, dans le cas d’une réduction du temps de travail, le taux du salaire horaire ne baisse pas, sans quoi l’effet d’une demande amoindrie annihilera la stimulation de la productivité. La variation de la demande globale ne peut donc pas être considérée comme le seul déterminant du niveau de l’emploi, et cela surtout quand on envisage le moyen et le long terme : d’une part, il existe une tendance longue à la réduction du temps de travail, bien qu’elle ne soit pas linéaire ; d’autre part, il n’y a aucune raison de supposer que la productivité et la production évoluent sur le long terme strictement dans les mêmes proportions.[3] Les auteurs citent Kalecki qui distinguait « le travail direct des cols bleus et le travail indirect des cols blancs », le premier dont « la quantité est directement proportionnelle à la production », tandis que le second « est proportionnel à la capacité productive » (p. 224-225). Mais n’est-ce pas contradictoire avec l’idée de Robinson rapportée par L.-P. Rochon : « Nous ne pouvons pas aller et venir entre les stocks de biens et les stocks de capital. Une fois qu’une entreprise a acheté un bien d’équipement, il lui est difficile de s’en détourner et d’abandonner cet investissement. Cela signifie donc qu’il est difficile d’échanger du travail contre du capital. Le concept même de substituabilité entre les facteurs de production est donc à rejeter. » (p. 56) ? Michaël Lainé reprend la même idée : « Joan Robinson le dit bien : la prise en compte de l’incertitude implique celle du temps historique, par opposition au temps logique des modèles mainstream. En effet, un investissement est irréversible : cette machine qui débite des boulons, ce logiciel qui gère mes bases de données existent bien. Maintenant que les ai payées, je suis obligé de faire avec, je ne peux revenir sur ma décision. » (p. 155). Si le raisonnement de Robinson est appliqué aux différentes sortes de travail considérées alors comme des facteurs de production distincts, on ne peut plus faire du travail une donnée homogène et dire que « le produit intérieur brut est une fonction directe et proportionnelle du travail » (p. 226).[4]
Si l’évolution de la productivité du travail est prise en compte (p. 230-231), pourquoi ne pas la mettre en relation avec l’évolution de la durée du travail ? D’autant plus que, sur le moyen et le long terme, la qualité du travail, celle des emplois et, au-delà, la qualité de la production importent beaucoup. En un mot, les finalités et le sens du travail peuvent-ils être pensés dans le cadre des modèles post-keynésiens actuels comme ceux des fondateurs ? Nous retrouverons ce problème en discutant de la prise en considération de la soutenabilité du développement. Pour l’instant, il est clair que, pour les post-keynésiens, notamment pour Minsky, « une économie de plein emploi est tenue de croître » (p. 341). Si la réduction du temps de travail est évoquée en faveur de « l’adoption de programmes de partage du temps de travail », c’est, selon Nicolas Zorn, après avoir rappelé que « afin de réduire les inégalités, il est donc indispensable que le plein emploi, qui suppose de maximiser la croissance économique soutenable à long terme, (re)devienne l’objectif principal des politiques économiques. (p. 364-365). M. Lavoie et D. Lang enfoncent le clou : « Même dans une économie où la population serait constante, un taux de chômage constant nécessite une hausse de la production si la productivité par travailleur est en hausse. » (p. 231). Et É. Berr, O. Costantini, M. Llorca, V. Monvoisin et M. Seccareccia définissent l’action contracyclique de l’État :
« L’objectif premier d’une telle politique est de promouvoir les dépenses en matière d’investissement public afin de provoquer un effet d’entraînement sur l’investissement privé, favorable à l’emploi et vecteur de réduction des déficits publics. » (p. 328).
Devant l’incapacité des théoriciens néoclassiques à expliquer correctement le chômage et l’incapacité (ou la non-volonté) des politiques néolibérales à l’endiguer, la proposition de l’État employeur en dernier ressort pour offrir une « garantie d’emploi universelle » (p. 343) connaît aujourd’hui un regain d’intérêt. Mais n’est-elle pas conçue comme un dernier recours parce que le secteur capitaliste ne parvient pas assurer le plein emploi, comme une sorte de pis-aller ? É. Berr, O. Costantini, M. Llorca, V. Monvoisin et M. Seccareccia indiquent que Keynes recommande « la socialisation de l’investissement, à savoir un contrôle social de l’investissement par l’État, autrement dit une augmentation de l’investissement public afin de combler les lacunes de l’investissement privé pour atteindre un niveau cohérent avec le plein emploi » (p. 317). Quirin Dammerer, Antoine Godin et Dany Lang expliquent que
« l’État peut accroître l’investissement en procédant à ses propres investissements. Keynes fait deux précisions importantes : le but est avant tout d’obtenir un investissement élevé ; il n’est pas nécessaire que l’État soit propriétaire des ces nouveaux investissements, l’essentiel étant d’induire un taux d’investissement important et non pas d’en influencer la nature » (p. 337).
Certes, ces auteurs soulignent l’existence de besoins à satisfaire qui justifierait la création de ces emplois de dernier ressort (p. 353), mais ils citent Randall Wray pour qui « les dépenses liées à ce programme chuteront mécaniquement (même si les recettes fiscales s’accroissent) » (p. 344) alors que « le marché privé n’est pas le seul mécanisme de validation des résultats » (p. 346). Cette hésitation n’est-elle pas révélatrice de la croyance selon laquelle tout emploi dans le secteur non marchand est par nature improductif, croyance aussi bien répandue dans l’imaginaire libéral que dans la tradition véhiculée par le marxisme orthodoxe ? Or, on peut soutenir que le travail employé dans cette sphère produit de la valeur économique pour la société et non pour le capital, validée socialement par décision politique collective et non par le marché.[5]
2) Emploi, travail, production et monnaie
Dans une tribune publiée au moment de la parution de l’ouvrage présenté ici, Antoine Godin et Dany Lang précisent qu’il s’agit de « développer « une politique d’emploi public permanent » et que l’expression « employeur en dernier ressort » fait écho à l’idée de banque centrale comme « prêteur en dernier ressort »[6]. On retrouve donc, au cœur de la théorie post-keynésienne, la monnaie indispensable à l’économie monétaire de production. On l’a dit, la monnaie endogène est l’un des fils conducteurs du post-keynésianisme. Cependant, on peut déceler maintes nuances entre les auteurs de cet ouvrage.
Au point de départ, il y a l’idée, dont l’origine remonte sans doute à Tooke, Marx et Wicksell[7], maintes fois rappelée à juste titre que « la monnaie bancaire et la monnaie centrale sont endogènes aux besoins de l’économie de production et aux opérations quotidiennes des banques. À partir de cette analyse, il devient possible d’affirmer que les banques ne sont pas de simples intermédiaires financiers, mais qu’elles sont les créatrices de la monnaie et qu’elles n’ont pas besoin de dépôts ou de réserves préalables pour le faire. » (p. 173). Le principe de la monnaie endogène étant posé, cela signifie-t-il que tous les régimes monétaires qu’a connus le capitalisme relevaient de ce principe ? L’un des arguments principaux de Keynes pour mettre fin à l’étalon-or était que celui-ci était inadapté à l’évolution de l’économie dans l’entre-deux-guerres : « l’étalon-or fait obstacle à la politique discrétionnaire nécessaire pour stabiliser les économies »[8].
Au-delà de la position de principe, des nuances apparaissent entre certains auteurs du livre : pour V. Monvoisin et L.-P. Rochon, reprenant une thèse d’Augusto Graziani[9], le « financement initial » de la production concerne les salaires, les investissements étant financés par la vente des actifs financiers aux ménages et la récolte de l’épargne […] ne nécessitant pas de création monétaire stricto sensu » (p. 170) ; pour les circuitistes, en revanche, le financement de la production par création monétaire porte sur les investissements et les salaires. En effet, comment les entreprises pourraient-elles lancer la production si elles disposaient de main-d’œuvre sans les moyens matériels de production ? Sans doute, l’ouvrage aurait pu fournir davantage de précisions sur la controverse qui oppose les post-keynésiens entre « horizontalistes » et « structuralistes », ou plus simplement revenir à la définition de la « finance » que donnait Keynes qui « n’avait rien à voir avec l’épargne »[10]. D’autre part, au niveau de l’ensemble de l’économie, que signifierait cette idée d’un « financement final » des investissements supposant l’épargne déjà constituée ?[11] Ce ne serait-il pas en porte-à-faux avec le rappel d’Edwin Le Héron : « La monnaie est avant tout une anticipation de richesse » (p. 375).
Cette contradiction ne peut être résolue qu’en opérant une coupure radicale entre les raisonnements micro et macroéconomiques. À cette seule condition on peut se ranger derrière Laurent Cordonnier, Thomas Dallery, Vincent Duwicquet, Jordan Melmiès et Frank Van de Velde : « Cette réticence [celle des épargnants] oblige les entreprises à verser des intérêts très élevés pour convaincre les épargnants d’abandonner la liquidité et de placer leurs fonds sous forme de prêts à plus long terme, ce qui condamne de très nombreux projets d’investissement dont la rentabilité attendue est inférieure au taux d’intérêt. » (p. 244). Au niveau macroéconomique, l’investissement net requiert une création monétaire. C’est ce que confirment É. Berr, O. Costantini, M. Llorca, V. Monvoisin et M. Seccareccia :
« Pour les post-keynésiens, même s’il est possible pour un agent individuel – entreprise ou ménage –, donc au niveau microéconomique, de financer ses dépenses par le biais de son épargne, au niveau macroéconomique, l’épargne ne peut jamais être source de financement des dépenses. Au contraire, dans une économie monétaire, l’épargne est toujours le résultat d’un endettement, qu’il provienne du secteur privé ou du secteur public. D’ailleurs, selon la comptabilité nationale, l’épargne du secteur privé n’est rien d’autre que la contrepartie de l’endettement net du secteur public – le déficit budgétaire – et de l’endettement net des étrangers – représenté par un surplus du compte courant vis-à-vis du reste du monde. » (p. 319-320).[12]
Cependant, il reste un sujet de controverse : la création monétaire est-elle nécessaire seulement dans une économie en croissance ou également dans une économie qui serait stationnaire ? Marx et Luxemburg demandaient déjà d’où venait la monnaie pour réaliser monétairement la plus-value.[13] Cette question renvoie à la distinction entre surplus social approprié par la classe dominante (indépendamment d’une croissance de l’économie) et surplus de croissance : cela signifie qu’un taux de surplus social (taux de profit) peut être positif avec un taux de croissance économique nul, ou bien un taux de surplus social peut être supérieur au taux de croissance économique.
L’équation des profits de Kalecki est exacte comptablement mais elle laisse en suspens la question précédente : profits des entreprises (leur épargne) + épargne des ménages = investissement privé + déficit public + solde des exportations nettes (p. 320). Cette équation est équivalente à celle que le circuit de F. Poulon met en évidence, à savoir : profits des entreprises (leur accumulation nette, c’est-à-dire investissement net – financement bancaire) = investissement net des entreprises + déficit public + solde des exportations nettes – épargne des ménages.
Néanmoins, ces équations comptables permettent aux différents auteurs de l’ouvrage de revenir régulièrement sur le fait que « le déficit budgétaire, parce qu’il stimule la demande et notamment celle d’importation, va de pair le plus souvent avec le déficit commercial » (p. 141, voir aussi p. 229, 273, 315).
L’analyse post-keynésienne est fondamentalement macroéconomique. Mais la contribution de Pascal Seppecher sur les modèles à base d’agents multiples est utile pour montrer que « la combinaison de la cohérence des stocks et des flux et de la multiplicité des agents est une opération essentielle au renouveau de la modélisation macroéconomique » (p. 279).
La problématique macroéconomique n’exclut pas d’examiner le comportement des firmes. Ainsi, Thomas Dallery et Jordan Melmiès font état des recherches qui mettent en relation celui-ci avec le cadre institutionnel :
« Dans cette vision, les entreprises fixent une marge qui répond à un double objectif de la firme : s’assurer une croissance des ventes tout en disposant des fonds nécessaires, en interne, qui permettent d’autofinancer une partie des dépenses d’investissement nécessaires à cette croissance. » (p. 298-299).
Bien sûr, le lecteur pourrait se demander comment s’effectue le va-et-vient entre le micro et le macro après avoir intégré l’idée que l’investissement net exige au plan global une monnaie nouvelle. De la même façon, il pourrait s’interroger au sujet d’un possible retour de l’idée d’effet d’éviction[14] quand Q. Dammerer, A. Godin et D. Lang rapportent la thèse d’Abba Lerner : « en empruntant, le gouvernement retire les fonds excédentaires qui nuisent à l’économie » (p. 339). Au passage, s’il existe des fonds nuisibles, on ne voit pas pourquoi il n’y aurait pas aussi des fonds utiles à l’économie.
Ces discussions ne sont pas seulement théoriques, elles sont aussi politiques : par exemple, dans le cadre d’une transition écologique, les banques seraient tenues de ne répondre à la demande de crédit que sous la condition de respecter des normes écologiques et sociales, la banque centrale n’accepterait le refinancement des banques qu’en contrepartie de titres certifiés comme répondant à ces normes, elle garantirait les emprunts publics allant dans cette direction et, si nécessaire, elle pourrait financer directement l’État dans ce but[15]. Et, justement, E. Le Héron écrit, lui aussi :
« Ainsi, la banque centrale doit jouer son rôle de prêteur en dernier ressort et pouvoir financer directement l’État afin de stabiliser les taux d’intérêt en fournissant la liquidité nécessaire. […] Les post-keynésiens développent une théorie qualitative de la monnaie, c’est-à-dire que la qualité des contreparties de la monnaie est l’élément déterminant de la bonne santé et d’un développement harmonieux des économies. […] La politique monétaire post-keynésienne doit donc orienter la monnaie vers l’investissement productif, l’innovation et la recherche, la recherche de compétitivité et la soutenabilité de la croissance. Cela peut passer par la sélectivité du crédit, grâce à des taux d’intérêt privilégiés que propose la banque centrale – c’est-à-dire plus bas que la moyenne des taux pratiqués. » (p. 376-381).[16]
3) La soutenabilité, parente pauvre
Placés surtout sous le signe du court terme, il est compréhensible que les modèles post-keynésiens de base soient des modèles qui portent sur des flux, les flux de la période pour laquelle les anticipations des « esprits animaux » ont été formulées. Il faut donc saluer cet ouvrage pour avoir présenté aux lecteurs un aperçu des modèles plus récents dits « post-keynésiens stock-flux cohérents ». Ceux-ci, notamment sous l’impulsion de Wynne Godley et Marc Lavoie, représentent une tentative d’introduction en leur sein d’une véritable dynamique : d’une part, ils s’attachent à intégrer ensemble flux et stocks, réels et financiers ; d’autre part, ils décrivent les enchaînements entre les différentes temporalités. Méthodologiquement, ils prennent en considération, selon E. Le Héron, « l’importance des institutions, des conventions souvent imprégnées de l’idéologie dominante, des processus mimétiques, ou de « l’état de confiance » des agents, [qui] justifient que beaucoup de comportements économiques trouvent leur fondement dans des phénomènes macroéconomiques et sociaux » (p. 260). Mais, comme le fait remarquer l’auteur lui-même, « ces modèles sont dynamiques et déterminent un état stable, où toutes les variables croissent à un taux constant. Il s’agit d’ailleurs là d’une des limites principales des modèles SFC : dans l’état actuel de la modélisation, il n’y a pas de crise endogène » (p. 262).
Or, la crise que connaît l’économie mondiale est certainement endogène à la logique même du capitalisme et à sa course perpétuelle au productivisme. Et il est tout à fait opportun que l’ouvrage se termine par deux chapitres, l’un sur le « nouveau développementisme », l’autre sur la soutenabilité du développement. Le premier, rédigé par Éric Berr et Luis-Carlos Bresser-Pereira, dessine les traits d’un courant s’écartant de l’orthodoxie néolibérale, et s’inscrivant dans une continuité nuancée des analyses structuralistes et dépendantistes. En particulier, une critique des politiques budgétaires trop laxistes est effectuée ainsi que du recours excessif à l’endettement extérieur : « Dès lors, la macroéconomie promue par le nouveau développementisme doit assurer un taux de profit satisfaisant pour les entreprises et compatible avec un niveau de salaires acceptable pour la populations – ce qui n’est possible qu’avec un taux de change compétitif, c’est-à-dire non surévalué à long terme. » (p. 421). Les auteurs de ce chapitre le reconnaissent implicitement : ce courant se situe un peu entre l’orthodoxie et l’hétérodoxie, car il faut « adapter l’approche développementiste au contexte de mondialisation » (p. 426). Mais, précisément, quelle est la nature de cette mondialisation ? Ce courant a-t-il forgé des concepts théoriques nouveaux ? Il s’oppose au libre-échange intégral, mais pourquoi le concept d’échange inégal – critique le plus radical de la loi des coûts comparatifs de Ricardo – est-il absent, de même que son auteur, Arghiri Emmanuel[17], seulement signalé en bibliographie ? De même est absent Samir Amin, à qui l’on doit d’avoir lui aussi tenté d’intégrer la question du développement dans le cadre de l’accumulation à l’échelle mondiale, donnant ainsi une perspective plus large que celle des structuralistes des années 1950-1960.[18]
L’approche en terme de soutenabilité du développement termine cet ouvrage. Éric Berr admet d’emblée que cette problématique fut longtemps ignorée par les post-keynésiens et que sa prise en compte date tout au plus des années 2000, en dépit, selon l’auteur, des « intuitions » de Keynes et de la notion d’« écodéveloppement » d’Ignacy Sachs. Pourquoi ? On serait tenté de répondre : fondamentalement, le keynésianisme et le post-keynésianisme sont avant tout des théories du court terme. Dès lors, même si la prise en compte du « temps historique » est proclamée, celui-ci est toujours celui des anticipations des entrepreneurs qui, aussi loin que peut porter leur regard, n’a rien à voir avec le temps biologique et physique des écosystèmes terrestres. Aussi, aucun des auteurs post-keynésiens postérieurs à 2005 cités par Berr qui « estiment que les bases existent et que l’objectif des post-keynésiens est de s’attacher à l’élaboration écologiquement soutenable et socialement équitable » (p. 431) n’a produit de concept se rapportant à la soutenabilité. Tous les fondements critiques à la fois du productivisme inhérent à l’accumulation du capital et de ladite économie de l’environnement néoclassique ont été bâtis ailleurs. La critique de la soutenabilité faible au nom de la complémentarité des facteurs de production et de la notion de facteur limitant, ou l’articulation de la soutenabilité écologique et de la soutenabilité sociale, notamment par l’utilisation des gains de productivité pour réduire le temps de travail et repenser le sens et les finalités du travail, plutôt que pour produire toujours plus, ou bien encore l’impossibilité d’une croissance infinie tout en adoptant une position critique sur la décroissance, ont été conceptualisées soit par le courant de l’économie écologique, elle-même très composite[19], soit par les néo-marxistes écologistes[20], sans oublier les nombreuses contributions émanant de la société civile à travers les conflits sociaux d’ordre environnemental[21]. Or, on a un peu l’impression que le dernier chapitre de cet ouvrage saute par dessus ces contributions théoriques et pratiques, comme si certains post-keynésiens redécouvraient le monde. Par exemple, que pensent les post-keynésiens sensibles à la préoccupation écologiste de l’introduction de la question de l’entropie en économie, telle que l’a formulée Georgescu-Roegen[22] ? Le seul point de ce domaine à mettre au crédit des post-keynésiens – et redisons qu’il n’est pas négligeable – est d’avoir mis en évidence la nécessité de réduire les inégalités, ce qui constitue un aspect important de la soutenabilité sociale, mais c’est toujours parce que les inégalités sont un frein à la croissance ; or celle-ci peut entrer en conflit avec la soutenabilité écologique.
L’absence de concepts post-keynésiens en matière de soutenabilité se ressent dans les essais de formalisation proposés. Le modèle tiré de Kalecki et de Sachs présenté par Berr relie le taux de croissance économique à la somme du taux de croissance de la productivité du travail et de celui de l’emploi. Le taux de croissance de la productivité du travail est ensuite décomposé en la somme du « taux de croissance de la productivité de l’énergie et du taux de croissance de l’intensité énergétique » (p. 437). Or, cette décomposition est purement arbitraire et ne détermine aucune causalité. N’importe quel facteur supposé explicatif de la productivité du travail pourrait être introduit : eau, matière première, terre, connaissances et savoir-faire, état de santé de la population… De plus, cette décomposition reprend à son compte la notion de « productivité de l’énergie », typique des thèses néoclassiques en vigueur dans tous les rapports des instances internationales, avec des chiffrages fondés sur des fonctions de production Cobb-Douglas.[23]
3. Esquisse de passerelles
Le premier intérêt de cet ouvrage est de jalonner les chemins qui ont conduit de Keynes et des économistes qui l’entouraient à leurs héritiers actuels qui ne se sont pas contentés de répéter l’enseignement des maîtres, mais qui ont véritablement apporté des améliorations sur des problèmes parfois restés dans l’ombre. Il est possible d’aller plus loin encore, c’est-à-dire de ne pas rester strictement à l’intérieur de la famille (post-)keynésienne. Prenons trois exemples.
À la suite de la crise de 2007, dans le déclenchement de laquelle la responsabilité du système bancaire est écrasante, certains écologistes ont cru voir la racine de cette crise dans le principe de la création monétaire, dite ex nihilo, et donc dans le principe du crédit. Ils en ont alors conclu que la critique de la croissance économique et du productivisme impliquait de remettre en cause la création monétaire, au motif que le crédit entraînait le versement d’un intérêt, et de ce fait obligeait à faire croître perpétuellement l’économie. Or, ce raisonnement est erroné : ce n’est pas le crédit qui exige une croissance économique, c’est la croissance qui exige le crédit. Ce point est un acquis aussi bien de certains travaux régulationnistes de la monnaie que marxistes[24] et on le retrouve dans une publication récente post-keynésienne de Louison Cahen-Fourot et Marc Lavoie qui réfutent qu’« il n’y aurait jamais assez d’argent dans le circuit pour répondre aux exigences de remboursement de la dette et du paiement des intérêts, par conséquent, de nouveaux fonds doivent être créés en permanence et cela ne serait durable que dans une économie en croissance. […] Il semble donc que certains économistes écologiques, pour régler les problèmes monétaires, confondent en quelque sorte les stocks et les flux, ce qui les conduit à supposer la nécessité de conditions non nécessaires pour une économie d’atteindre un état stationnaire. Ce qui doit rester constant est le stock, à savoir la dette, mais le flux, à savoir le paiement d’intérêts, ne doit pas nécessairement être réduit à zéro. »[25] La conception de la monnaie endogène pourrait donc être une première passerelle entre certaines recherches écologistes hétérodoxes, plus proches de la critique de l’économie politique que de la branche dominante de ladite économie écologique[26], et le post-keynésianisme, afin d’aborder de nouvelle manière la soutenabilité du développement en tenant compte que « le temps historique [est] irréversible » (p. 116). En prenant sérieusement en compte la soutenabilité, on devrait pouvoir éviter le raccourci présent dans l’introduction générale de l’ouvrage qui impute la responsabilité « du réchauffement climatique, des pollutions et des dégradations environnementales » au néolibéralisme (p. 13). Évidemment, c’est faux, le changement climatique est dû aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre engendrées depuis l’aube du capitalisme industriel. La critique du productivisme doit donc être rapprochée de celle du capitalisme.
Cela permet d’aborder un deuxième exemple d’une possible passerelle. Puisque la monnaie est au centre de l’analyse post-keynésienne de l’économie monétaire de production qu’est le capitalisme, comment se fait-il que ne soit pas perçue une possible proximité avec Karl Polanyi qui montre en 1944 dans La Grande transformation le danger pour la société que constituerait la transformation en marchandises du travail, de la terre et de la monnaie ? Polanyi était contemporain de Keynes, Kalecki, Robinson, Kaldor, il a analysé la même situation de l’entre-deux-guerres que les fondateurs du keynésianisme. Or, son œuvre n’est pas citée une seule fois dans l’ouvrage présenté ici. Pourtant, Polanyi pourrait être un appui important pour historiciser le post-keynésianisme : « On s’était battu pour le libre-échange en 1846 à propos des Corn Laws, et il avait gagné ; on se battit à nouveau quatre-vingts ans plus tard, et cette fois il perdit. Le problème de l’autarcie hantait l’économie de marché depuis le début. En conséquence, les tenants de l’économie libérale exorcisaient le spectre de la guerre et appuyaient naïvement leur thèse sur l’hypothèse d’une économie de marché indestructible. On ne prit pas garde que leurs démonstrations prouvaient purement et simplement la grandeur du péril encouru par un peuple qui confiait sa sécurité à une institution aussi fragile que le marché autorégulateur. » [27] La critique du marché autorégulateur n’est-elle pas un thème (post-)keynésien ? Il est vrai qu’il faudrait examiner si la critique polanyienne de l’autarcie est compatible avec la prétendue préférence keynésienne pour le protectionnisme.
Aussi curieux que cela puisse paraître, l’objet d’étude du post-keynésianisme est le capitalisme mais le grand absent de l’ouvrage est également Marx. Certes, son nom est prononcé à trois ou quatre reprises en 450 pages, notamment dans les chapitres sur Kalecki, Robinson, le circuit et la répartition. Mais c’est toujours en passant. Le lecteur ne saura pas vraiment ce que Kalecki ou Robinson doivent à Marx. Quelle est la filiation entre la condition d’équilibre de la reproduction élargie de Marx[28] et « l’interdépendance entre les secteurs » de Kalecki qu’expose M. Assous (p. 39) ou bien encore avec l’équation des profits du même Kalecki ? L’idée que l’emploi « dépend de la différence entre la productivité par travailleur et le salaire réel » (p. 230) n’est-elle pas la passerelle par excellence entre Marx et le post-keynésianisme ? Comme le suggère M. Lavoie (p. 119), le rapprochement avec l’École de la régulation devrait faciliter les choses.
Dans le chapitre sur l’inflation, Sébastien Charles et Jonathan Marie définissent l’inflation, comme un rapport social : « Pour être plus précis, l’inflation est principalement provoquée par le conflit de répartition qui oppose les détenteurs du capital aux travailleurs. Les rapports sociaux sont au cœur de l’analyse, suivant une voie ouverte par l’économiste français Henri Aujac (1950). » (p. 185). On veut bien apprendre cette référence, mais l’opposition capital/travail et le concept de rapports sociaux sont nés ailleurs et bien avant. De même, le concept de force de travail utilisé à bon escient par les auteurs (p. 187) est emprunté à Marx et à lui seul. On pourrait dire la même chose de celui de « fétichisme de la liquidité » (p. 23) qui résonne avec celui de fétichisme de l’argent, car le but du capitalisme est de faire de l’argent, le capital « est une valeur en procès ». À plusieurs reprises différents auteurs de l’ouvrage définissent le taux d’intérêt comme une variable de répartition (p. 171, 177, 186, 201) : répartition de quoi, sinon d’une part de la plus-value ? Par construction, les rapports sociaux capitalistes doivent engendrer de la valeur. La valeur reste en filigrane dans l’ouvrage… Ce serait une nouvelle discussion à ouvrir… Du conflit de répartition de la valeur produite, on serait amené à voir le conflit sur le mode de production et, au final, on retrouverait la soutenabilité que viennent de découvrir les post-keynésiens… Le post-keynésianisme est en bonne voie…
***
En terminant la lecture de cet ouvrage passionnant, il faut remercier les auteurs de nous fournir un très grand nombre de clés pour nous débarrasser de la théorie néoclassique, aussi peu crédible conceptuellement que dans ses préconisations politiques. Bien sûr, il y a dans cet ouvrage plusieurs portes entrebâillées qui méritent d’être encore davantage ouvertes. Mais les lecteurs, étudiants ainsi que professeurs, trouveront matière à réflexion approfondie. Non seulement ce livre propose une construction théorique dont la cohérence est grande et toujours en construction, mais il arme pour mener une confrontation méthodologique et épistémologique avec la prétendue « science économique » qui n’a jamais su se penser comme une science sociale.
Références
– Aglietta M., Espagne É., Perissin-Fabert B. (2015), « Une proposition pour financer l’investissement bas carbone en Europe », France stratégie, note d’analyse no 24, 16 février, http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/bat_notes_danalyse_n24_francais_12_mars_17h_45.pdf.
– Aglietta M. (2016), en collaboration avec Ould Ahmed P. et Ponsot J.-F., La Monnaie entre dettes et souveraineté, Paris, Odile Jacob.
– Amin S. (1973), Le développement inégal, Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique, Paris, Éd. de Minuit.
– Beitone A. et Hemdane E. (2018), Relations monétaires internationales, Paris, Armand Colin.
– Beitone A. et Rodrigues C. (2017), Économie monétaire, Théories et politiques, Paris, Armand Colin.
– Berr É., Monvoisin V., Ponsot J.-F. (sous la dir. de, 2018), L’économie post-keynésienne, Histoire, théories et politiques, Préface de J.K. Galbraith, Postface d’A. Parguez, Paris, Seuil.
– Burkett P. (2006), Marxism and Ecological Economics : Toward a Red and Green Economy, 1999, Chicago, Haymarket.
– Cahen-Fourot L. et Lavoie M. (2016), « Ecological monetary economics : A post-keynesian critique », Ecological Economics, n° 126, p. 163-168.
– Contretemps (2017), « Extension du domaine de la valeur », 5 juin, https://www.contretemps.eu/dossier-valeur-capitalisme.
– De Brunhoff Suzanne (1967), La Monnaie chez Marx, Paris, Éditions sociales, 3e édition.
– Douai A. et Plumecocq G. (2017), L’économie écologique, Paris, La Découverte, Repères.
– Durand C. (2014), Le capital fictif, Comment la finance s’approprie notre avenir, Paris, Les Prairies ordinaires.
– Emmanuel A. (1969), L’échange inégal, Essai sur les antagonismes dans les rapports économiques internationaux, Paris, François Maspero.
– Foster J.B. (2000), Marx’s Ecology, Materialism and nature, New York, Monthly Review Press.
– Foster J.B (2011). Marx écologiste, Paris, Amsterdam.
– Georgescu-Roegen N. (1995), La décroissance, Entropie-écologie-économie, Paris, Éd. Sang de la terre, 2e éd.
– Godin A. et Lang D. (2018), « Pour une politique d’emploi public permanent », 23 septembre, https://blogs.mediapart.fr/les-economistes-atterres/blog/230918/pour-une-politique-d-emploi-permanent.
– Goux J.-F. (1989), « Keynes et la finance d’entreprise », Revue française d’économie, n° 4-3, p. 169-203, http://www.persee.fr/doc/rfeco_0769-0479_1989_num_4_3_1229.
– Graziani A. (1988), « Le financement de l’économie dans la pensée de J.M. Keynes », Cahiers d’économie politique, n° 14-15, 1988, p. 151-166, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/monnaie/equilibre-comptable.pdf.
– Harribey J.-M. (1997), L’économie économe, Le développement soutenable par la réduction du temps de travail, Paris, L’Harmattan.
– Harribey J.-M. (2012). « Contre le retour de l’épargne préalable, une conception sociale de la monnaie », Séminaire des Économistes atterrés sur la monnaie , Paris, 24 mars, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/monnaie/monnaie-epargne.pdf.
– Harribey J.-M. (2013), La richesse, la valeur et l’inestimable, Fondements d’une critique socio-écologique de l’économie capitaliste, Paris, Les Liens qui libèrent.
– Harribey J.-M. (2014), « Derrière l’imposture de la science économique, il y a l’impasse du capitalisme », Revue du MAUSS permanente, 2015/1, n° 45, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/valeur/imposture-sceco.pdf.
– Harribey J.-M. (2015-a), « L’hétérodoxie économique dans tous ses états (2), Le découplage absolu entre production et consommation de ressources est impossible », Blog Alternatives économiques, 4 mars, https://blogs.alternatives-economiques.fr/harribey/2015/03/04/l-heterodoxie-economique-dans-tous-ses-etats-2-le-decouplage-absolu-entre-production-et-consommation-de-ressources-est-impossible.
– Harribey J.-M. (2015-b), « L’équilibre comptable macroéconomique d’une économie monétaire, Petite note technique », 23 mars, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/monnaie/equilibre-comptable.pdf.
– Harribey J.-M. (2016), « Minsky au milieu du gué ? », Les Possibles, n° 10, Été, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/monnaie/minsky-stabilite.pdf.
– Harribey J.-M. (2018-a), « La réalisation monétaire de la production capitaliste et donc du profit : Non, rien de rien… », Blog d’Alternatives économiques et Les Possibles, n° 17, Été, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/valeur/realisation-monetaire.pdf.
– Harribey J.-M. (2018-b), « Comment financer la transition écologique ?, Contribution pour des temps qui s’annoncent chauds », Note pour les Économistes atterrés, octobre, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/soutenabilite/arlesienne-financement.pdf.
– Keen S. (2014), L’imposture économique, Paris, Éd. de l’Atelier.
– Keynes J.M. (1969), Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, 1936, Paris, Payot.
– Keynes J.M. (1937), « Alternative Theories of the Rate of the Interest », Economic Journal, Vol. 47, n° 186, juin, p. 241-252.
– Lavoie M. (2004), L’économie post-keynésienne, Paris, La Découverte, Repères.
– Les Économistes atterrés (2018), La monnaie, un enjeu politique, Paris, Seuil.
– Luxemburg R. (1972). L’accumulation du capital, 1913, Paris, Petite collection Maspero.
– Malherbe L. (2017), « Monnaie endogène : une synthèse hétérodoxe », Gretha-Université de Bordeaux, n° 08, mars, http://cahiersdugretha.u-bordeaux4.fr/2017/2017-08.pdf.
– Marchand O. et Thélot C. (1991), Deux siècles de travail en France, Population active, structure sociale, durée et productivité du travail, INSEE Études, Paris.
– Martinez Alier J. (2014), L’écologisme des pauvres, Une étude des conflits environnementaux dans le monde, Paris, Les Petits matins, Institut Veblen.
– Marx K. (1968), Le Capital, Livre II, 1885, dans Œuvres, tome II, Paris, Gallimard, La Pléiade.
– Minsky H.P. (2016), Stabiliser une économie instable, Paris, Institut Veblen, Les Petits matins.
– Monvoisin V. (2001), « Essai d’unification des définitions post-keynésiennes de la monnaie endogène : des divergences à la complémentarité », Colloque du CRIEF « Du franc à l’euro, Changements et continuité de la monnaie », Poitiers, 14-16 novembre, http://sceco.univ-poitiers.fr/franc-euro/articles/VMonvoisin.pdf.
– O’Connor J. (1992), « La seconde contradiction du capitalisme : causes et conséquences », Actuel Marx, n° 12, deuxième semestre 1992, p. 30-40.
– Polanyi K. (1983), La Grande transformation, Aux origines politiques et économiques de notre temps, 1944, Paris, Gallimard.
Notes
[1] É. Berr, V. Monvoisin, J.-F. Ponsot (sous la dir. de, 2018).
[2] Minsky H.P. (2016). Voir aussi Keen S. (2004), et Harribey J.-M. (2014 et 2016).
[3] On peut calculer que, en France, sur les XIXe et XXe siècles, la productivité horaire du travail a été multipliée environ par le facteur 30, la production par 26 et le temps de travail individuel a été divisé par 2. Aussi, le nombre d’emplois a été multiplié par 1,73. Pour les données en longue série, voir Marchand O. et Thélot C., (1991).
[4] Par ailleurs, l’utilisation par Kalecki de la distinction entre travail direct et travail indirect est propre à entretenir une confusion, alors que, sur ce point, l’économie politique classique était parfaitement claire.
[5] La question du travail productif dans la sphère monétaire non marchande fait l’objet d’un débat serré parmi les auteurs se réclamant de Marx. Voir Harribey J.-M. (2013), ainsi que la discussion sur http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/valeur/index-valeur.html et le dossier de Contretemps (2017).
[6] Godin A. et Lang D. (2018).
[7] Voir Beitone A. et Rodrigues C. (2017, chapitre 6).
[8] Beitone A. et Hemdane E. (2018, p. 77).
[9] Graziani A. (1988).
[10] Keynes J.M. (1937). Sur ces discussions, voir notamment Goux J.-F. (1989), Monvoisin V. (2001), Malherbe L. (2017).
[11] Sur la critique de cette distinction financement initial/final, voir Harribey J.-M. (2012).
[12] Ce point théorique fondamental est parfois encore le sujet de controverses entre les post-keynésiens et certains keynésiens formés à l’école des années de la « synthèse »… D’où l’ambiguïté signalée plus haut de la notion de « financement final ». La discussion n’est pas seulement théorique, elle est aussi politique : voir Harribey J.-M. (2015-b et 2018-b). Dans (2018-b) je propose que la banque centrale garantisse les emprunts destinés à financer les investissements en faveur de la transition écologique et qu’elle puisse si nécessaire financer directement l’État.
[13] C’est la question que se posait Marx, notamment dans le Livre II du Capital et que reprendra Luxemburg dans L’accumulation du capital. J’ai exposé ce problème dans Harribey J.-M. (2018-a). Voir aussi Les Économistes atterrés (2018).
[14] À propos de la position des post-keynésiens sur l’effet d’éviction, voir Lavoie M. (2004, p. 81).
[15] Aglietta M., Espagne É., Perissin-Fabert B. (2015), Harribey J.-M. (2018-b).
[16] Sur l’idée de qualité de la monnaie, voir aussi Beitone A. et Rodrigues C. (2017, p. 166).
[17] Emmanuel A. (1969).
[18] Voir notamment de cet auteur : Amin S. (1973).
[19] Pour une présentation critique, voir Douai A. et Plumecocq G. (2017).
[20] O’Connor J. 1992), Burkett P. (2006), Foster J.B. (2000 et 2011), Harribey J.-M. (1997 et 2013).
[21] Martinez Alier J. (2014).
[22] Georgescu-Roegen N. (1995).
[23] La décomposition du taux de croissance en introduisant n’importe quel facteur est une habitude devenue récurrente aussi bien chez les néoclassiques, que chez certains hétérodoxes comme R.U. Ayres ou G. Giraud : pour un examen critique, voir Harribey J.-M. (2013 et 2015-a).
[24] Aglietta M. (2016), De Brunhoff (1967), Durand C. (2014), Harribey J.-M. (2013).
[25] Cahen-Fourot L. et Lavoie M. (2016), p. 164 et 165, notre traduction.
[26] Voir Douai A. et Plumecocq G. (2017).
[27] Polanyi K. (1983, p. 251).
[28] L’équilibre est atteint si la demande de biens de production en provenance de la section des biens de consommation plus la part de la plus-value accumulée dans cette section est égale aux salaires versés dans la section des biens de production plus la part de la plus-value consommée par les capitalistes de cette section.






