
Entre austérité et pratiques sécuritaires, la psychiatrie prise en tenailles
Mathieu Bellahsen et Rachel Knaebel, La Révolte de la psychiatrie, Paris, La Découverte, mars 2020.
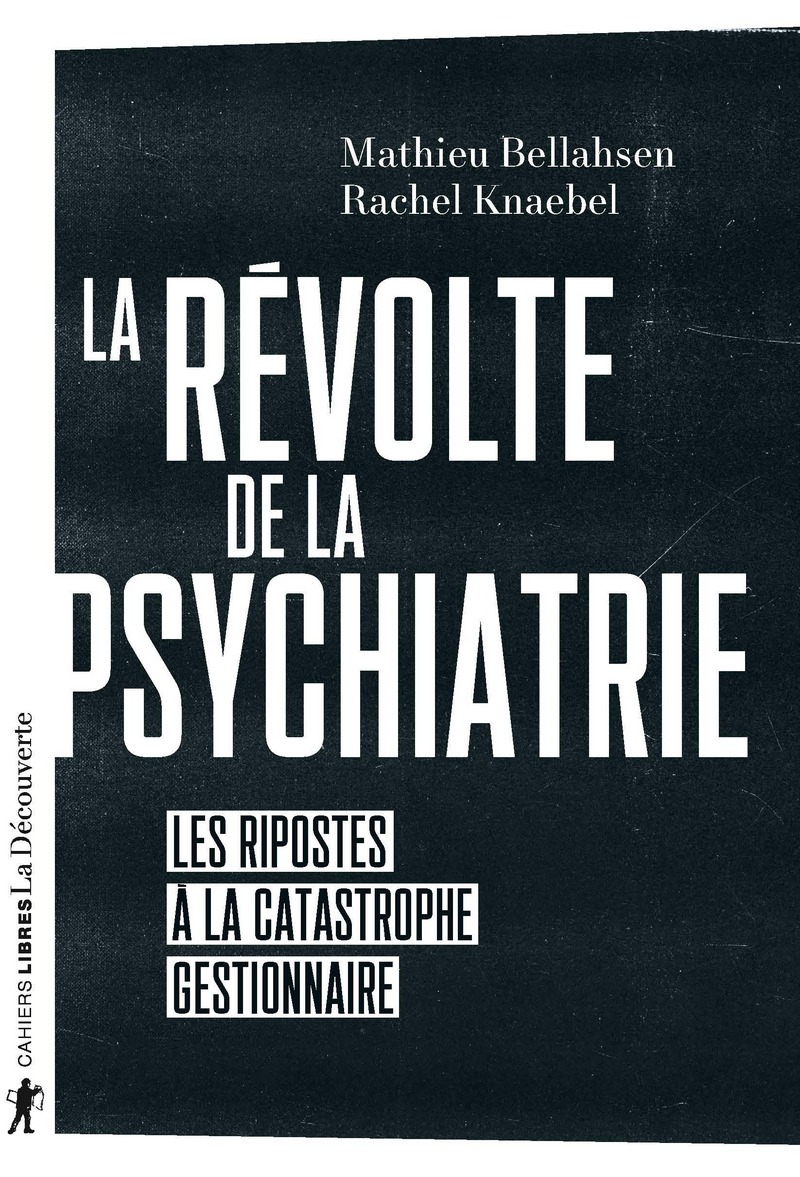
Chapitre VI – Face aux demandes de soin accrues, capacités d’accueil en baisse et pratiques sécuritaires en hausse
« Quelle hospitalité pour la folie ? » C’est la question que pose depuis 2008 le Collectif des trente-neuf contre la nuit sécuritaire[1]. Ce mouvement, qui réunissait d’abord trente-neuf soignants, s’était constitué en protestation contre le tournant sécuritaire engagé alors par Nicolas Sarkozy dans la psychiatrie (voir chapitre suivant). « Tandis que la demande de soins croît – notamment pour les enfants –, les moyens humains se raréfient : diminution des postes d’infirmiers, marginalisation scandaleuse des psychologues, raréfaction des psychiatres (publics et privés) », constatent les trente-neuf dans leur appel du 1er novembre 2014. Six ans plus tard, à la question « Qui accueille la folie ? Qui reçoit les patients de la psychiatrie ? », la réponse est malheureusement toujours la même : tandis que la demande de soins croît, les moyens se raréfient.
L’augmentation constante du nombre de patients en psychiatrie
En matière de prévalence des troubles psychiques en France, les études épidémiologiques précises sont rares. Cela n’empêche pas les chiffres alarmants d’être souvent mis en avant, parfois pour demander des fonds, en particulier pour la recherche en neuropsychiatrie, pour déplorer que des « malades mentaux » soient « livrés à eux-mêmes » si ces personnes sont trop visibles dans l’espace public[2], ou encore pour expliquer que les affections psychiques coûtent trop cher aux finances publiques. Par exemple, Leboyer et Llorca écrivent dans leur livre Psychiatrie : l’état d’urgence, en citant une étude étatsunienne de 2014 : « Les maladies mentales sont fréquentes, elles touchent chaque année une personne sur cinq. » Une personne sur cinq a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie, prévient aussi l’Inserm. Selon la Haute Autorité de santé, les troubles bipolaires affectent entre 1 % et 2,5 % de la population en France[3] et la schizophrénie un peu moins de 1 %, soit environ 600 000 personnes (encore d’après l’Inserm). En 2018, une étude réalisée auprès de 3 200 actifs par la Fondation Pierre-Deniker concluait que 22 % des travailleurs en France présentent une « détresse orientant vers un trouble mental » (26 % chez les femmes, 19 % chez les hommes)[4]. Le chiffre élevé des suicides en France est également régulièrement souligné : environ 9 000 par an, ce qui représente, rapporté à la population, l’un des taux de mortalité par suicide parmi les plus élevés d’Europe de l’Ouest (mais pas le plus élevé[5]). À cela il faut ajouter la prévalence des troubles psychiques dans la population carcérale : plus de 20 % des personnes incarcérées sont atteintes de troubles psychotiques, dont plus de 7 % de schizophrénie ; huit hommes détenus sur dix présentent au moins un trouble psychiatrique, la grande majorité en cumulant plusieurs, dont la dépression pour nombre d’entre eux, l’anxiété généralisée ou la névrose traumatique. Selon l’Observatoire international des prisons (OIP), le taux de pathologies psychiatriques est vingt fois plus élevé en prison que dans le reste de la population. Et, en 2011, la Cour des comptes estimait à 107 milliards d’euros par an le coût économique et social des troubles psychiatriques[6].
Si l’on regarde les seuls chiffres des personnes prises en charge par les structures de soins psychiatriques du pays, c’est-à-dire la « file active » (total des patients vus au moins une fois dans l’année en hospitalisation, en consultation ou en visite à domicile), le constat est en tout cas à la hausse : « La file active des secteurs de psychiatrie ne cesse d’augmenter, au point de se demander quand ce phénomène se stabilisera », s’interrogeait en 2017 l’Inspection générale des affaires sociales[7]. Entre 1991 et 2003, cette file active des patients en psychiatrie avait bondi de plus de 60 % pour la psychiatrie générale et de 80 % pour la psychiatrie infantojuvénile[8]. Depuis, les chiffres continuent de grimper : plus 22 % entre 2007 et 2014 pour la pédopsychiatrie. En 2015,
419 000 personnes ont été hospitalisées au moins une fois dans une structure de psychiatrie, dont 46 000 enfants et adolescents. On comptait alors 569 structures opérantes. En 2018, trois ans plus tard, le nombre d’hospitalisations en psychiatrie s’élevait à 424 000 personnes, soit 5 000 de plus, dont 49 000 enfants et adolescents. Dans le même temps, le nombre de structures psychiatriques baissait à 552. Quant au nombre de personnes prises en charge en ambulatoire (c’est-à-dire sans hospitalisation), il a plus que doublé en vingt ans : de 1 million environ au début des années 2000 à plus de 2 millions en 2018.
La plupart de ces actes en ambulatoire sont réalisés dans les centres médico-psychologiques (CMP, dans lesquels travaillent des psychologues, infirmiers, psychiatres, éducateurs…) et aussi dans les centres d’activité thérapeutique à temps partiel (CATTP). En psychiatrie, on distingue aussi entre hospitalisation complète et hospitalisation « de jour », qui n’est pas à proprement parler une hospitalisation puisque les personnes ne se rendent alors à l’hôpital que durant la journée, pour y suivre des soins ou des activités (le nombre de places en hôpital de jour en psychiatrie était d’environ 28 000 en 2019). Il existe aussi des centres de postcure (des unités de moyen séjour, de transition, pour assurer un prolongement des soins après une phase aiguë), qui restent toutefois limités en nombre de places (un peu moins de 1 500 en 2019). On compte en plus quelques centaines de places d’hospitalisation à domicile, un millier en appartements thérapeutiques et environ 3 000 en placement familial thérapeutique.
Souvent, des malades psychiques sont aussi pris en charge ou accompagnés au sein de structures dites « médicosociales » à l’origine destinées à l’accueil du handicap, comme les maisons d’accueil spécialisées (MAS), les foyers d’accueil médicalisés (FAM), les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (Samsah) et les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS). La question de la frontière, poreuse, établie par la puissance publique entre maladies psychiques et handicap s’est posée dès la première loi sur le handicap de 1975. Comme on l’a vu, celle de 2005 a implicitement reconnu le « handicap psychique » provoqué par des troubles psychiques comme distinct du handicap mental (voir chapitre I). S’agissant de l’accompagnement et du soin, ce glissement a pour effet que la psychiatrie se retrouve de plus en plus cantonnée au traitement de la crise, alors que l’accompagnement quotidien est de plus en plus renvoyé à des structures médico-sociales, moins coûteuses, ou même aux familles, qui deviennent des « aidants ».
Les consultations en centres médico-psychologiques de moins en moins accessibles
Toujours plus de patients, plus d’actes en ambulatoire, moins de structures[9], voilà la traduction chiffrée du « tournant ambulatoire » en psychiatrie. Les capacités d’accueil en hospitalisation à temps plein en psychiatrie générale n’ont pas cessé de diminuer depuis les années 1990 – 71 000 lits en 1997, 57 000 en 2015 –, alors que la diminution du nombre de lits a été beaucoup moins importante dans les autres secteurs de la médecine. Les « lits » d’intrahospitalier ont été fermés sans que les structures alternatives à l’accueil à temps plein soient forcément déjà là. Et surtout, en psychiatrie, même le nombre de centres médico-psychologiques, qui sont pourtant des structures ambulatoires même si elles dépendent d’un « secteur » et d’un centre hospitalier, a drastiquement chuté : en 2011, il y avait plus de 3 800 CMP sur le territoire français, ils n’étaient plus que 3 136 en 2019[10]. Près de 670 CMP ont disparu en seulement huit ans, soit près de 84 CMP fermés chaque année. Ces chiffres ne sont pas qu’abstraits. Car les CMP, qui font surtout des consultations et des entretiens, sont des lieux de premier accueil et de suivi à l’extérieur de l’hôpital pour les personnes qui y ont déjà fait un séjour. Ils représentent un rouage essentiel de la « continuité du soin ». Supprimer des centaines de CMP a donc des conséquences bien concrètes, au quotidien, sur la prise en charge des troubles psychiques, sur l’accès aux soins pour les citoyens, sur les conditions de travail et la possibilité de faire un travail correct pour les personnels des centres.
Des territoires se retrouvent aujourd’hui sans aucun CMP, leurs habitants doivent faire une demi-heure, voire une heure, de trajet pour avoir cet accès à des professionnels de la psychiatrie, alors que le principe d’un CMP est justement qu’il soit plus aisé d’en ouvrir la porte, parce que le terme « psychiatrie » ne figure pas dans son appellation et qu’il ne se trouve pas forcément dans l’enceinte d’un hôpital[11]. Peu importe, la volonté des tutelles ne semble pas d’aider à l’accès sur tout le territoire aux services publics de santé. Le CMP infanto-juvénile de la commune de Bruyères (Vosges), par exemple, a fermé début 2018. Les enfants, adolescents et leurs familles suivis dans cette zone rurale doivent depuis se déplacer plus loin pour continuer à voir un psychologue, un infirmier ou le pédopsychiatre. Fin 2017, c’est un CMP pour enfants et adolescents de la commune de Caluire, en banlieue de Lyon, qui a fermé. L’heure est aussi aux « regroupements » de CMP, autre manière d’en nommer la disparition. Au sein du centre hospitalier du Vinatier, à Bron près de Lyon, des CMP, des hôpitaux de jour et des CATTP relevant de deux secteurs différents ont été regroupés sur un même site. Résultat : « L’accessibilité au dispositif extrahospitalier est diminuée », en particulier pour les « zones moins urbaines et moins desservies par les transports en commun », est bien obligée de constater l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS)[12]. Dans le Calvados, en Normandie, les CMP d’Honfleur et Équemauville ont été concentrés sur un même lieu début 2019. « C’est une demande de l’Agence régionale de santé de regrouper les lieux de soins », expliquait alors au journal régional Ouest France une cadre du centre[13].
Les effets de cette politique se font aussi sentir sur les centres qui restent : les files d’attente s’allongent, les délais pour avoir un rendez-vous aussi. Le délai pour une consultation en CMP était de neuf mois dans les Bouches-du-Rhône, signalait ainsi le Sénat en 2017[14]. Et, au printemps 2019 à Paris, des enfants et adolescents devaient attendre plus d’un an, alertait un collectif de soignants de pédopsychiatrie du XIXe arrondissement[15]. « Nous nous retrouvons dans une situation où nous acceptons de plus en plus l’idée de trier les patients, pour voir quelles familles nous pourrions adresser en libéral », témoignait alors une psychologue d’un CMP infanto-juvénile de Paris dans lequel le temps pour décrocher un premier rendez-vous dépassait les six mois[16].
Avec ces listes d’attente qui s’allongent, les pouvoirs publics peuvent de plus en plus difficilement nier que la situation est dramatique. D’autant plus que, comme le notait l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 2018 au sujet des CMP pour enfants et adolescents, avec la « hausse de la demande », les « contraintes sur le personnel » menaçaient jusqu’à la « viabilité des centres »[17]. Mais que proposait alors la mission de l’IGAS pour pallier ce problème ? Plus de moyens humains ? Pas du tout. Elle recommandait des « outils » pour améliorer la « gestion » de la file active (c’est-à-dire essentiellement des logiciels pour dispatcher les demandes sur différents centres), de « positionner l’offre des centres dans leur environnement » (sans expliquer ce que cela pourrait bien vouloir dire), de « garantir le respect des droits des patients et des familles » (comme si « garantir les droits » était un énoncé performatif et qu’il suffisait de l’écrire pour que cela se réalise sans besoin d’attribuer aucun moyen pour le faire) ; l’IGAS demandait encore de « renforcer l’efficience de l’activité des centres » (mais comment faire alors que leur viabilité était déjà menacée ?) et de « piloter » des « évaluations » (l’évaluation comme réponse à tout)…
Souvent, la justification des agences régionales de santé pour fermer les CMP, en particulier ceux pour enfants et adolescents, est qu’ils n’ont plus de psychiatres. Il est vrai que la démographie médicale pose un grave problème en psychiatrie, en particulier dans la psychiatrie publique, et encore plus en pédopsychiatrie. Au 1er janvier 2016, le pays comptait quelque 15 000 psychiatres en exercice, dont plus de la moitié étaient salariés (de structures publiques ou privées). Mais leur répartition est extrêmement déséquilibrée : plus de 80 % des cabinets de psychiatres libéraux se trouvent dans des villes de plus de 50 000 habitants[18]. Paris et la plupart des régions du sud de la France sont ainsi très bien dotées. D’autres territoires le sont beaucoup moins. En 2018, le département du Cantal ne comptait par exemple que douze psychiatres, aucun d’exercice libéral. La Lozère en avait neuf, de même tous salariés. La pénurie des pédopsychiatres est encore plus forte[19].
Dans la psychiatrie publique, celle des hôpitaux et de leurs antennes ambulatoires (dont les CMP), près d’un tiers des postes de psychiatre étaient vacants, soit plus de 2 500 postes de psychiatre sans titulaire. Et la spécialité attire de moins en moins les étudiants en médecine. En 2019, 17 % des postes offerts à l’internat de psychiatrie n’ont pas été pourvus faute de candidats intéressés. « Un record quasi historique », notait un site d’informations à destination des médecins[20]. L’année précédente, seuls 4 % des postes n’avaient pas été pourvus, et moins de 2 % en 2017. Pour continuer à fonctionner malgré tout, les hôpitaux recrutent des praticiens formés à l’étranger, ou même des psychiatres intérimaires, payés à la journée. À quel tarif ? Au moins 500 euros nets la journée, avec le logement souvent pris en charge. « Comme dans la plupart des hôpitaux, la course aux moyens est devenue l’obsession des services, ainsi mis en tension constante, jusqu’à l’insoutenable, témoigne le praticien hospitalier Fethi Bretel. Les médecins quittent le navire, souvent contraints (comme ce fut mon cas) ou simplement lassés, toujours usés. Les plus jeunes d’entre nous répugnent désormais à s’y installer. Or, s’il est aisé pour un médecin de retrouver une activité hors hôpital, ce n’est pas le cas des soignants. Ceux-là n’ont guère d’autre choix que de rester et donc soit travailler dans la résignation, soit se révolter »[21].
La psychiatrie publique souffre sur ce plan directement de la concurrence des cliniques privées. Qu’une nouvelle clinique s’installe à proximité de l’hôpital psychiatrique du Havre, ou juste à côté de l’hôpital Philippe-Pinel d’Amiens (voir chapitre 4), et cela devient d’autant plus difficile pour ces hôpitaux de garder leurs psychiatres. Ceux-ci n’ont plus qu’à « traverser la rue » pour aller dans le privé. Les infirmières et infirmiers, de leur côté, doivent bien rester, dans des services de plus en plus surchargés des CMP regroupés, avec toujours moins de moyens humains. C’est ainsi qu’à Montreuil, en région parisienne, en décembre 2019, le CMP a décidé de ne plus prendre en charge de nouveau patient.
Les phénomènes sont-ils liés ? En tout cas ils sont concomitants. En parallèle d’une baisse du nombre de lits d’hospitalisation et de la fermeture de centaines de CMP, la France a vu depuis des années le nombre d’hospitalisations psychiatriques sous contrainte grimper en flèche. En 1992, quelque 40 000 personnes avaient été prises en charge en psychiatrie sans leur consentement au moins une fois dans l’année. Le chiffre monte à plus de 60 000 en 1997, plus de 70 000 en 2000, 73 000 en 2006, plus de 80 000 en 2012, 94 000 en 2015[22]. En 2018, 95 600 personnes ont été prises en charge au moins une fois sans consentement. La hausse est presque continue depuis les années 1990. Le nombre des personnes prises en charge sous contrainte a augmenté bien plus vite que la seule « file active » du nombre global de personnes accueillies en psychiatrie. Cette extension du domaine du soin contraint a connu un bond particulièrement marqué depuis 2012. C’est l’effet, entre autres, d’une nouvelle loi et d’une volonté politique de verrouillage de la psy venue du plus haut sommet de l’État.
À partir de 2012, l’extension constante des hospitalisations et des soins sans consentement
Le 12 novembre 2008, un patient de l’hôpital psychiatrique de Saint-Égrève, dans l’Isère, s’enfuit de l’établissement. Dans les rues de Grenoble, il poignarde un jeune homme et le tue. Le drame est largement médiatisé, et avec lui la figure du « malade mental dangereux » comme à chaque fois qu’un patient ou ex-patient psychiatrique est impliqué dans un crime. Une figure du malade mental dangereux qui fait toujours peur dans l’opinion, alors que, statistiquement, les malades psychiques sont beaucoup plus souvent victimes de violence qu’ils n’en sont les auteurs[23]. Trois semaines plus tard, le 2 décembre, Nicolas Sarkozy, président de la République élu un an plus tôt, se rend dans un hôpital psychiatrique de la banlieue parisienne, à Antony.
Devant le personnel réuni, il y prononce ce qui est resté dans les mémoires des professionnels concernés, profondément choqués par cette ignorance abyssale des réalités du travail quotidien de prise en charge des personnes en souffrance psychique, comme le « discours d’Antony », allocution qui préfigure le tour de vis sécuritaire visant la psychiatrie française : « Les malades potentiellement dangereux doivent être soumis à une surveillance particulière afin d’empêcher un éventuel passage à l’acte. Et vous savez fort bien, mieux que moi, que des patients dont l’état s’est stabilisé pendant un certain temps peuvent soudainement devenir dangereux »[24]. Les patients de la psychiatrie, quels qu’ils soient et même si cela ne concerne qu’une infime minorité, sont d’abord renvoyés à une possibilité de « passage à l’acte » criminel face aux « concitoyens » que le président veut protéger et semble opposer aux patients. Tandis que les soignants sont présentés comme étant « du côté du malade » alors que le chef de l’État doit « répondre à l’interrogation des familles des victimes ». Le président Sarkozy annonce alors un plan d’investissements de 70 millions d’euros pour l’aménagement de chambres d’isolement, d’unités fermées et pour « sécuriser » les enceintes hospitalières : 40 millions sont prévus pour la création de quatre unités pour malades difficiles (UMD, destinées selon le Code de la santé publique à des patients qui « présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique ») ; et 30 millions pour l’« amélioration de la sécurité des établissements » de psychiatrie[25]. Rien pour embaucher du personnel. « Trop d’établissements spécialisés en psychiatrie ont encore des enceintes insuffisamment délimitées et sécurisées, comprenant un nombre d’entrées supérieur à ce qui est nécessaire pour leur fonctionnement, précise la circulaire adoptée quelques mois plus tard pour mettre en œuvre ce plan. Cela empêche, y compris durant les heures de fermeture de ces établissements, tout contrôle des allées et venues. Cet état de fait contribue à la difficulté de prévenir les fugues des patients et représente un facteur d’insécurité pour les personnels de santé. C’est pourquoi il est demandé que les établissements qui ne l’ont pas encore fait limitent le nombre d’accès à l’enceinte de l’établissement et les sécurisent par les moyens les mieux adaptés à la configuration et au fonctionnement du site : barrière d’entrée, vidéosurveillance. »
Ce jour de décembre 2008, Nicolas Sarkozy rend aussi publique une « innovation » juridique que son gouvernement prépare en matière de psychiatrie : les soins sans consentement en dehors même de l’hôpital. Deux ans plus tôt, il avait déjà tenté de réformer les modalités d’hospitalisation psychiatrique sous contrainte dans son projet de loi de prévention de la délinquance de 2006, avant de faire machine arrière[26]. Et, en février 2008, il avait fait adopter une loi instaurant la « rétention de sûreté », visant à maintenir en rétention un prisonnier condamné pour des crimes lourds, même après avoir purgé sa peine[27]. Dans ce dispositif, les psychiatres sont sollicités pour se prononcer sur la dangerosité à venir de détenus en fin de peine. La logique, là aussi, est d’étendre le domaine de la contrainte, même après la peine de prison pour les détenus, même en dehors de l’hôpital pour les patients psychiatriques.
Les 70 millions d’euros promis sont débloqués dès 2009 pour bâtir ou rebâtir les enceintes des hôpitaux, créer des unités fermées, des chambres d’isolement supplémentaires, des dispositifs de surveillance[28]. Puis, les préfets reçoivent l’ordre de ne plus valider systématiquement les sorties des personnes hospitalisées d’office, même si elles sont demandées par les psychiatres hospitaliers[29]. En mai 2010, la ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot, présente finalement le projet de loi de réforme des soins psychiatriques sans consentement. La loi qui en découle plus d’un an après marque un nouveau jalon dans l’histoire des législations sur l’internement imposé en France : après les lois de 1838 (sanctionnant le statut médico-juridico-administratif de l’« aliéné ») et de 1990 (réformant ce statut et instituant à la place les hospitalisations d’office et les hospitalisations à la demande d’un tiers), a donc été adoptée la loi du 5 juillet 2011. Celle-ci ajoute aux deux anciennes modalités d’hospitalisation sans consentement – celle à la demande d’un tiers et celle d’office, qui devient, dans la loi de 2011, « sur décision d’un représentant de l’État » –, une hospitalisation psychiatrique sans consentement « en cas de péril imminent », qui vise les personnes désocialisées et isolées, celles qui vivent dans la rue entre autres. Le nombre de ce type d’hospitalisation a vite explosé : d’un peu plus de 8 500 en 2012 à plus de 19 500 en 2015[30].
Mais la loi de 2011 ouvre aussi et surtout aux soins sans consentement pratiqués hors de l’hôpital. Cela signifie qu’une personne qui a été hospitalisée sous contrainte pour des troubles psychiques peut se voir prescrire des soins obligatoires, le plus souvent médicamenteux, une fois sortie de l’hôpital. Un soignant peut par exemple passer une fois par semaine ou par jour au domicile et vérifier la prise d’un médicament. Une personne peut aussi se voir administrer un neuroleptique sous forme d’injection dite « retard », ce qui signifie que l’injection agit pendant plusieurs semaines. Ou bien le patient aura l’obligation de se rendre régulièrement dans une structure de soin. En cas de refus, la menace pèse sur lui de se retrouver à nouveau hospitalisé, toujours sans l’avoir choisi. La contrainte sort de l’hôpital, elle se déplace jusqu’au domicile des personnes, sans perdre pour autant son caractère de restriction de la liberté. Depuis la loi de 2011, le recours à cette modalité du soin imposé s’est également largement développé : en 2018, 44 % des personnes en soins sans consentement l’étaient hors de l’hôpital, contre 35 % en 2012[31].
Quand le juge est entré à l’hôpital
Dès le discours d’Antony, cette perspective du tout sécuritaire, du renforcement du joug asilaire, de son extension « hors les murs », a toutefois suscité un large mouvement de résistance. Le Collectif des trente-neuf contre la nuit sécuritaire[32] et l’Appel des appels lancé par le psychanalyste Roland Gori se sont créés dès la fin 2008 – des mouvements toujours actifs dix ans après. Dans le même temps, en 2010, une association de défense des droits des personnes psychiatrisées, le Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie (CRPA, scission du Groupe information asile, GIA), principalement composée d’anciens patients de la psychiatrie, s’est mobilisée elle aussi sur le plan du droit contre le projet de loi gouvernemental.
Elle est ainsi parvenue à faire modifier le texte de la loi de 2011 dans le sens des droits des patients, « par une sorte de “putsch” judiciaire » comme l’a écrit le président du CRPA André Bitton[33].
Comment ? En en appelant à la Constitution. Depuis 2008 en France, tout citoyen qui s’estime victime d’une décision judiciaire contraire à ses droits fondamentaux garantis par la Constitution peut, seul avec son avocat ou aux côtés d’une association, poser au Conseil constitutionnel une « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC). C’est par exemple par cette voie que Cédric Herrou, l’activiste qui soutient les migrants dans la vallée de la Roya, est parvenu en juillet 2018 à faire modifier la loi faisant de la solidarité envers les personnes migrantes un « délit » : suite à sa requête, le Conseil constitutionnel a jugé ce « délit de solidarité » en partie contraire au principe de fraternité ancré dans la Constitution. De 2010 à 2019, les avocats du Groupe information asile (GIA) puis du CRPA ont de même posé sept QPC concernant des cas d’internements psychiatriques jugés abusifs ou illégaux par ces associations.
Deux d’entre elles ont abouti à une modification de la loi.
Le 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel rend sa décision au sujet de la requête de Danielle S., soutenue par le CRPA. Cette femme avait été hospitalisée en hôpital psychiatrique à la demande d’un tiers, donc sous contrainte. Le Conseil a jugé que le fait que « l’hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire » méconnaît les « exigences de l’article 66 de la Constitution », lequel stipule que « nul ne peut être arbitrairement détenu » et que « l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Quelques jours plus tôt, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avait condamné la France pour détention arbitraire dans le cas d’une hospitalisation psychiatrique sous contrainte longue de vingt-sept ans[34].
À la suite de cette QPC, le gouvernement a dû modifier, contraint par le Conseil constitutionnel, son projet de loi de mai 2010 (ayant conduit à la loi de 2011) pour y introduire le passage obligatoire devant un juge de tous les patients hospitalisés en psychiatrie sous contrainte. Au-delà de quinze jours d’abord, puis de douze jours à partir de 2014 (en application de la loi du 27 septembre 2013 réformant partiellement celle du 5 juillet 2011 sur la base d’une proposition du député socialiste Denys Robiliard), un juge des libertés et de la détention doit se prononcer sur la légalité de la poursuite de l’hospitalisation. La question doit être ensuite reposée au juge tous les six mois en cas d’hospitalisation sous contrainte à temps complet au long cours. En 2012, une nouvelle QPC initiée par le CRPA obtiendra à nouveau gain de cause : le Conseil constitutionnel a censuré les mesures spéciales prévues par la loi de 2011 pour les patients des « unités pour malades difficiles » (UMD).
Même si la décision de novembre 2010 peut être jugée « minimaliste », comme l’écrira le président du CRPA André Bitton, elle n’en reste pas moins historique : elle fait entrer pour la première fois le juge dans l’hôpital psychiatrique, vieille revendication du Groupe information asile (né dans les années 1970), déjà en pratique dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest (Allemagne, Belgique, Italie, Royaume-Uni – où existent des Mental Health Tribunals). Ainsi, à l’axe sécuritaire de la loi de 2011 s’en est adjoint un autre, de préservation des libertés, arraché de haute lutte par le combat du GIA puis du CRPA, là où les mobilisations des professionnels de la psychiatrie n’avaient pas permis d’infléchir le texte. Cette séquence a démontré la « force altératrice » de la pratique du droit par les premiers concernés par la contrainte (voir chapitre 8). Elle en a fait également des interlocuteurs crédibles et de poids, alors que nombre de professionnels dans les instances d’État désavouent ces associations et leurs adhérents, marqués d’étiquettes psychiatriques dépréciatives.
La nouveauté, qui devait être mise en œuvre dès août 2011, n’a pas été acceptée d’emblée par l’ensemble des professionnels. Ni les juges, ni les avocats, ni les psychiatres, ni les autres personnels des hôpitaux n’y sont alors préparés[35]. Certains services hésitent à envoyer leurs patients devant une chambre judiciaire, parce que cela pourrait désorienter encore plus ceux qui le sont déjà et parce que les juges n’ont aucune compétence médicale. Les dispositifs testés au tout début, séances en vidéoconférence ou venue du patient au tribunal, n’aident pas forcément à faire accepter cette disposition. À l’hôpital de Ville-Evrard, à l’été 2011, la commission médicale d’établissement avait même décidé de refuser catégoriquement d’envoyer les patients en audience[36]. Et puis le passage devant le juge est entré dans le paysage psychiatrique. Le nombre de mainlevées (invalidations des décisions de maintien en hospitalisation sous contrainte) prononcées par les juges est passé d’un peu plus de 5 000 en 2012 à plus de 7 000 en 2018. Le pourcentage de mainlevées des décisions prises reste depuis 2012 autour de 9 %[37]. Il s’agirait principalement d’irrégularités de procédure, mais pas seulement.
Il arrive en effet aux juges des libertés et de la détention de décider d’une mainlevée parce que les personnes ont subi pendant leur hospitalisation des placements à l’isolement ou une contention jugés non justifiés, ou en tout cas non suffisamment documentés. Ces décisions sont rendues possibles par un article de la loi de « modernisation » de la santé de 2016, qui stipule : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin »[38]. Cet article avait été adopté sur proposition, encore une fois, du député Denys Robiliard. Depuis, un registre des contentions et des isolements doit être tenu dans chaque établissement.
En octobre 2016, dans les mois qui suivent l’adoption de cette loi, une ordonnance de la cour d’appel de Versailles considère le juge judiciaire comme compétent pour statuer sur la légalité, ou l’illégalité, de mesures d’isolement ou de contention en psychiatrie, toujours en application de l’article 66 de la Constitution[39]. Le 20 juin 2017, un juge des libertés et de la détention de Versailles ordonne par exemple la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation sur décision du représentant de l’État pour une personne qui avait été mise en isolement. Le juge a retenu que l’absence d’informations relatives à la motivation de l’isolement violait la loi. Le 23 juin 2017, une autre décision de mainlevée est prise au motif que les conditions ayant présidé à une mesure d’isolement étaient insuffisamment détaillées, « les troubles du comportement ayant motivé l’hospitalisation sous contrainte étant en eux-mêmes insuffisants pour justifier cette pratique clinique »[40]. Dans un autre cas (10 juillet 2017), le juge des libertés et de la détention a prononcé une mainlevée pour un patient admis sur demande de tiers, parce que les documents relatifs à l’isolement étaient illisibles[41].
Ainsi, l’effet du « putsch judiciaire » du CRPA dépasse le seul contrôle de la légalité des hospitalisations sans consentement. La loi de 2011 modifiée par celle de 2013, jointe à l’article de la loi de 2016 relatif à la traçabilité de l’isolement et de la contention, a eu pour effet collatéral de soumettre également ces pratiques à la justice. À terme, une jurisprudence pourrait se développer en la matière. Et peut-être contribuer à limiter le recours à la contention et à l’isolement, pratiques redevenues courantes, selon nombre de soignants, dans de nombreux établissements psychiatriques en partie du fait des baisses d’effectifs.
Mesures attentatoires aux libertés
En mars 2016, Adeline Hazan, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL, une autorité administrative indépendante), publie un rapport accablant sur la situation au Centre psychothérapeutique de l’Ain, à Bourg-en-Bresse, hôpital privé mais d’intérêt collectif géré par une association, faisant partie du secteur psychiatrique public et seule structure de soin des pathologies psychiques du département. La contrôleuse y décrit des « atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes hospitalisées » : « L’isolement et la contention sont utilisés dans des proportions jamais observées jusqu’alors » ; des patients sont attachés à leur lit ou à leur fauteuil jusqu’à vingt-trois heures par jour, « mesure [qui] dure pour certains depuis des mois, voire des années ». Les patients détenus, envoyés dans le centre psychiatrique par la prison où ils sont enfermés parce qu’ils ont besoin de soins, sont quant à eux systématiquement attachés jusqu’au premier entretien avec un psychiatre, puis placés en chambre d’isolement durant toute la durée de leur hospitalisation. Le rapport fait évidemment scandale.
En octobre 2016, la CGLPL publie un état des lieux général de la contention et de l’isolement en France. Là aussi, le constat est dur : « Les visites de la CGLPL dans les établissements de santé mentale lui ont fait découvrir une utilisation de l’isolement et de la contention d’une ampleur telle qu’elle semble être devenue indispensable aux professionnels » ; « Il est difficile, même aux professionnels, de remettre en cause des méthodes qui leur ont été enseignées et dont ils usent de toute bonne foi et avec la conviction que c’est un soin » ; « Le recours à la contention et à l’isolement en psychiatrie ne fait l’objet d’aucune autorisation ni le plus souvent d’information aux proches au motif qu’il serait exigé par l’état clinique du patient ». La Haute Autorité de santé et l’Agence régionale de santé de Rhône-Alpes n’avaient quant à elles rien vu des conditions honteuses d’hospitalisation au Centre psychothérapeutique de l’Ain, alors même que ses services y avaient effectué des visites les années précédentes[42]. Suite à quoi, en 2017, la HAS publie des recommandations sur l’usage de la contention et de l’isolement. Ces mesures, dit-elle, « ne doivent être utilisées qu’en dernier recours après échec des mesures alternatives de prise en charge »[43]. Dans certains services, contention et isolement sont totalement exclus – mais ils l’étaient déjà avant que la HAS n’émette un avis sur le sujet.
En janvier 2018, une nouvelle visite de la CGLPL, aux urgences du CHU de Saint-Étienne cette fois, donne à penser que ni l’article de la loi de 2016 ni les recommandations de la HAS de 2017 n’ont eu partout les effets attendus. À Saint-Étienne, Adeline Hazan constate la « présence aux urgences générales du CHU de vingt patients relevant de la psychiatrie en attente de places ». « Sept patients faisaient l’objet de contentions au niveau des pieds et d’une ou des deux mains. Deux de ces patients attachés étaient en soins libres, les autres étant en soins sans consentement à la demande du représentant de l’État ou à la demande d’un tiers. Ces sept patients se trouvaient aux urgences depuis des durées allant de quinze heures à sept jours, cinq étant présents depuis plus de trois jours. Ils n’avaient pu ni se laver, ni se changer, ni avoir accès à leur téléphone portable. Trois d’entre eux devaient user d’un urinal posé le long de leur jambe sur le brancard au-dessus du drap. Or aucun de ces patients ne présentait d’état d’agitation, certains demandant juste à pouvoir être détachés, sans véhémence, dans une forme de résignation et d’acceptation. Les contentions étaient visibles de toute personne circulant dans les couloirs des urgences, notamment des patients souffrant d’autres pathologies et de leurs familles. Les entretiens avec les médecins et infirmiers, comme la délivrance des traitements, s’effectuaient sans aucune confidentialité »[44].
Les recommandations et la loi n’ont-elles eu aucun effet ? La lutte contre la pratique liberticide de contention ne pourra-t‑elle gagner que par voie de justice ? Le juge français aura-t‑il à terme aussi le pouvoir de contrôler systématiquement ces mesures attentatoires aux libertés ? C’est en tout cas le chemin qu’a pris l’Allemagne. Outre-Rhin, le passage devant le juge pour valider ou invalider les internements sous contrainte est pratiqué depuis longtemps. Pour autant, les juges valident les décisions dans la quasi-totalité des cas, et les hospitalisations sous contrainte y sont encore plus nombreuses qu’en France[45]. Mais, en 2018, le tribunal constitutionnel allemand a décidé d’étendre le contrôle judiciaire aux pratiques de contention. À la suite des requêtes de deux personnes qui en avaient fait l’expérience pendant leur séjour psychiatrique, pendant plusieurs heures pour l’un des plaignants, plusieurs jours pour l’autre, les magistrats constitutionnels ont décidé qu’à l’avenir la contention devra elle aussi être obligatoirement soumise à un aval judiciaire : au-delà de trente minutes, la fixation d’un patient à son lit ou au fauteuil devra désormais être contrôlée par un juge, parce qu’il s’agit d’une « atteinte au droit fondamental à la liberté de la personne »[46]. En Islande, contention et isolement sont carrément bannis des pratiques psychiatriques. Mais le taux de soignants y est aussi le plus élevé d’Europe[47].
« Beaucoup d’avocats et de magistrats ont fait valoir que, bien souvent, les patients contestaient moins le principe même de leur hospitalisation que ses conditions, particulièrement au regard des pratiques en matière d’isolement et de contention, qui peuvent être des facilités pour des établissements sous-dotés en moyens humains et matériels et qui peuvent prendre des formes très préoccupantes dans certains établissements », rappelait le député Denys Robiliard dans son rapport de 2017 sur les droits des personnes en soin psychiatrique[48]. Des associations représentantes des usagers, comme le CRPA, et de leurs familles, comme Le Fil conducteur psy, demandent l’abolition de la contention. Des professionnels sont aussi sur cette position, comme cela est ressorti des AG et discussions du collectif du Printemps de la psychiatrie : « Je t’enchaîne, tu te déchaînes, nous souffrons », avait ainsi écrit une soignante en lutte sur sa blouse lors d’une manifestation du collectif à Paris en mars 2019. Car oui, dans les services psychiatriques, les personnels souffrent, du manque d’effectifs, du manque de moyens, de l’absence d’espaces pour en parler avec leur direction et des conséquences que cela a sur leur travail. Et sur les personnes en soins.
*
Illustration : Le docteur Philippe Pinel faisant tomber les chaînes des aliénés. Tony Robert-Fleury s.d. Paris, hôpital de la Salpêtrière © RMN / Bulloz.
Notes
[1] Voir son site < www. collectifpsychiatrie. fr >.
[2] Voir par exemple Elsa Mari, « Des psychiatres s’alarment : pourquoi tant de malades mentaux livrés à eux-mêmes ? », Le Parisien, 16 janvier 2019.
[3] Haute Autorité de santé, Troubles bipolaires : repérage et diagnostic en premier recours, 2014.
[4] Fondation Pierre-Deniker, Santé mentale des actifs en France : un enjeu majeur de santé publique, 2018.
[5] Le taux français de mortalité par suicide était de 13,2 pour 100 000 habitants en 2016. Il était la même année de 17 pour 100 000 habitants en Belgique, de 13,6 en Autriche et de plus de 14 en Finlande. Le taux de mortalité par suicide est aussi plus élevé qu’en France dans plusieurs pays d’Europe centrale et orientale, comme en Estonie (14 pour 100 000 habitants), en Hongrie (près de 18), en Lettonie (18,5), Lituanie (28), Slovénie (18) (chiffres Eurostat).
[6] Cour des comptes, L’Organisation des soins psychiatriques : les effets du plan « Psychiatrie santé mentale » (2005‑2010). Rapport public thématique, 2011.
[7] IGAS, « Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, soixante ans après la circulaire du 15 mars 1960 », 2017.
[8] Voir le rapport du député Denys Robiliard, Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie, 2013.
[9] Sauf pour la psychiatrie pénitentiaire, qui a vu s’ériger de 2010 à 2019 neuf unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), des unités fermées pour les personnes incarcérées, des « hôpitaux prisons ».
[10] 2 245 pour les adultes et 1 565 pour les enfants et adolescents en 2011 ; 1 794 en psychiatrie adultes, 1 342 en pédopsychiatrie en 2019. Les chiffres sont ceux des panoramas annuels de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Dress) sur les établissements de santé.
[11] Voir Aurore Esclauze, « Les centres médico-psychologiques débordés », Le Monde, 17 août 2018.
[12] IGAS, Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, soixante ans après la circulaire du 15 mars 1960, 2017.
[13] « Équemauville. Les soins psychiatriques réunis en un seul lieu », Ouest France, 25 juin 2019.
[14] Sénat, Une prise en charge sanitaire majoritairement ambulatoire, op. cit.
[15] Collectif Pédopsy 75019, « Appel du collectif pédopsychiatrie du XIXe en lutte », blog sur Mediapart, 12 avril 2019.
[16] Entretien avec Rachel Knaebel, juin 2019.
[17] IGAS, Mission relative à l’évaluation du fonctionnement des Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), des Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et des Centres médico-psychologiques de psychiatrie infanto-juvénile (CMP-IJ), 2018.
[18] Michel Laforcade, Rapport relatif à la santé mentale, op. cit.
[19] Ordre national des médecins, Atlas démographique national 2018, approche territoriale des spécialités.
[20] « Procédure de choix 2019 : catastrophe pour la psy, la MG relève la tête », What’s up Doc, 26 septembre 2019.
[21] Fethi Bretel, « Tourner le dos à la résignation », Pratiques, n° 84, 1er trimestre 2019.
[22] IGAS, Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, op. cit. ; et Magali Coldefy, Sarah Fernandes et David Lapalus, « Les soins sans consentement en psychiatrie : bilan après quatre années de mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 », Questions d’économie de la santé, n° 222, 1er trimestre 2017.
[23] Voir l’étude de la Haute Autorité de santé, Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque de violence hétéro-agressive chez les personnes ayant des troubles schizophréniques ou des troubles de l’humeur, mars 2011 : « Les comportements violents ne concernent comme acteurs qu’une petite minorité de personnes souffrant de troubles mentaux. Beaucoup plus fréquemment, ces dernières sont les victimes, de leur fait ou de celui d’autrui ou de la société (difficultés de logement, précarité économique, isolement, désengagement des aides sociales, etc.). » Et encore : « Plusieurs études récentes convergent pour souligner la survictimation des personnes souffrant de troubles mentaux graves (elles sont sept à dix-sept fois plus fréquemment victimes de violence que la population générale). » Voir aussi, dans le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, Isolement et contention dans les établissements de santé mentale (2016) : « La réalité, c’est que les personnes atteintes de troubles psychiatriques dans la population générale (hors personnes sans domicile fixe) sont douze fois plus victimes d’agressions physiques, cent trente fois plus victimes de vols et ont vingt-cinq ans d’espérance de vie en moins que leurs concitoyens. » Puis : « Le rapport Violence et santé mentale (Anne Lovell, 2005), demandé par le gouvernement suite à l’assassinat de deux infirmières à Pau en 2004, a montré que seuls 2,7 % des actes violents sont commis par des personnes souffrant de troubles psychiatriques. »
[24] Cécile Prieur, « Le président de la République engage l’hôpital psychiatrique dans un tournant sécuritaire », Le Monde, 3 décembre 2008.
[25] « Psychiatrie : Sarkozy veut “sécuriser” », Le Monde, 2 décembre 2008. Ces annonces seront mises en œuvre via une circulaire en 2009 (Ministère de la Santé et des Sports, « Circulaire DHOS/O2/F2 n°2009‑23 du 22 janvier 2009 relative au financement par le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) du plan d’amélioration de la sécurité des établissements ayant une autorisation en psychiatrie », 15 mars 2009, < frama. link/xQcQx3wq >).
[26] « M. Sarkozy retire le volet santé mentale du projet de loi sur la délinquance », Le Monde, 13 février 2007.
[27] La même loi réformait la procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour pathologie mentale
[28] Voir Cour des comptes, « L’organisation des soins psychiatriques. Les effets du plan “Psychiatrie et santé mentale” (2005‑2010) », 2011.
[29] Cécile Prieur, « Réforme de la psychiatrie, le grand enfermement », Le Monde, 29 mars 2011. Une circulaire interministérielle du 11 janvier 2010 voulait aussi restreindre les possibilités d’octroi de sorties d’essai pour les personnes en hospitalisation d’office, elle a été annulée par un arrêt du Conseil d’État dans un arrêt du 30 septembre 2011.
[30] Magali Coldefy et Sarah Fernandes (avec la collaboration de David Lapalus), « Les soins sans consentement en psychiatrie : bilan après quatre années de mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 », Questions d’économie de la santé, n° 222, février 2017.
[31] « Beaucoup de zones d’ombre demeurent sur les programmes de soins sans consentement », Hospimedia, 11 juin 2019.
[32] Voir La Nuit sécuritaire, revue Sud/Nord, n° 23, 2008.
[33] André Bitton, « La loi du 5 juillet 2011, tournant sécuritaire et “putsch” judiciaire », L’Information psychiatrique, 2013, n° 89, p. 9‑12, < frama. link/RaqMJ4Ko >.
[34] CEDH, « Baudoin c. France », requête n° 35935/03, 18 novembre 2010.
[35] Voir le récit qu’en a fait l’avocate Corinne Vaill ant, « L’intervention du juge des libertés depuis la loi du 5 juillet 2011 : les premiers obstacles rencontrés », L’Information psychiatrique, vol. 87, n° 10, 2011, p. 763‑768.
[36] Voir le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, « Établissement public de santé de Ville- Evrard », février 2012.
[37] CRPA, « 7 000 décisions de main-levée d’hospitalisations sans consentement en 2018 et en 2017 prises par les JLD », 13 juin 2019.
[38] Article L. 3222‑5-1 du Code de santé publique.
[39] Ordonnance de la cour d’appel de Versailles du 24 octobre 2016 (voir CRPA, « Pour la cour d’appel de Versailles, l’illégalité de l’isolement du patient constitue une atteinte qui justifie la levée de la mesure d’hospitalisation sans consentement », 26 octobre 2016).
[40] Voir Jean-Marc Panfili, « Soins psychiatriques et non-respect des obligations en matière de contention et d’isolement : quelle sanction et par quel juge ? », CRPA, 1er octobre 2017.
[41] Ibid.
[42] Voir Éric Favereau, « Psychiatrie, l’enfer derrière les portes », Libération, 25 mars 2016.
[43] Haute Autorité de santé, Isolement et contention en psychiatrie générale. Recommandations pour la pratique clinique, mars 2017.
[44] Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Recommandations en urgence relatives au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne (Loire), 2018.
[45] Cora Schmechel, Fabian Dion, Kevin Dudek, Mäks Rossmöll er (dir.), Gegendiagnose II. Beiträge zur radikalen Kritik an Psychologie und Psychiatrie, Assemblage, Münster, 2015, p. 24.
[46] Bundesverfassungsgericht, décision du 24 juillet 2018.
[47] Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Isolement et contention dans les établissements de santé mentale, 2016, p. 51.
[48] Denys Robiliard et Denis Jacquat, Rapport d’information en conclusion des travaux de la mission d’évaluation de la loi n° 2013‑869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011‑803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, février 2017.









