
Ce que pourrait être une gauche antiraciste
Ce texte est la conclusion de l’ouvrage coordonné par Félix Boggio Éwanjé-Épée et Stella Magliani-Belkacem : Race et capitalisme, Paris, Syllepse, 2012.
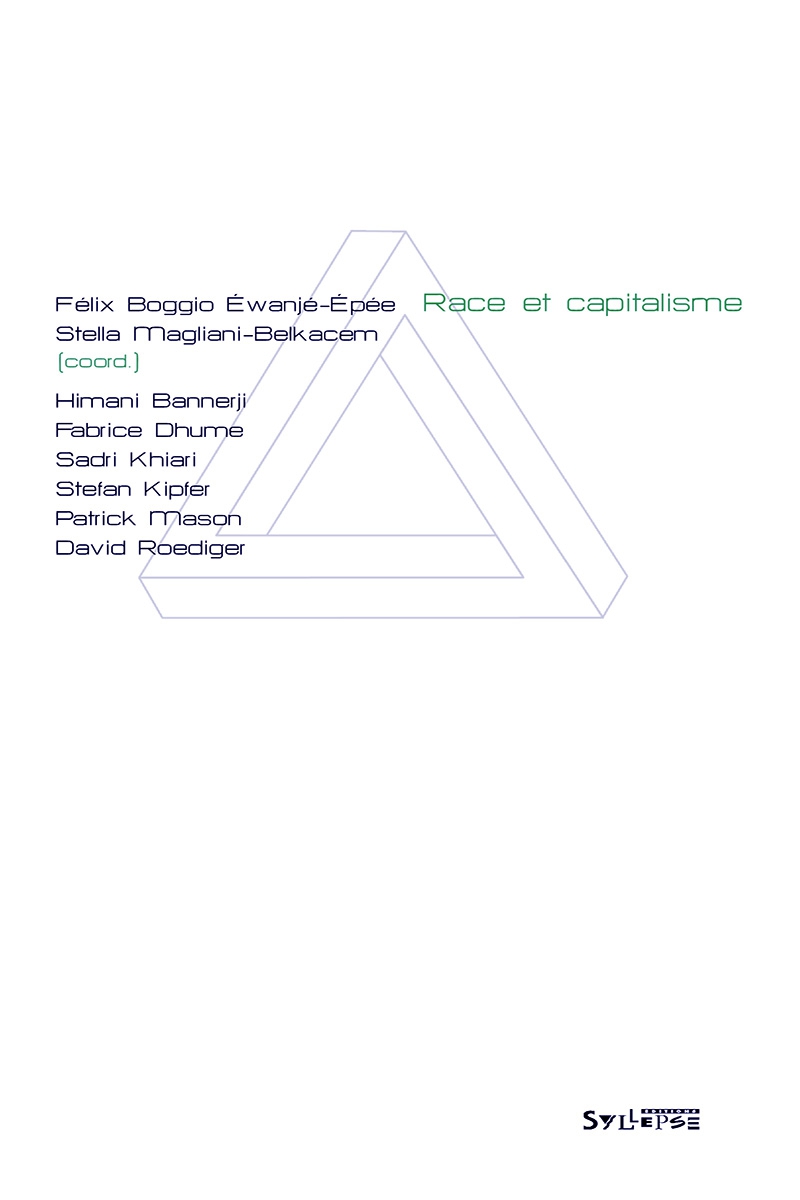
Sommaire de l’ouvrage
– Ce que pourrait être une gauche antiraciste, par Félix Boggio Éwanjé-Épée et Stella Magliani-Belkacem
– L’éclipse de la race et de la classe, par David Roediger
– De la reconnaissance à l’effacement. La politique française de lutte contre les discriminations et la question raciale, par Fabrice Dhume
– Le visage de Janus de la race: Rhonda M. Williams sur la schizophrénie de l’économie orthodoxe, par Patrick L. Mason
– La passion de la nomination: identité, différence et politique de classe, par Himani Bannerji
– Ghetto or not ghetto, telle n’est pas la seule question. Quelques remarques sur la «race», l’espace et l’État à Paris, par Stefan Kipfer
– Nous avons besoin d’une stratégie décoloniale, par Sadri Khiari
Ce que pourrait être une gauche antiraciste
Lorsque l’on souhaite envisager la question raciale dans une perspective matérialiste et critique en France, on se trouve dans un embarras théorique qui n’est pas dissociable d’une situation politique. Si de nombreux et de nombreuses acteurs et actrices du paysage des politiques d’émancipation s’accordent sur une opposition abstraite au racisme, ce dernier enjeu est bien celui qui donne à voir le plus de confusion dans la gauche intellectuelle et politique, toutes traditions confondues. En effet, rares sont les courants en mesure de faire preuve de la même rigueur ou de la même érudition à propos des enjeux de race qu’au sujet de la crise économique, de la stratégie révolutionnaire, des transformations du travail ou de l’histoire du mouvement ouvrier. L’ironie du sort est que la question raciale pourrait être une entrée possible dans ces dernières thématiques.
Il serait difficile de caractériser de façon très générale cette absence de rigueur. Mais on peut sans aucun doute l’associer aux manières courantes de traiter du racisme au sein de la gauche radicale. Le racisme serait une manière de détourner l’attention, une diversion opérée par la classe dominante en direction des classes populaires pour réduire leur combativité collective. Souvent, cet argument est nourri par l’idée, partiellement vraie, que le racisme constitue une division de la classe révolutionnaire ; que cette classe révolutionnaire devra dépasser le racisme pour renverser le capitalisme ; ou le dépassera dans la lutte pour ce renversement – dans les syndicats ou encore sur les piquets de grève où les distinctions s’estomperaient face aux impératifs matériels.
Ces perspectives politiques ont contribué à restreindre la discussion théorique autour de la race et du racisme. Rattrapé•e•s par l’urgence de l’activisme, les militant•e•s peuvent reconnaître qu’il faut combattre le racisme, mais il est néanmoins plus important pour eux et elles de se demander comment reconstituer l’unité du prolétariat du jour au lendemain que de réfléchir à ce qui, précisément, clive durablement les subalternes. Il n’est à cet égard pas étonnant que les rares prises en compte théoriques sérieuses de la question raciale soient le fruit de militant•e•s et d’intellectuel•le•s en rupture avec les exclusions de femmes voilées et en lutte contre la loi du 15 mars 2004 – interdisant le port du hijab à l’école. Cette expression du racisme était alors manifestement transversale à la totalité du champ politique, et révélait notamment combien l’extrême gauche pouvait se rendre complice du système raciste (Lévy 2010). Il était dès lors impossible de restreindre le racisme à une manipulation de l’extrême droite ou des classes dominantes – et c’est à ce titre qu’on a pu lire chez Pierre Tevanian, Sylvie Tissot, Laurent Lévy, Christine Delphy, Saïd Bouamama, dans le sillage du mouvement d’Une école pour tout•e•s et dans la production du Mouvement/Parti des indigènes de la république, des élaborations à la fois radicales et novatrices sur la question raciale en France.
Une conception du racisme en terme de simple diversion et/ou de division produit deux effets. D’une part, elle réduit la race à un dommage collatéral de la lutte des classes. Dès lors, ce qui importe n’est pas tant de discuter de la race comme une formation sociale et un système durables, mais comme une idéologie qui influence plus ou moins le cours du combat de classe, à la manière des nationalismes ou des populismes.
Corrélativement, cette conception n’implique aucunement une rupture avec le sens commun : quelle que soit l’analyse portée sur le racisme – en le considérant comme « peur/ignorance de l’Autre » jusqu’à en proposer une lecture en terme de continuité coloniale – le racisme ferait écran devant les vrais enjeux. Toute discussion théorique sur le racisme lui-même reste très secondaire – puisque cette discussion, quand elle existe, ne sert qu’à expliquer pourquoi, en dernière instance, le prolétariat (blanc et non blanc) est uni par des intérêts communs.
Le phénomène du racisme demeure pourtant bien plus complexe que l’enjeu de la division du prolétariat. Ce recueil entend notamment donner à voir quelques axes de recherche qui travaillent au plus près les différentes dimensions de l’organisation raciale du monde et des sociétés, et qui mettent en jeu les controverses portant sur l’interprétation du phénomène racial. Les débats ici discutés font intentionnellement l’impasse sur les rengaines autour de « l’universalisme » et de la « République une et indivisible ». En effet, ces discussions se contentent de se demander si l’on peut poser ou non le problème racial plutôt que de le penser précisément. C’est cette nécessité de précision qui a orienté le choix de ces textes, marqués par une ambition scientifique notable – ce qui rend parfois leur compréhension difficile ; mais ce qui les rend avant tout difficile d’approche, c’est qu’ils s’inscrivent dans des champs spécialisés. La spécialisation est souvent le fait de l’ancrage académique qui partitionne les disciplines et morcelle la compréhension globale d’un système. Mais elle est peut-être la seule façon de rendre compte d’aspects du racisme qui sont habituellement négligés ou mal problématisés dans le sens commun à gauche.
Ce que permet la spécialisation, c’est de traiter du racisme de façon très précise et dans toute sa complexité. Le champ académique anglophone a depuis longtemps pris en charge cette variété de champs d’action pour la question raciale. C’est notamment à ce titre que ce recueil comporte nombre de traductions de l’anglais. Parmi elles, on peut s’attarder sur la contribution de Stefan Kipfer qui est l’exemple même d’une lecture en termes de racialisation de l’espace urbain en France. Son approche spécialisée, ancrée dans le champ de la géographie critique et nourrie par les observations de Frantz Fanon, lui permet d’échapper aux simplifications induites par de nombreuses comparaisons entre le ghetto étatsunien et les « banlieues » en France. La complexité des processus de racialisation est rendue intelligible par une attention portée sur les réseaux constitués par les instances de rénovation urbaine, les municipalités, l’État et les impérialismes : loin d’être des enjeux étroitement nationaux, la production raciale de l’espace et la production spatiale de la race sont des mécanismes inscrits dans la suprématie du monde occidental, et reproduisent l’hégémonie des populations blanches aux échelles nationales et locales. Les apports d’une approche géographique s’affirment dans ce choix de traiter du racisme comme un phénomène et un processus inscrits dans l’espace, qui doivent nécessairement s’envisager à plusieurs échelles. De son côté, le champ académique français a largement occulté la question raciale. La sociologie reste l’un des rares espaces théoriques en France au sein desquels la question raciale peut-être discutée sous différents aspects et selon différentes analyses. Il n’en reste pas moins que le champ sociologique français porte une lourde tendance à dématérialiser la question raciale en l’envisageant le plus souvent autour de l’unique problématique de la « perception sociale » alors que, dans le champ anglophone, on accorde à la race une capacité de structuration du monde social plus conséquente. Le texte de Fabrice Dhume, sociologue contribuant à cet ouvrage, montre comment la définition de la discrimination raciale, dans le cadre des politiques publiques, participe d’une dématérialisation des pratiques racistes au profit d’euphémisations (« diversité », « personnes appartenant à des minorités », etc.) qui dépolitisent la lutte contre les discriminations racistes.
Le texte de David Roediger, qui ouvre ce recueil, s’il n’est pas lui-même un article spécialisé dans un champ particulier, donne à voir une cartographie des prises de position intellectuelles dans l’approche de la race et de sa mise en concurrence avec la classe. Il s’agit de poser des discussions générales et de résumer des enjeux théoriques. C’est pour éviter cette mise en concurrence stérile entre race et classe que nous avons choisi d’intituler ce recueil Race et capitalisme.
Il s’agit pour nous de partir de l’hypothèse que, historiquement, le capitalisme a toujours été racialisé. D’abord, dans sa formation même : le rôle du commerce des esclaves et celui des richesses tirées de l’esclavage colonial a été crucial pour accumuler le capital qui a financé la révolution industrielle (Williams 1944). Des auteurs comme CLR James ont audacieusement défendu la thèse que la plantation anticipe l’entreprise capitaliste et le salariat moderne (James 2008 [1938]). Par la suite, la formation des impérialismes et l’organisation du marché mondial au 19e siècle se sont jouées sur la compétition des nations occidentales dans l’expansion coloniale. Ce qui justifie de ne pas avoir intitulé ce recueil « race et classe », c’est que dans cette émergence commune du capitalisme et du phénomène esclavagiste/colonial, la formation des classes sociales est inséparable de leur racialisation.
Pour Himani Bannerji, dont un des textes figure dans le présent recueil, il n’existe pas de classe sociale dépourvue d’identités liées à des formes d’oppression constituées avec le capitalisme. Pour elle, il ne s’agit pas, là non plus, de considérer le capitalisme comme une oppression fondamentale à laquelle s’ajouteraient les autres oppressions, comme les scories d’une barbarie irrationnelle ou archaïque. Bannerji n’envisage pas les identités comme de simples stigmates ou encore se réduisant à des constructions culturelles. Les identités sont le produit des mêmes histoires que celles qui ont concouru à l’essor et au développement du capitalisme comme phénomène mondial : l’esclavagisme, la colonisation et la division internationale du travail. Les identités sont les « noms » et les perceptions sociales qui sont imposés ou que se donnent les opprimé•e•s dans le contexte de cette multiplicité de traitements d’exception. Ces « noms » et ces perceptions ne sont ni des essences ni des constructions contingentes ; ils sont ancrés dans l’évolution concrète des rapports juridiques, des relations de subordination entre les populations occidentales et les populations colonisées ou anciennement colonisées ; ils dépendent aussi des rapports de force politiques entre les forces vives de la décolonisation et celles qui entendent maintenir le statu quo colonialiste, entre les processus d’abolition des institutions esclavagistes et les forces ségrégationnistes, entre la résistance des non-Blanc•he•s et la suprématie blanche – appuyée à l’international sur l’exploitation du Tiers-Monde et, à l’intérieur des États-nations occidentaux, sur la discrimination systématisée des non-Blanc•he•s.
C’est ici que le texte de Patrick Mason vient ici rejoindre et compléter la proposition de Himani Bannerji. Pour comprendre la possibilité d’une discrimination systématisée à un niveau économique, Mason propose un modèle qui rend compte d’un principe d’exclusion inhérent au fonctionnement du capitalisme. En effet, même dans l’hypothèse d’un marché concurrentiel, persistent forcément du chômage involontaire et une certaine rareté des situations de travail réunissant les meilleures conditions. L’accès à l’emploi et aux postes les mieux rémunérés, les plus qualifiés, fait l’objet d’une compétition dans la mesure où le capitalisme ne permet pas d’offrir des situations économiques satisfaisantes pour tous et toutes, dans la mesure où subsiste une armée industrielle de réserve et une stratification des conditions économiques. Cette rareté produit dès lors ce que l’on pourrait se figurer comme une file d’attente pour chaque position dans la hiérarchie sociale et économique. Le fait que les un•e•s sont amené•e•s à passer devant les autres engendre des possibilités de discriminations. La race participe de l’appareil identitaire qui vient coder l’attribution des places dans la file d’attente. C’est en cela que l’identité devient un véritable enjeu : l’identité blanche, par exemple, constitue un passe-droit pour passer devant les autres – à l’embauche, à l’avancement, au logement, etc. À l’inverse, comme le montre Patrick Mason en regard de la situation étatsunienne, l’accès aux rares positions les plus favorables (dans les secteurs les plus syndicalisés, aux postes les mieux rémunérés pour la même qualification, etc.) demandent à tou•te•s ceux et celles qui n’ont pas le « bon ticket », le bon marqueur identitaire, d’en faire deux fois plus que les autres. Il s’agira également pour eux et elles de se conformer à un modèle d’intégration, et toute réussite qui pourrait en découler sera dès lors soumise à l’excellence : en effet, le droit à l’erreur n’est pas permis et il suffira du moindre écart pour se voir ramené•e•s à « ses origines ». Il faut également prendre en compte le prix à payer pour avoir droit à la reconnaissance sociale – un prix qui implique le plus souvent une rupture avec la communauté et une collaboration avec le statu quo inégalitaire : si la discrimination est le produit d’une compétition entre Blanc•he•s et non-Blanc•he•s pour l’accès à des positions sociales favorables ou à l’emploi, alors la compétition au sein des non-Blanc•he•s sera d’autant plus rude qu’il s’agit du groupe qui ne bénéficie pas des privilèges et du pouvoir qui permet aux Blanc•he•s de passer en priorité dans la file d’attente. Sans cette priorité, la réussite individuelle pour chaque non-Blanc•he est condamnée à reposer en partie sur une distinction par rapport à l’ensemble de son propre groupe, systématiquement discriminé. À un niveau individuel, il n’est pas possible de baser sa réussite sur une remise en cause du privilège des Blanc•he•s, mais de la mettre en œuvre en passant à travers ces privilèges, en se positionnant comme une exception à la règle de l’exclusion qui frappe les autres non-Blanc•he•s – ce que la société sanctionne en retour, non comme le fait d’un individu appartenant à un groupe discriminé surmontant un stigmate, mais comme la confirmation de la rengaine libérale et raciste du « quand on veut, on peut ».
Ce qui est ici en jeu, c’est la manière dont les identités produites par l’histoire complexe des oppressions, telle que la raconte Himani Bannerji, se voient non seulement reproduites, mais également inscrites dans des stratégies de promotion sociale. L’identité a bien une fonction économique. C’est à partir de cette analyse qu’il faut briser l’imaginaire très persistant à gauche qui consiste à faire du racisme une conséquence de la carence en cadres collectifs pour les Blanc•he•s des classes populaires (un mouvement ouvrier fort, des syndicats puissants, etc.) Dans cette imagerie, cette absence de cadres collectifs de résistance ne laisserait aux prolétaires blanc•he•s que la solution individuelle de rejeter « l’Autre », « l’immigré », « l’étranger ». C’est en cela que la gauche se refuse à penser l’identité blanche comme un privilège collectif. Si cet imaginaire admet bien qu’il y a des situations où être perçu•e comme blanc•he donne accès à des avantages notables (l’obtention d’un emploi ou d’un logement), il n’envisage pas que l’organisation des classes populaires blanches en tant que « classe ouvrière » puisse être un moyen de conserver et d’étendre les privilèges associés à l’identité blanche. L’argument souvent invoqué est que les privilèges des Blanc•he•s et la discrimination systémique des non-Blanc•he•s, sont des obstacles à l’organisation du prolétariat et à l’obtention d’un rapport de force suffisant face à la classe dominante – l’unité serait tout simplement plus gagnante que la division. Mais comprenons bien que ce n’est pas parce que, pour les travailleurs et travailleuses Blanc•he•s, on pourrait faire mieux sans le racisme, que l’on ne se porte pas bien en s’appuyant sur ses privilèges. Dans le cas de la lutte de classe des prolétaires Blanc•he•s, là aussi, le mieux est l’ennemi du bien.
On peut citer différents exemples à l’appui de ces arguments. Pour de nombreux libéraux ou sociaux-démocrates réformistes, le New Deal étatsunien des années 1930 est une référence en matière de législation progressiste. Mais il se trouve que le New Deal a précisément constitué une législation protectrice des travailleurs et travailleuses blanc•he•s, en excluant subtilement les Noir•e•s des mesures en question. Plutôt que de faire figurer cette exclusion de façon explicite, la législation sociale votée par les membres du Congrès faisait simplement l’impasse sur les emplois où les Noir•e•s étaient surreprésenté•e•s – les ouvriers agricoles et les domestiques en particulier. Ainsi, le Congrès a mis en place des durées légales du travail, des salaires minimum, une sécurité sociale et des structures syndicales qui n’ont pas concerné les Noir•e•s. (Katznelson 2005 : 22-23) On peut étoffer cet exemple en ajoutant les remarques du chercheur autodidacte Theodore Allen. Allen s’est particulièrement intéressé à cet épisode car il est non seulement l’auteur du classique The Invention of the White Race, mais qu’il est l’une des figures d’un groupe marxiste, la Sojourner Truth Organization, qui s’inscrivait dans une réflexion antiraciste radicale. Dans un texte de 1973, il montre comment le parti communiste des États-Unis est devenu, au cours des années 1930 et « au nom de l’unité antifasciste », un « auxiliaire du New Deal ». Pour ne pas « risquer de perdre les concessions offertes par le New Deal », le parti communiste étatsunien n’a pas souligné le caractère racial et discriminatoire de la réforme, rompant avec ses prises de positions antérieures en faveur d’un combat antiraciste. De même, à propos du mouvement syndical, Allen explique comment les militants syndicalistes de l’AFL et du CIO (deux syndicats majeurs aux États-Unis) se sont désolidarisés des Noir•e•s pour ne pas risquer de s’aliéner les Blanc•he•s. Il en a résulté que le différentiel entre le taux de chômage des Noir•e•s et celui des Blanc•he•s au Nord des États-Unis est passé de 75% en 1930 à 115% en 1937. Citant Franklin Frazier, Allen ajoute que « la politique du New Deal visant à protéger le droit d’organisation du travailleur (blanc) d’une part, et le droit des Noir•e•s à avoir un emploi d’autre part, entrèrent alors souvent en conflit » (Allen 1973).
Ce conflit, il est aussi perceptible dans l’histoire du mouvement ouvrier en France. À partir de l’après-guerre, la CGT a longtemps promu un protectionnisme ouvrier. Elle s’est opposée à l’introduction de travailleurs étrangers dans la force de travail jusqu’en 1974, et a même été à l’initiative de la création de l’Office national de l’immigration – dans lequel elle a siégé jusqu’en 1947. Quand la CGT a abandonné cette politique étroitement nationaliste, elle a converti ses positions sur l’immigration en une défense pour un retour au pays dans des conditions confortables pour les travailleurs immigrés. Là encore, c’était considérer l’« immigré » comme un travailleur de second plan. En effet, ce virage s’opère à l’heure des grandes restructurations et de la crise économique. Dès lors, quand les syndicalistes jugent que, face aux licenciements, la priorité pour ces travailleurs immigrés n’est pas le maintien de leur emploi mais un retour au pays dans les meilleures conditions, il devient alors notable que les grands syndicats n’ont pas considéré ces travailleurs comme une composante de leur base sociale mais comme une force de travail dont la présence n’est qu’une anomalie. Le mouvement syndical a cédé à l’« illusion du provisoire », formule chère à Abdelmalek Sayad :
« Un immigré, c’est essentiellement une force de travail et une force de travail provisoire, temporaire, en transit. En vertu de ce principe, un travailleur immigré (travailleur et immigré étant, ici, presque un pléonasme) […] reste toujours un travailleur qu’on définit et qu’on traite comme provisoire, donc révocable à tout moment. […] En fin de compte, un immigré n’a sa raison d’être que sur le mode du provisoire et à condition qu’il se conforme à ce qu’on attend de lui : il n’est là et n’a sa raison d’être que par le travail, pour le travail et dans le travail : parce qu’on a besoin de lui, tant qu’on a besoin de lui, pour ce pourquoi on a besoin de lui et là où on a besoin de lui ». (Sayad 2006 : 50-51)
Ces exemples – du grand ralliement au New Deal ou des options des syndicats hégémoniques français depuis la Libération jusqu’aux grandes restructurations – nous montrent combien les conflits d’intérêt entre travailleurs blancs et non blancs se mettent clairement en œuvre dans ce que le mouvement ouvrier blanc juge comme des opportunités stratégiques : dans le cas du New Deal, il s’agit de conforter une législation protectrice excluant les Noir•e•s ; dans le cas des réformes de la Libération, il s’agit de protéger les secteurs dominés par les nationaux en devenant agent du contrôle de l’immigration ; à l’heure des grandes restructurations, les syndicats majoritaires ont ignoré les luttes de travailleurs immigrés menées à la même période : les grèves des loyers dans les foyers d’immigrés marquaient peut-être un ancrage sur le long terme et pas forcément une nécessité immédiate de retour au pays. Cette invisibilisation ou ce choix notable des fronts à sacrifier marquent bien une tendance structurelle du mouvement ouvrier octroyée et façonnée par le privilège blanc.
Aujourd’hui encore,
« le mouvement social dans son ensemble ne se donne pas pour priorité d’appuyer les luttes des descendant•e•s de colonisé•e•s. Le plus souvent, les composantes de la gauche politique et syndicale tendent à juger leurs propres préoccupations comme universelles, portant sur la situation de l’ensemble de la population (retraite, service public, droit au logement, etc.) Or, la lutte contre la suprématie blanche ne saurait être remplacée par une lutte pour obtenir une plus grande part du gâteau, qui sera de toute façon répartie inégalement entre tous et toutes » 1.
Ces revendications sont considérées comme « universelles » précisément parce qu’elles ne prennent pas en compte les besoins spécifiques. On a beau gagner une plus grosse part de gâteau, les miettes resteront toujours pour les mêmes : des victoires du mouvement ouvrier blanc n’empêchent pas une reconduite à l’identique de l’inégalité entre Blanc•he•s et non-Blanc•he•s. La grande mobilisation contre le CPE constitue un bon exemple de ce passage à la trappe d’intérêts spécifiques au nom de « l’intérêt général ». La Loi sur l’égalité des chances avait été conçue et présentée comme une réponse aux révoltes de novembre 2005. Pourtant, la dynamique majoritaire de la mobilisation a exclusivement porté sur le CPE, évinçant les autres mesures prévues par la loi dans son ensemble :
« [Elle] comprend des mesures de déscolarisation qui, bien sûr, menacent tous les adolescents indépendamment de leurs origines, mais comment ne pas la mettre également en rapport avec les multiples discours concernant l’incapacité spécifique des enfants issus de l’immigration à suivre une scolarité normale ? Le Titre III de la loi qui prévoit de sanctionner les parents en leur retirant les allocations familiales n’aurait de toute évidence pas existé si une large campagne n’avait pas été menée soulignant la prétendue incompétence des pères – souvent dénoncés comme polygames – et des mères – s’acharnant à parler l’arabe – à s’occuper de leurs enfants. Et que viennent faire les dispositions du Titre IV concernant la « lutte contre les incivilités » dans une loi consacrée à « l’égalité des chances » si ce n’est pour parachever la logique de cette loi par des mesures sécuritaires dont la cible est prioritairement les Noirs, les Arabes et les musulmans. On pourrait en dire autant du Titre V qui instaure un « service civil volontaire » pour « former le jeune aux valeurs civiques » ! Qui sont les jeunes qu’à longueur de discours et d’articles, on dénonce pour leur manque de « valeurs civiques » sinon ceux qui sont issus de l’immigration postcoloniale ? Comment ne pas faire le lien entre ces décisions et celles qui conditionnent la délivrance d’un titre de séjour par l’adhésion aux « valeurs de la république » ? » (Khiari 2006a).
Là encore, « on arguera bien sûr que, sur le seul CPE, il est possible de gagner ; que pour construire la mobilisation la plus large, il fallait se donner un objectif clair et un seul, qui soit le plus « rassembleur » possible. Mais comment expliquer ce « hasard » qu’il faille toujours mettre de côté les revendications des populations issues de l’immigration pour gagner en efficacité ? » (Khiari 2006).
Les exemples ci-dessus confirment bien qu’il existe, contrairement aux hypothèses de la gauche classique, des divergences d’intérêt entre les non-Blanc•he•s dans leur ensemble et les Blanc•he•s, y compris à travers les organisations des classes populaires blanches. Ces divergences peuvent se manifester par l’exclusion explicite de certain•e•s non-Blanc•he•s – comme ç’a été longtemps le cas des Noir•e•s dans le syndicalisme étatsunien, ou aujourd’hui en France celui des femmes voilées dans les partis politiques de la gauche radicale –, par la secondarisation explicite ou insidieuse des besoins et des préoccupations des non-Blanc•he•s, par une invisibilisation de leurs luttes et de leurs résistances, ou encore par la volonté plus ou moins bienveillante d’annexer ces résistances à l’orbite des partis et syndicats du mouvement ouvrier classique. Il va de soi que ces divergences doivent nécessairement se traduire sur le plan politique.
S’organiser politiquement, c’est prétendre à exercer le pouvoir, à diriger l’organisation de la société. Du point de vue du mouvement ouvrier, le pouvoir consiste, de façon ultime, à diriger la société de sorte que l’oppression capitaliste soit vaincue. La conquête du pouvoir politique par le prolétariat implique un certain nombre de conditions : l’indépendance politique vis-à-vis de la classe dominante, la transformation radicale (ou la destruction) de l’État bourgeois ainsi que des mesures politiques précises pour neutraliser le pouvoir économique et social des propriétaires des moyens de production. De la même manière, l’organisation politique des non-Blanc•he•s vise à diriger la société, à exercer le pouvoir de sorte à faire dépérir le privilège blanc – comme le rappelle Sadri Khiari dans sa contribution qui vient conclure le recueil.
De nombreuses compatibilités existent entre ces deux programmes. Mais l’enjeu ici est, d’abord, de réaliser en quoi ces deux mouvements suivent des trajectoires politiques qui ne sont pas réductibles l’une à l’autre. La constitution d’un pouvoir politique indigène – pour reprendre la formule de Sadri Khiari – s’élabore au travers de mouvements ayant leur propre temporalité comme leur propre espace, leur historicité, leur mémoire spécifique : des luttes anticoloniales aux projets panarabistes ou panafricains, de la Marche pour l’égalité et contre le racisme aux luttes contre les exclusions des femmes portant le hijab, des luttes contre la double-peine à celles contre les violences policières, des révoltes des quartiers populaires à la solidarité avec la Palestine. Si les intérêts entre Blanc•he•s et non-Blanc•he•s sont amenés à diverger, alors la continuité des luttes des descendant•e•s de colonisé•e•s n’a pas la même centralité dans la mémoire et l’héritage politique des partis et organisations de la gauche blanche. Si des fractions de ces organisations, des groupuscules ou des individu•e•s, peuvent se réclamer de l’ensemble de ces moments sous l’égide de l’anti-impérialisme, il n’en reste pas moins que l’espace-temps des indigènes n’est pas structurant pour la vie politique du mouvement ouvrier classique (Khiari 2006b).
Dès lors, même si les forces de la gauche politique et syndicale approchent la question raciale bien différemment de la classe dominante, il demeure que cette approche a échoué dans sa prise en compte de l’essence même de cette question : au lieu de promouvoir (sur le plan théorique comme sur le plan pratique) la dynamique et tout le potentiel portés par l’organisation des forces non blanches, la gauche blanche s’évertue surtout à les décourager – pour preuve, le déclenchement d’une grande hostilité de la part de la gauche de la gauche au lancement de l’Appel « Nous sommes les indigènes de la république » et au moment de la constitution du Parti des indigènes de la république (Lévy 2010).
Ainsi, les forces émancipatrices à gauche persistent à ignorer le potentiel de radicalisation d’ensemble qu’insuffle l’organisation autonome des non-Blanc•he•s en elle-même. Certes, cette organisation est minoritaire, comme le sont les non-Blanc•he•s dans leur ensemble ; elle est fragmentée – en partis, associations, fronts, comités de familles, collectifs, autour de mosquées ou de listes municipales. Mais elle est capable de perturber conséquemment le champ politique classique en proposant notamment des modes d’action riches d’enseignements pour l’ensemble du mouvement social. La campagne Boycott, désinvestissement, sanctions contre l’apartheid et l’occupation de la Palestine (BDS) a mobilisé de larges secteurs des forces non-blanches organisées, et constitue bien l’exemple d’une campagne de longue durée, capable de construire des rapports de force locaux – sous la forme de coalitions de partis, associations et syndicats contre Agrexco dans le Sud de la France par exemple 2 –, une visibilité nationale et des liens avec d’autres forces à l’international. Sans que la lutte ait la même intensité partout et sur une période concentrée, les actions de boycott des produits israéliens dans les supermarchés, les manifestations, les campagnes d’information, peuvent avoir lieu à tout moment, avec toutes les forces qui souhaitent s’y associer, pour des objectifs précis. Ce type de campagne traduit, d’une part, l’internationalisme conséquent visible au creux des manifestations de solidarité avec la Palestine ou des peuples arabes en lutte – qui mobilisent des secteurs de la population non blanche exclus de l’espace politique et militant. Par ailleurs, elle traduit également une capacité à conduire une lutte sur des bases fermes – loin de faire l’unanimité à gauche de la gauche dans le cas de BDS – tout en acceptant toutes les alliances nécessaires pour construire des rapports de forces.
Les modes d’action singuliers que mettent en jeu ce type d’organisation autonome se jouent également aux creux de la violence policière qui frappe spécifiquement et quotidiennement les non-Blanc•he•s : ceci implique que leurs campagnes entrent en conflit direct avec le pouvoir d’État et ses appareils répressifs.
Ainsi on voit combien certains éléments de radicalisation politique sont portés par une minorité consciente de la population, et que la gauche radicale peut non seulement apprendre de cette radicalité, mais sera rapidement confrontée à ses propres inconséquences si elle se refuse à l’appuyer. La lutte contre l’islamophobie et les lois prohibitionnistes, menée depuis au moins 2003-2004, a produit un conflit au sein des forces de gauche que les plus radicales d’entre elles n’ont pas su trancher. Comme l’expliquent Houria Bouteldja et Sadri Khiari :
« Prenons maintenant l’exemple du grand perdant de la recomposition à gauche, le NPA. Ce parti, souvenons-nous, avait traversé de graves difficultés internes lors de la deuxième affaire du voile (2004) alors qu’il était encore la LCR. Ces difficultés se sont aggravées pour se transformer en véritable crise lors des élections régionales de 2010 avec la candidature d’Ilham Moussaid. Cette candidature s’est ajoutée à des désaccords importants concernant les alliances à gauche pour attiser la discorde au sein du NPA et provoquer le départ d’un grand nombre de ses militants. En apparence, l’affaire Ilham n’a rien à voir avec les divergences sur la politique unitaire. Ces deux questions nous paraissent, pourtant, intimement liées. La candidature d’Ilham Moussaid – et la campagne haineuse dont celle-ci a été l’objet dans les médias – a suscité immédiatement un élan de sympathie au sein des populations issues de l’immigration. Considéré jusqu’alors comme un truc « gauchiste », typique du folklore français, le NPA devenait l’objet d’une attention bienveillante. Aveugle ou indifférent à cette évolution qui aurait dû l’intéresser au plus haut point, le parti anticapitaliste a, au contraire, été paniqué par l’hostilité que la candidature d’une femme voilée suscitait parmi les Blancs. On se souvient de la suite, la crise a rebondi au lendemain des élections, conduisant au départ de nombreux militants et notamment de la majorité des militants arabes du Comité NPA auquel appartenait Ilham, ce même comité qui était donné en modèle de « l’intervention quartier » du parti anticapitaliste. En favorisant une telle issue, le NPA montrait ainsi qu’il était incapable de se tourner vers les quartiers » (Bouteldja & Khiari 2012).
Si nous réfutions en amont les conséquences politiques que la gauche tire de l’idée selon laquelle le racisme divise les classes populaires, il y a là, par contre, une division dont elle pourrait tirer de précieuses leçons : l’organisation autonome des non-Blanc•he•s divise la majorité (Breitman 1964). La majorité blanche, dont sont partie prenante aussi bien les partis institutionnels qui soutiennent l’ordre capitaliste que le mouvement social blanc qui en remet en cause certaines de ses conséquences ou même ses fondations, est clivée par les revendications et les luttes des non-Blanc•he•s. Comme nous le disions, dans l’histoire complexe du capitalisme, les oppressions spécifiques et les identités constituent des divergences d’intérêt entre subalternes et différents espaces-temps, différentes communautés de résistance. Mais les résistances des un•e•s ne sont pas sans impact sur le combat des autres. Dans les années 2000, les luttes contre l’islamophobie sont un exemple de division portée au cœur de la majorité blanche. Elles ont ouvert la voie à la candidature d’Ilham Moussaïd, qui a scandalisé tout le champ politique blanc, tout en suscitant la confusion au sein du NPA sur son positionnement face au consensus islamophobe. Le NPA s’envisage comme un parti des classes populaires dans leur ensemble, comme un parti qui s’oppose aux partis institutionnels et à leur politique, mais il n’a pas su, d’un même mouvement, briser le consensus islamophobe en se solidarisant avec sa candidate face aux attaques de tout le monde politique.
Plus le mouvement de l’immigration gagne en cohésion et en fermeté, plus il est à même de demander des comptes, à propos de ses propres préoccupations, aux candidat•e•s, partis, syndicats et associations du monde blanc. Ces interpellations suscitent des désaccords, des polémiques, un éventail de positions dans le champ politique blanc, en premier lieu parce que ce champ politique ne peut pas faire « sans » les non-Blanc•he•s et donc, se dispenser totalement de concessions à leur égard. Si les partis institutionnels, les partis blancs qui soutiennent l’ordre capitaliste, sont incapables de concessions d’ampleur, dans la mesure où leur aile gauche n’a même plus l’ambition de faire des concessions aux classes populaires dans leur ensemble, les partis et organisations de la gauche radicale doivent bien faire avec la réalité que : « lorsque l’on regarde les chiffres officiels de la population française (…) 30 % des milieux populaires (ouvriers et employés) sont issus de l’immigration postcoloniale 3. C’est peut-être à partir de là qu’il faut entendre le mot d’ordre de la mobilisation du 8 mai 2012 qui réunissait bon nombre d’organisations de l’immigration et des quartiers populaires : « Nous ne comptons pas sur eux et ils ne pourront plus faire sans nous ! » 4.
C’est à partir de ces éléments d’antagonismes que la minorité (raciale, en l’occurrence) cesse d’être une minorité : en devenant capable de disloquer le groupe majoritaire, l’organisation non blanche bénéficie d’une certaine marge de manœuvre, peut avoir un impact majeur et jouer un rôle prépondérant dans les rapports de force. Cette division de la majorité peut porter des bénéfices bien au-delà de la minorité. En effet, en mettant à jour les difficultés du bloc dominant, ses faiblesses et sa vulnérabilité, le combat minoritaire ouvre des opportunités de transformation et des possibilités d’alliances prometteuses sur de nouvelles bases :
« Si l’homme blanc est l’ennemi, tous les Blancs sont-ils des ennemis équivalents ? – aussi bien les Blancs qui ont le pouvoir dans ce pays, les dirigeants, que les Blancs qui n’ont pas le pouvoir, et qui sont exploités par ceux qui dirigent – pas aussi exploités que les Noirs, mais exploités aussi ? Si le Blanc est l’ennemi, y a-t-il un moyen de diviser l’ennemi, de le pousser à la séparation, de creuser un fossé au sein des Blancs, de les pousser à se battre les uns contre les autres – au bénéfice du Noir ? Si le Blanc est l’ennemi, y a-t-il un moyen de transformer la situation de manière à ce que certains Blancs soient démobilisés ou neutralisés, ou même, dans certaines circonstances, transformés en alliés ou alliés potentiels du Noir parce que ce serait dans leur propre intérêt ? » (Breitman 1967).
Ce qu’il faut entendre dans la proposition de recherche Race et capitalisme, ce n’est ni la mise en concurrence de deux systèmes, ni la subordination de l’un par l’autre, ni une articulation principielle. C’est comprendre sur le terrain de la théorie ce qui se joue sur le plan pratique dans la constitution historique de majorités blanches, leurs contradictions internes et les voies par lesquelles leur hégémonie peut être remise en cause, neutralisée, au profit de nouvelles majorités émancipatrices.
Bibliographie :
Allen Theodore, « White Supremacy in U.S. History », un discours prononcé au Guardian Forum on the National Question, le 28 avril 1973.
Bouteldja Houria & Khiari Sadri, « L’Évolution en ciseaux des champs de l’antiracisme », 2012.
Breitman George, « How A Minority Can Change Society », International Socialist Review, Vol.25 No.2, Spring 1964, p. 34-41.
Breitman George, « Myths About Macolm X », discours au Detroit Friday Night Socialist Forum, 1967.
Katznelson Ira, When Affirmative Action Was White: An Untold History of Racial Inequality in Twentieth-Century America, WW Norton, 2005.
Khiari Sadri, « À propos des mobilisations contre le CPE », http://www.indigenes-republique.fr/, jeudi 6 avril, 2006a.
Khiari Sadri, Pour une politique de la racaille, Textuel, 2006b.
Lévy Laurent, « La Gauche », les Noirs et les Arabes, La fabrique, 2010.
James Cyril Lionel Robert, Les Jacobins noirs, éditions Amsterdam, 2008.
Sayad Abdelmalek, L’Immigration ou les paradoxes de l’altérité, Raisons d’agir, 2006.
Williams Eric, Capitalism & Slavery, University of North Carolina Press, 1944.
Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.
à voir aussi
références
| ⇧1 | Comité de soutien à Houria Bouteldja, « Le procès qui accuse Houia Bouteldja : un cas d’école », 2011. |
|---|---|
| ⇧2 | « Une victoire du BDS et de la « Coalition contre Agrexco ! » ». |
| ⇧3 | « Entretien avec Saïd Bouamama : Pourquoi Sarkozy ne peut pas nettoyer la racaille au Karcher ? ». |
| ⇧4 | Premiers signataires : Action Citoy’Aisne, Alliance Noire Citoyenne(ANC)/Brigades Anti-Négrophobie, Alternative Libertaire, Art de la paix, Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF), Campagnes Civiles Internationale Pour la Protection du peuple Palestinien (CCIPPP), Coup pour Coup 31, Collectif des Musulmans de France (CMF), Déchoukaj, ETM 31 (Egalité Toulouse Mirail), Europalestine, « Ensemble à Bagnolet », Epices, Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR), Fondation Frantz Fanon, Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires (FUIQP), Génération Palestine (GP), Générations Spontanées contre le racisme et l ’islamophobie, GUPS (Union Générale des Étudiants de Palestine), Groupe Frantz Fanon, H.I.J.A.B., Les Indivisibles, Mouvement des Quartiers pour la Justice Sociale (MQJS), Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Parti des Indigènes de la République (PIR), Printemps des quartiers, Quartiers Nord Quartiers Forts, Union Juive Française pour la Paix (UJFP), Uni’T, Vies Volées, Zone d’Expression Populaire (ZEP). |







