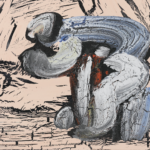Superprofits et dividendes : ce que (nous) coûte le capital
Le gouvernement macroniste et les économistes de cour n’ont cessé de critiquer la proposition de taxer les « superprofits » que s’arrogent les géants de l’économie – notamment dans le secteur de l’énergie et de l’agro-alimentaire. Pour bien comprendre ce qui se joue, il faut avoir en tête la manière dont fonctionne le capitalisme actuel dans son ensemble, marqué par une ponction énorme et permanente de la part des marchés financiers. C’est ce que permet le livre qu’Attac et l’Observatoire des multinationales ont consacré récemment à cette question (aux éditions Les Liens qui libèrent), dont nous publions ici le 1er chapitre.

Dividendes et rachats d’actions : la ponction des marchés financiers
« Les superprofits, je ne sais pas ce que c’est. »
Bruno Le Maire à l’université d’été du Medef, août 2022
Les années se suivent et se ressemblent à la Bourse de Paris. Chaque printemps, pendant la saison des assemblées générales annuelles des actionnaires, les grands groupes du CAC40 annoncent de nouveaux records de versements de dividendes et de rachats d’actions. Au printemps 2018, ce sont ainsi 55,2 milliards d’euros qui ont été octroyés directement ou indirectement aux actionnaires. L’année suivante, ce sera 63,4 milliards. Après une brève période de recul partiel due à la pandémie de Covid-19, ils sont immédiatement repartis à la hausse, atteignant près de 80 milliards d’euros au printemps 2022 – un record historique… qui risque fort d’être battu au printemps 2023, sur fond de poursuite des « superprofits » de beaucoup de grandes entreprises françaises.
TotalEnergies a ainsi annoncé un bénéfice record pour 2022 de 19 milliards d’euros – et même de 34 milliards d’euros si l’on ne tient pas compte des dépréciations comptables liées aux conséquences de l’agression russe en Ukraine. Beaucoup d’autres groupes ont battu leurs records de profits à l’image de Stellantis (17 milliards d’euros), LVMH (11 milliards) ou encore BNP Paribas (plus de 10 milliards).
La hausse des dividendes versés par les grandes entreprises françaises est une tendance lourde. Selon un calcul de l’Observatoire des multinationales portant sur un échantillon de 26 groupes du CAC40, leurs versements de dividendes ont augmenté en 20 ans (entre 2000 et 2020) de 265%, soit une multiplication par trois et demi. L’ONG Oxfam et le bureau d’études Le Basic se sont eux aussi penchés sur le sujet et montrent que non seulement les dividendes du CAC40 augmentent beaucoup plus rapidement que l’investissement et la rémunération des salariés, mais aussi que les entreprises françaises sont parmi les plus généreuses au monde envers leurs actionnaires, bien plus par exemple que leurs homologues européennes.
Un tribut versé aux seigneurs de la finance
Ces chiffres, qui font régulièrement la une des médias, ont fait du CAC40 le symbole d’une accumulation de richesses de plus en plus déconnectée de la situation réelle de l’économie et de la société. Les dividendes ne sont pas seulement une affaire de gabegie des super-riches, baignant dans les milliards d’euros tandis que les autres ont du mal à boucler leur fin de mois. Ils ne sont pas non plus, évidemment, une juste récompense des prétendus « risques » pris par les actionnaires en plaçant leur argent, comme le prétendent les éléments de langage qui nous sont habituellement servis par les défenseurs des marchés financiers. Ils sont une ponction toujours croissante, au profit des marchés financiers, des richesses générées par les entreprises, leurs travailleurs et travailleuses, grâce à leurs clients, aux pouvoirs publics et à la collectivité dans son ensemble. Ils sont un tribut en augmentation constante que nous payons indirectement chaque année à la bourse – une sorte d’impôt privé imposé par les seigneurs de la finance.
C’est pourquoi on parle aujourd’hui de plus en plus de la notion de « coût du capital », dont les dividendes et rachats d’actions ne sont que l’aspect le plus visible. On nous prétend qu’il ne s’agit que de l’argent durement gagné et mérité par les actionnaires ; en réalité, c’est un coût imposé à la société.
On veut aussi nous faire croire que la bourse et les marchés seraient nécessaires pour permettre aux entreprises de se financer, et donc d’investir et de créer de l’emploi, et qu’elles n’auraient donc pas d’autre choix que de se soumettre aux exigences des investisseurs. Il n’en est rien : certes, les grandes entreprises émettent encore occasionnellement de nouvelles actions sur les marchés pour se financer, mais elles ont davantage recours à l’autofinancement et au crédit. Si l’on compare d’un côté les émissions d’actions (autrement dit l’argent qui va des marchés financiers dans les caisses des grandes entreprises) et de l’autre les dividendes et rachats d’actions (l’argent qui va des caisses des grandes entreprises vers les marchés financiers), on s’aperçoit que la différence est… négative. En réalité, les marchés financiers ne sont pas là pour financer les entreprises, ou très peu. Ils sont là pour prélever leur écot.
Grâce aux éléments partiels divulgués par le CAC40 sur son actionnariat, il est possible de mettre un nom sur les principaux bénéficiaires de cette générosité mal placée. Chaque année, ce sont les mêmes qui reviennent en tête de ce classement : Bernard Arnault et BlackRock. On ne saurait mieux mettre en lumière au service de qui, en dernière instance, tout le système opère – ceux à qui nous payons notre tribut : d’un côté les milliardaires, et de l’autre côté les grands investisseurs de Wall Street qui gèrent, notamment, l’argent des fonds de pension. Au titre de l’année 2021, le groupe de Bernard Arnault a touché 2,4 milliards de dividendes grâce à sa participation dans LVMH. BlackRock, de son côté, est présent au capital de la quasi-totalité des groupes de l’indice parisien, généralement à hauteur de quelques pourcents : selon les chiffres disponibles (car les « petites » participations au capital ne sont pas forcément publiques), il a touché au moins 2 milliards d’euros de dividendes au titre de l’année 2021. Ils sont suivis par l’État français (on y revient au chapitre suivant), les familles Bettencourt (L’Oréal), Pinault (Kering), le fonds Amundi et la famille Hermès.
Dividendes et rachats d’actions : de quoi s’agit-il concrètement ?
Un dividende est en théorie une partie des profits annuels engrangés par une entreprise qui est reversée l’année suivante à ses actionnaires, à hauteur de quelques centimes ou quelques euros par action. Comme le capital des groupes du CAC40 est réparti en millions d’actions, les sommes cumulées versées aux actionnaires peuvent rapidement s’élever à des centaines de millions, voire des milliards d’euros. Le niveau de dividendes est assez variable au sein du CAC40, en fonction de la capitalisation boursière et du chiffre d’affaires brassé par les différents groupes : les plus gros verseurs de dividendes du CAC40 sont traditionnellement TotalEnergies, Sanofi, les groupes de luxe comme LVMH ou L’Oréal et les grandes banques.
Rien n’oblige une entreprise à verser des dividendes. Beaucoup de groupes en développement rapide s’abstiennent de verser des dividendes afin de pouvoir embaucher et investir – cela a par exemple été le cas de géants du numérique comme Amazon à ses débuts et aujourd’hui des plateformes comme Uber. La place croissante prise par les dividendes est souvent le signe d’un passage à une logique d’investissement à une logique de rente.
Quant aux rachats d’actions, il s’agit d’une pratique de plus en plus répandue consistant pour les entreprises à acquérir leurs propres actions en bourse auprès des actionnaires existant en vue de les supprimer. À valorisation boursière constante et avec un nombre d’actions moindre en circulation, la « valeur » détenue par les actionnaires restant augmente mécaniquement en proportion. Les rachats d’actions du CAC40 ont atteint en 2021 le niveau record de 22,4 milliards d’euros. Nageant dans le cash grâce à leurs superprofits et aux aides publiques directes et indirectes, les géants français ne savent apparemment plus trop quoi faire de leur argent, et en consacrent une part croissance à ces opérations de pure ingénierie financière très avantageuses pour les actionnaires, qui bénéficient en outre d’un régime fiscal extrêmement favorable.
Au service du sacro-saint dividende
La priorité accordée au versement de dividendes, que l’on constate au niveau du CAC40 dans son ensemble, se vérifie au niveau de chaque entreprise : dans beaucoup de cas, le dividende fixé augmente mécaniquement et comme inexorablement d’année en année, comme une machine bien huilée. Quels que soient les bénéfices effectivement réalisés, quelle que soit la situation économique générale, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il y ait une pandémie, il y a comme un droit sacré des actionnaires non seulement à bénéficier d’un dividende, mais encore de bénéficier d’un dividende supérieur à celui de l’année précédente.
Le dividende d’entreprises comme Sanofi et Air Liquide a ainsi augmenté sans interruption chaque année entre 2006 et 2021. Celui de L’Oréal est passé sur la même période d’un peu plus de 1 euro par action à 4,8 euros. Il n’y a qu’au printemps 2020, en raison de l’épidémie de Covid, que ses dirigeants ont condescendu à réduire le dividende prévu – mais de quelques pourcents à peine. Certes, certaines entreprises n’ont parfois pas eu d’autre choix que de baisser ou suspendre leur dividende – par exemple Renault pendant la pandémie ou encore BNP Paribas suite à la crise financière de 2008 puis encore au moment du Covid lorsque la Banque centrale européenne l’a imposé. Mais cela a été à chaque fois pour repartir de plus belle à la hausse.
Certaines entreprises vont même jusqu’à s’endetter pour pouvoir verser leurs dividendes. Plusieurs exemples ont fait la une des médias ces dernières années, comme celui de Veolia dont les dirigeants ont redoublé de générosité pour amadouer leurs actionnaires à un moment où l’entreprise était chahutée en bourse. Cela a aussi éte le cas de SFR-Altice, des sociétés concessionnaires d’autoroute (filiales de Vinci et Eiffage), ou encore – comble du comble – d’EDF, alors que le bénéficiaire de l’immense majorité de ce dividende n’était autre que… l’État français, alors actionnaire à 84% de l’entreprise.
Il n’est pas rare que des grandes entreprises versent davantage de dividendes qu’elles n’ont engrangé de profits l’année précédente. Oxfam et Le Basic ont montré qu’entre 2009 et 2016, Engie, Veolia et ArcelorMittal avaient globalement versé des dividendes supérieurs – et parfois largement supérieurs – à leurs bénéfices effectifs durant la période. Au printemps 2021, c’est le CAC40 dans son ensemble qui a reversé à ses actionnaires l’équivalent de presque 160% des profits générés en 2020 – autrement dit, tous les bénéfices accumulés cette année-là plus 60% supplémentaires prélevés directement dans ses caisses. Ce qui n’a pas empêché le gouvernement français de continuer à créer de nouvelles aides publiques et de poursuivre ses baisses d’impôts, en refusant que ces aides directes et indirectes soient assorties, comme le demandaient des députés, des syndicats et des ONG, de restrictions sur les versements aux actionnaires.
La malédiction actionnariale
Cette « préférence française » pour le dividende constitue une véritable malédiction pour les entreprises et leurs travailleuses et travailleurs. Sur le plan économique, la proportion croissante des bénéfices reversés aux actionnaires représente autant d’argent qui n’est pas consacré à investir, à embaucher, à augmenter les salaires ou à améliorer la situation financière de l’entreprise si elle est en difficulté.
C’est notamment, mais pas seulement, un enjeu de « partage de la valeur ajoutée » – autrement dit d’équilibre entre les profits et la rémunération du capital, les salaires et la contribution fiscale. L’augmentation inexorable des dividendes a pour pendant la baisse de la part du travail (masse salariale) dans la valeur ajoutée et celle des impôts acquittés en France et ailleurs. Au détriment donc des salariés et salariées du CAC40 et des finances publiques (voir Chapitres 5 et 6).
On peut aller plus loin encore : elle se fait aussi au détriment de toutes celles et ceux qui gravitent autour des grands groupes. Les client·es supportent des prix qui ne baissent pas d’année en année ; les fournisseurs et les sous-traitants se voient imposer des contraintes de coûts et de délais accrues (voir Chapitre 9) ; les riverain·es, en France et ailleurs, sont confrontés à une dégradation de leur environnement naturel…
C’est toute la machine que constituent les grandes entreprises et leur sphère d’influence qui sont orientées en fonction de l’exigence finale de redistribution la plus généreuse possible aux actionnaires et aux marchés financiers. C’est pour cela que l’on délocalise les emplois, que l’on multiplie les plans d’économies et de réductions des coûts, que l’on intensifie le travail, que l’on évite l’impôt, que l’on laisse les salaires stagner, que l’on pressurise les fournisseurs et les clients. Et, quoi que l’on veuille nous faire croire aujourd’hui, cela n’a rien d’inéluctable.
Profits contre coût de la vie
Depuis le début de l’année 2022, l’inflation frappe tout particulièrement les ménages les plus modestes : hausse des prix des carburants, de l’énergie de manière générale, et de nombreux produits de grande consommation. L’inflation alimentaire atteint 14,5% entre les mois de février 2022 et 2023 selon l’INSEE.
Mais pour certains grands groupes, la crise du coût de la vie s’avère… une aubaine. Le Wall Street Journal l’affirme candidement : le contexte inflationniste post-Covid a constitué une « occasion comme il n’en existe qu’une par génération pour augmenter leurs prix ». Et ainsi d’accroître leurs marges. Cela a été particulièrement le cas dans le domaine de la finance, des télécoms, de l’aviation ou de l’industrie pharmaceutique. Les géants de l’agro-alimentaire ont même imposé une hausse de leurs prix… y compris dans une période où le cours des matières premières était à la baisse.
C’est l’expression même du pouvoir de marché des grandes firmes : elles sont en mesure de tirer profit du contexte inflationniste. Ainsi s’expliquent les bénéfices exceptionnels des grandes multinationales françaises comme Total, Engie, Vinci (pour les autoroutes), Sanofi ou encore l’armateur CGA-CGM. Ce dernier affiche un bénéfice de 23,5 milliards d’euros en 2022, sans précédent dans l’histoire économique française, grâce aux prix élevés dans le secteur de la logistique et du transport… Et qui, comme les prix de l’énergie, alimentent l’inflation généralisée et la crise du coût de la vie.
A cette situation, les gouvernants ne semblent pas prêts de remédier. La Banque centrale européenne (BCE) et le gouvernement français continuent de promouvoir des orientations délétères pour lutter contre l’inflation : comprimer les salaires et réduire la demande en augmentant les taux. Une politique de rigueur qui frappera une nouvelle fois les catégories les plus pauvres. Pourtant même la très orthodoxe a dû le reconnaître : l’inflation est tirée par la volonté des grands groupes de maintenir des résultats élevés. Bref : ce sont les profits qui font les hausses de prix !
Des dirigeants « accros » aux dividendes
Ce n’est pas un hasard si, chaque année, les controverses sur les dividendes sont accompagnées de discussions tout aussi enflammées sur les montants record empochés par les dirigeants des grandes entreprises françaises. Les patrons de Sanofi, de Dassault Systèmes, de Teleperformance ou encore de Kering touchent désormais plus de 10 millions d’euros par an, et parfois beaucoup plus. Il faut environ cinq années à un employé de Teleperformance pour toucher autant que son PDG en un jour.
Il y a quelques décennies, un dirigeant était encore avant tout un salarié de son entreprise, qui touchait une rémunération fixe, certes confortable, mais pas totalement déconnectée de celle de ses subordonnés. Aujourd’hui, les parts fixes ne représentent plus qu’un cinquième à peine de la rémunération des patrons du CAC40. Les parts variables – largement indexées sur les performances financières et boursières de l’entreprise – représentent près de 30% du total. Les paiements en actions, quant à eux, en constituent près de la moitié. Cette évolution n’a rien d’un hasard.
La structuration des rémunérations des dirigeants d’entreprise a été pensée par les intellectuels organiques de Wall Street pour aligner solidement les intérêts économiques des dirigeants sur ceux des actionnaires plutôt que sur ceux des employés. Plus l’entreprise prospérera en bourse et sera généreuse envers ses actionnaires, plus élevée sera la rémunération des dirigeants. On s’étonne moins de leur propension à augmenter les dividendes d’année en année.
C’est aussi pourquoi la solution aujourd’hui mise en avant par le gouvernement et une partie du patronat, avec le slogan du « dividende salarié », est un jeu de dupes. Il s’agit en réalité de poursuivre et étendre une politique mise en place par de Gaulle dans les années 1960, consistant à acheter la paix sociale en proposant aux salariés – ou du moins aux plus favorisés d’entre eux – de devenir actionnaires de leur propre entreprise. L’idée est que s’ils bénéficient d’une fraction des dividendes versés chaque année par les grandes entreprises – même si ce ne seront jamais que quelques gouttelettes par rapport à ce qu’empochent Bernard Arnault ou BlackRock – ils seront moins enclins à critiquer leurs patrons ou à demander des augmentations de salaires. Soit un peu le même tour de passe-passe qu’avec les dirigeants, mais à l’échelle de tout le groupe (ou du moins des salariés de nationalité française). Cela revient à vouloir faire entériner par les salariés eux-mêmes le primat de la finance et des actionnaires.
Une logique de rente délétère
La machine à cracher des dividendes pourra-t-elle jamais s’arrêter d’elle-même ? À long terme, l’expansion infinie des versements aux actionnaires ne peut être que profondément délétère pour les entreprises elles-mêmes. Elle se fait comme on l’a vu aux dépens des salaires, de l’emploi et de la contribution fiscale, mais aussi aux dépens de l’investissement – condition indispensable pour assurer la pérennité et la viabilité des entreprises à long terme, ainsi que pour répondre à l’urgence climatique. Force est de constater que les grandes entreprises françaises, installées dans une logique de rente, investissent peu.
Et quand elles le font, ce n’est en général pas en France, mais pour s’étendre à l’étranger – « aller chercher la croissance là où elle est », selon l’expression consacrée. Les superprofits et les dividendes étant intouchables, à chaque fois qu’il faut investir en France même, elles réclament l’aide de l’État. Besoin de moderniser leurs usines et leurs équipements pour réduire les pollutions et les gaz à effet de serre ? De relocaliser une petite partie de leur production ? De créer des emplois ? Le gouvernement vient toujours à la rescousse, inventant une nouvelle forme d’aide publique pour satisfaire les exigences des grands groupes. À lire les communiqués de presse, on pourrait avoir l’impression que ces derniers réalisent régulièrement d’importants investissements en France ; il suffit de lire les notes de bas de page pour prendre conscience que la puissance publique couvre en général une proportion non négligeable desdits investissements, en laissant le secteur privé s’en attribuer tout le mérite.
L’autre conséquence de la soumission aux marchés et aux intérêts des actionnaires est qu’au sein des grands groupes les stratégies financières prennent le pas sur les stratégies industrielles. Cela se traduit par exemple par des grandes fusions prestigieuses – Alcatel avec Lucent, Lafarge avec Holcim, Technip avec FMC, Essilor avec Luxottica, PSA avec Fiat, Veolia avec Suez, Alstom avec Bombardier – qui n’ont souvent de sens que parce qu’elles satisfont les égos des dirigeants, enrichissent les banquiers et les avocats d’affaires qui concluent les deals, permettent de justifier des suppressions d’emploi sous prétexte d’« économies d’échelle », et justifient le versement de dividendes exceptionnels au nom de la « valeur » ainsi créée comme par magie… et qui souvent ne se matérialise pas. Si la France a perdu tant de fleurons industriels ces dernières années, c’est certes en raison de l’incurie de nos responsables politiques, mais c’est aussi parce que leurs propres dirigeants et actionnaires ont orchestré ces opérations au nom du primat des marchés.
*
Illustration : Wikimedia Commons.