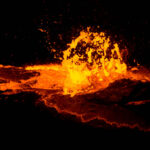Chili, 11 septembre 1973 : « il n’y a jamais eu de barricades à rejoindre »
Marc Cooper est journaliste et écrivain, il a été le traducteur de Salvador Allende. Il a quitté le Chili huit jours après le coup d’État du 11 septembre 1973 sous la protection du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Il restitue dans cet article l’atmosphère au sein de la gauche dans la période qui a précédé le coup d’État qui mit brutalement fin à l’expérience de l’Unité populaire et aboutit à l’assassinat sauvage de milliers de militant-es. Il présente les options stratégiques qui étaient défendues à l’époque parmi les forces de gauche et assure que la voie choisie par Allende était loin d’être absurde. Le débat demeure évidemment ouvert sur l’une des expériences de transformation sociale les plus riches, et à bien des égards, l’une des plus tragiques, pour la gauche au 20e siècle.
***
Quelques semaines avant le coup d’État de 1973 qui a renversé Salvador Allende, pour lequel je travaillais en tant que traducteur, un ami argentin qui avait été mon colocataire est venu me rendre visite. Son nom de guerre était Django. Il avait été guérillero dans l’ERP (Armée révolutionnaire populaire) et était en exil au Chili. Sa sœur, qui s’était également retrouvée au Chili, avait été l’une des prisonnières politiques les plus célèbres d’Argentine et avait également séjourné dans mon appartement pendant un certain temps.
Django s’est assis à la fenêtre de mon salon, au 17e étage, et a contemplé avec tristesse l’étendue de Santiago. « Ça va être la merde », m’a-t-il dit, « ce sont les derniers jours ». Il a ensuite sorti de sa veste un Browning 9 millimètres semi-automatique et a déclaré sans ambages : « Ils ne me prendront pas vivant. J’ai déjà enquêté sur l’ambassade de Suède et, s’il le faut, je tirerai pour me frayer un chemin quand le coup viendra ».
À l’époque, il n’était pas choquant d’entendre quelqu’un parler de la possibilité ou de la probabilité d’un d’un coup d’État. C’est juste que personne, du moins personne que je connaissais, n’avait la moindre idée du moment où il se produirait ou de ce à quoi il ressemblerait. Je faisais partie des naïfs et des romantiques qui, d’une part, croyaient qu’une confrontation armée était probable et supposaient – ou du moins espéraient – que les forces armées se diviseraient et qu’un bon nombre de recrues issues de la classe ouvrière rejoindraient l’autre côté des barricades et défendraient le gouvernement démocratique contre les fascistes.
Il s’est avéré qu’il n’y a jamais eu de barricades à rejoindre, et bien que quelques poches de l’armée et de la marine aient été prêtes à résister au coup d’État, elles ont été rapidement étouffées et n’ont pas réussi à entraîner qui que ce soit.
À l’époque, je pensais – comme beaucoup d’autres personnes et comme les militaires – que les dés avaient été jetés pour renverser d’Allende quelques semaines plus tôt. Le 29 juin 1973, un petit régiment de chars, soutenu par un groupe civil néo-fasciste, a organisé une tentative de coup d’État [le tancazo] qui n’a abouti à rien, mais qui a fait 22 morts. Alors la riposte à cette tentative de coup était en cours, Allende a appelé les travailleurs à s’emparer de leurs lieux de travail et à les occuper. Il s’agissait sans doute pour lui d’une mesure défensive temporaire, mais les travailleurs chiliens ne l’entendaient pas ainsi. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, ils ont refusé de rendre des usines et l’opposition politique a parlé plus ouvertement d’un coup d’État. Les forces productives du Chili étaient entre les mains de travailleurs organisés mais non armés.
Ensuite, il y avait la faction plus modérée du gouvernement de l’Unité populaire, dirigée par le Parti communiste chilien (PCC), qui semblait croire qu’un coup d’État ou une guerre civile pouvaient être évités par la répétition de slogans. Ainsi, pendant des semaines, nous avons été inondés de propagande du PCC martelant « Non, non, non, non à la guerre civile » ! Cela a atteint des proportions plutôt tragicomiques lorsque le même parti a organisé une campagne de pétition contre la guerre civile – je ne sais pas exactement à qui elle était adressée. Il a ensuite organisé un marathon télévisé sur la chaîne 9 de l’université du Chili, appelant à nouveau les gens à s’opposer à la guerre civile. Je n’ai pas trouvé cela très logique.
À l’époque, au cours d’un de mes déjeuners, j’ai rendu visite à Hugo Blanco, le légendaire révolutionnaire péruvien en exil, pour lui demander son avis sur la confrontation imminente. Il a été direct et simple : « Si vous pensez qu’il va pleuvoir, a-t-il dit, c’est probablement une bonne idée d’acheter des parapluies ».
Le président Allende et son cabinet, qui était divisé sur cette question, avaient une stratégie de désescalade. Après l’échec de la tentative de coup d’État du 29 juin, Allende a demandé au parti démocrate-chrétien de centre-droit (mais de moins en moins au centre et de plus en plus à droite) d’entamer un dialogue avec la gauche dans le but d’entrer finalement comme partenaire minoritaire dans le gouvernement afin d’élargir sa base et de stabiliser la situation. Allende a beaucoup insisté dans ce sens. Les communistes aussi.
Mais l’aile gauche du Parti socialiste d’Allende, un autre parti appelé MAPU et le MIR [gauche révolutionnaire extraparlementaire] se sont opposés à tout dialogue ou compromis et ont plutôt appelé au renforcement des organes du pouvoir populaire. J’appartenais fermement à cette faction et, pour être honnête, la seule arme à feu que je possédais était un pistolet argentin de calibre 22 à six coups, que j’avais payé 6 dollars et qui aurait probablement explosé si j’avais appuyé sur la gâchette.
Le débat sur le compromis n’a finalement pas abouti. Après des débuts hésitants, la Démocratie chrétienne rompt les négociations. Quelques jours plus tard, le 22 août, elle signe avec le Parti national d’extrême droite une déclaration publique commune appelant les militaires à renverser le gouvernement Allende. Lorsque le commandant en chef de l’armée, Carlos Prats, favorable à la démocratie, fut contraint de démissionner après avoir perdu la confiance du corps général, il devenait évident qu’un coup d’État était sur le point de se produire.
Mais que faire ? Le 4 septembre 1973 – troisième anniversaire de l’élection d’Allende et une semaine avant le coup d’État – la gauche a fait sa dernière grande apparition publique. Environ un million de Chiliens défilèrent pendant des heures dans la nuit devant les portes du palais présidentiel de la Moneda, tandis qu’Allende les saluait du haut d’un balcon. Les chants étaient presque uniformes : « Allende, Allende, le peuple te défend ! », « Le peuple armé ne sera jamais écrasé ! », « Nous voulons des armes ! ».
C’était une scène à la fois héroïque et pathétique. Héroïque parce que la gauche chilienne, organisée et massive, était prête à se battre, alors que tout le monde savait qu’il n’y avait pas d’armes et qu’il était impossible d’armer des dizaines de milliers de travailleurs. Une semaine plus tard, le coup d’État liquidait l’expérience des trois années de la révolution chilienne et d’un siècle entier de gouvernements démocratiques.
Allende n’était pas un imbécile. Il n’était pas indifférent au risque qu’il prenait. Il n’était pas non plus naïf quant aux conséquences d’un échec. Ceux qui ne vivent pas au Chili se sont empressés de critiquer Allende en lui demandant pourquoi il n’avait pas armé les travailleurs. Je suis généralement sidéré par une question aussi stupide, qui émane généralement de révolutionnaires de salon basés aux États-Unis.
Aucun de ces critiques n’a jamais pu clarifier trois détails importants d’un tel « plan » : 1) D’où seraient sorties ces millions d’armes ? Comment le gouvernement était-il censé les acquérir sans que l’armée s’en aperçoive ? 2) Comment les distribue-t-on et comment forme-t-on les gens qui sont armés ? 3) Et comment vaincre une armée, une armée de l’air, une marine et une police nationale militarisées, professionnelles et hautement entraînées, surtout lorsqu’elles savent que vous vous armez et qu’elles veulent frapper en premier ?
Plus précisément, la révolution pacifique n’était pas une option tactique pour Allende. C’était l’œuvre de sa vie et de son engagement. Il s’est présenté pour la première fois à l’élection présidentielle en 1958. Les partis qui l’ont porté au pouvoir soutenaient le système parlementaire et travaillaient dans son cadre depuis des décennies. Il en a été de même pour les deux piliers de sa coalition : les communistes et les socialistes, bien que ces derniers aient adopté une position plus radicale au cours de la dernière année.
Allende a agi dans le cadre des paramètres de la guerre froide ; il n’était donc pas prêt à critiquer publiquement les États staliniens de l’époque en les qualifiant de non-démocratiques. Mais il a fait de son propre engagement en faveur de la démocratie une valeur absolue. Il devrait être admiré, respecté et célébré pour cela, car trop de gens de gauche sont prêts à tolérer l’oppression et la répression qui n’étaient pas seulement la marque de fabrique de l’Union soviétique et de la Chine, mais aussi de Cuba et du Viêt-Nam.
Après 50 ans de réflexion, je suis arrivé à la même conclusion que nombre de mes anciens amis et camarades qui partageaient ma vision de « zéro concession » en 1973. Allende avait raison. Il avait été élu avec 35 % des voix. Près de trois ans plus tard, lors de deux élections, l’Unité populaire a obtenu un étonnant 44 % dans les conditions de l’hyperinflation et du chaos politique. Mais la gauche était toujours minoritaire. Cela signifie que, même si les armes étaient apparues comme par magie, la seule voie vers la victoire et la stabilité aurait été une autre dictature de gauche, quelque chose d’étranger au caractère et aux désirs d’Allende.
La seule issue en 1973 était une sorte de compromis avec la Démocratie chrétienne pour élargir la base du gouvernement et désamorcer l’escalade. Ceux d’entre nous qui s’y opposaient étaient naïfs. Les communistes étaient favorables au dialogue et, bien qu’Allende ait été en phase avec le PCC sur le plan programmatique, il n’était pas idéologiquement aligné sur eux – franchement, c’était une bande de durs à cuire et trop sectaires pour qu’on puisse s’entendre avec eux. En outre, je ne suis pas prêt à me porter garant du type de société post-révolutionnaire auquel ils aspiraient, car il n’était probablement pas le même que celui d’Allende.
Salvador Allende a sans doute été le véritable père du socialisme démocratique révolutionnaire bien avant l’émergence de son incarnation actuelle, plus modérée. C’est pourquoi il devrait occuper une place centrale dans le panthéon des grands leaders de la gauche.
PS : Dix ans après le coup d’État, je suis allé à Stockholm pour quelques jours. J’ai regardé dans l’annuaire et il y avait le numéro et l’adresse de Django. Il avait réussi à s’en sortir vivant.
*
Marc Cooper est actuellement professeur de journalisme à la USC Annenberg School.
Ce texte est initialement paru dans Jacobin America Latina. Traduction Contretemps.
Illustration : Wikimedia Commons.
![Chili 73 : un coup d’État qui permit la contre-révolution néolibérale [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/golpe-chile-1973-150x150.jpg)