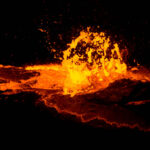Leçons chiliennes. Comment affronter la contre-révolution
Ralph Miliband (1924-1994) fut, de l’avis général, l’un des plus importants théoriciens marxistes britanniques de l’après-guerre. Un pionnier, avec Nicos Poulantzas et les courants gramsciens d’Italie et d’Amérique latine, du renouveau de la théorie politique marxiste dans les années 1960 et 1970, il est pourtant resté très injustement méconnu dans l’hexagone.
Seul son ouvrage classique L’Etat dans la société capitaliste, paru en 1969, a bénéficié d’une traduction française (Maspero, 1973) ; rapidement épuisé, il a fallu attendre pas moins de 40 ans pour qu’il soit réédité – par un éditeur universitaire d’outre-Quiévrain. Son débat avec Nicos Poulantzas sur la conceptualisation adéquate à l’Etat capitaliste, un moment marquant de l’effervescence théorique des années 1970, initialement paru dans les pages de Politique aujourd’hui (en français) et de la New Left Review (en anglais), constamment réédité (et étudié) dans le monde anglophone, était introuvable en français jusqu’à sa reprise, en 2015, par Contretemps (ici et ici).
Miliband était tout sauf un marxiste de la chaire ; militant du Parti travailliste dans les années 1950, il devient l’une des figures de proue de la « Nouvelle Gauche » britannique et reste proche des courants travaillistes les plus radicaux. En 1964, il fonde, avec l’historien John Saville, la publication annuelle Socialist Register, qui devient rapidement une référence au niveau international et reste toujours active, reprise après son décès par Leo Panitch (1945-2020), puis par Greg Albo, Nicole Aschoff et Alfredo Saad-Filho, qui en sont les actuels animateurs.
Dans ce texte important, traduit en plusieurs langues mais indisponible jusqu’à présent en français, écrit dans la foulée du coup d’État pour l’édition de 1973 de Socialist Register, Miliband analyse quasiment à chaud – mais aussi avec une profondeur de vue remarquable – l’enjeu stratégique central posé par l’expérience chilienne et sa fin tragique : comment un gouvernement de gauche, porté par un mouvement de masse puissant et bien organisé, qui accède au pouvoir (gouvernemental) par la voie électorale et se fixe comme objectif la transformation socialiste (et non un simple compromis social-démocrate), peut-il affronter la contre-offensive inévitable des classes dominantes internes et de leurs appuis externes (l’impérialisme étatsunien en l’occurrence) ?
Tout en défendant la « voie démocratique » comme la seule susceptible d’amener au pouvoir la gauche de rupture (dans les régimes parlementaires), Miliband en explore minutieusement les difficultés, qui toutes se ramènent aux formidables résistances que ne manquent pas de lui opposer les forces sociales et politiques qui, à juste titre, se sentent menacées dans leur existence même par une telle entreprise.
Le théoricien britannique mène ici un combat sur un double front : contre les « sages » du camp bourgeois et libéral (au sens anglophone, soit le « centre-gauche ») qui, en substance, rejettent la responsabilité du coup d’État sur le radicalisme supposément excessif d’Allende et de sa coalition gouvernementale ; mais aussi contre ceux qui, à gauche, persistent à ne voit d’autre issue que celle de la « conciliation » et du compromis, que l’adversaire de classe ne cesse pourtant de rejeter et dont l’aboutissement fut justement la paralysie des forces populaires face à la violence contre-révolutionnaire scellée par le coup d’État du 11 septembre 1973. Rejetant les appels incantatoires à la « lutte armée », il se refuse à livrer une recette a priori et se contente d’indiquer que la clé d’une possible victoire se trouve dans la préparation des forces populaires à l’inéluctable affrontement – donc dans leur mobilisation – combinée à des initiatives offensives de démocratisation de l’État.
Il semble difficile de nier que qui s’est passé dans la gauche mondiale au cours du demi-siècle qui a suivi la publication de ce texte – du « compromis historique » italien au « tournant de la rigueur » mitterrandien et à la capitulation de Tsipras face à la l’Union européenne – a confirmé la pertinence de l’approche de Miliband, et sa crainte que surviennent de « nouveaux Chili » – fût-ce sous des formes nouvelles.
Ses analyses présentent toutefois un intérêt supplémentaire : celui d’expliquer pourquoi, à la surprise de certaines bonnes âmes libérales occidentales, la bourgeoisie chilienne ne semble, jusqu’à aujourd’hui même, aucunement regretter la flagrante violation de sa propre légalité – constitutionnelle et démocratique – par la soldatesque pinochetienne. Car il ne s’agissait pas, ce 11 septembre 1973, d’un banal golpe à la latino-américaine, donnant une issue répressive mais temporaire à une crise institutionnelle, mais bien d’une contre-révolution armée, bénéficiant de l’appui déterminé de pans entiers de la société chilienne (ainsi que de l’impérialisme étatsunien). Son objectif n’était pas simplement de renverser un gouvernement élu mais de mettre fin à un processus qu’il faut bien caractériser de révolutionnaire, qui affectait le cœur même des rapports d’exploitation et de domination.
C’est aussi pour cela que les efforts actuels, en particulier du côté de la gauche « réaliste » actuellement représentée au Chili par le président Boric, de construire un récit « consensuel » de ces événements, essentiellement fondé sur le rappel des violations massives de la légalité constitutionnelle et des droits humains par la dictature, sont à la fois mystificateurs et illusoires. Mystificateurs car ils livrent une version édulcorée et dépolitisante de l’expérience de l’Unité populaire et gomment la profonde continuité entre l’ordre néolibéral institué par régime de Pinochet et celui du Chili actuel. Illusoires, car la droite chilienne oppose obstinément une fin de non-recevoir à ces mains tendues, et fait preuve d’aussi peu de scrupules aujourd’hui qu’il y a un demi-siècle à défendre la nécessité de la violation de la légalité quand l’ordre social est menacé dans ses fondements.
Reste à savoir si, comme l’appelle de ses vœux Miliband dans ce texte, peut émerger – à une échelle de masse – une gauche aussi déterminée à assumer son histoire et ses objectifs, que ses adversaires le sont à défendre les leurs. Rester fidèle au combat de Salvador Allende et de milliers de militant.e.s chilien.ne.s c’est aussi lutter pour maintenir aujourd’hui ouverte cette question.
Stathis Kouvélakis
***
Ce qui s’est passé au Chili le 11 septembre 1973 n’a pas soudainement révélé quelque chose de radicalement nouveau sur la manière dont les hommes de pouvoir et de privilège cherchent à protéger leur ordre social : l’histoire des 150 dernières années est parsemée d’épisodes de ce genre. Néanmoins, le Chili a au moins forcé de nombreuses personnes de gauche à réfléchir et à poser des questions gênantes sur la « stratégie » la plus appropriée dans les régimes de type occidental pour ce qui était vaguement appelé la « transition vers le socialisme ». Bien sûr, les hommes et les femmes « raisonnables » de gauche, et d’autres aussi, se sont empressé.e.s de proclamer que le Chili n’est ni la France, ni l’Italie, ni la Grande-Bretagne. C’est vrai. Aucun pays n’est identique à un autre : les circonstances sont toujours différentes, non seulement d’un pays à l’autre, mais aussi d’une période à l’autre dans un même pays. Cette sagesse rend possible et plausible l’argument selon lequel l’expérience d’un pays ou d’une période ne peut offrir de « leçons » définitives. Il est également vrai qu’il faut, par principe, se méfier des personnes qui s’empressent en toute occasion de tirer des « leçons » Il y a de fortes chances qu’ils ou elles les aient tirées bien avant que l’occasion ne se présente et qu’ils ou elles essaient simplement d’adapter l’expérience à leurs opinions antérieures. Soyons donc prudents lorsque nous tirons ou donnons des « leçons ».
Néanmoins, et quelle que soit la prudence qui s’impose, il y a des choses à apprendre, ou à désapprendre, ce qui revient au même, de cette expérience. Tout le monde disait, à juste titre, que seul le Chili, en Amérique latine, était une société constitutionnelle, parlementaire, libérale, pluraliste, un pays qui faisait de la politique : pas exactement comme les Français.es, les Étatsunien.nes ou les Britanniques, mais bien dans un cadre « démocratique » ou, comme diraient les marxistes, « démocratique- bourgeois ». Cela étant, et aussi prudent que l’on veuille être, ce qui s’est passé au Chili pose certaines questions, appelle certaines réponses, et pourrait même fournir certains rappels et avertissements. Il peut, par exemple, suggérer que des stades pouvant être utilisés à d’autres fins que le sport, et aussi que des prisonnier.e.s politiques de gauche existent non seulement à Santiago, mais aussi à Rome et à Paris, voire à Londres ; ou que quelque chose ne va pas quand Marxism Today, le mensuel « théorique et de débats du Parti Communiste de Grande-Bretagne » [de 1957 à 1991], a choisi comme article principal pour son numéro de septembre 1973 un discours prononcé en juillet par le secrétaire général du Parti Communiste Chilien, Luis Corvalan (actuellement en prison dans l’attente de son procès et de son exécution éventuelle)[1], intitulé « Nous disons non à la guerre civile ! Mais nous sommes prêts à écraser la sédition ». A la lumière de ce qui s’est passé, ce slogan louable semble plutôt pathétique et suggère qu’il y a quelque chose de grave qui pose problème, qu’il faut évaluer pour essayer d’y voir plus clair. Dans la mesure où le Chili était une démocratie bourgeoise, ce qui s’y est passé concerne la démocratie bourgeoise et pourrait également se produire dans d’autres démocraties bourgeoises.
Après tout, au lendemain du coup d’État, le Times [de Londres] affirmait (les mots devraient être soigneusement mémorisés par les gens de gauche) : « … que les forces armées aient eu raison ou non d’agir comme elles l’ont fait, les circonstances étaient telles que tout officier militaire raisonnable aurait pu, de bonne foi, penser qu’il était de son devoir constitutionnel d’intervenir ».[2] Si un épisode similaire devait se produire en Grande-Bretagne, il y a fort à parier que, quelle que soit la personne présente dans le stade de Wembley, ce ne sera pas le rédacteur en chef du Times : il sera occupé à rédiger des éditoriaux regrettant ceci et cela, mais convenant, même à contrecœur, que, compte tenu de toutes les circonstances, et malgré la nature pénible du choix, il n’y avait pas d’autre solution pour des militaires raisonnables que d’intervenir… et ainsi de suite…
Lorsque Salvador Allende a été élu à la présidence du Chili en septembre 1970, le régime qui a alors été inauguré était censé constituer un test pour la transition pacifique ou parlementaire vers le socialisme. Il s’est avéré, au cours des trois années suivantes, que cette affirmation était quelque peu exagérée. Ce régime a réalisé beaucoup de réformes économiques et sociales, dans des conditions incroyablement difficiles, mais il est resté délibérément « modéré » : en fait, il ne semble pas exagéré de dire que la cause de sa mort, ou du moins l’une des principales causes de sa mort, a été sa « modération » obstinée. Mais non, nous disent aujourd’hui des experts comme le professeur Hugh Thomas, du département d’études européennes contemporaines de l’Université de Reading : le problème était qu’Allende était beaucoup trop influencé par des gens comme Marx et Lénine, « plutôt que par Mill, Tawney, ou Aneurin Bevan, ou n’importe quel autre penseur européen du socialisme démocratique». Dans ces conditions, poursuit allègrement le professeur Thomas, « le coup d’État chilien ne peut en aucun cas être considéré comme une défaite du socialisme démocratique, mais bien du socialisme marxiste ». Donc, tout va bien, du moins pour le socialisme démocratique. Il ne fait aucun doute que le docteur Allende avait « le cœur à la bonne place [c’est-à-dire à gauche] » – il faut être juste sur ce point – , mais « il y a de nombreuses raisons de penser que sa prescription n’était pas la bonne pour soigner les maladies du Chili, et bien sûr le résultat de la tentative de l’appliquer peut avoir conduit un chirurgien adepte des méthodes fortes à se rendre au chevet du malade. La bonne prescription, bien sûr, était le socialisme keynésien, pas le socialisme marxiste ». [3] La messe est dite : le problème avec Allende, c’est qu’il n’était pas Harold Wilson [premier ministre travailliste de 1964 à 1970 et de 1974 à 1976], entouré de conseillers imprégnés de « socialisme keynésien » comme l’est manifestement le professeur Thomas.
Nous ne devons pas nous attarder sur les Thomas de ce monde et leurs opinions préconçues sur les orientations politiques d’Allende qui ont amené un « chirurgien partisan de la manière forte » au chevet d’un Chili malade. Car même si l’expérience chilienne n’a pas été un test concluant pour la « transition pacifique vers le socialisme », elle offre néanmoins un exemple très suggestif de ce qui peut se produire lorsqu’un gouvernement donne l’impression, dans une démocratie bourgeoise, qu’il a réellement l’intention d’apporter des changements sérieux dans l’ordre social et de s’orienter vers le socialisme, même de manière constitutionnelle et graduelle. Quoi que l’on puisse dire d’Allende et de ses camarades, de leurs stratégies et de leurs orientations politiques, il n’y a aucun doute que c’est ce qu’ils voulaient faire. Ils n’étaient pas, et leurs ennemis le savaient, de simples politiciens bourgeois criant des slogans « socialistes ». Ils n’étaient pas des « socialistes keynésiens ». C’étaient des gens sérieux et dévoués, comme beaucoup l’ont montré en mourant pour ce en quoi ils et elles croyaient.
C’est ce qui fait de la réaction conservatrice à leur égard un sujet d’un grand intérêt et d’une grande importance. Il est nécessaire que nous essayions d’en décoder le message, l’avertissement, les « leçons ». En effet, l’expérience peut avoir une importance cruciale pour d’autres démocraties bourgeoises : il n’est certainement pas nécessaire d’insister sur le fait qu’une partie de cette expérience est directement pertinente pour tout « modèle » de changement social radical dans ce type de système politique.
Lutte et guerre de classe
Le message, l’avertissement ou la « leçon » les plus importants sont peut-être aussi les plus évidents, et donc le plus facilement ignorés. Il s’agit de la notion de lutte des classes. Si l’on met de côté l’idée que la lutte des classes est le résultat de la propagande et de l’agitation « extrémistes », il n’en reste pas moins que la gauche est plutôt encline à une perspective selon laquelle la lutte des classes est un combat mené par les travailleurs.ses et les classes subalternes contre les classes dominantes. C’est bien sûr le cas. Mais la lutte des classes signifie aussi, et souvent d’abord, la lutte menée par la classe dominante, et l’État agissant en son nom, contre les travailleurs.ses et les classes subalternes. Par définition, la lutte n’est pas un processus à sens unique, mais il convient de souligner qu’elle est activement menée par la ou les classes dominantes et, à bien des égards, de manière beaucoup plus efficace que la lutte menée par les classes subordonnées.
Deuxièmement, mais dans le même contexte, il existe une différence énorme, si grande qu’elle nécessite un changement de nom, entre, d’une part, la lutte de classe « ordinaire », du type de celle que l’on observe au quotidien dans les sociétés capitalistes, sur le plan économique, politique, idéologique, micro et macro, et dont on sait qu’elle ne constitue pas une menace pour le cadre capitaliste dans lequel elle se déroule, et, d’autre part, la lutte de classe qui affecte, ou dont on pense qu’elle est susceptible d’affecter, l’ordre social de manière vraiment fondamentale. La première forme de lutte des classes constitue l’essentiel de la politique de la société capitaliste. Elle n’est pas sans importance, ni un simple simulacre, mais elle ne met pas non plus le système politique sous une pression intolérable. La deuxième forme de lutte ne devrait pas être décrite comme une lutte de classe, mais comme une guerre de classe. Lorsque les puissants et les privilégiés (et ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus de pouvoir et de privilèges qui sont les plus intransigeants) croient qu’ils sont confrontés à une menace réelle venant d’en bas, que le monde qu’ils connaissent, qu’ils aiment et qu’ils veulent préserver semble miné ou sous l’emprise de forces maléfiques et subversives, alors une forme de lutte tout à fait différente entre en action, dont l’acuité, les dimensions et l’universalité justifient le qualificatif de « guerre de classe ».
Le Chili a connu la lutte des classes dans un cadre démocratique bourgeois pendant de nombreuses décennies : c’était sa tradition. Avec l’arrivée à la présidence d’Allende, les forces conservatrices ont progressivement transformé la lutte des classes en guerre de classe : là encore, il convient de souligner que ce sont les forces conservatrices qui ont transformé l’une en l’autre.
Avant d’y regarder de plus près, je voudrais aborder une question qui a souvent été soulevée à propos de l’expérience chilienne, à savoir la question des pourcentages électoraux. On a souvent dit qu’Allende, en tant que candidat présidentiel d’une coalition de six partis, n’avait obtenu que 36 % des voix en septembre 1970, l’implication étant que s’il avait obtenu, disons, 51 % des voix, l’attitude des forces conservatrices à son égard et à l’égard de son administration aurait été très différente. Dans un sens cela peut être vrai mais, dans un autre sens, cela me semble être une dangereuse absurdité.
Pour commencer par ce dernier point, l’un des analystes français les plus compétents à propos de l’Amérique latine, Marcel Niedergang, a publié un document pertinent sur la question. Il s’agit du témoignage de Juan Garces, l’un des conseillers politiques personnels d’Allende pendant plus de trois ans qui, sur ordre direct du président, s’est échappé du palais de La Moneda le 11 septembre. Selon Garces, c’est précisément après que la coalition gouvernementale eut progressé et obtenu 43% lors des élections législatives de mars 1973 que les forces conservatrices ont commencé à envisager sérieusement un coup d’État. « Après les élections de mars, explique-t-il, un coup d’État légal n’était plus possible, car la majorité des deux tiers requise pour obtenir la mise en accusation constitutionnelle du président ne pouvait être atteinte. La droite a alors compris que la voie électorale était épuisée et qu’il ne restait plus que la voie de la force ». [4]
Ceci a été confirmé par l’un des principaux promoteurs du coup d’État, le général de l’armée de l’air Gustavo Leigh, qui a déclaré au correspondant au Chili du Corriere della Sera que « nous avons commencé à préparer le renversement d’Allende en mars 1973, immédiatement après les élections législatives ».[5] Ces indices ne sont pas des preuves définitives, mais ils sont suggestifs. Ecrivant avant que ces informations ne soient révélées, Maurice Duverger affirmait que si Allende avait le soutien d’un peu plus d’un tiers des Chilien.e.s au début de sa présidence, il en avait gagné presque la moitié au moment du coup d’État ; et cette moitié était celle qui était la plus durement touchée par les difficultés matérielles. Il écrit à ce propos :
« Voici probablement la raison majeure du putsch militaire. Tant que la droite chilienne a cru que l’expérience de l’Unité populaire prendrait fin par la volonté des électeurs, elle a respecté le jeu démocratique. Il valait la peine de respecter la Constitution en attendant que l’orage passe. Lorsque la droite en vint à craindre que l’orage ne passe pas et que le jeu des institutions libérales aboutisse au maintien de Salvador Allende au pouvoir et au développement du socialisme, elle préféra la violence à la loi ».[6]
Duverger exagère probablement l’« attitude démocratique » de la droite et son respect de la Constitution avant les élections de mars 1973, mais son argument principal semble, comme je l’ai suggéré plus haut, très raisonnable.
Ses implications vont très loin. À savoir : pour les forces conservatrices, les pourcentages électoraux, aussi élevés soient-ils, ne confèrent pas de légitimité à un gouvernement qui leur semble s’orienter vers des politiques qu’elles jugent réellement ou potentiellement désastreuses. Cela n’a rien d’étonnant car, en l’occurrence, aux yeux de la droite, nous avons affaire à des démagogues vicieux, des traîtres de classe, des imbéciles, des gangsters et des escrocs, soutenus par une populace ignorante, qui s’emploient à provoquer la ruine et le chaos dans un pays jusqu’ici paisible et agréable à vivre, etc. Le scénario est familier. L’idée que, dans une telle perspective, les scores électoraux aient une quelconque importance est naïve et absurde : ce qui importe, pour la droite, ce n’est pas le pourcentage de votes par lequel un gouvernement de gauche est soutenu, mais les objectifs qui le motivent. Si ces objectifs sont erronés, profondément et fondamentalement erronés, les résultats électoraux n’ont aucune importance.
Il y a cependant un sens dans lequel les pourcentages ont de l’importance dans le type de situation politique à laquelle la droite est confrontée dans des conditions de type chilien. En effet, plus le pourcentage de votes en faveur de la gauche est élevé, plus les forces conservatrices sont susceptibles d’être intimidées, démoralisées, divisées et incertaines quant à la voie à suivre. Ces forces ne sont pas homogènes et il est évident que les expressions électorales de soutien populaire sont très utiles à la gauche dans sa confrontation avec la droite, à condition que la gauche ne les considère pas comme décisives. En d’autres termes, les pourcentages de voix peuvent contribuer à intimider la droite, mais pas à la désarmer. Il se peut que la droite n’aurait pas osé frapper comme elle l’a fait si Allende avait obtenu des pourcentages électoraux plus élevés. Mais si, après avoir obtenu ces pourcentages, Allende avait continué à suivre la voie qu’il s’était tracée, la droite aurait frappé dès que l’occasion se serait présentée. Le problème était de la priver de cette opportunité ou, à défaut, de faire en sorte que l’affrontement se déroule dans les conditions les plus favorables possibles.
L’opposition de droite
Je me propose maintenant de revenir sur la question de la lutte et de la guerre de classes et sur les forces conservatrices qui les mènent, en me référant plus particulièrement au Chili, bien que les considérations que je formule ici ne s’appliquent pas seulement à ce pays, ne serait-ce qu’en ce qui concerne la nature des forces conservatrices dont il faut tenir compte et que j’examinerai tour à tour, en la mettant en relation avec les formes de lutte dans lesquelles ces différentes forces s’engagent.
La société comme champ de bataille
Parler de « forces conservatrices », comme je l’ai fait jusqu’à présent, n’implique pas l’existence d’un bloc économique, social ou politique homogène, que ce soit au Chili ou ailleurs. Au Chili, ce sont notamment les divisions entre les différentes composantes de ces forces conservatrices qui ont permis à Allende d’accéder à la présidence. Même si ces divisions ont été dûment prises en compte, il convient de souligner qu’un aspect crucial de la lutte des classes est mené par ces forces dans leur ensemble, en ce sens que la lutte se déroule dans toute la « société civile », qu’elle n’a pas de front, pas d’objectif spécifique, pas de stratégie particulière, pas de direction ou d’organisation élaborée : c’est la bataille quotidienne menée par chaque membre des classes supérieures et moyennes mécontentes, chacun à sa manière, et aussi par une grande partie de la classe moyenne inférieure.
Cette lutte part d’un sentiment qu’Evelyn Waugh, rappelant les « horreurs » du gouvernement Attlee en Grande-Bretagne après 1945, a admirablement exprimé lorsqu’il écrivit en 1959 que, dans ces années de gouvernement travailliste, « le royaume semblait être sous occupation ennemie ». L’« occupation ennemie » invite à diverses formes de résistance, et chacun doit y mettre du sien. Cette résistance inclut les « femmes au foyer » de la classe moyenne qui manifestent en tapant sur des casseroles devant le palais présidentiel ; les propriétaires d’usines qui sabotent la production ; les commerçants qui accumulent des stocks ; les propriétaires de journaux et leurs subordonnés qui mènent des campagnes incessantes contre le gouvernement ; les propriétaires terriens qui empêchent la réforme agraire ; la propagation de ce que l’on appelait en Grande-Bretagne, en temps de guerre, « la panique et le découragement » (et qui était d’ailleurs puni par la loi) : en bref, tout ce que des personnes influentes, aisées, éduquées (ou moins éduquées) peuvent faire pour entraver un gouvernement qu’elles détestent. Pris comme une « totalité détotalisée »[7], les dommages qui peuvent ainsi être causés sont considérables. Je n’ai pas encore mentionné les catégories socioprofessionnelles supérieures, les médecins, les avocats, les fonctionnaires de l’État, dont la capacité à ralentir le fonctionnement d’une société, de toute société, doit être considérée comme élevée. Rien de très spectaculaire n’est nécessaire : il suffit d’un rejet individuel, dans la vie et l’activité quotidiennes, de la légitimité du régime, qui se transforme de lui-même en une vaste entreprise collective de production de perturbations.
On peut supposer que la grande majorité des membres des classes supérieures et moyennes (certainement pas tous) seront irrémédiablement opposés au nouveau régime. La question de la classe moyenne inférieure est un peu plus complexe. La première exigence à cet égard est d’établir une distinction radicale entre, d’une part, les professions libérales et les employés de bureau, les techniciens, les cadres inférieurs, etc. et, d’autre part, les petits capitalistes et les petits commerçants. Les premiers font partie intégrante de ce « travailleur collectif » dont parlait Marx il y a plus de cent ans, et ils participent, comme la classe ouvrière industrielle, à la production de la plus-value. Cela ne veut pas dire que cette classe ou strate se considérera nécessairement comme faisant partie de la classe ouvrière, ou qu’elle soutiendra « automatiquement » des politiques de gauche (pas plus que la classe ouvrière proprement dite – mais cela signifie qu’il y a là au moins une base solide pour une alliance.
C’est beaucoup plus douteux, en fait très probablement faux, pour l’autre partie de la classe moyenne inférieure, le petit entrepreneur et le petit commerçant. Dans l’article cité plus haut, Maurice Duverger suggère que « la première condition de la transition démocratique vers le socialisme dans un pays occidental de type français est qu’un gouvernement de gauche rassure les classes moyennes sur leur sort dans le futur régime, afin de les dissocier du noyau des grands capitalistes qui sont pour leur part condamnés à disparaître ou à se soumettre à un contrôle strict ».[8] L’ennui, c’est que, dans la mesure où l’on entend par « classes moyennes » les petits capitalistes et les petits commerçants (et Duverger précise qu’il s’agit bien d’eux), la tentative est vouée à l’échec dès le départ. Pour les accueillir, Duverger veut que « l’évolution vers le socialisme soit très progressive et très lente, de façon à rallier à chaque étape une partie importante de ceux qui ont eu peur au début ». De plus, les petites entreprises doivent être assurées que leur sort sera meilleur que dans le capitalisme monopolistique ou oligopolistique[9].
Il est intéressant, et ce serait amusant si l’affaire n’était pas aussi grave, que le réalisme dont le professeur Duverger sait faire preuve à l’égard du Chili l’abandonne dès qu’il se rapproche de son pays. Son scénario est ridicule et même s’il ne l’était pas, il n’y a aucun moyen de donner aux petites entreprises des garanties adéquates. Je ne voudrais pas donner l’impression que je préconise la liquidation des « koulaks » français des villes moyennes et petites : ce que je dis, c’est qu’adapter le rythme de la transition vers le socialisme aux espoirs et aux craintes de cette classe, c’est prôner la paralysie ou se préparer à la défaite. Mieux vaut ne pas commencer. La manière de traiter le problème est une autre question. Mais il est important de commencer par le fait qu’en tant que classe ou couche sociale, cet élément doit être considéré comme faisant partie des forces conservatrices.
Cela semble certainement avoir été le cas au Chili, notamment en ce qui concerne les désormais célèbres 40 000 propriétaires de camions, dont les grèves répétées ont contribué à accroître les difficultés du gouvernement. Ces grèves, parfaitement coordonnées, et très probablement soutenues par des subsides venant de l’étranger , mettent en évidence le problème auquel un gouvernement de gauche doit s’attendre à être confronté, à un degré plus ou moins élevé selon les pays, dans un secteur d’une importance économique considérable en termes de distribution. La question prend une allure d’autant plus ironique que, selon les sources statistiques des Nations Unies, c’est cette « classe moyenne » qui a le plus prospéré sous le régime d’Allende en termes de répartition du revenu national. En effet, il apparaît que les 50 % les plus pauvres de la population ont vu leur part passer de 16,1 % à 17,6% ; celle de la « classe moyenne » (45 % de la population) a augmenté de 53,9 % à 57,7 % tandis que les 5 % les plus riches ont vu leur part chuter de 30 % à 24,7 %.[10] Ce n’est pas vraiment l’image d’une classe moyenne mortellement opprimée, d’où la signification de son hostilité.
L’intervention conservatrice extérieure
Il n’est pas possible de discuter de la guerre des classes, où que ce soit, et surtout en Amérique latine, sans tenir compte de l’intervention extérieure, plus précisément et évidemment de l’intervention de l’impérialisme étatsunien, représenté à la fois par des entreprises privées et par l’État américain lui-même. Les activités d’ITT ont fait l’objet d’une grande publicité, de même que son projet de plonger le pays dans le chaos afin d’amener des « militaires amis » à réaliser un coup d’État. ITT n’était pas non plus la seule grande entreprise étatsunienne présente au Chili : il n’y a en fait aucun secteur important de l’économie chilienne qui n’ait été pénétré et parfois dominé par des entreprises étatsuniennes : leur hostilité au régime Allende a dû considérablement accroître les difficultés économiques, sociales et politiques de ce dernier.
Tout le monde sait que la balance des paiements du Chili dépendait très largement de ses exportations de cuivre ; or, le prix mondial du cuivre, qui avait presque été divisé par deux en 1970, est resté à ce bas niveau jusqu’à la fin de 1972. Et des pressions étatsuniennes ont été exercées dans le monde entier pour imposer un embargo sur le cuivre chilien. En outre, les États-Unis ont exercé avec succès des pressions sur la Banque Mondiale pour qu’elle refuse d’accorder des prêts et des crédits au Chili. Il n’était d’ailleurs pas nécessaire d’insister beaucoup pour parvenir à ce résultat, que ce soit auprès la Banque Mondiale ou sur d’autres institutions bancaires. Quelques jours après le coup d’État, le Guardian notait que « les nouvelles avances nettes qui ont été gelées à la suite des pressions étatsuniennes comprenaient des sommes totalisant 30 millions de livres sterling, pour des projets que la Banque Mondiale avait déjà jugés dignes d’être soutenus ».[11]
Le président de la Banque Mondiale est bien entendu Robert McNamara. Il fut un temps où l’on disait que McNamara avait subi une sorte de conversion spirituelle en raison des remords qu’il éprouvait pour le rôle qu’il avait joué, lorsqu’il était secrétaire d’État à la Défense, en infligeant tant de souffrances au peuple vietnamien : sous sa direction, la Banque Mondiale viendrait en fait en aide aux pays pauvres. Ce que les colporteurs de ce beau récit ont omis d’ajouter, c’est qu’il y avait une condition : que les pays pauvres fassent preuve du plus grand respect pour les exigences de l’entreprise privée, notamment de l’entreprise privée étatsunienne, ce que précisément le Chili n’a pas fait.
Le régime d’Allende a été, dès le départ, confronté à une tentative étatsunienne implacable d’étranglement économique. Par rapport à ce fait, qui doit être mis en parallèle avec le sabotage économique auquel se sont livrés les intérêts économiques conservateurs internes, les erreurs commises par le gouvernement de l’Unité Populaire sont d’une importance relativement mineure, même si elles sont tellement mises en avant non seulement par les détracteurs mais aussi par certains de ses amis. Ce qui est vraiment remarquable, contre toute attente, ce ne sont pas les erreurs, mais le fait que le régime ait tenu le coup économiquement aussi longtemps qu’il l’a fait, d’autant plus que les partis d’opposition au Parlement l’ont systématiquement empêché de prendre les mesures qui s’imposaient.
De ce point de vue, la question de savoir si le gouvernement des États-Unis a été ou non directement impliqué dans la préparation du coup d’État militaire n’est pas particulièrement importante. Il a certainement eu connaissance du coup d’État avant qu’il ne se produise. L’armée chilienne avait des liens étroits avec les forces armées des États-Unis. Il serait évidemment stupide de penser que le genre de personnes qui dirigent le gouvernement des États-Unis s’abstiendraient de participer activement à un coup d’État ou à son déclenchement. Le point important ici, cependant, est que le gouvernement des États-Unis a fait de son mieux au cours des trois années précédentes pour préparer le terrain au renversement du régime Allende en menant une guerre économique contre lui.[12]

Les partis politiques conservateurs
Le type de lutte des classes mené par les forces conservatrices dans la société civile, auquel j’ai fait référence plus haut, nécessite en définitive une direction et une articulation politique, à la fois au Parlement et dans le pays en général, pour se transformer en une force politique réellement efficace. Cette direction a été ici assurée par les partis conservateurs, et principalement facilitée au Chili par la Démocratie Chrétienne.
Comme l’Union Chrétienne-Démocrate en Allemagne et le Parti Chrétien-Démocrate en Italie, la Démocratie Chrétienne au Chili abritait de nombreuses tendances différentes, allant de diverses formes de radicalisme (bien que la plupart des radicaux soient partis former leurs propres groupes après l’arrivée au pouvoir d’Allende) à un conservatisme extrême. Mais elle représentait essentiellement la droite constitutionnelle conservatrice, le parti de gouvernement, dont l’une des figures les plus emblématiques, Eduardo Frei, avait été président avant Allende. Avec une détermination constante et croissante, cette droite constitutionnelle conservatrice a cherché par tous les moyens légaux dont elle disposait à bloquer l’action du gouvernement et à l’empêcher de fonctionner correctement. Les partisans du parlementarisme disent toujours que son fonctionnement dépend de l’existence d’un certain degré de coopération entre le gouvernement et l’opposition, et ils ont sans aucun doute raison. Mais le gouvernement d’Allende s’est vu refuser cette coopération par ceux-là mêmes qui ne cessent de proclamer leur attachement à la démocratie parlementaire et au constitutionnalisme.
Là aussi, sur le front législatif, la lutte des classes s’est facilement transformée en guerre des classes. Les assemblées législatives font partie du système étatique, à quelques exceptions près qui ne sont pas pertinentes ici ; au Chili, l’assemblée législative était solidement contrôlée par l’opposition. Il en allait de même pour d’autres éléments importants du système étatique, sur lesquels je reviendrai dans un instant. La résistance de l’opposition au gouvernement, au Parlement et à l’extérieur, n’a pris sa véritable ampleur qu’après la victoire de la coalition de l’Unité populaire aux élections de mars 1973. A la fin du printemps, les anciens partisans du constitutionnalisme et du parlementarisme se sont engagés sur la voie de l’intervention militaire. Après le putsch avorté du 29 juin 1973, qui marque le début de la crise finale, Allende tente de trouver un compromis avec les leaders de la Démocratie Chrétienne, Patricio Aylwin et Eduardo Frei. Ceux-ci refusent et accentuent leur pression sur le gouvernement. Le 22 août, l’Assemblée Nationale, dominée par leur parti, adopte une motion qui demande effectivement à l’armée de « mettre fin aux situations qui constituent une violation de la Constitution ». Dans le cas chilien au moins, la responsabilité directe de ces hommes politiques dans le renversement du régime Allende ne fait aucun doute.
Les dirigeants de la Démocratie Chrétienne auraient sans aucun doute préféré pouvoir renverser Allende sans recours à la force et dans le cadre de la Constitution. Les politiciens bourgeois n’aiment pas les coups d’État militaires, notamment parce qu’ils les privent de leur rôle. Mais qu’ils le veuillent ou non, et quel que soit leur attachement au constitutionnalisme, la plupart de ces hommes politiques auront recours à l’armée lorsqu’ils estimeront que les circonstances l’exigent.
Les calculs qui entrent en ligne de compte pour décider du recours à l’illégalité en fonction des circonstances sont nombreux et complexes. Ces calculs comprennent des pressions et des incitations de différents types et de différents calibres. L’une de ces pressions est la pression générale et diffuse de la classe, ou des classes, auxquelles appartiennent ces hommes politiques. « Il faut en finir », leur dit-on de toutes parts, ou plutôt de celles auxquelles ils prêtent attention et cela compte dans la dérive vers le putschisme. Mais une autre pression, qui devient de plus en plus importante au fur et à mesure que la crise s’aggrave, est celle des groupes situés à la droite des conservateurs constitutionnels qui, dans ces circonstances, deviennent un élément avec lequel il faut compter.
Les groupements de type fasciste
Le régime d’Allende a dû faire face à une violence organisée importante de la part de groupes de type fasciste. Cette activité de guérilla ou de commandos d’extrême-droite a atteint son paroxysme dans les derniers mois précédant le coup d’État, avec l’explosion de pylônes électriques, des attaques contre des militants de gauche et d’autres actions de ce type qui ont largement contribué au sentiment général qu’il fallait mettre un terme à la crise d’une manière ou d’une autre. Là encore, des actions de ce type, dans des circonstances « normales » de conflit de classe, n’ont pas une grande importance politique, et certainement pas une importance telle qu’elles menacent un régime ou même qu’elles l’ébranlent de façon significative. Tant que le gros des forces conservatrices reste dans le camp des constitutionnalistes, les groupements de type fasciste restent isolés, voire boudés par la droite traditionnelle.
Mais, dans des circonstances exceptionnelles, on parle à des gens avec qui on ne voudrait être vu pour rien au monde ; on fait un signe de tête et un clin d’œil là où autrefois un froncement de sourcils et une réprimande auraient été une réponse presque automatique. « Il faut que jeunesse se passe », disent maintenant avec indulgence leurs aînés conservateurs. « Bien sûr, ils sont sauvages et font des choses horribles. Mais regardez à qui ils le font, et que peut-on attendre quand on est gouverné par des démagogues, des criminels et des escrocs ? ». C’est ainsi que des groupes comme Patrie et Liberté ont opéré de plus en plus audacieusement au Chili, et contribué à accroître le sentiment de crise en encourageant les dirigeants politiques à réfléchir à des solutions drastiques pour y remédier.
L’opposition administrative et judiciaire
Partout, les forces conservatrices peuvent toujours compter sur le soutien, l’assentiment ou la sympathie plus ou moins explicite des membres des échelons supérieurs du système étatique, voire de nombreux membres des échelons inférieurs, si ce n’est de la plupart d’entre eux. Par leur origine sociale, leur éducation, leur statut social, leurs liens de parenté et d’amitié, les échelons supérieurs, pour nous concentrer sur eux, font intrinsèquement partie du camp conservateur et si aucun de ces facteurs ne suffit, les dispositions idéologiques les y placent certainement. Les hauts fonctionnaires et les membres du pouvoir judiciaire peuvent, en termes idéologiques, aller du libéralisme modéré au conservatisme extrême, mais le libéralisme modéré, sous sa forme la plus progressiste, se situe à l’extrémité du spectre. Dans des conditions « normales » de conflit de classes, cette situation peut ne pas trouver beaucoup de formes d’expression, si ce n’est dans le type de préjugé implicite ou explicite attendu de ces personnes. Dans des conditions de crise, en revanche, lorsque la lutte des classes prend des allures de guerre des classes, ces membres du personnel de l’État deviennent des participants actifs à la bataille et sont les plus susceptibles de vouloir apporter leur contribution à l’effort patriotique pour sauver leur pays bien-aimé – sans parler de leurs postes bien-aimés – des dangers qui le menacent.
Le régime d’Allende a hérité d’un personnel d’État qui, pendant de longues années, avait travaillé pour des partis conservateurs et qui ne devait pas compter beaucoup de personnes qui voyaient le nouveau régime avec une quelconque sympathie, pour ne pas dire plus. L’élection d’Allende a changé beaucoup de choses à cet égard, dans la mesure où un nouveau personnel, qui soutenait la coalition de l’Unité Populaire, est venu occuper des postes de premier plan dans le système étatique. Malgré cela, et dans les circonstances qui prévalaient, il était peut-être inévitable que les échelons intermédiaires et inférieurs de ce système continuent d’être occupés par des bureaucrates traditionnels. Le pouvoir de ces personnes peut être très grand. Le décret peut venir d’en haut, mais ils sont bien placés pour veiller à ce qu’il ne fonctionne pas, ou qu’il ne fonctionne pas comme il le devrait. Pour varier la métaphore, la machine ne répond pas correctement parce que les mécaniciens qui en ont la charge n’ont aucun désir particulier qu’elle réponde correctement. Plus le sentiment de crise est grand, moins les mécaniciens sont disposés à le faire ; et moins ils sont disposés à le faire, plus la crise s’aggrave.
Malgré tout, le régime Allende ne s’est pas « effondré ». Malgré l’obstruction législative, le sabotage administratif, la guerre politique, les interventions étrangères, les pénuries économiques, les divisions internes, malgré tout cela, le régime a tenu. C’est là, pour les politiciens et les classes qu’ils représentent, que le bât blesse. Dans un article sur lequel l’occasion de revenir, Eric Hobsbawm [historien et membre à cette époque du PC de Grande-Bretagne – NdT] note à juste titre qu’ « à ces commentateurs de droite qui se demandent quel autre choix restait aux opposants d’Allende qu’un coup d’État, la réponse est simple : ne pas faire de coup d’État ». [13] Mais cela signifiait prendre le risque qu’Allende se sorte des difficultés auxquelles il était confronté. En effet, il semblerait que, la veille du coup d’État, lui et ses ministres aient décidé d’une dernière tentative constitutionnelle, à savoir un plébiscite, qui devait être annoncé le 11 septembre. Il espérait, s’il le gagnait, obtenir une délai supplémentaire des putschistes et se donner une nouvelle marge de manœuvre. S’il avait perdu, il aurait démissionné, dans l’espoir que les forces de gauche se retrouveraient un jour en meilleure pour exercer le pouvoir.[14] Quoi qu’on pense de cette stratégie, dont les politiciens conservateurs devaient avoir connaissance, elle risquait de prolonger la crise à laquelle ils voulaient absolument mettre fin, ce qui signifiait l’acceptation, voire le soutien actif, du coup d’État que les militaires préparaient. Finalement, face au danger que représentait le soutien populaire à Allende, il n’y avait pas d’autre choix : il fallait faire appel aux assassins.
Les militaires
Certes, on nous a dit et répété que les militaires chiliens, contrairement à ceux de tous les autres pays d’Amérique latine, étaient apolitiques, ou alors politiquement neutres, respectueux de la Constitution, etc. Même si l’on a un peu exagéré, il est vrai que, grosso modo, les militaires chiliens ne se « mêlaient pas de politique ». Il n’y a pas non plus de raison de douter qu’au moment où Allende est arrivé au pouvoir et pendant un certain temps après, les militaires n’ont pas voulu intervenir et monter un coup d’État. C’est une fois le « chaos » créé, l’instabilité politique extrême provoquée et la faiblesse de la réponse du régime face à la crise révélée (nous y reviendrons) que les dispositions conservatrices des militaires sont apparues au grand jour et ont fait pencher la balance de manière décisive. Il serait, en effet, absurde de penser que la « neutralité » et les « attitudes apolitiques » des forces armées signifient qu’elles n’ont pas de positions idéologiques définies, et que celles-ci ne sont pas résolument conservatrices. Comme le note également Marcel Niedergang, « quoi qu’on ait pu dire, il n’y a jamais eu d’officiers supérieurs socialistes, et encore moins communistes. Il y avait deux camps : les partisans de la légalité et les ennemis du gouvernement de gauche. Les seconds, de plus en plus nombreux, ont fini par l’emporter ».[15]
Les italiques de cette citation ont pour but de souligner la dynamique cruciale qui s’est produite au Chili et qui a affecté les militaires ainsi que tous les autres protagonistes. Cette notion de processus dynamique est essentielle à l’analyse de tout type de situation : les personnes qui se positionnent de telle façon à un moment donné, et qui sont ou ne sont pas disposées à faire ceci ou cela, changent sous l’impact d’événements qui évoluent rapidement. Bien sûr, elles changent le plus souvent à l’intérieur d’un certain éventail de positions, mais dans de telles situations, le changement peut être très important. Ainsi, des militaires conservateurs mais constitutionnalistes deviennent, dans certaines situations, encore plus conservateurs, ce qui signifie qu’ils cessent d’être constitutionnalistes. La question évidente est de savoir ce qui a provoqué ce changement. En partie, sans doute, la dégradation de la situation « objective » ainsi que la pression exercée par les forces conservatrices. Mais, dans une très large mesure, le changement est dû à la position adoptée par le gouvernement de l’époque et à la manière dont elle a été perçue. Selon moi, la faiblesse de la réponse de l’administration Allende à la tentative de coup d’État du 29 juin 1973, son recul constant face aux forces conservatrices (et aux militaires) dans les semaines qui ont suivi, et la perte subie avec la démission du général Prats, le seul général qui semblait fermement disposé à soutenir le régime, tout cela était en grande partie lié au fait que les ennemis du régime dans les forces armées (c’est-à-dire les militaires qui étaient prêts à faire un coup d’État) devenaient « de plus en plus nombreux ». En la matière, une loi s’impose : plus le gouvernement est faible, plus ses ennemis sont audacieux et plus leur nombre s’accroît jour après jour.
C’est ainsi que ces généraux « constitutionalistes » ont frappé le 11 septembre et mis en œuvre ce qui a été appelé, de manière significative à la lumière du massacre des militant.es de gauche, en Indonésie, l’Opération Djakarta. Avant de passer à la partie suivante de cette histoire, celle qui concerne les actions du régime Allende, sa stratégie et sa conduite, il convient de souligner la sauvagerie de la répression déclenchée par le coup d’État et la responsabilité que les politiciens conservateurs portent dans cette répression. Au lendemain de la Commune de Paris, alors que les communards continuaient à être exécutés, Marx constatait amèrement que « la civilisation et la justice de l’ordre bourgeois se montrent sous leur jour sinistre chaque fois que les esclaves de cet ordre se lèvent contre leurs maîtres. Alors, cette civilisation et cette justice se démasquent comme la sauvagerie sans masque et la vengeance sans loi »[16]. Ses propos s’appliquent parfaitement au Chili après le coup d’État. Ainsi, le magazine Newsweek, une publication qui n’est pas vraiment de gauche, a publié un article de son correspondant à Santiago peu après le coup d’État, intitulé « Abattoir à Santiago », où on peut lire ce qui suit :
La semaine dernière, je me suis glissé par une porte latérale dans la morgue de Santiago, exhibant ma carte de presse délivrée par la junte avec l’autorité impatiente d’un haut fonctionnaire. Cent cinquante cadavres gisaient au rez-de-chaussée, attendant d’être identifiés par les membres de la famille. À l’étage, j’ai franchi une porte battante et là, dans un couloir faiblement éclairé, gisaient au moins cinquante autres corps, serrés les uns contre les autres, la tête appuyée contre le mur. Ils étaient tous nus.
La plupart avaient été abattus à bout portant sous le menton. Certains avaient été mitraillés. Leurs poitrines avaient été ouvertes et recousues de façon grotesque lors de ce qui avait vraisemblablement été une autopsie de pure forme. Ils étaient tous jeunes et, à en juger par la rugosité de leurs mains, tous issus de la classe ouvrière. Deux étaient des filles, que l’on distinguait parmi la masse des corps uniquement par les courbes de leurs seins. La plupart de leurs têtes avaient été écrasées. Je suis resté deux minutes tout au plus, puis je suis parti.
Les employés de la morgue ont été prévenus qu’ils seraient traduits en cour martiale et fusillés s’ils révélaient ce qui s’y passe. Mais les femmes qui vont voir les corps disent qu’il y en a entre 100 et 150 par jour au rez-de-chaussée. J’ai pu obtenir de la fille d’un membre du personnel de la morgue un décompte officiel des corps : au quatorzième jour suivant le coup d’État, dit-elle, la morgue avait reçu et traité 2 796 cadavres.
Le jour même de la publication de ce rapport, le Times de Londres commentait dans un éditorial que « l’existence d’une guerre ou de quelque chose de très proche explique clairement la sévérité drastique du nouveau régime qui a pris de nombreux observateurs par surprise ». La « guerre » est bien sûr une invention du Times. Après l’avoir inventée, ce quotidien a ensuite relevé qu’« un gouvernement militaire confronté à une opposition armée généralisée a peu de chances d’être trop pointilleux sur les subtilités constitutionnelles ou même sur les droits de l’homme les plus élémentaires ». Cependant, afin de ne pas donner l’impression qu’il approuve la « sévérité drastique » du nouveau régime, le journal a déclaré à ses lecteurs que « les amis du Chili à l’étranger, comme sans doute la grande majorité des Chiliens, doivent garder l’espoir que les droits de l’homme seront bientôt pleinement respectés et que l’ordre constitutionnel sera bientôt rétabli ».[17] Amen.
Personne ne sait combien de personnes ont été tuées dans la terreur qui a suivi le coup d’État, et combien de personnes mourront encore à cause de lui[18]. Si un gouvernement de gauche avait fait preuve d’un dixième de la cruauté de la junte, les gros titres des journaux du monde « civilisé » l’auraient dénoncé jour après jour. En l’occurrence, l’affaire a été rapidement passée sous silence et le gouvernement britannique s’est empressé, onze jours après le coup d’État, de reconnaître la junte. La plupart des autres gouvernements occidentaux épris de liberté ont fait de même.
On peut supposer que les nantis chiliens partageaient, et même davantage, le sentiment du rédacteur en chef du Times de Londres qui estimait que, compte tenu des circonstances, on ne pouvait pas attendre des militaires qu’ils soient trop « pointilleux [avec les règles] ». Là encore, Eric Hobsbawm le dit très bien lorsqu’il souligne que « la gauche a généralement sous-estimé la peur et la haine de la droite, la facilité avec laquelle les hommes et les femmes bien habillés acquièrent le goût du sang ».[19] C’est une vieille histoire. Dans son ouvrage sur Flaubert [L’idiot de la famille], Sartre cite un passage du journal d’Edmond de Goncourt écrit le 31 mai 1871, immédiatement après l’écrasement de la Commune de Paris :
Enfin, la saignée a été une saignée à blanc ; et les saignées comme celle-ci, en tuant la partie bataillante d’une population, ajournent d’une conscription la nouvelle révolution. C’est vingt ans de repos que l’ancienne société a devant elle, si le pouvoir ose tout ce qu’il peut oser en ce moment.[20]
Goncourt, on le sait, n’a pas eu à s’inquiéter. La classe moyenne chilienne non plus, si les militaires non seulement osent, mais peuvent, c’est-à-dire sont autorisés, à donner au Chili « vingt ans de repos ». Une journaliste ayant une longue expérience du Chili rapporte, trois semaines après le coup d’État, la « jubilation » de ses amies de la classe supérieure qui avaient longtemps prié pour que le coup d’État ait lieu.[21] Ces dames ne risquent pas d’être perturbées outre mesure par le massacre de militant.es de gauche. Leurs maris non plus.
Ce qui a apparemment dérangé les politiciens conservateurs, c’est la rigueur avec laquelle les militaires ont rétabli la « loi et l’ordre ». Traquer et abattre les militant.es est une chose, tout comme brûler les livres et régenter les universités. Mais dissoudre l’Assemblée nationale, dénoncer la « politique » et caresser l’idée d’un État « corporatiste » de type fasciste, comme le font certains généraux, c’est autre chose, et c’est plus grave. Peu après le coup d’État, les dirigeants de la Démocratie Chrétienne, qui ont joué un rôle si important dans sa réalisation et qui continuent à exprimer leur soutien à la junte, ont néanmoins commencé à exprimer leur « inquiétude » face à certaines de ses velléités. En effet, l’ex-président Frei est allé jusqu’à confier à un journaliste français sa conviction que « la Démocratie Chrétienne devra passer dans l’opposition dans deux ou trois mois »[22], sans doute après que les militaires aient massacré suffisamment de militant.es de gauche. En étudiant la conduite et les déclarations de tels hommes, on comprend mieux le mépris sauvage que Marx exprima à l’égard des politiciens bourgeois qu’il exécrait dans ses écrits historiques. La lignée n’a pas changé.
Le prix de la ligne de « conciliation »
Il faut s’attendre à ce que la configuration des forces conservatrices analysée dans la section précédente soit présente dans toute démocratie bourgeoise, dans des proportions inégales, bien sûr, ou sans parallèles exacts d’un pays à l’autre. Mais le cas du Chili n’est pas unique. Les choses étant ainsi, le plus important est alors de tenter l’analyse la plus précise possible de la réponse du régime Allende au défi que lui lançaient ces forces.
En l’occurrence, et bien qu’il y ait et qu’il continuera d’y avoir une controverse sans fin au sein de la gauche pour savoir qui porte la responsabilité de ce qui a mal tourné (si tant est que quelqu’un la porte), et si les choses auraient pu se passer autrement, il y a très peu de controverses sur ce qu’était réellement la stratégie du régime d’Allende. En fait, il n’y en a pas non plus à gauche. Tant les modérés que les radicaux de la gauche sont au moins d’accord sur le fait que la stratégie d’Allende consistait à effectuer une transition constitutionnelle et pacifique vers le socialisme.
Les modérés estiment que c’était la seule voie possible et souhaitable. Les radicaux affirment que c’était la voie qui menait au désastre. Ces derniers ont vu juste au bout du compte, mais reste à savoir si c’est pour les bonnes raisons. Quoi qu’il en soit, plusieurs questions se posent ici, beaucoup trop importantes et beaucoup trop complexes pour être résolues par des slogans. C’est de certaines de ces questions que je voudrais traiter ici.
Commençons par le commencement, à savoir par la manière dont l’arrivée de la gauche au pouvoir, ou à des fonctions gouvernementales, doit être envisagée dans les démocraties bourgeoises. Il y a de fortes chances que cela se produise par le biais du succès électoral d’une coalition de gauche composée de communistes, de socialistes et d’autres groupements de tendances plus ou moins radicales. Dire cela ne signifie pas pas qu’une crise ne pourrait pas se produire qui ouvrirait des possibilités d’un autre type : il se peut, par exemple, que mai 1968 en France ait été une crise de ce type.
Mais, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, les partis susceptible de prendre le pouvoir dans ce type de situation, à savoir les grandes formations de la gauche, notamment les partis communistes français et italien, n’ont absolument pas l’intention de s’engager dans une telle voie ; ils sont en fait fermement convaincus que cela conduirait à un désastre certain et ferait reculer le mouvement de la classe ouvrière pour les générations à venir. Leur attitude pourrait changer si des circonstances impossibles à anticiper se présentaient, par exemple l’imminence évidente ou le déclenchement pur et simple d’un coup d’État de droite. Mais il s’agit là d’une spéculation. Ce qui ne l’est pas, en revanche, c’est que ces grandes formations, qui bénéficient du soutien de la majeure partie de la classe ouvrière organisée, et ce pour encore très longtemps, sont totalement déterminées à conquérir le pouvoir, ou le gouvernement, par des moyens électoraux et constitutionnels. Telle était également la position de la coalition dirigée par Allende au Chili.
Il fut un temps où beaucoup de monde à gauche affirmait que, si une gauche clairement engagée en faveur de profonds changements économiques et sociaux était en passe de remporter une élection, la droite « ne la laisserait pas faire », et qu’en d’autres termes, qu’elle lancerait une attaque préventive par un recours au coup d’État. Ce point de vue n’est plus très répandu : on estime, à tort ou à raison, que, dans des circonstances « normales », la droite ne serait pas en mesure de décider si elle peut ou non « autoriser » la tenue d’élections. Quoi que la droite et le gouvernement puissent faire pour influencer les résultats, ils ne pourraient pas prendre le risque d’empêcher la tenue des élections.
La position actuelle de « l’extrême » gauche tend à dire que, même s’il en est ainsi, et en admettant qu’il en sera probablement ainsi, toute victoire électorale de ce type est, par définition, vouée à être stérile. L’argument, ou l’un des principaux arguments sur lequel repose cette affirmation est que l’obtention d’une victoire électorale ne peut être obtenue qu’au prix d’un surcroît de manœuvres, de compromis et de calculs électoralistes qui la priveraient de toute signification réelle. Il me semble qu’il y a là davantage de validité que ce que les modérés de la gauche sont prêts à concéder, mais sans que cela corresponde nécessairement à ce qu’affirment leurs adversaires. Dans ce domaine, les définitions ne sont pas d’un grand secours. Les opposants à la « voie électorale » n’ont pas non plus grand-chose à offrir en termes d’alternative, dans les conditions propres aux démocraties bourgeoises des sociétés capitalistes avancées. Les options qu’ils proposent se sont jusqu’à présent révélées dépourvues d’attrait pour la majeure partie de la population dont le soutien est indispensable précisément pour leur mise en œuvre, et rien ne permet sérieusement de penser qu’il pourrait en être radicalement autrement dans les temps à venir.
En d’autres termes, il faut partir du principe que, dans les pays dotés d’un tel système politique, c’est par le biais d’une victoire électorale que les forces de gauche parviendront au gouvernement. La question vraiment importante est de savoir ce qui se passe alors. Car, comme Marx le notait également au moment de la Commune de Paris, la victoire électorale ne donne que le droit, pas le pouvoir de gouverner. Sauf à considérer comme acquis que ce droit de gouverner ne pourra jamais, dans ces conditions, se transformer en pouvoir de gouverner, c’est là que la gauche se trouve confrontée à des questions complexes qu’elle n’a jusqu’à présent que très imparfaitement explorées ; c’est là que les slogans, la rhétorique et l’incantation se sont le plus volontiers substitués au dur labeur d’une réflexion politique réaliste. De ce point de vue, le Chili offre des indications et des « leçons » extrêmement importantes sur ce qu’il convient de faire, et peut-être, de ne pas faire.
La stratégie adoptée par les forces de la gauche chilienne avait une caractéristique qui n’est pas souvent associée à la coalition, à savoir un degré élevé d’inflexibilité. Je veux dire par là qu’Allende et ses alliés avaient décidé, bien avant leur arrivée au pouvoir, d’adopter certaines lignes de conduite et d’en délaisser d’autres. Ils avaient décidé d’agir dans le strict respect du constitutionnalisme, de la légalité et du gradualisme ; et corollairement, ils étaient prêts à tout pour éviter une guerre civile. Ayant pris cette décision avant leur entrée en fonction, ils s’y sont tenus jusqu’au bout, en dépit des changements de circonstances. Pourtant, il se peut bien que ce qui était juste, approprié et inévitable au départ soit devenu suicidaire au gré de l’intensification du rapport de forces. Ce qui est en cause ici, ce n’est pas l’opposition « réforme ou révolution » : c’est le fait qu’Allende et ses camarades aient été attachés à une version particulière du modèle « réformiste », qui les a finalement mis dans l’incapacité de se confronter aux obstacles qui se sont dressés sur leur route. Ce point mérite d’être approfondi.
Accéder au pouvoir par la voie électorale implique d’emménager dans une maison longtemps occupée par des personnes aux habitudes très différentes : cela implique, d’ailleurs, d’emménager dans une maison dont de nombreuses pièces s’avèrent toujours occupées par ces personnes. En d’autres termes, la victoire d’Allende aux élections a permis à la gauche d’occuper l’un des éléments du système étatique, l’exécutif, un élément extrêmement important, peut-être le plus important, mais évidemment pas le seul. Après cette victoire partielle, le président et son équipe ont entrepris de mettre en œuvre leurs politiques en faisant fonctionner un système dont ils étaient devenus eux-mêmes partie intégrante.
Ce faisant, ils contrevenaient sans aucun doute à un principe essentiel du canon marxiste. Comme Marx l’a écrit dans une célèbre lettre à Kugelmann au moment de la Commune de Paris, « la prochaine tentative de la révolution en France devra consister, non plus à faire passer la machine bureaucratique et militaire en d’autres mains comme ce fut le cas jusqu’ici, mais à la détruire. C’est la condition première de toute véritable révolution populaire sur le continent ». De même, dans La guerre civile en France, Marx note que « la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre tel quel l’appareil d’État prêt à l’emploi et de le faire fonctionner pour son propre compte » ; puis il décrit la nature de l’alternative telle qu’elle a été préfigurée par la Commune de Paris. Marx et Engels considéraient cette question comme si importante que, dans la préface à l’édition allemande de 1872 du Manifeste communiste, ils notaient que « la Commune a surtout prouvé une chose », cette chose étant l’observation de Marx dans La guerre civile en France que je viens de citer. C’est de ces observations que Lénine a tiré l’idée que « briser l’État bourgeois » était la tâche essentielle du mouvement révolutionnaire.
J’ai soutenu ailleurs[23] que dans le sens où il semble être utilisé dans L’État et la Révolution (et d’ailleurs dans La guerre civile en France), c’est-à-dire dans le sens de l’établissement d’une forme extrême de démocratie des conseils (ou, en russe, soviets) au lendemain même de la révolution comme substitut à l’État bourgeois détruit, la notion constitue une projection impossible qui ne peut être d’aucune pertinence immédiate pour tout régime révolutionnaire. Elle n’était certainement d’aucune pertinence immédiate pour la pratique léniniste au lendemain de la révolution bolchevique. Il est donc assez difficile de reprocher à Allende et à ses collègues de ne pas avoir fait quelque chose qu’ils n’avaient jamais envisagé, et de les blâmer au nom de Lénine, qui n’a certainement pas tenu la promesse énoncée dans L’État et la révolution, et n’aurait de toute façon pas pu la tenir.
Cependant, bien qu’il soit honteusement « révisionniste » de le suggérer, il peut y avoir d’autres possibilités qui sont pertinentes pour la discussion de la pratique révolutionnaire, et pour l’expérience chilienne, et qui diffèrent également de la version particulière du « réformisme » adoptée par les dirigeants de la coalition de l’Unité populaire.
Ainsi, un gouvernement déterminé à opérer des changements économiques, sociaux et politiques majeurs, à certains égards cruciaux, a plusieurs options devant lui, même s’il n’envisage pas de « briser l’État bourgeois ». Il peut, par exemple, être en mesure d’effectuer des changements considérables dans la fonction publique et dans différents domaines du système étatique. Dans le même ordre d’idées, il peut, par une variété de procédés institutionnels et politiques, commencer à attaquer et à déborder l’appareil d’État existant. En fait, il doit le faire s’il veut survivre, et il doit finalement le faire en ce qui concerne l’élément le plus difficile de tous, à savoir l’armée et la police.
Le régime Allende a pris certaines mesures dans ce sens. La question de savoir s’il aurait pu en faire davantage, compte tenu des circonstances, doit être débattue ; mais il semble qu’il ait été moins capable ou moins désireux de s’attaquer au problème le plus difficile, celui posé par l’armée. Au lieu de cela, il semble avoir cherché à obtenir le soutien et la bonne volonté de celle-ci par la conciliation et les concessions, jusqu’au moment du coup d’État, malgré les preuves de plus en plus nombreuses de l’hostilité des militaires.
Dans le discours qu’il a prononcé le 8 juillet dernier [1973] et auquel j’ai fait référence au début de cet article, Luis Corvalán a observé que « certains réactionnaires ont commencé à chercher de nouvelles façons de creuser un fossé entre le peuple et les forces armées, allant jusqu’à affirmer que nous avons l’intention de remplacer l’armée professionnelle. Non, messieurs ! Nous continuons à soutenir le caractère absolument professionnel des institutions armées. Leurs ennemis ne se trouvent pas dans les rangs du peuple, mais dans le camp réactionnaire ».[24] Il est bien dommage que les militaires n’aient pas partagé ce point de vue : l’une de leurs premières actions après leur prise du pouvoir a été de libérer les fascistes du groupe Patrie et Liberté que le gouvernement Allende avait fini par envoyer en prison. D’autres dirigeants de la coalition, ainsi qu’Allende lui-même, ont souvent fait des déclarations similaires à celles de Corvalan, exprimant leur confiance dans l’esprit constitutionnel des militaires.
Bien sûr, ni eux ni Corvalan ne se faisaient beaucoup d’illusions sur le soutien qu’ils pouvaient attendre de l’armée, mais il semblerait néanmoins que la plupart d’entre eux pensaient pouvoir soudoyer l’armée et que ce n’était pas tant un coup d’État sur le modèle « latino-américain » classique qu’Allende craignait, mais plutôt une « guerre civile ».
Régis Debray a écrit, en s’appuyant sur sa connaissance personnelle de la personne, qu’Allende avait une « aversion viscérale » de la guerre civile. La première chose à dire à ce sujet est que seules des personnes moralement et politiquement paralysées dans leur sensibilité se moqueraient de cette « aversion » ou la considéreraient comme ignoble. Mais cela n’épuise pas le sujet. Il y a différentes façons d’essayer d’éviter la guerre civile : il peut y avoir d’autres occasions où l’on ne peut pas l’éviter et survivre. Debray écrit également (et ses termes sont intéressants en eux-mêmes) qu’« il [Allende] n’était pas dupe de la phraséologie du ‘pouvoir populaire’ et ne voulait pas porter la responsabilité de milliers de morts inutiles : le sang des autres l’horrifiait. C’est pourquoi il n’a pas écouté son parti, le Parti Socialiste qui l’accusait de manœuvres inutiles et qui le pressait de passer à l’offensive ».[25]
Il serait utile de savoir si Debray lui-même pense que le « pouvoir populaire » est nécessairement une « phraséologie » à laquelle il ne faut pas se laisser « prendre » ; et aussi ce qu’il entend par « passer à l’offensive ». Quoi qu’il en soit, « le refus viscéral « opposé par Allende à la guerre civile, comme Debray le précise, n’était qu’une partie de l’argument en faveur de la conciliation et du compromis, l’autre étant son profond scepticisme quant à l’existence d’une autre issue possible. Le récit de Debray, qui décrit les discussions qui ont eu lieu dans les dernières semaines avant le coup d’État, contient un paragraphe révélateur à ce sujet :
« Désarmer les comploteurs ? » – « Avec quoi ? », répondait Allende. « Donnez-moi d’abord les forces pour le faire ». « Mobilisez-les », lui disait-on de toutes parts. Car il est vrai [c’est Debray qui parle – R.M.] qu’il planait là-haut, dans les superstructures, laissant les masses sans orientations idéologiques ni direction politique. « Seule l’action directe des masses arrêtera le coup d’État. » – « Et combien de masses faut-il pour arrêter un char d’assaut ? », répondait Allende.[26]
Que l’on soit d’accord ou non pour dire qu’Allende « planait là-haut, dans les superstructures », ce genre de dialogue a des accents de vérité et peut contribuer à expliquer une bonne partie des événements au Chili.
Compte tenu des circonstances de la mort de Salvador Allende, une certaine réticence s’impose. Pourtant, il est impossible de ne pas lui attribuer au moins une partie de la responsabilité de ce qui s’est passé. Dans l’article que je viens de citer, Debray raconte également que l’un des plus proches collaborateurs d’Allende, Carlos Altamirano, secrétaire général du Parti Socialiste, lui avait dit, avec colère, à propos des manœuvres d’Allende, que « la meilleure façon de précipiter un affrontement et de le rendre encore plus sanglant, c’est de lui tourner le dos ».[27] D’autres proches d’Allende étaient depuis longtemps du même avis. Mais, comme l’a également noté Marcel Niedergang, tous « respectaient Allende, le centre de gravité et la véritable figure tutélaire de la coalition de l’Unité Populaire ».[28] Allende, comme nous le savons, était absolument déterminé à suivre la voie de la conciliation, encouragé dans ce sens par sa peur de la guerre civile et de la défaite, par les divisions dans la coalition qu’il dirigeait et par les faiblesses dans l’organisation de la classe ouvrière chilienne, par un Parti communiste extrêmement « modéré », etc.
Le problème de cette orientation est qu’elle présente tous les éléments d’une catastrophe autoréalisatrice. Allende a cru à la conciliation par crainte du résultat d’une confrontation. C’est précisément parce qu’il croyait que la gauche était vouée à la défaite dans une telle confrontation qu’il a dû poursuivre avec un désespoir toujours plus grand sa politique de conciliation ; mais ses adversaires gagnaient en assurance et en audace à mesure qu’il poursuivait cette politique. En outre, et c’est un point crucial, une politique de conciliation avec les opposants au régime comportait le risque grave de décourager et de démobiliser ses partisans.
La « conciliation » signale une tendance, une impulsion, une direction, qui s’exprime concrètement sur de nombreux terrains, qu’elle soit voulue ou non. Ainsi, en octobre 1972, le gouvernement avait fait adopter par l’Assemblée nationale une « loi sur le contrôle des armes » qui donnait à l’armée de larges pouvoirs de recherche des caches d’armes. Dans la pratique, et compte tenu des préjugés et des inclinations de l’armée, cette loi s’est rapidement transformée en un prétexte pour mener des raids militaires dans des usines considérées comme des bastions de la gauche, dans le but évident d’intimider et de démoraliser les militants de gauche[29], tout cela de manière tout à fait – ou du moins suffisamment – « légale ».
Ce qui est vraiment extraordinaire dans cette expérience, c’est que la politique de « conciliation », poursuivie de manière si résolue et désastreuse, n’a pas provoqué une démoralisation plus grande et plus précoce à gauche. Même à la fin du mois de juin 1973, lors du coup d’État militaire avorté, la volonté populaire de se mobiliser contre les candidats putschistes était, de l’avis général, au plus haut depuis l’accession d’Allende à la présidence. Ce fut probablement le dernier moment où un changement de cap aurait été possible, et ce fut aussi, d’une certaine manière, le moment de vérité pour le régime : un choix devait alors être fait. Un choix a été fait, à savoir le président Allende continua à chercher la conciliation ; il a continué à céder, encore et encore, aux exigences des militaires.
Je ne prétends pas ici, répétons-le, qu’une autre stratégie aurait garanti la réussite, mais seulement que celle qui a été adoptée était vouée à l’échec. Eric Hobsbawm, dans l’article déjà cité, écrit que « Allende n’aurait pas pu faire grand-chose après (disons) le début de 1972, si ce n’est temporiser, assurer l’irréversibilité des grands changements déjà accomplis [mais comment ? – R.M.] et, avec un peu de chance, maintenir un système politique qui donnerait plus tard une seconde chance à l’Unité populaire … pour les derniers mois, il est à peu près certain qu’il n’a pratiquement rien pu faire ».[30] En dépit de son apparence raisonnable et réaliste, l’argument est à la fois très abstrait et suicidaire.
D’une part, on ne peut pas « jouer la montre » dans une situation où de grands changements se sont déjà produits, qui ont entraîné une polarisation considérable et où les forces conservatrices passent de la lutte des classes à la guerre des classes. On peut soit avancer, soit battre en retraite, jusqu’à sombrer dans l’oubli, ou être à l’offensive pour relever le défi.
Dans une telle situation, il n’est pas bon non plus d’agir en partant du principe qu’il n’y pas grand-chose à faire, dès lors que cela implique en pratique que rien ne sera fait, pour se préparer à la confrontation avec les forces conservatrices. Une telle attitude ne tient pas compte de la possibilité que le meilleur – et peut-être le seul – moyen d’éviter une telle confrontation consiste précisément à s’y préparer et à se mettre le plus possible en situation de vaincre si elle a lieu.
Cela nous ramène directement à la question de l’État et de l’exercice du pouvoir. J’ai noté précédemment qu’un changement majeur dans le personnel de l’État est une tâche urgente et essentielle pour un gouvernement désireux d’opérer un changement bien réel, et que ce changement doit s’accompagner d’une série de réformes et d’innovations institutionnelles, destinées à faire avancer le processus de démocratisation de l’État. A cet égard, il faut faire beaucoup plus, non seulement pour réaliser un ensemble d’objectifs socialistes à long terme concernant l’exercice socialiste du pouvoir, mais aussi comme moyen soit d’éviter la confrontation armée, soit de l’affronter dans les conditions les plus avantageuses et les moins coûteuses si elle s’avère inévitable.
Cela ne signifie pas simplement « mobiliser les masses » ou « armer les travailleurs.ses ». Il s’agit de slogans, et de slogans importants, auxquels il faut donner un contenu institutionnel effectif. En d’autres termes, un nouveau régime désireux de modifier fondamentalement les structures économiques, sociales et politiques doit, dès le départ, commencer à construire et à encourager la construction d’un réseau d’organes de pouvoir, parallèle et complémentaire au pouvoir d’État. Il peut ainsi constituer une infrastructure solide pour la « mobilisation des masses » en temps voulu et pour la direction efficace de leurs actions. Les formes que prend cette mobilisation, comités de travailleurs.ses sur leur lieu de travail, comités civiques dans les quartiers, etc.., et la manière dont ces organes viennent participer du « maillage » de l’État n’est guère susceptible d’être planifiée. Mais le besoin est là, et il est impératif d’y répondre, sous les formes les plus appropriées.
Ce n’est manifestement pas, la façon dont le régime Allende a agi. Une partie de ce qu’il fallait faire fut fait ; mais la « mobilisation » qui s’est produite et les préparatifs qui ont été faits, très tard, en vue d’une éventuelle confrontation, manquaient de direction, de cohérence et même, dans de nombreux cas, d’encouragement. Si le régime avait réellement encouragé la création d’une infrastructure parallèle, il aurait peut-être survécu. Incidemment, il aurait peut-être eu moins de problèmes avec ses opposant.e.s et ses critiques au sein de la gauche. Par exemple avec le MIR [Mouvement de la Gauche Révolutionnaire], puisque ses membres n’auraient pas éprouvé un besoin aussi pressant de mener leurs propres action, qui furent un tel embarras pour le gouvernement : ils et elles auraient peut-être été plus disposé.e.s à coopérer avec un gouvernement dont ils auraient estimé la volonté révolutionnaire davantage digne de confiance. Le « gauchisme » est, au moins en partie, le produit d’un excès de « modérantisme ».
Salvador Allende était une figure noble et il est mort en héros. Cependant, bien que la chose soit difficile à admettre, là n’est pas la question. Ce qui importe, en fin de compte, ce n’est pas la façon dont il est mort, mais la question de savoir s’il aurait pu survivre en suivant des orientations différentes. Il est faux de prétendre qu’il n’y avait pas d’alternative aux politiques qui ont été menées. Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, et ici plus encore que partout ailleurs, les faits ne dictent leur logique que dans la mesure où on leur permet de le faire.
Allende n’était pas un révolutionnaire doublé d’un politicien parlementaire. C’était un politicien parlementaire qui, de manière assez remarquable, avait de véritables tendances révolutionnaires. Mais ces tendances n’ont pas pu surmonter un style politique qui n’était pas adapté aux objectifs qu’il voulait atteindre.
La question n’est évidemment pas celle du courage. Allende avait tout le courage nécessaire, et davantage encore. La célèbre remarque de Saint-Just, souvent citée depuis le coup d’État, selon laquelle « ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau » est plus proche de la réalité, mais elle peut facilement être détournée de son sens. Certains à gauche y trouvent simplement une justification du recours impitoyable à la terreur, et répètent, comme s’ils venaient d’inventer l’idée, qu’ « on ne peut pas faire d’omelettes sans casser des œufs ». Mais comme l’a fait remarquer l’écrivain français Claude Roy il y a quelques années, « on peut casser beaucoup d’œufs sans faire une bonne omelette ». La terreur peut faire partie d’une lutte révolutionnaire. Mais la question essentielle est de savoir dans quelle mesure celles et ceux qui sont chargés de mener cette lutte sont capables et désireux d’engendrer et d’encourager la mobilisation effective, c’est-à-dire organisée, des forces populaires. S’il y a une « leçon » précise à tirer de la tragédie chilienne, c’est bien celle-là ; les partis et mouvements qui ne l’apprennent pas, et s’en tiennent à ce qu’ils connaissent, risquent fort de se préparer de nouveaux Chili.
*
Ce texte est initialement paru dans l’édition de 1973 de Socialist Register sous le titre « The Coup in Chile ». Il est également disponible en ligne sur le site marxists.org.
Traduction par Christian Dubucq, avec l’aide de Stathis Kouvélakis, Thierry Labica et Ugo Palheta.
Notes
[1] Sans la pression et les protestations internationales, Corvalan aurait probablement déjà été exécuté (octobre 1973), comme tant d’autres, après un semblant de procès ou sans procès. [En décembre 1976, suite à des négociations entre l’URSS et le régime de Pinochet – menées sous la houlette des Etats-Unis – Luis Corvalán a été libéré en échange de la libération du dissident soviétique Vladimir Boukovski – NdT].
[2] The Times, 13 septembre 1973.
[3] Ibid.
[4] Le Monde, 29 septembre 1973.
[5] Cité par K.S. Karol dans Le Nouvel Observateur, 8 octobre 1973.
[6] Le Monde, 23-24 septembre 1973.
[7] Terme de Jean-Paul Sartre, élaboré dans la Critique de la raison dialectique, désignant la façon dont, au cours des processus historique, la praxis des individus et des groupes est sans cesse déviée de son but, finit par échouer et par se perdre dans une infinité non-maîtrisable de conséquences (NdT).
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Le Monde, 13 septembre 1973.
[11] The Guardian, 19 septembrse 1973.
[12] Depuis l’écriture de ce texte, les travaux de la Commission Church du Sénat des Etats-Unis (cf. son rapport concernant plus spécifiquement le Chili publié en 1976) ont établi l’implication étatsunienne dans la préparation du coup d’Etat. Son ampleur a été confirmée par des milliers de documents officiels déclassifiés à la fin des années 1990 [NdT].
[13] Eric J. Hobsbawm, « The Murder of Chile », in New Society, 20 septembre 1973.
[14] Le Monde, 29 septembre 1973.
[15] Ibid.
[16] Karl Marx, La guerre civile en France (1871) – en ligne.
[17] The Times, 5 octobre 1973.
[18] Selon les estimations actuelles, 3200 personnes seraient mortes, 40 000 auraient été torturées et des centaines de milliers poussées à l’exil. 1200 personnes sont à ce jour toujours portées disparues [NdT].
[19] New Society, art. cit.
[20] Jean-Paul Sartre, L’Idiot de la Famille. Gustave Flaubert de 1821 à 1857, vol. III, Paris, Gallimard, 1988 [1ère édition 1972], p. 585.
[21] Marcelle Auclair, « Les Illusions de la Haute Société », in Le Monde, 4 octobre 1973.
[22] Ibid., 29 septembre 1973.
[23] Ralph Miliband, « Lenin’s The State and Revolution », Socialist Register, 1970, p. 309-319.
[24] Marxism Today, Septembre 1973, p. 266. Voir également ci-dessous note 27.
[25] Le Nouvel-Observateur, 17 septembre 1973.
[26] Ibid.
[27] Ibid. Il convient toutefois de noter qu’Altamirano aurait également déclaré, après la tentative de coup d’État du 29 juin, que « jamais l’unité entre le peuple, les forces armées et la police n’a été aussi grande qu’aujourd’hui … et cette unité se renforcera à chaque nouvelle bataille dans la guerre historique que nous menons ». (Le Monde, 16-17 septembre 1973).
[28] Le Monde, 29 septembre 1973.
[29] Ibid., 16-17 septembre 1973. [Il s’agit d’une référence à un article de Jean-Pierre Beauvais, paru dans Rouge, qui relate un raid de l’armée, le 4 août 1973, au cours duquel un homme a été tué et plusieurs ont été blessés lors de ce qui s’apparentait à une attaque de troupes parachutistes contre une usine textile].
[30] New Society, art. cit.
![Chili 73 : un coup d’État qui permit la contre-révolution néolibérale [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/golpe-chile-1973-150x150.jpg)