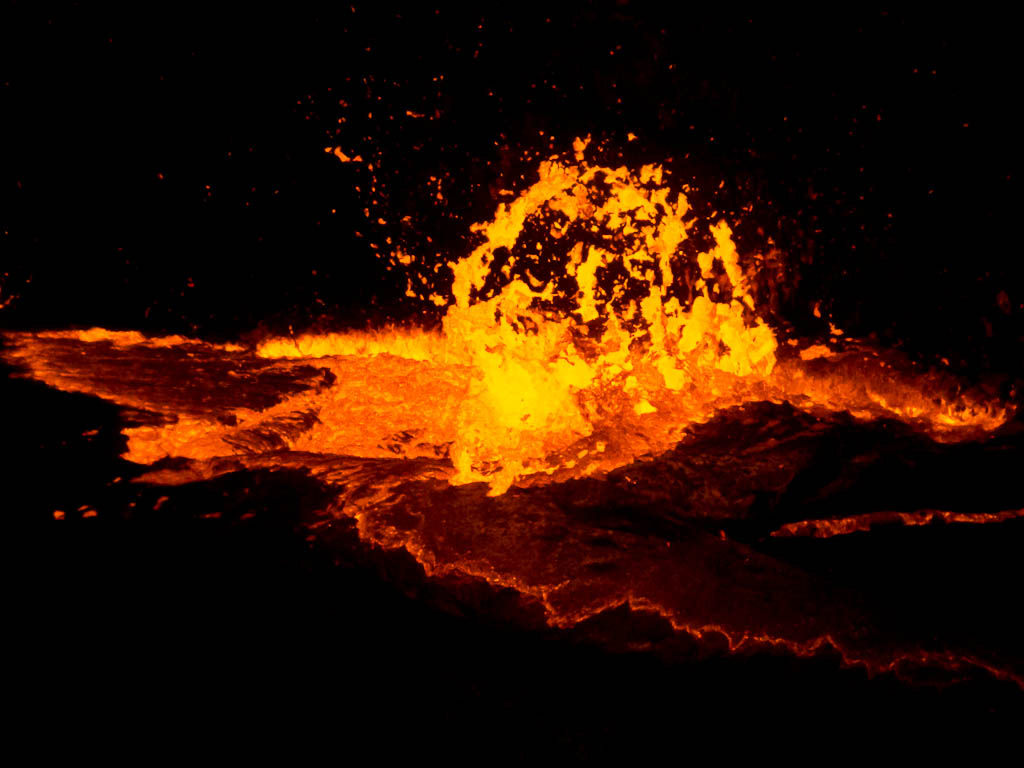
Chili : la révolution comme événement persistant, 50 ans après le coup d’État
Dans ce texte, Pablo Abufom Silva, militant, traducteur et éditeur relie les débats et la lutte pour le pouvoir populaire qui eurent lieu durant le gouvernement de Salvador Allende aux récentes mobilisations sociales de son pays et, particulièrement, au soulèvement d’octobre 2019. Il interroge ainsi les résonances historiques et la signification stratégique du concept de « pouvoir populaire » chilien pour penser les alternatives au 21ème siècle.
Ce texte constitue le prologue à la réédition de l’anthologie consacrée aux mille jours de la « voie chilienne au socialisme » (1970-1973) présentée et éditée par l’historien Franck Gaudichaud (membre de la rédaction de Contretemps Web) et intitulée Venceremos. Expériences chiliennes du pouvoir populaire (Syllepse, 2023).
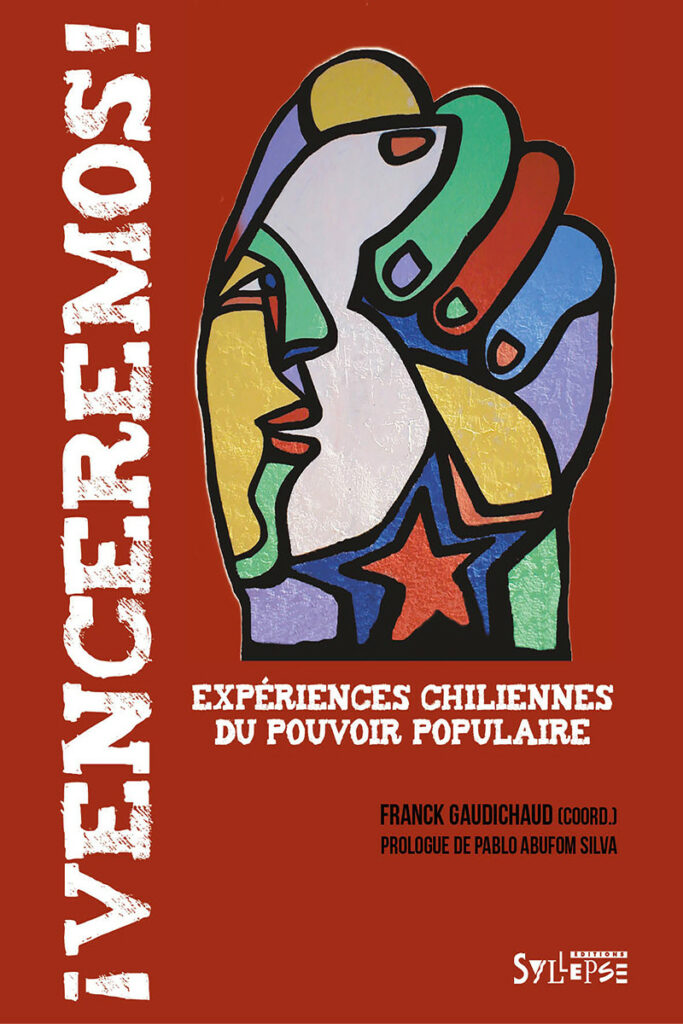
Que signifie le passage du temps pour les grands évènements historiques ? Leur consécration dans la mémoire mondiale leur apporte une protection contre l’érosion de l’oubli mais les expose à la bataille interminable autour de leur signification historique. Une bataille qui s’est livrée durant des décennies ou des siècles pour établir leur vérité, c’est-à-dire l’effet le plus persistant qu’ils auront sur la mémoire de l’avenir, du moins jusqu’à ce que leur signification donne lieu à une nouvelle bataille. De ce point de vue, les événements historiques ne connaissent pas le passage du temps mais en viennent à composer la trame même de l’histoire et sont évoqués dans chaque nouvelle conjoncture afin d’expliquer la nature d’un phénomène donné ainsi que la nature même du temps social qui habite l’humanité. Ces événements acquièrent une fréquence propre avec laquelle ils vibrent à travers les siècles puis résonnent dans des événements futurs à des fréquences similaires.
Quel est l’évènement historique que l’on commémore cinquante ans après le coup d’État du 11 septembre 1973 ? S’agit-il du coup d’État lui-même, avec sa violence dévastatrice et les décennies sombres qu’il a ouvertes ? Du gouvernement de l’Unité populaire en tant qu’exemple emblématique d’une victoire défaite ? Du processus de construction du pouvoir populaire, qui contenait mais dépassait l’Unité populaire et plongeait ses racines dans l’ « aube de la révolution » trente ou quarante ans auparavant ? À la différence de commémorations antérieures, ces cinquante ans surviennent alors que nous sommes au milieu d’une crise politique aiguë ouverte par un conflit autour de la signification de cet événement, avec une atmosphère de guerre de tranchées inédite pour notre génération. Le renouveau pinochetiste ne commémore-t-il pas, pour sa part, la cristallisation la plus pure de l’issue autoritaire à la crise qu’il appelle aujourd’hui de ses vœux ? N’est-ce pas également une commémoration de cet « effondrement de la démocratie » que déplorent de façon ambiguë les champions néolibéraux de la transition, sans qu’on sache avec certitude si l’agent de cet effondrement fut Allende ou Pinochet ? Enfin, n’est-ce pas là une opportunité pour l’actuel gouvernement progressiste de se débarrasser de l’image combative de sa jeunesse étudiante pour s’inscrire pleinement dans la tradition démocratique chilienne, avec toute son hypocrisie légaliste et sa condescendance petite-bourgeoise face aux « excès » des pauvres aux moments cruciaux de son histoire ?
Face à cette mémoire historique bigarrée, il semble raisonnable d’affirmer que la commémoration des cinquante ans est précisément la célébration d’une lutte sans merci pour la vérité de la crise actuelle, qui vibre plus fort que jamais et dans laquelle on peut entendre les échos des cinq dernières décennies. Depuis octobre 2019, nous habitons un Chili qui connaît de fortes résonances avec la longue période commencée en 1970, résonances évoquées par toutes les composantes de la population face aux expériences de la révolte populaire, aux multiples états d’exception, au triomphe d’un président à la tête d’une coalition incluant la gauche, à l’échec de la première tentative constituante du siècle, au retour des groupes violents de l’extrême droite, à la menace de coups d’État militaires pour canaliser les aspirations au changement, parmi d’autres épisodes qui ont fait vibrer les cordes de la mémoire collective nationale.
Tous ces aspects de notre histoire présente ont trouvé des similitudes, des variations ou des préfigurations dans des faits des cinquante dernières années. Et c’est cette question que nous voulons approfondir dans cet avant-propos. Non pas parce que penser l’histoire comme un jeu d’analogies où tout se ressemble ait du sens, mais parce que la conjoncture de ces dernières années s’est présentée devant la mémoire du peuple chilien comme la plus grande opportunité de se défaire du lourd fardeau de cette même note tragique qui retentit depuis septembre 1973: la double défaite stratégique que signifièrent pour la classe ouvrière le coup d’État et la transition démocratique négociée.
La tragédie d’une double défaite
Le projet révolutionnaire chilien du 20e siècle, avec sa double voie vers le pouvoir, connut un coup d’arrêt absolu avec le coup d’État et la dictature, qui fit régresser de presque un siècle l’organisation populaire et des apprentissages stratégiques. Non seulement les organisations et les militant.es furent brisés et éliminés matériellement, mais on détruisit également les conditions ouvrant la possibilité d’un projet révolutionnaire dans les termes imaginés par les organisations de pobladores (habitant.es des quartiers pauvres et précaires), les syndicats et les partis ouvriers du siècle dernier. Les transformations économiques sous la dictature et leur approfondissement pendant la transition démocratique entraînèrent une fragmentation objective de la vie des classes travailleuses au Chili, imposant une marginalisation de leur force et des ressources institutionnelles permettant leur organisation, comme l’illustrent les conséquences du Plan Laboral de 1978 sur les luttes syndicales. Ces luttes se sont trouvées acculées par une législation faite sur mesure pour favoriser la sous-traitance, le déclin de la force syndicale et la fragmentation des centrales ouvrières en une multitude de petites organisations corporatistes[1]. Les transformations économiques néolibérales, avec la réorganisation de la majorité de la force de travail déportée vers le secteur des services, eurent, elles aussi, des effets sur les formes de lutte ouvrière, intégrant de manière subordonnée femmes et jeunes dans un marché du travail flexible où les syndicats ont peu de poids. La rénovation urbaine, fondée sur l’éradication des poblaciones et des terrains occupés fut tout aussi profonde, en tentant de mettre un terme par la force à une revendication combative du droit à la ville remontant à l’époque des grandes migrations rurales au milieu du 20e siècle[2]. Ce programme d’urbanisation capitaliste eut finalement pour effets l’expulsion des classes populaires vers les périphéries appauvries ainsi qu’un verrouillage antidémocratique de l’espace public.
Mais la défaite de 1973 est également une défaite stratégique car elle se produisit dans un contexte international marqué par des attaques systématiques contre la classe ouvrière mondiale et un désarmement progressif des alternatives anticapitalistes. L’avancée du néolibéralisme de Pinochet, Thatcher et Reagan articula une réponse globale à la crise de rentabilité des années 1970[3], contraignant les États providence à devenir des États « précarisateurs » et préparant le terrain pour que la fin de l’Union soviétique se déroulât dans un contexte d’offensive capitaliste contre la classe ouvrière dans le monde entier. Ainsi, la lutte contre la dictature dans les années 1980 fut le dernier cri du 20e siècle sous les bannières du socialisme et de la révolution tels que nous les avons connus et fut absorbée par une transition par le haut marquée par l’impunité pour le bloc civilo-militaire de la dictature et la continuité du régime politico-économique. La lutte contre la dictature fut menée par des organisations comme le Movimiento de izquierda revolucionaria (MIR) ou le Frente patriótico Manuel Rodríguez[4], qui adoptèrent le principe d’une confrontation directe avec le régime et ses agents; par des secteurs des classes populaires autoorganisés autour de la résistance quotidienne à la répression, au chômage et à la pauvreté; et par des partis, de la Démocratie chrétienne putschiste au Parti communiste interdit, dans un processus complexe de réorganisation des forces politiques se disputant au sujet du sens et de la portée que devait avoir la « transition démocratique ».
Au bout du compte, ce qui prévalut fut une issue négociée entre les secteurs de centre-gauche réunis au sein de la Concertación de partidos por la democracia (Concertation des partis pour la démocratie, qui incluait un Parti socialiste ‘rénové’), les nouveaux partis de la droite, Renovación nacional (RN) et la Unión demócrata independiente (UDI), et la direction civique-militaire de la dictature. De cette façon, la douloureuse espérance d’un peuple résistant, qui était redescendu dans la rue au cours des Journées nationales de protestation en 1983, fut mise à genoux devant une nouvelle élite politique qui prit les rênes du pays en 1991.
Ce tournant marque une deuxième défaite stratégique pour la classe ouvrière du Chili. La transition démocratique négociée implique un déplacement de l’énergie subversive déployée pour renverser la dictature, remplacée par une continuité négociée du régime socio-économique qui a pris forme depuis les années 1970. La force de la lutte populaire contre la dictature se nourrissait, à grands traits, de deux sources combinées. Une première provenant des traditions militantes du Parti communiste, du Parti socialiste, du Movimiento de acción popular unitaria (MAPU) et du MIR, auxquelles vinrent s’ajouter celles du FPMR et du Movimiento juvenil Lautaro (MJL). Il s’agissait d’organisations diversement implantées dans la classe ouvrière et la paysannerie ainsi que dans certaines couches moyennes de fonctionnaires et d’intellectuels. La lutte contre la dictature menée par ces structures politiques avait une composante défensive, pour la survie matérielle, ainsi qu’une composante de lutte politico-militaire contre un régime autoritaire qui, d’une certaine manière, faisait déjà partie de leur analyse de la situation des dictatures en Amérique latine ou du fascisme européen. Surtout, cette lutte subversive était marquée par le cap de la transformation révolutionnaire : ne jamais cesser de brandir le drapeau du retour à la démocratie tout comme celui de la conquête d’un Chili socialiste.
Mais l’autre source de la force de la lutte contre la dictature fut la réponse populaire à la crise économique du début des années 1980, qui aggrava l’exclusion et l’endettement dont souffraient les pauvres au Chili. Tandis que le régime militaire volait au secours des banques en faillite, le taux de chômage s’élevait à près de 24 % en 1982, provoquant une riposte massive des syndicats et des habitants des quartiers ouvriers. La jeunesse et les femmes jouèrent un rôle central dans les journées nationales de protestation qui commencèrent il y a quarante ans, en mai 1983. Les jeunes des couches populaires, dont beaucoup étaient encore des enfants lors du coup d’État, descendirent dans les rues de leurs quartiers et des centres-villes pour protester à la fois contre le dictateur et contre la misère. Pinochet était devenu synonyme de faim. Les femmes, quant à elles, construisirent des réseaux pour survivre et mirent leur expérience militante des luttes pour le logement et la survie au service du combat contre le régime « au lit, à la maison et dans la rue ». Elles reconfigurèrent même une forme de protestation, les cacerolazos, promue durant l’Unité populaire par les femmes de droite, et en firent le bruit organisé de la résistance.
Durant les années 1980 cette double force explosa, la résistance en venant à se déployer dans toutes les sphères de la vie. Il n’y eut aucun espace dans lequel la lutte contre la dictature n’était pas en jeu. À rebours de la conception de cette décennie au Chili comme une époque de répression totale, de black-out culturel, d’enfermement inexpugnable, d’abattement spirituel d’un peuple tout entier, comme si le pays avait connu une éclipse sociopolitique, on assista en réalité à une explosion de résistance sur tous les fronts. Les manifestations de rue et la lutte armée eurent l’impact le plus fort sur la conjoncture nationale, mais il exista en outre une constellation fascinante d’expressions sociales et culturelles qui permirent à la résistance de conquérir les cœurs et les esprits des masses populaires du Chili[5].
La véritable éclipse sociopolitique fut la transition vers une démocratie sous tutelle. La victoire à la Pyrrhus de la Concertación, restée aux affaires sans interruption entre 1991 et 2010, ne constitua pas une sortie de la dictature mais la transformation de celle-ci sous l’égide de la démocratie libérale. La force massive et militante de la résistance fut noyée dans le triomphalisme des nouveaux mandarins. La combativité des années 1980 n’avait plus de sens, nous disaient-ils, car nous avions vaincu la dictature en nous rendant pacifiquement aux urnes (le plébiscite du 5 octobre 1988), non plus que la mémoire socialiste des partis et mouvements politiques de gauche, car la fin de la dictature coïncidait avec la fin de l’Union soviétique, avec la fin des utopies et le début d’une ère de consensus capitaliste. Voilà pourquoi l’administration civile héritière de la dictature opta pour une politique de l’ennemi intérieur dirigée contre les groupes armés qui pointaient les risques et les limites d’une démocratie sous tutelle. Mais elle déploya également une politique consistant à affaiblir le syndicalisme, à réserver les institutions politiques au bloc partisan reconverti à l’ « économie sociale de marché » et en une dépolitisation générale de la société. Par ailleurs, l’essor de la consommation via l’augmentation de l’endettement privé et la gestion néolibérale des droits sociaux contribuèrent à un sentiment général de modernisation qui balaya une réalité sociale de précarisation de la vie la cachant sous le tapis des statistiques macroéconomiques.
La conjonction de l’élimination matérielle des forces populaires et de la restructuration néolibérale de la reproduction sociale contribua à détruire les conditions de la perspective d’un programme et d’une stratégie de changement pour le peuple chilien. Voilà pourquoi nous qualifions le coup d’État de 1973 et la transition amorcée en 1988 de double défaite stratégique pour la classe ouvrière et pour la gauche du Chili. Ces deux processus historiques vinrent mettre un coup d’arrêt à la longue construction d’un mouvement populaire à l’œuvre depuis le début du 20e siècle. Si le coup d’État mit fin à l’expérience révolutionnaire qui se déroula entre 1970 et 1973, la transition transforma le terrain sur lequel se livrerait la lutte des classes à partir de 1991, mettant à l’agonie les formes partisanes et syndicales du 20e siècle.
Les significations et les « voies » du pouvoir populaire
Le pouvoir populaire peut se dire de bien des façons, mais toutes renvoient à un singulier phénomène polymorphe : le rôle de premier plan joué par les masses dans les processus révolutionnaires. Sa première formulation moderne se trouve peut-être dans l’Union ouvrière de Flora Tristan, suivie de près par le Manifeste du parti communiste, mais elle trouve son expression la plus primordiale dans le préambule de l’adresse inaugurale de la 1re Internationale: « L’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. » Cette phrase, que Luis Emilio Recabarren[6] considérait comme « une vérité irréfutable éprouvée par le temps », introduit irrévocablement le principe de l’indépendance de classe dans l’imaginaire du mouvement socialiste international. Après les tragiques apprentissages des classes populaires lors de la Révolution française, la révolution haïtienne et les révolutions de 1848, le mouvement ouvrier atteint « la forme enfin trouvée » de son autonomie politique, qui se cristallise sur le plan organisationnel dans l’Internationale, puis la met à l’épreuve avec la Commune de Paris.
C’est avec la Commune que se forge l’alphabet du pouvoir populaire avec lequel s’écriront ensuite toutes les histoires révolutionnaires : mobilisation générale des travailleurs et travailleuses des campagnes et des villes, développement de capacités politico-militaires face au régime, destruction créatrice des formes étatiques du pouvoir politique, autogestion économique, égalité matérielle dans tous les domaines, et un large spectre de subversions esthétiques et spirituelles afin de démolir la culture bourgeoise et ériger enfin une culture libre et universelle. Cette vision révolutionnaire s’appuie sur la conviction que la classe ouvrière est la seule capable d’être l’agent d’une émancipation générale de l’humanité. Il s’ensuit que le pouvoir populaire est pouvoir de s’émanciper, une forme active du pouvoir, et non la simple institutionnalisation d’une victoire politico-militaire; il s’agit du pouvoir populaire comme projet stratégique.
Au Chili, durant la période évoquée par les documents de ce livre, le pouvoir populaire eut deux acceptions principales qui ont résonné au cours de l’histoire ultérieure dans une inépuisable danse de tensions créatives. La première désigne le pouvoir populaire incarné politiquement dans le gouvernement de l’Unité populaire, le processus de conquête du pouvoir politique qui a été le protagoniste principal de l’historiographie mondiale consacrée à ce sujet. Il s’agit là de l’acception du pouvoir populaire par le haut. Ensuite, et surtout face à l’ampleur de l’offensive réactionnaire, le pouvoir populaire acquit une acception par le bas, revendiquée par des organisations syndicales, paysannes et partisanes, qui s’identifiaient politiquement avec l’Unité populaire mais qui avaient compris que dans un processus révolutionnaire on ne peut pas laisser toute l’initiative au gouvernement. Ce fut le cas des Cordons industriels qui, s’ils furent pour nombre d’entre eux constitués et/ou menés par des dirigeants de partis ou des dirigeants syndicaux avec des affiliations partisanes, revendiquaient leur indépendance afin de pouvoir approfondir le processus révolutionnaire au-delà des limites imposées aux pouvoirs exécutif et législatif. Ce fut le cas, dans une certaine mesure, des brigades et des mouvements de jeunesse qui agirent pour défendre le processus de l’Unité populaire, mais avec des méthodes de violence politique que le gouvernement en tant que tel ne pouvait reprendre à son compte. Ce fut aussi le cas des Commandos communaux, des Commandos paysans et, surtout, des Comités d’approvisionnement et de contrôle des prix, qui furent créés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le boycott économique mais qui favorisèrent une mobilisation de base territoriale qui dépassait le cadre de l’action de l’État. Tout cela signifie que le pouvoir populaire par le bas ne saurait être réduit à une forme de « double pouvoir », il est plutôt une puissance née de la souffrance qui émerge des entrailles des couches populaires mobilisées par une crise révolutionnaire et qui en commençant à détricoter les limites de l’État bourgeois, s’acheminent vers des formes d’autogouvernement populaire.
Ces deux conceptions du pouvoir populaire ont résonné sans trêve dans la mémoire de la gauche chilienne, entrelaçant dès lors le destin des courants s’étant revendiqués de l’une ou de l’autre, ou même d’une synthèse des deux, en particulier depuis le retour du mot socialisme sur la scène latino-américaine dans les années 2000. Au Chili, tout militant de gauche a sa lecture de l’Unité populaire et de l’acception du pouvoir populaire qui aurait dû avoir plus de poids dans le processus. Cette existence duelle du pouvoir populaire a été formulée de façon dichotomique comme la question des « voies » vers le socialisme, opposant la « voie chilienne », c’est-à-dire pacifique, institutionnelle, fondée sur la tradition démocratique chilienne – promue par les partis de l’UP –, et la « voie révolutionnaire » – c’est-à-dire insurrectionnelle, contre l’État bourgeois et pour le gouvernement ouvrier, s’appuyant sur l’idée d’une rupture avec cette tradition –, représentée classiquement par le MIR et certains secteurs du PS. La métaphore ferroviaire des voies souffre de la même rigidité que les itinéraires des trains: elles semblent séparées, indépendantes l’une de l’autre, voire conduire à des destinations différentes. Les « voies » se présentent comme des ensembles tactiquo-stratégiques complets et autosuffisants, clairement différenciés. C’est du moins de cette façon qu’elles ont été conçues dans la littérature et la mémoire de la gauche au Chili.
Cette conception en termes de « voies » rend effectivement compte du fait qu’il exista deux idées quant aux chemins que devait emprunter la révolution au Chili, idées qui furent ardemment défendues par leurs partisans. L’erreur, c’est que ces « voies » ont été présentées comme des options pouvant être librement choisies par les acteurs, comme s’il s’agissait d’une décision réfléchie entre deux avenues historiques possibles. Mais en politique, presque personne ne choisit, la réalité s’impose à nous ; les chemins sont jonchés d’obstacles, nous avançons, nous reculons, nous changeons de parcours. L’urgence règne, et ce bien plus encore dans le temps fragmenté de la crise révolutionnaire. Et les chemins parcourus, ainsi que la façon de les parcourir, ne résultent pas d’un libre choix idéologique mais de notre capacité à identifier une fenêtre d’opportunité et de nous élancer à travers elle vers un futur possible, sans garantie aucune. De sorte que les « voies » vers le socialisme, au Chili et ailleurs, sont les modalités concrètes par lesquelles la conjoncture révolutionnaire s’est exprimée dans le corps collectif des acteurs du drame historique.
L’existence de courants politiques différenciés devrait être comprise comme la représentation politique du fait qu’il existe bien des groupes sociaux différenciés. Et les tactiques situées à divers moments de la dialectique entre l’institutionnel et l’extra-institutionnel répondent précisément aux modalités d’organisation dans le cadre de la conflictualité politique et sociale adoptées par divers secteurs de la classe ouvrière à partir de leur réalité matérielle et de leur trajectoire historique. En somme, la diversité de la gauche est une expression de l’hétérogénéité de la classe ouvrière, et non l’inverse. Il convient de souligner qu’il s’agit d’une expression et non d’un simple reflet, car cette hétérogénéité existe à travers ce type bien particulier de médiation que nous appelons organisations politiques. De même, l’unité de la gauche résulte toujours de l’unité des différentes composantes de la classe autour d’un conflit ou d’un projet commun. Tel est le fondement ontologique de toute conception démocratique et pluripartisane de la dispute entre courants de gauche.
Du point de vue du pouvoir populaire comme projet stratégique (soit le rôle de premier plan des masses dans le processus révolutionnaire en quête d’une émancipation générale de la société), les « voies » ne sont rien d’autre que l’existence clivée d’un sujet historique traversé par les contradictions d’une société capitaliste. La séparation entre société civile et État, la distance entre des couches précarisées et des couches professionnellement insérées de la même classe, l’existence de courants politiques différenciés représentant des groupes sociaux différenciés, ont conduit les acteurs de la politique transformatrice à devoir assumer des tactiques radicalement distinctes en apparence. Au regard de la théorie révolutionnaire que nous a léguée le 20e siècle, le problème d’une conception rigide de l’action politique pendant l’Unité populaire nous a conduits à concevoir la dimension tactique dans le cadre d’une crise révolutionnaire comme l’expression de projets stratégiques différents. Cette conception rigide et dichotomique est l’expression conceptuelle de la double défaite, affaiblissant la complémentarité des tactiques des différents courants politiques dans le cadre du projet stratégique d’émancipation.
L’objectif de cette réflexion n’est pas de trancher le débat entre les voies ou les conceptions du pouvoir populaire, mais d’indiquer des clés de lecture pour sortir de l’impasse d’une dichotomie inutile pour notre époque. La pensée dichotomique, qui affaiblit encore les gauches au Chili, fait peser le poids du drame historique sur des volontés libres qui auraient pu choisir des « voies » ou surestime les différences tactiques entre courants politiques avec plus de véhémence que celle qu’elle met dans le combat contre l’ennemi commun. C’est une façon de réfléchir qui réduit la complexité du problème stratégique à une analogie erronée (celle des voies) et que l’ampleur de la crise actuelle ne nous permet pas de continuer à faire nôtre.
Ce qui résonne, c’est l’avenir
Revenons à notre question initiale: que commémore-t-on cinquante ans après le coup d’État de 1973 ? Quel est l’événement qui fait vibrer et mobilise les forces du présent ? L’hypothèse de cet avant-propos est que cet événement est le pouvoir populaire comme projet stratégique. C’est cela que l’on commémore, qu’on y soit favorable ou non. Telle est la fréquence fondamentale qui résonne aujourd’hui, bien qu’affaiblie par un demi-siècle de rouille conservatrice et les coups de boutoir de la précarisation.
De même qu’un son complexe peut être décomposé en différentes fréquences qui lui donnent son caractère particulier, ce projet de pouvoir populaire est constitué d’une série de sphères qui résonnent entre elles et à travers lesquelles il est possible de lire la situation du Chili en 2023. Il est également possible, à la lumière de ces sphères, de contribuer à la compréhension du coup d’État de 1973 au-delà de l’hypothèse du mal intrinsèque de l’autoritarisme anticommuniste des dictatures latino-américaines soutenues par l’impérialisme pour imposer par la force les intérêts du capital mondial. Enfin, elles nous permettent de comprendre que la « mémoire obstinée » du Chili n’est pas la nostalgie triste d’un passé détruit, mais la mélancolie rebelle d’un avenir possible, d’un avenir qui peut être conquis. Dans cette dernière partie, je voudrais souligner quelques-unes des cordes qui ont vibré pendant la crise politique chilienne ouverte en octobre 2019, qui n’a pas encore épuisé son potentiel de réorganisation du terrain de la lutte des classes au Chili.
Le temps-maintenant de la révolte
Pour les générations dont la subjectivité a été construite par le Chili post-dictatorial, les nuits du 18 et 19 octobre 2019 ont fait résonner en nous une fureur que nous n’avions jamais ressentie auparavant. Nous avons fait partie d’une rébellion massive qui a répandu l’espoir, à rebours de l’insupportable normalité de l’« oasis » chilienne des riches. Nous avons vu comment, minute après minute, des millions d’autres personnes sont descendues dans les rues et sur les routes, se sont jointes au débat en personne et sur les réseaux sociaux, et ont rapidement ressenti un frisson de peur et de joie. La nuit du 18 a été la gifle du réveil, nous avons embrassé sans hésiter ce moment que nous avions tant imaginé et qui, en même temps, était radicalement impossible à imaginer. Mais nous avons aussi commencé à voir les images d’étudiants blessés par les projectiles de la police. Nous avons aussi entendu à la radio qu’il y aurait une déclaration du président. Et sur le chemin du retour, après avoir traversé des avenues en feu, nous nous sommes assis pour attendre la déclaration du patron.
Après minuit, Sebastián Piñera déclarait l’état d’urgence, dont l’objectif était de « garantir l’ordre public, assurer la tranquillité des habitants de la ville de Santiago, protéger les biens publics et privés et, surtout, garantir les droits de chacun de nos compatriotes qui ont été gravement violés par l’action de véritables délinquants qui ne respectent rien ni personne, qui sont prêts à détruire une institution aussi utile et nécessaire que le métro, et qui ne respectent pas non plus les droits et les libertés de leurs compatriotes ». Trente ans après la fin juridique de la dictature, les militaires retournaient dans les rues pour mettre fin à une révolte populaire, poussés par la figure de l’ennemi intérieur que le gouvernement Piñera a agitée jusqu’à la fin. Le lendemain, un couvre-feu, sans précédent dans la période post-dictature, était instauré. Et cette nuit-là, la nuit du samedi 19 octobre, certains d’entre nous ont été confrontés pour la première fois, à la première personne, à cette histoire que tous les Chilien.nes ont entendu raconter lors des repas de famille à un moment ou à un autre. Des militaires dans la rue, le couvre-feu qui approche, vais-je avoir le temps de rentrer chez moi ? Je n’ai pas dû être le seul à imaginer que l’heure du couvre-feu s’abattrait comme un marteau de silence et de paranoïa sur les rues de Santiago. Les récits de nos parents nous faisaient imaginer des rues menaçantes et silencieuses.
Mais la réalité fut tout autre. Ce samedi-là, à 22 heures, les rues bruissaient de protestations et d’une confiance renouvelée en nos forces. Au rythme des bruits de casseroles et des cris spontanés de la nuit collective, l’arrivée du couvre-feu fut un compte à rebours semblable à celui de la nouvelle année. Que célébrions-nous au milieu de la barbarie d’un État qui nous déclarait la guerre ? Quelque chose de simple et de puissant: la possibilité de redevenir un peuple. Nous avons célébré la défaite des héritages spirituels de la dictature en nous. Nous avons fait la fête toute la nuit autour de feux de joie à la fois clandestins et exhibitionnistes.
Ces premiers jours de révolte, nous les avons célébrés comme s’il n’y avait pas d’autre temps que le présent. Mais un présent étrange, un présent chargé de passé et d’avenir, un moment ouvert. Accrochés au bord de cette fenêtre d’opportunité ouverte par la passion destructrice dont parlait le vieux Bakounine, nous avons pu voir pendant une seconde ce que c’était que d’ouvrir nos grandes alamedas, nos grandes avenues. Le temps actuel de la révolte a laissé s’entrechoquer des fragments de passé et de futur jusqu’à ce que des étincelles jaillissent. La déclaration de l’état d’urgence et le couvre-feu nous ont plongés dans le passé dictatorial, et placés à la merci des forces armées, mais nous ont aussi obligés à réfléchir aux actions nécessaires pour débarrasser les rues du spectre de l’autoritarisme et ouvrir de nouvelles voies de changement. Les différentes formes de protestation, les assemblées territoriales, les cabildos (réunions citoyennes)proto-constituants, l’occupation démocratique des rues, l’inépuisable créativité d’un peuple enflammé par son propre espoir, ont été autant de portes ouvertes sur un avenir possible. En elles, c’est la tradition des opprimés qui faisait irruption, à cor et à cri ou silencieusement. Et avec elle retentissait, entre le drame de la défaite imminente et l’illusion d’une victoire improbable, l’écho de ces moments du cycle 1970-1973 que nous voyions émerger et se mêler au présent.
Démocratie radicale et démocratie socialiste
C’est dans les premiers jours de la révolte qu’apparaissent deux formes d’organisation de base très caractéristiques de la révolte : les assemblées territoriales et les cabildos. Convoquées par des personnes ou des groupes d’un même quartier, les assemblées permettent d’organiser la résistance à la répression, le débat politique sur le moment vécu et la survie quotidienne dans des territoires où le travail, le transport ou le ravitaillement étaient devenus difficiles[7]. Les cabildos, quant à eux, avaient un esprit plus explicitement constituant, dans la mesure où ils étaient compris comme le point de départ et la base d’un processus de changement de la Constitution frauduleusement adoptée lors du plébiscite de 1980 organisé par la dictature.
Ces institutions essentielles de la révolte sont traversées par une revendication/aspiration de démocratie radicale, comprise comme une participation effective à la création d’un espace de délibération et d’action collectives. À travers les mécanismes des assemblées et le vote majoritaire, les assemblées et les cabildos dessinaient le déploiement local de la révolte nationale, quartier par quartier, avec leurs caractéristiques propres. Au début du mois de novembre 2019, ces initiatives locales commençaient déjà à s’entrelacer pour former des coordinations plus larges, comme le Comité de coordination des assemblées territoriales (CAT), qui aspirait à ce que les assemblées de la région métropolitaine et du reste du pays deviennent un sujet politique qui fasse entendre leurs voix et leurs revendications au milieu de la crise politique.
La démocratie radicale occupe, au moins depuis la Commune de Paris, une place prépondérante dans l’imaginaire du mouvement populaire dans toutes ses expressions. Elle est généralement présentée comme la préfiguration d’une démocratie socialiste. Préfiguration n’est pas synonyme d’anticipation. Il s’agit plutôt d’une incarnation du futur dans le présent, et consiste à agir « comme si nous avions déjà fait la révolution ». Elle a quelque chose d’une performance, sachant qu’une démocratie socialiste n’est pas une démocratie vide, une participation indépendante des fins, mais une démocratie avec un contenu, une démocratie qui répond aux buts de la classe ouvrière. Une démocratie socialiste, fondée sur les objectifs et les modes d’existence de la classe ouvrière, est à la fois inclusive et exclusive. Elle inclut ceux qui ont été traditionnellement bannis du domaine de la délibération et de l’action collective, mais elle exclut également ceux qui, « par la raison ou par la force » [8], ont monopolisé le pouvoir social.
C’est peut-être là ce qui introduit la différence la plus substantielle entre la démocratie radicale de la révolte de 2019 et les formes démocratiques du pouvoir populaire de la période 1970-1973. Les Cordons industriels, les Commandos communaux et les Commandos paysans s’inscrivent dans un processus de création d’institutions populaires qui aspirent à la fois à préfigurer un avenir révolutionnaire et à devenir des machines de combat révolutionnaire contre l’offensive bourgeoise. Pour leur part, les assemblées et les cabildos ne s’inscrivent pas dans un processus de pouvoir populaire qui les aurait préalablement englobés, mais répondent rapidement et le plus souvent de manière improvisée à ce qu’impose la situation. Leur esprit participatif radical répond à une hypothèse démocratique de base qui s’est enracinée dans les générations post-dictature lors des vagues successives de mobilisation étudiante (2006 et 2011) et féministe (à partir de 2018), qui ont mis l’accent sur les assemblées, les mandats et les porte-parole, plutôt que sur les cellules, les ordres et les directions.
Mais 2019 est parvenu à faire revivre une hypothèse de pouvoir populaire en expérimentant des formes de contrôle territorial de courte durée dans certains quartiers et poblaciones, et de délibération politique représentative d’un sujet social diversifié, qui n’est désormais plus identifié exclusivement aux notions de prolétariat ou de paysannerie, mais combine des couches contradictoires de subjectivité. Ce phénomène est un effet des formes néolibérales d’individuation, mais représente aussi un exercice de résistance à l’homogénéisation capitaliste. Dans les assemblées, on pouvait sentir la vibration des Cordons, des Commandos, des Comités d’approvisionnement. La révolte jouait sur une double partition : elle s’incarnait dans des militants plus âgés qui nous transmettaient « cette nécessité de tirer la leçon de la confusion des faits, c’est-à-dire une expérience nouvelle »[9] et elle était présente chez celles et ceux d’entre nous qui n’ont pas oublié même ce qu’ils et elles n’ont pas vécu.
Violence politique et ordre public
Outre le retour de l’armée dans les rues du Chili, la révolte a fait écho en partie avec la période de l’Unité populaire dans le rôle que l’occupation des espaces publics et privés, les combats de rue entre forces antagonistes et les diverses manifestations de colère et d’espoir populaires ont commencé à jouer. Dans les deux cas, la violence politique a été l’une des forces déterminantes dans la création d’un nouvel ordre public, marqué par une polarisation aiguë.
L’espace de l’Unité populaire était un tissu de conflits, dans lequel les forces populaires et les forces réactionnaires luttaient pour s’imposer. La contre-offensive réactionnaire organisa des manifestations, des marches et des attaques contre des sièges de partis politiques. Au moins depuis 1971, la participation de femmes, de jeunes et de secteurs radicalisés de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie fut déterminante. La marche des casseroles vides, menée par des femmes en décembre 1971, fut un jalon important dans l’histoire de cette confrontation, car elle créa un espace politique pour les femmes réactionnaires, au nom de la féminité, de la famille et de la patrie. La réponse populaire à cette manifestation et à d’autres vint des brigades de jeunes et de groupes de travailleurs pro-UP, avec des formes de violence qui finirent par coûter au ministre de l’intérieur, José Tohá (père de l’actuel ministre de l’intérieur du gouvernement de Gabriel Boric), une mise en « accusation constitutionnelle » et sa destitution.
Lors de la révolte de 2019, dans un scénario inversé, c’étaient les forces populaires qui étaient des opposantes au gouvernement Piñera et au régime chilien. Leurs outils étaient beaucoup plus rudimentaires, car elles ne disposaient pas du soutien politique, médiatique et économique de l’élite nationale et de ses alliés impérialistes. Mais cela n’a pas empêché un processus fascinant de validation de la violence politique comme méthode de création d’un nouvel ordre public démocratique. La reconnaissance du rôle de ce que l’on appelle la « première ligne » constitue une étape clé. La « première ligne » est apparue comme une tactique défensive lors des manifestations de 2019, et a établi une infrastructure et une division du travail émeutier pour maintenir la répression policière à distance pendant les manifestations. La « première ligne » était une réinvention collective de la figure du « jeune à capuche ». Ce passage de la figure du jeune à capuche (une contestation individuelle) à la tactique de la première ligne a permis de modifier le rapport à la violence politique, dans la mesure où de nombreuses personnes qui, dans d’autres contextes, condamnaient les actions défensives contre la répression dans les manifestations, ont approuvé ces mêmes méthodes au cours de la révolte. Il ne s’agit pas, il ne s’agit jamais, de défendre les destructions comme une fin en soi, mais de reconnaître qu’une démocratie dotée d’un contenu populaire passe par une réappropriation véhémente de l’espace public privatisé par la loi ou par les armes.
Sous l’Unité populaire comme dans la révolte de 2019, il est possible de retracer une transformation dans la manière de comprendre espace public. L’enjeu du conflit n’était pas seulement l’usage fait de l’espace public, comme s’il s’agissait d’un lieu vide à remplir d’une chose ou d’une autre ; il s’agissait d’une lutte pour redéfinir la notion même d’espace public, dans le sens de qui a le droit de le construire, de l’utiliser et même de le détruire pour le réinventer. Dans cette dispute autour de la notion d’espace public, les secteurs populaires ont historiquement porté un regard iconoclaste et irrévérencieux, sans la pudibonderie esthétique de la classe moyenne, avec un respect absolu de la mémoire et des vaincus, et un manque de respect absolu pour ce « monument à la barbarie » que l’on appelle la ville dans le capitalisme.
Dans la création d’un espace public démocratique, la violence politique et la lutte pour la mémoire se croisent. Et dans cette intersection, les formes de violence politique qui ont précédé et accompagné l’Unité populaire, ainsi que celles qui ont existé pendant la dictature et cette longue transition post-dictatoriale, résonnent très fortement.
Le difficile chemin vers l’institutionnalisation
Pendant l’Unité populaire, le projet de pouvoir populaire vu « par le haut » déploya sa lutte sur le terrain institutionnel existant, à la recherche de tranchées pour avancer plus loin. C’est ce que le juriste Eduardo Novoa Monreal a appelé « le chemin difficile de la légalité », que la « voie chilienne vers le socialisme » s’efforça de parcourir en cherchant à réaliser des « changements révolutionnaires dans le cadre de la légalité »[10]. Les tensions entre les pouvoirs de l’État marquèrent la première ligne institutionnelle du conflit. L’opposition resserra ses rangs pour asphyxier le gouvernement de l’UP par des recours constitutionnels, le blocage des initiatives ministérielles et le harcèlement médiatique mené par les partis et leurs alliés de la société civile, en particulier les organisations patronales. Cette attaque permanente s’accompagna du développement de groupes de combat que la droite déploya dans les rues pour contrer l’avancée de la jeunesse révolutionnaire et pour intimider les secteurs populaires à coups de bâtons et de chaînes. Elle ajouta également toutes sortes de tactiques de boycott économique à toutes les échelles, du stockage des produits de base au blocage des chaînes de distribution, financées par les États-Unis.
L’utilisation du cadre constitutionnel en faveur d’un processus politique qui transformerait ce même cadre était une prémisse de la « voie chilienne ». Mais ce qui était un « chemin difficile » en avril 1972 se transforma rapidement en un bourbier quasi inextricable. Le centre politique, incarné à l’époque par la Démocratie chrétienne, adopta une position putschiste et finit ainsi de dynamiter la voie de la légalité. La bourgeoisie intensifia son offensive politique, économique et militaire. Il n’y aura ainsi plus de place pour un socialisme au pays « des empanadas et du vin rouge »[11]. Au lieu de cela, il y aura près de deux décennies de résistance clandestine et de lutte armée.
Dans le Chili de la révolte populaire, le peuple n’a pas choisi le « chemin difficile de la légalité », mais y a été poussé par l’Accord pour la paix sociale et la nouvelle Constitution du 15 novembre 2019. Après une grève générale qui a mobilisé le Chili et interrompu sa normalité capitaliste le 12 novembre, le gouvernement Piñera s’est senti plus acculé que jamais et a cédé sur un point qu’il avait esquivé pendant un mois : le changement constitutionnel. La rédaction d’une nouvelle « Grande Charte » par le biais d’une Assemblée constituante était dans l’esprit de certains secteurs du mouvement social et de la gauche depuis le jour même où la Constitution de 1980, rédigée à huis clos par Jaime Guzmán et d’autres membres de la dictature, avait été instaurée. Mais elle n’avait jamais trouvé un élan suffisant comme dans les jours qui ont suivi le soulèvement, l’estallido [explosion] du 18 octobre. Dès les premiers jours de la révolte, la nécessité d’un changement constitutionnel a commencé à se répandre, présentée comme une condition juridique pour la conquête des revendications sociales accumulées par le peuple depuis 1990. La Constitution avait transformé le triomphe politico-militaire de la dictature en un terrain contre-révolutionnaire stable. C’est un document qui garantit un régime démocratique restreint, une structure sociale basée sur l’individu et la famille, et un modèle économique qui ne laisse aucune place à l’initiative publique et qui est centré sur le rôle du secteur privé : le versant juridique du « plus jamais ça » antipopulaire de la dictature de Pinochet.
L’Accord du 15 novembre a transformé le terrain du conflit ouvert par la révolte, obligeant les assemblées territoriales, les mouvements sociaux et la gauche sans représentation parlementaire à définir comment elles et ils allaient continuer à peser sur ce contexte. Le sentiment que « le Chili s’était réveillé » et qu’il n’y avait pas de retour en arrière a prévalu dans les secteurs organisés et la majorité a choisi de participer au processus constituant. Ce processus est devenu l’institutionnalisation de la révolte, avec toutes les contradictions que cela implique : réduction des niveaux de combativité dans la rue, mais permanence dans le temps d’un processus de changement ; engagement dans la dynamique des élections et des négociations parlementaires mais renforcement de la capacité programmatique des organisations et de leurs porte-parole.
Le 25 octobre 2020, lors d’un plébiscite appelant à « approuver » ou à « rejeter » la rédaction d’une nouvelle Constitution, l’option « J’approuve » remporta 80 % des voix. Lors des élections des représentants à la Convention constitutionnelle, les 15 et 16 mai 2021, une majorité anti-néolibérale parvint à s’installer dans cette institution sui generis, avec notamment la parité hommes-femmes, des sièges réservés aux peuples autochtones et la participation de candidats non-membres de partis. Et le 4 juillet, l’organe politique le plus démocratique de l’histoire du Chili était instauré, donnant lieu à une proposition constitutionnelle tout aussi inédite qui modifiait les fondements institutionnels avec une ouverture démocratique aux secteurs populaires, une garantie systématique des droits sociaux, un rôle plus actif du secteur public dans l’économie, une reconnaissance politique et culturelle des nations indigènes et une approche féministe qui consacrait le droit à l’avortement, le droit à l’accès aux soins et la reconnaissance du poids économique du travail non rémunéré des femmes. En profonde résonance avec la période politique d’avant 1973, dans le domaine de l’organisation syndicale, le projet de nouvelle Constitution renforçait le rôle des syndicats et leur pouvoir de négociation, tout en établissant le droit de grève et de négociation collective au niveau de la branche, et pas seulement dans les entreprises prises séparément. Finalement, le projet de nouvelle Constitution sera rejeté lors d’un plébiscite, le 4 septembre 2022, avec une majorité écrasante de 62 %, ce qui va représenter un défi radical à la compréhension de la gauche constituante de ce qui se fermait et de ce qui s’ouvrait[12].
Parallèlement au processus constituant, Gabriel Boric était élu président lors d’un second tour contre le candidat du pinochetisme, José Antonio Kast. La génération de 2011 arrivait ainsi au pouvoir, avec la promesse d’un renouveau et d’un programme social-démocrate moderne. Dans le contexte de polarisation politique qui a accompagné cette période au Chili, le gouvernement de Boric a représenté pour la droite un gouvernement de la gauche radicale, tandis que pour les secteurs organisés à gauche de ce dernier, il a représenté un gouvernement de plus en plus centriste. Certains ont osé comparer Boric à Allende, mais il va sans dire que de telles comparaisons forcées ne sont d’aucune utilité pour l’analyse historique. Significativement, ce nouveau gouvernement progressiste, dans un contexte de crise politique et économique, a effectivement été placé devant la possibilité d’utiliser les leviers du pouvoir exécutif pour un processus d’accumulation de force et de pédagogie politique du changement, à l’instar de l’Unité populaire. Mais c’est là que les chemins divergent et que les résonances entre l’Union populaire et le gouvernement Apruebo Dignidad commencent à entrer dans l’espace de la dissonance.
Alors qu’Allende prétendait gouverner pour le peuple et les travailleurs, Boric a insisté sur le fait qu’il gouverne « pour tous les Chiliens », ce qui ne signifie rien d’autre qu’un gouvernement qui accepte la limitation structurelle imposée par le pacte interclassiste de la transition post-dictatoriale. À la fin de la dictature, la Concertación mobilisa le peuple autour d’un projet de modernisation capitaliste fondé sur un équilibre délicat entre ajustements structurels et dépenses sociales. Elle y parvint grâce à la mue néolibérale des principaux partis d’opposition à la dictature et à des dirigeants syndicaux et sociaux bien disposés, que les partis de la Concertación avaient réussi à convaincre que la voie vers la rupture était impossible et que ce qui était souhaitable, c’était une « politique d’accords ». Le gouvernement Boric s’appuyait sur les épaules de ces géants, défenseurs du consensus entre l’élite nationale et les dirigeants du peuple. La différence, à l’ère Boric, est que nous ne sommes plus dans le boom économique des années 1990 ou 2000, mais dans la crise post-2008, aggravée par la pandémie et la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, une politique d’accords et un « gouvernement pour tous les Chiliens » sont, en réalité, une politique d’accords avec la bourgeoisie parce que le jeu à somme nulle de la lutte des classes est à son paroxysme.
Pour le gouvernement de Boric, la question n’est pas le « chemin difficile de la légalité », car il n’a pas l’intention de procéder à des changements révolutionnaires dans le cadre institutionnel existant. « Les conditions ne sont pas réunies », nous disent les représentant.e.s du gouvernement. Et en effet, l’opposition obstinée de la droite au Parlement, le travail de sape médiatique permanent, une économie lente et stagnante et un peuple désarmé sont autant de conditions qui conspirent pour entraver tout processus de changement. Et c’est peut-être ce qui différencie le plus le gouvernement Apruebo Dignidad du gouvernement de l’Unité populaire : alors que ce dernier s’efforça de créer les conditions rendant possible une transformation à long terme, notre gouvernement actuel abdique devant l’existant, assurant dans le meilleur des cas une mise en œuvre minimale des programmes, ou, dans le pire des cas, cédant le terrain aux politiques de droite. Il en résulte clairement que les prochaines élections ne sont nullement assurées (parce que le programme promis n’a pas été réalisé), et que l’on ne s’est pas approché des conditions pour gagner à l’avenir (parce que le capital politique et social du gouvernement a été dynamité dans un processus de mini-réformes).
Il ne fait aucun doute que le véritable jugement sera porté par les générations futures, mais il convient de noter que, face à cette occasion perdue, il nous reste à déchiffrer, « dans l’obscurité, sans certitudes »[13], les domaines dans lesquels il est possible de construire les pièces des instruments qui nous permettront de faire résonner avec intensité les sons des révolutions passées lorsqu’ils reviendront nous visiter.
La question du parti
La principale dissonance entre les années d’Unité populaire et le cycle politique ouvert en 2019 tient à la question du parti. Sous les auspices de la « tradition des opprimés », je fais usage de la notion historique de parti telle qu’elle fut comprise par Karl Marx, Mikhaïl Bakounine, Rosa Luxemburg, Vladimir Lénine et bien d’autres : le projet politique qui parvient à organiser l’action des masses populaires dans un complexe de structures et de dynamiques sociales qui agissent comme un tout pour imposer les intérêts historiques d’une classe. Cette notion ne doit pas être confondue avec le parti au sens plus spécifique de structure politique de cadres ou de masses, qui aspire en général à devenir le référent principal d’un processus de transformation. Le rapport entre organisation politique et parti au sens historique est une question encore en suspens au sein de la gauche radicale chilienne, mais elle mériterait un autre texte.
Sous l’Unité populaire, le parti de la classe ouvrière, dans ce sens large et historique, était incarné par une série d’organisations politiques, notamment le Parti socialiste, le Parti communiste, le Movimiento de izquierda revolucionaria (MIR), mais aussi par des initiatives populaires interpartisanes comme les Cordons industriels, les Commandos communaux et paysans. Par-dessus tout, le parti de la classe pendant l’Unité populaire fut l’Unité populaire elle-même, en tant que moment historique de la lutte des classes au Chili, en tant que projet de transformation révolutionnaire qui organisa toutes les forces sociales et politiques autour de son développement. Aucun être humain doté d’un cœur et d’aspirations au changement ne saurait nier que l’Unité populaire, en tant que moment de l’histoire du Chili, est le point culminant de notre histoire en tant que peuple, quelle que soit la vision que nous ayons de ses succès et de ses échecs. Elle reste le paradigme à l’aune duquel nous mesurons nos rêves et nos espoirs, sur lequel se portent nos critiques et nos réexamens.
La construction d’un parti – et ses difficultés – n’est pas la solution magique aux problèmes d’une classe ouvrière fragmentée et précarisée, mais elle a, en revanche, été l’une des causes principales d’une faiblesse de notre peuple qui n’a que trop duré. Nous avons connu des vagues successives de recomposition dans le processus de rupture avec le temps homogène de la double défaite, mais cela n’a pas suffi. Nous avons été vidés de l’histoire, et avec elle, c’est l’histoire elle-même, en tant que création du nouveau, qui a été vidée. Le conflit n’a pas été évincé, car nous avons connu des décennies de conflictualité sociale, mais la possibilité concrète de l’emporter a été mise hors de notre portée.
L’absence de parti au Chili aujourd’hui est accablante. On a pu le constater systématiquement à chaque cycle de mobilisations, et surtout à partir de 2019. Nous avons pallié l’absence d’un espace de construction démocratique et massive d’une force transformatrice par une multiplicité d’appareils plus ou moins grands qui entravent la pensée stratégique en rendant presque impossible une vision d’ensemble. Nous avons pallié l’absence d’un horizon traduit en programme de transformations structurelles par des plans de lutte et des listes de revendications pour répondre aux cycles politiques et aux moments les plus aigus de la crise économique. Nous avons pallié l’absence d’un esprit commun qui exprime la diversité des subjectivités vivantes de notre classe par de multiples bannières, identités et mythes qui paraissent susciter plus de loyauté qu’un destin commun de notre lutte. Tout cela nous maintient dans un état encore fragile. Notre principal espoir a été le mouvement féministe, qui a réussi à articuler la grève générale avec un programme contre la précarité, au-delà de tout corporatisme, et qui a esquissé un horizon transformateur qui n’a pas peur de renoncer à la nostalgie creuse d’une gauche faite principalement par et pour les hommes, mais qui n’a pas non plus peur d’imaginer un avenir qui se réapproprie l’histoire des luttes populaires au Chili pour les projeter au-delà.
Aujourd’hui, les chemins de la barbarie s’ouvrent à nouveau devant nous. D’une part, la menace d’une ultra-droite qui a l’intention de gouverner très bientôt, sortant le pinochetisme des poubelles de l’histoire, et cherchant à affronter la crise actuelle avec un projet conservateur, autoritaire et nationaliste. D’autre part, une crise écosociale qui représente une menace existentielle pour les classes populaires, qui ont été et continueront d’être les plus durement touchées par la destruction de l’environnement, contraintes d’émigrer ou de vivre dans des conditions inhumaines. Dans ce contexte, il apparaît urgent de construire des espaces et des instruments politiques qui contribuent à la création d’un parti au sens large et historique du terme. Cela requiert la plus grande humilité et générosité possible, nous permettant de trouver l’unité dans la différence et de sauvegarder l’expérience de la révolte et du processus constituant en tant qu’exercices politiques fondamentaux pour ouvrir une nouvelle période de notre histoire.
Mémoire du futur
L’histoire du pouvoir populaire en tant que projet révolutionnaire nous suggère quelques pistes pour atteindre cet objectif. Ce parti historique doit s’exprimer à travers une alternative politique transformatrice construite par et pour les masses populaires, qui puisse être habitée par les membres de la classe ouvrière comme un espace public dans lequel leurs aspirations, leurs intérêts et leurs préoccupations peuvent être pleinement pris en compte. Il doit s’agir d’une alternative qui ne renonce pas aux acquis du mouvement des femmes, du mouvement écologiste, du mouvement ouvrier et des mouvements indigènes au Chili, considérés comme les sources essentielles d’un projet transformateur universel, et pas seulement pour certains. Il doit être construit démocratiquement, sur la base d’un débat public qui utilise le langage de notre peuple pour exprimer jusqu’aux plus grandes complexités de la pensée stratégique. Il doit accepter la nécessité tragique de rompre avec l’illusion d’un changement sans confrontation ni polarisation, en embrassant à nouveau pleinement les vérités simples du mouvement ouvrier : « La classe ouvrière et la classe patronale n’ont rien en commun », comme l’affirme le préambule des statuts de l’Industrial Workers of the World (IWW) ; et de cette affirmation découle un « principe d’exclusion » à l’égard du projet de la grande bourgeoisie, mais aussi de « l’atroce, atroce, petite bourgeoisie »[14].
Ce que nous disons, et qui est si désagréable à entendre par le progressisme d’aujourd’hui, n’est ni tellement nouveau, ni tellement révolutionnaire. La droite chilienne le sait, d’où le coup d’État, d’où sa rupture avec la démocratie libérale et le parlementarisme. Et nous ne disons pas cela pour choquer, mais pour offrir une surface de résonances, un peu de matière dans laquelle les sons révolutionnaires du passé peuvent résonner avec confiance, sans mystifications et sans nostalgie. « Laissons les morts enterrer leurs morts », car ce n’est pas à nous de porter les peurs d’un autre temps comme le font certain.e.s qui reculent devant chaque fanfaronnade de la droite. Mais à cette décharge des peurs s’ajoute un serment de responsabilité historique : tant que nous serons en vie, nous aurons le devoir de tourner notre regard vers cet avenir révolutionnaire qui nous a été refusé en 1973, et d’écouter attentivement comment le pouvoir populaire résonne au présent, ici, maintenant, jusqu’à ce que nous épuisions le feu de son rêve dans une victoire finale.
Pablo Abufom Silva est rédacteur en chef de Posiciones, Revista de Debate Estratégico, membre fondateur du Centro Social y Librería Proyección et membre du collectif éditorial de Jacobin América Latina. Traduction de l’espagnol (Chili) par Emmanuel Delgado Hoch des éditions Syllepse.
Illustration : Crédit photo : Erta Ale Magma lake par pierre c. 38 via https://www.flickr.com/photos/52340452@N05/6775460971
Notes
[1] P. Pérez, Building Power to Shape Labor Policy: Unions, Employee Associations, and Reform in Neoliberal Chile, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2023.
[2] E. Murphy, Por un hogar digno: el derecho a la vivienda en los márgenes del Chile urbano, 1960-2010, Santiago, LOM, 2022 ; N. Angelcos et M. Pérez, Vivir con dignidad : transformaciones sociales y políticas de los sectores populares en Chile, Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2023.
[3] S. H. Heap, «World Profitability Crisis in the 1970s: Some Empirical Evidence», Capital & Class, n° 4 (3), 1980; R. Brenner, «Introducing Catalyst», Catalyst, n° 1, printemps 2017, https://catalyst-journal.com/2017/11/editorial-robert-brenner.
[4] Le FPMR, fondé en 1983, était dans un 1er temps le « bras armé » du PCC. Il s’est autonomisé par la suite, notamment après l’échec de l’attentat contre Pinochet en 1986. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_patriotique_Manuel_Rodr%C3%ADguez.
[5] J. Manzi et N. Cristi, Resistencia gráfica. Dictadura en Chile: APJ-Tallersol, Santiago, LOM, 2016; C. D. Trumper, Ephemeral Histories: Public Art, Politics, and the Struggle for the Streets in Chile, Berkeley, University of California Press, 2016.
[6] L. E. Recabarren, « Carta a Abdón Díaz », dans El Trabajo, 23 février 1902. Reproduit dans X. Cruzat et E. Devés (éd.), Recabarren. Escritos de prensa, 1898-1905, Santiago, Nuestra América y Terranova, t. 1, 1985.
[7] Cal y Canto, n° 8, 2021.
[8] NdT: devise nationale du Chili.
[9] F. Chabod, Escritos sobre Maquiavelo, Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1984.
[10] M. E. Novoa, « El difícil camino de la legalidad», Revista de la Universidad Técnica del Estado, n° 7, avril 1972.
[11] Selon l’expression consacrée : Allende prétendait construire un socialisme « des empanadas [sorte de chausson fourré à la viande] et du vin rouge », c’est-à-dire authentiquement chilien [NdT].
[12] P. Abufom Silva, «A Memory for the Future», NACLA Report on the Americas, n° 54, 2022.
[13] F. Chabod, Escritos sobre Maquiavelo, op. cit.
[14] J. Kirkwood, «Feministas y políticas», NUSO, n° 78, 1985, https://nuso.org/articulo/ feministas-y-politicas/.





![Chili 73 : un coup d’État qui permit la contre-révolution néolibérale [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/golpe-chile-1973-150x150.jpg)

![Pourquoi la gauche et les mouvements populaires ont-ils subi un coup d’arrêt au Chili ? [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/1KpJBvyPs4RmjBJXZ5Bc5jg-150x150.jpg)

