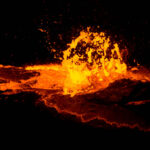Du Chili au Nicaragua, explorer les voies de la révolution pour le 21e siècle
Nous proposons à nos lecteurs·rices la retranscription d’un entretien avec Daniel Bensaid datant de 2007-2008, suivi d’un texte du même auteur, autour notamment de l’expérience chilienne de l’Unité populaire (1970-1973) et du coup d’État qui mit fin à cette tentative d’aller au socialisme par une voie institutionnelle et graduelle. Chemin faisant, Daniel Bensaid reprend certaines des grandes questions stratégiques qui se pose pour toute révolution socialiste au 21e siècle. Ces deux textes sont précédés d’une introduction de Stathis Kouvélakis.
***
Entre 2007 et 2008, Daniel Bensaïd donne une douzaine d’entretiens à la radio Fréquence Paris Plurielle. Ils s’organisent autour de 12 dates, associées à des figures du mouvement ouvrier ou à des évènements marquants du « court vingtième siècle » : révolution d’Octobre, guerre d’Espagne, Seconde Guerre mondiale, luttes anticoloniales, Cuba 1959, assassinat de Lumumba, Mai 1968, Chili 1973, mai 1981, chute du mur de Berlin… L’ensemble de ces entretiens est disponible en ligne en format audio. Une version transcrite a été publiée en 2020, aux éditions du Croquant, sous le titre Fragments radiophoniques. 12 entretiens pour interroger le 20e siècle.
Nous reprenons ici la transcription de l’entretien consacré aux expériences révolutionnaire chilienne et nicaraguayenne, qui marquent la fin du cycle révolutionnaire de la seconde moitié du 20e siècle en Amérique latine. Nous le faisons suivre par un article antérieur, écrit à l’occasion du trentenaire du coup d’Etat du 11 septembre 1973, dans lequel Daniel Bensaïd polémique avec ceux qui, à gauche, offrent une interprétation « réaliste » de la défaite du Chili, jugeant qu’il aurait fallu aller encore plus loin dans la voie des compromis. Les mêmes n’hésitent pas, de surcroît, de rendre responsables de l’issue tragique, pour partie du moins, les secteurs les plus radicaux de la gauche chilienne, en particulier le MIR. Loin de relever d’une simple discussion historique, ces bilans visent in fine, comme le souligne Bensaïd, à justifier le ralliement de leurs auteurs aux politiques social-libérales menées dans les années 2000 par les gouvernements de centre-gauche (ou de gauche modérée), en Amérique latine ou en Europe.
Outre leur intérêt propre, une lecture comparée de ces deux textes de Daniel Bensaïd est d’autant plus stimulante qu’elle suggère une évolution de la réflexion de leur auteur sur les questions de stratégie révolutionnaire qui furent au centre de ses préoccupations. Une évolution en lien étroit avec celle des conjonctures en Amérique latine et en Europe et des recompositions qui traversaient les organisations de la gauche radicale et de son propre courant politique.
Commençons par celles du « double pouvoir », inspirée du schéma classique de la Révolution russe qui a vu la structure des soviets se substituer à une autorité étatique en voie de délitement, et du type de réponse aux entreprises contre-révolutionnaires venant des forces armées. Dans le premier texte, après avoir souligné l’échec cinglant de la logique de concessions à l’adversaire, Bensaïd cite de façon approbatrice la position du dirigeant du MIR Andrès Pascal qui estime, rétrospectivement, que « l’erreur stratégique fut de ne pas tenter de répliquer au tankazo (le coup avorté de juin 1973) par une contre-offensive insurrectionnelle, sociale et armée ».
Cette position fait également écho à une situation de type Octobre 1917, comme l’indique la référence à Kornilov – le général tsariste qui a tenté de renverser le gouvernement provisoire de Kerenski (également cité). C’est, en effet, la riposte populaire victorieuse à cette tentative de coup qui a relancé le processus révolutionnaire et ouvert la voie à l’offensive d’Octobre. Dans cette perspective, Daniel Bensaïd laisse également ouverte la question d’un « double pouvoir » qui, au Chili de l’Unité populaire, aurait pu surgir d’une « centralisation des cordons industriels et des commandos communaux, combinée à des expériences démocratiques larges comme l’assemblée populaire de Conception » et qui, moyennant une stratégie adéquate, aurait servi à lancer la « contre-offensive insurrectionnelle et armée » évoquée auparavant.
Dans l’entretien de 2007, la question se présente sous des termes en partie nouveaux. Est alors évoqué « un autre scénario pour répliquer au coup d’État, que ce soit en juin ou en septembre, par une grève générale, le désarmement de l’armée, effectivement quelque chose d’insurrectionnel ». Mais, cette fois, la critique adressée à Allende porte essentiellement sur le fait de ne pas avoir appelé, dès le déclenchement du coup, à des formes plus actives de résistance, comme la grève générale, mais qui s’écarte du schéma d’une confrontation armée. Bensaïd admet par ailleurs que même une telle forme de résistance civile « n’était peut-être pas possible » et que « même une organisation comme le MIR, qui était censée être préparée militairement, a été prise de court par le coup d’État ».
En réalité, cette inflexion est liée à une autre, qui concerne la question de la constitution de gouvernements de gauche issus des urnes mais qui, à l’instar de l’Unité populaire, se proposent de mettre en œuvre un programme de rupture ouvrant la voie à la transformation sociale. Dans le texte de 2007, on notera la réticence de Daniel Bensaïd quant à la caractérisation d’Allende comme « réformiste », malgré les concessions aux classes dominantes qui ont d’emblée marqué son mandat. Se trouvent également discutées les conditions sous lesquelles la participation du MIR au gouvernement de l’Unité populaire aurait pu être envisagée, au cours de la période décisive entre le coup d’Etat avorté de juin 1973 (le tankazo) et celui, réussi, du 11 septembre, période de la dernière chance pour défendre et relancer le processus révolutionnaire.
Dans un texte contemporain de cet entretien, reprenant le fil des débats sur le « front unique » et le « gouvernement ouvrier », Bensaïd revient de façon plus systématique sur la question des stratégies d’accès au pouvoir et des formes de démocratie qui y correspondent[1]. Il écrit ainsi qu’« il est bien évident en effet, a fortiori dans des pays de tradition parlementaire plus que centenaire, où le principe du suffrage universel est solidement établi, qu’on ne saurait imaginer un processus révolutionnaire autrement que comme un transfert de légitimité donnant la prépondérance au ‘socialisme par en bas’, mais en interférence avec les formes représentatives ». Il admet également que « pratiquement, nous avons évolué sur ce point, à l’occasion par exemple de la révolution nicaraguayenne. »
C’est à partir de cette position qu’il examine la question de la participation d’organisations révolutionnaires « à une coalition gouvernementale dans une perspective transitoire », relue à la lumière des expériences récentes (France, Amérique latine) et en particulier du cas brésilien. Dans ce pays, suite à la victoire de Lula en 2002, le courant Démocratie et socialisme (DS), affilié à la IVe Internationale, qui occupait des positions importantes au sein du Parti des Travailleurs, décide de participer au gouvernement, et obtient notamment le poste du ministère de l’agriculture. Cette décision, combinée au cours respectueux du cadre néolibéral suivi par Lula, conduit à la scission de DS et au départ d’une partie de ses cadres et militants vers le PSOL (fondé en 2004, avec d’autres courants de la gauche radicale brésilienne).
Reprenant les débats qui ont scandé les voies de l’accès au pouvoir « en Occident », pour reprendre la catégorie de Gramsci, à savoir un contexte qualitativement différent de la Russie de 1917, Daniel Bensaïd énonçait « trois critères, combinés de façon variable » de participation » à un gouvernement de coalition de forces de gauche :
« a) que la question d’une telle participation se pose dans une situation de crise ou du moins de montée significative de la mobilisation sociale, et non pas à froid ;
b) que le gouvernement en question se soit engagé à initier une dynamique de rupture avec l’ordre établi (par exemple – plus modestement que l’armement exigé par Zinoviev [lors des débats de l’Internationale communiste sur le « front unique » de 1923-1924] – réforme agraire radicale, « incursions despotiques » dans le domaine de la propriété privée, abolition des privilèges fiscaux, rupture avec les institutions – de la Ve République en France, des traités européens, des pactes militaires, etc.) ;
c) enfin que le rapport de force permette aux révolutionnaires sinon de garantir la tenue des engagements du moins de faire payer au prix fort d’éventuels manquements ».
C’est en fonction de ces critères qu’il concluait que « la participation [de la majorité de DS] au gouvernement Lula apparaît erronée ». Il ajoutait toutefois aussitôt qu’« en tenant compte de l’histoire du pays, de sa structure sociale, et de la formation du PT, tout en exprimant oralement nos réserves quant à cette participation et en alertant les camarades sur ses dangers, nous n’en avons pas fait une question de principe, préférant accompagner l’expérience pour en tirer avec les camarades le bilan, plutôt que d’administrer des leçons ‘de loin’ ».
Daniel Bensaïd n’a pas eu le temps de poursuivre sa réflexion sur ces questions stratégiques cruciales. Néanmoins, ces textes tardifs constituent un témoignage précieux de l’ouverture de sa pensée et de sa capacité à questionner à nouveaux frais les expériences des mouvements révolutionnaires qui ont marqué notre époque.
Stathis Kouvélakis
***
Entretien à Fréquence Paris Plurielle (2007)
11 septembre 1973, les militaires chiliens mettent fin dans le sang aux trois brèves années d’expérience réformiste des gouvernements de Salvador Allende. Augusto Pinochet prolonge un nouveau cycle de répression sanglante et de libéralisme économique brutal initié en Bolivie[2]. Il est bientôt imité par d’autres dictatures en Amérique du Sud. En 1979, dans un autre contexte, les Sandinistes amènent un peu d’espoir en prenant le pouvoir dans le tout petit Nicaragua. Dix ans plus tard, en 1990, asphyxiés par le blocus américain, ils rendent le pouvoir à l’occasion d’élections.
Les États-Unis, actifs dans l’ensemble de l’Amérique du Sud, n’ont pas l’intention d’autoriser les peuples de leur arrière-cour à relever la tête. Les deux expériences du Chili et du Nicaragua, posent, dans des contextes très différents, un Salvador Allende élu par le Congrès d’une part, une prise du pouvoir par les armes côté Sandinistes, d’autre part, la question du pouvoir et surtout de comment le conserver, avec qui et pourquoi.
En question subsidiaire, j’ai aussi envie d’ajouter une interrogation sur la place accordée ou, plutôt, la non-place accordée aux peuples indigènes ou assimilés dans ces processus.
Il faut peut-être commencer par rappeler que le 11 septembre, celui de 1973, et pas celui de 2001, a été d’abord un choc émotionnel. On était suspendus aux nouvelles qui arrivaient à la radio du siège du Palais présidentiel, La Moneda, et puis aux annonces qui sont arrivées petit à petit de la réussite du coup d’État. Au début, on espérait qu’il ne réussirait pas, puisqu’un autre coup d’État avait échoué en juin trois mois avant [le Tankazo], et puis la mort d’Allende, etc.
Comment expliquer un tel choc émotionnel, alors qu’il n’y avait pas eu l’équivalent lors du bain de sang d’une autre ampleur en 1965 au moment de l’écrasement du Parti communiste indonésien ou plus tard du Parti communiste soudanais ? Je crois parce qu’il y avait une très forte identification en Europe et en Amérique latine avec ce qui se passait au Chili. Le sentiment qu’effectivement se jouait là un scénario inédit et une possibilité, pratiquement une expérience de laboratoire, qui valait aussi bien pour l’Europe que pour l’Amérique latine, de manière différente.
Alors, pour l’Europe, pourquoi ?
Parce qu’on avait l’impression, en partie fausse je dirais aujourd’hui, d’avoir finalement un pays qui était notre propre reflet. À la différence d’autres pays d’Amérique latine, il y avait un parti communiste fort, il y avait un parti socialiste représenté ou dirigé par Salvador Allende, il y avait une extrême-gauche de la même génération que la nôtre, des petits groupes comme le MAPU[3] et le MIR[4], le Mouvement de la Gauche Révolutionnaire, nés dans les années 1964 -65 sous l’impulsion ou l’onde de choc de la Révolution cubaine. Il y a un effet d’identification avec cette dernière organisation, avec ses militants, avec ses dirigeants qui étaient pratiquement de notre génération, qui avaient un parcours assez comparable. Le MIR s’est formé à double source : d’un côté une inspiration guévariste, une référence à la Révolution cubaine ; de l’autre une influence trotskiste, il faut le dire, au travers d’un grand historien de l’Amérique latine, Luis Vitale. Il a été un des pères fondateurs du MIR même s’il en a été écarté, ou s’en est écarté rapidement par la suite. Tout cela dans un pays ou finalement le stalinisme n’avait jamais été dominant y compris dans la gauche, ni eu le rôle qu’a pu avoir le Parti communiste en Argentine par exemple.
Il y a une singularité chilienne, c’est d’ailleurs une des difficultés à comprendre la situation. Le Parti socialiste chilien, même s’il s’appelait socialiste, avait peu de chose à voir avec la social-démocratie européenne. C’était un parti qui s’était construit dans les années 1930, en réaction, en opposition à la stalinisation de l’Internationale Communiste. Donc c’était un parti plutôt à la gauche du PC qu’à sa droite. Il y avait donc une forte identification et l’idée que le Chili donnait l’exemple d’un scénario où la gauche arrivait au pouvoir par des élections, et où les élections pouvaient être le début d’un processus social de radicalisation débouchant ou, disons même, transitant vers une révolution sociale radicale à une époque où, il faut aussi le rappeler, le prestige de la Révolution cubaine en Amérique latine était sinon intact, du moins encore très important.
Je crois que cela reste une leçon de choses, ce qui s’est passé au Chili. Aujourd’hui, je serais plus prudent sur ce mécanisme de reflet. Je crois que, vu de loin, on avait tendance à sous-estimer quand même les rapports sociaux et les réserves de réaction et de conservatisme qu’il y a dans la société chilienne. On les a vus beaucoup dans l’armée parce que, comme on l’a dit et répété à l’époque, l’armée avait été formée par des instructeurs allemands sur le mode de l’armée prussienne, ce qui était déjà peu encourageant. Mais en plus, j’ai pu le constater depuis, c’est un pays où la tradition catholique, le côté catholique conservateur, est important.
Et d’ailleurs, c’était une donnée de départ, puisqu’Allende a été élu en septembre-octobre 1970, lors d’une élection présidentielle, mais avec une majorité relative de 37 % environ. Pour que son investiture soit ratifiée par l’Assemblée ont été posées des conditions[5]. Elles vont droit à l’essentiel : ne pas toucher à l’armée et respecter la propriété. Ce sont les deux limites posées d’emblée par les classes dominantes, par les institutions en vigueur, pour accepter l’investiture d’Allende.
Néanmoins, c’est vrai que la victoire électorale a donné le coup d’envoi d’une montée de l’espérance et d’une montée du mouvement social, laquelle a culminé sur le plan électoral dès janvier 1971 par une victoire importante aux municipales. Je crois que l’Unité populaire, la coalition de gauche sur laquelle s’appuyait Allende à ce moment, a eu pour cette unique fois une majorité absolue dans une consultation électorale.
Cela donnait évidemment une légitimité accrue pour développer le processus. Victoire électorale, radicalisation mais aussi une polarisation d’abord interne au Chili, qui s’est traduite petit à petit par une mobilisation de la droite, y compris par des méthodes actives de rue. La date marquante a été la grève des camionneurs en octobre 1972. Mais il ne faut pas croire qu’il s’agissait de salariés : c’était la corporation, alors qu’avec la configuration géographique du Chili, longiligne, le transport routier est stratégique. Une grève des camionneurs donc, appuyée en plus par ce que l’on a appelé des cacerolazos, c’est-à-dire des mouvements de protestation, notamment de consommateurs de la classe moyenne de Santiago – Santiago fait plus de la moitié du pays en termes de population – qui ont constitué une première tentative de déstabilisation à l’automne 1972. Enfin l’automne pour nous : là-bas c’est le printemps. Il faut inverser les saisons.
Après quoi s’est finalement posé un débat sur la suite du processus chilien, pour lequel s’ouvraient deux possibilités pour riposter à la déstabilisation de la droite, par ailleurs fortement appuyée par les États-Unis. On sait aujourd’hui avec les divulgations sur le plan Condor à quel point les États-Unis ont été de longue date impliqués dans la préparation du coup d’État, à travers les multinationales mais aussi à travers les conseillers militaires américains. Donc après cette alerte de la grève des camionneurs, début 1973, il y avait plusieurs options : soit une radicalisation du processus, avec des incursions accrues dans le secteur de la propriété privée, avec des mesures de redistribution radicales, des mesures salariales, etc., qui étaient débattues ; ou bien au contraire, et c’est la thèse qui l’a emportée, portée par [Pedro] Vuskovik, ministre de l’Économie et des Finances, membre du Parti communiste, de rassurer la bourgeoisie et les classes dominantes en délimitant de manière définitive l’aire de propriété publique ou de propriété sociale, et en donnant des gages supplémentaires aux militaires.
On ne va pas refaire toute l’histoire, mais quels sont les temps forts ?
Le deuxième épisode de déstabilisation a été beaucoup plus dramatique, non plus une grève corporative comme celle des camionneurs, mais une première tentative, une répétition de coup d’État en juin 1973, ce qu’on appelle le Tankazo, dans laquelle une armée, enfin un régiment de tankistes, est sorti manifester et a été neutralisé.
Et là je crois que c’est le moment crucial où le débat a eu lieu. Par exemple, c’est le moment où le MIR, qui est une petite organisation de quelques milliers de militants très dynamique – il faut garder les proportions en tête, mais pour le Chili c’était important –, s’est posé le problème de rentrer dans un gouvernement, mais à quelles conditions. Après le premier échec du coup d’État, se posait la question de faire un gouvernement dont le centre de gravité se déplacerait à gauche, qui prendrait des mesures de châtiment ou de désarmement des militaires conspirateurs. Mais ce qui s’est fait a été exactement l’inverse.
C’est-à-dire qu’entre la période de juin 1973 et du coup d’État effectif du 11 septembre 1973, on a eu la répression contre le mouvement de soldats qui existait dans les casernes, les perquisitions pour désarmer les militants qui auraient accumulé des armes en prévision d’une résistance au coup d’État, et puis surtout des gages supplémentaires donnés à l’armée avec la nomination à des postes ministériels, y compris d’Augusto Pinochet, le futur dictateur.
Donc on a eu un basculement, et Miguel Enriquez, le secrétaire général du MIR qui a été assassiné en octobre 1974, un an après, a écrit à l’époque un texte, dans cette période intermédiaire entre la tentative et le coup d’État, qui s’appelait « Quand étions-nous les plus forts ? ». Je crois qu’il était d’une extrême lucidité : jusqu’à août 1973 il y a eu des manifestations de 700 000 manifestants à Santiago, appuyant Allende et répliquant au coup d’État [au Tankazo]. C’est le moment effectivement où une contre-offensive du mouvement populaire était possible et où, au contraire, la réponse a été un élargissement à droite des alliances gouvernementales et des gages supplémentaires, qui signifient en réalité finalement un encouragement au coup d’État.
Voilà, c’est comme ça que nous avons été surpris. Tu évoquais le réformisme de Salvador Allende mais, enfin, comparé à nos réformistes, c’était quand même un géant de la lutte des classes. Si on regarde aujourd’hui les documents d’archives, il reste quelqu’un de respectable.
Dans le mouvement de solidarité avec le Chili qui a été très important dans les années qui ont suivi, 1973, 1974 et 1975, je dirais que nous avons été, pour ce qui nous concerne, un peu sectaires avec Allende dont on a fait un des responsables, même s’il est mort héroïquement. Cela ne change rien au problème politique. Cela implique du respect pour la personne, mais il y a quand même une énigme : pendant les premières heures du coup d’État, il disposait encore de la radio nationale, il était encore possible d’appeler à une grève générale, alors que l’on a appelé à une résistance statique finalement sur les lieux de travail, etc. Peut-être que cela n’était pas possible. Même une organisation comme le MIR, qui était censée être préparée militairement, a été prise de court par le coup d’État. On le voit aujourd’hui dans le livre de Carmen Castillo, Un jour d’octobre à Santiago ou dans son film [rue Santa Fe, 2007]. Ils ont été pris de vitesse, peut-être à mon avis parce qu’ils n’imaginaient pas un coup d’État aussi brutal et aussi massif. Ils imaginaient la possibilité d’un coup d’État mais qui soit, en quelque sorte, une demie-réussite qui ouvrirait une nouvelle période quasiment de guerre civile, avec des foyers de résistance armée à la campagne. D’où l’importance qu’ils avaient donnée – cela rejoint l’autre aspect de la question –, au travail chez les paysans dans la minorité mapuche, notamment dans le Sud du pays.
Mais le coup d’État a été un vrai coup de massue. Ils n’avaient pas réellement préparé, ni même probablement envisagé, un scénario de centralisation des organes de pouvoir populaire qui existaient tout de même, avec ce que l’on appelait les « cordons industriels » qui coordonnaient justement des formes d’auto-organisation plus ou moins développées dans les faubourgs de Santiago principalement, avec les « commandos communaux » à la campagne, avec le travail dans l’armée et même à Valparaiso un embryon d’assemblée populaire, une sorte de soviet local. Tout de même, tout ça existait et donne à penser ce qu’il aurait été possible d’envisager – mais il fallait pour ça en avoir la volonté et la stratégie –, un autre scénario pour répliquer au coup d’État, que ce soit en juin ou en septembre, par une grève générale, le désarmement de l’armée, effectivement quelque chose d’insurrectionnel.
C’est toujours risqué, mais enfin, quand on voit le prix du coup d’État en termes d’abord de vies humaines, de disparus, de torturés. Et puis surtout le prix social quand on voit ce qu’est le Chili aujourd’hui, après plus de trente ans de dictature de Pinochet, donc de laboratoire des politiques libérales, là on peut parler de défaite historique. Si on regarde deux pays voisins, le Chili et l’Argentine, le mouvement social en Argentine, finalement, s’est assez rapidement remis dans sa combativité des années de dictature [1976-1983] et malgré les 30 000 disparus. Au Chili la défaite est d’une autre portée et d’une autre durée, visiblement.
Le Nicaragua effectivement, c’est une autre séquence.
Je crois que le coup d’État au Chili est l’épilogue de la fermentation révolutionnaire qui a suivi la Révolution cubaine pendant dix-quinze ans en Amérique latine. Et tu l’as rappelé dans l’introduction, la simultanéité des dates est quand même impressionnante : trois mois avant le coup d’État au Chili, je crois que c’est juin 1973, il y a le coup d’État en Uruguay. En 1971 on avait eu le coup d’État en Bolivie. Tout ça n’est pas complètement désynchronisé puisque dans le même temps la dictature était tombée en Argentine, où elle reviendra en 1976. Mais disons que symboliquement ça clôt le cycle, dans le personnel politique, la disparition d’Allende, la disparition d’Enriquez et de pratiquement toute la direction du MIR. Cela clôt le cycle initié par la Révolution cubaine, les conférences de l’OLAS[6], l’expédition du Che en Bolivie en 1966.
Le Nicaragua, finalement, c’est peut-être l’inauguration d’un autre cycle, ou un point de départ qui a un peu surpris. Je parlais tout à l’heure de Luis Vitale. Il nous avait surpris justement dans une réunion en 1976 où on faisait un peu le bilan de cette régression en Amérique latine, en disant : « oui, mais l’épicentre – c’était la formule employée –, l’épicentre s’est déplacé, le prochain coup c’est le Nicaragua ». Franchement, beaucoup d’entre nous ne savaient pas où était le Nicaragua en 1976. Je ne veux pas dire que Vitale est un prophète ou un mage, mais effectivement il a vu venir une histoire en Amérique centrale, avec ses dictatures « maillon faible », dans de conditions très particulières avec des sociétés peu organisées. La dictature chilienne s’appuie sur une base sociale. Ces dictatures, Somoza et ses semblables, étaient quand même assez fantoches, ils reposaient sur peu de choses. Ce qui explique qu’une organisation qui n’était presque rien en 1967, puisqu’après la répression et l’échec d’une guérilla qui s’appelait la guérilla de Pancasàn, le Front sandiniste était réduit à moins de cent militants. On a travaillé avec eux à l’époque, ils demandaient de l’aide pour l’entraînement aux Palestiniens. Là, on a le processus inverse, d’abord une victoire d’un mouvement social ou insurrectionnel, ou militaire, je ne rentrerai pas dans les trois lignes stratégiques qui cohabitaient dans le Front sandiniste. Elles ont finalement réussi à se combiner, ce qui n’était pas joué d’avance : une ligne de guerre populaire prolongée à la campagne représentée par Tomàs Borge, une ligne plus insurrectionnelle vantée par Jaime Wheelock et puis les frères Ortega qui représentaient encore une troisième variante. Mais finalement tout ça s’est combiné, dans ce contexte spécifique. Et là, c’est la victoire politique et militaire de 1979 qui a inauguré un processus électoral.
Ce qu’il y a d’inédit dans l’affaire nicaraguayenne, c’est qu’une révolution, ou une première étape victorieuse d’une révolution, accepte de se soumettre à l’épreuve d’une légitimation électorale. On peut dire que c’était un pari impossible, dans un pays petit, avec moins de trois millions d’habitants. Quand on parle de classe ouvrière, par exemple, au Nicaragua, il faut avoir les chiffres en tête : 27 000 salariés dans des entreprises de plus de 100 salariés, principalement des entreprises de bois, de mise en bouteille d’eau gazeuse. Il faut quand même savoir de quoi on parle. La question agraire était fondamentale, et la question indigène peut-être, j’y reviendrai.
Le problème, pour aller à l’essentiel, c’est que le Nicaragua a été vaincu par épuisement avant d’être vaincu électoralement. C’est-à-dire que la guerre dite de « basse intensité » – l’expression est presque ironique – financée par les États-Unis très ouvertement, obligeait un pays déjà très appauvri à consacrer 50 % de son budget à la défense, et à imposer la conscription dans un pays où ce n’était pas la tradition. C’était très impopulaire dans les campagnes, les gens n’avaient pas l’habitude que les fils partent à l’armée. L’effort de guerre a épuisé largement, socialement, moralement, le pays. Tant qu’il y a eu une possibilité, et elle a été réelle, d’une extension de la Révolution nicaraguayenne à l’Amérique centrale, on pouvait tenir. Et la possibilité a existé, surtout au Salvador, où il y a eu plusieurs tentatives d’insurrection20 qui étaient sur le fil, auraient pu gagner.
Mais le point décisif, je crois, a été le Guatemala. Sur le Guatemala, on peut lire le témoignage de quelqu’un qui est mort aujourd’hui, qui s’appelle Mario Payeras, l’un des fondateurs de l’Armée de guérilla des pauvres. Il nous a expliqué, y compris oralement, comment paradoxalement la révolution nicaraguayenne a joué contre la révolution guatémaltèque. Dans quel sens ? Tout simplement parce qu’ils croyaient avoir affaire à des dictateurs du type Somoza, mais c’étaient des conseillers militaires en face d’eux. En 1984 il y a eu une marche sur Guatemala City : ceux qu’ils avaient en face, c’étaient des conseillers militaires taïwanais et israéliens, des spécialistes de la contre-insurrection. Ce n’était plus une armée de tontons macoutes ou de trucs comme ça, c’étaient vraiment des pros de la guerre civile internationale, pourrait-on presque dire. Du coup, le Guatemala, le Salvador ont perdu, et à partir de ce moment-là, la défaite électorale des Sandinistes était, je ne dis pas inéluctable en 1989-90, mais enfin elle était devenue largement probable à l’usure.
Ce que l’on peut discuter dans la politique des Sandinistes, de mon point de vue, ce n’est pas tant d’avoir fait les élections, parce que se maintenir contre vents et marées aurait pu être pire, mais de ne pas avoir maintenu une double source de légitimité.
Pendant un moment a existé ce que l’on appelait le Conseil d’État. Il ne faut pas imaginer que c’était comme le Conseil d’État en France. C’était une assemblée où il y avait les organisations patronales, dont Violetta Chamorro [dirigeante de l’opposition aux sandinistes et présidente du Nicaragua de 1990 à 1997], etc., et où étaient à peu près tous les mouvements sociaux. Une sorte de chambre sociale dont la légitimité pour défendre les acquis de la réforme agraire et toute une série de choses aurait été opposable à l’assemblée parlementaire élue. Donc maintenir une double légitimité pendant un temps, ça, c’était envisageable. De plus il ne faut pas ignorer ce qui a été découvert à posteriori, c’est la rapidité extrême – qui doit être une leçon dans les pays pauvres ou très pauvres comme celui-là – de l’explosion de la corruption y compris dans les rangs sandinistes. C’est ce qu’on a appelé la Piñata, au plus haut niveau de la direction sandiniste, comme quoi finalement, les plus fortes convictions idéologiques ne sont pas insensibles à la logique matérielle du monde. Cela a été quand même aussi un élément de perte de crédit moral du gouvernement sandiniste.
On a le symétrique, sur les dates : l’année 1989, on s’en rend compte à posteriori, ferme aussi un autre cycle d’une dizaine d’années. 1989 avec le procès Ochoa à Cuba, l’échec de la deuxième candidature de Lula en 1994 au Brésil, à une époque où Lula n’avait pas encore été relooké, « bodygraphé », « taillebarbé » pour être un candidat présentable et éligible. Il est passé très très près d’une victoire électorale qui aurait donné un tout autre contexte. C’est aussi la chute du mur de Berlin, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui bascule en 1989-90, dont le Nicaragua fait partie.
Concernant la politique indigène… Au Chili, je crois qu’il y a eu un effort réel et une volonté affirmée de la part des organisations d’extrême-gauche. Au Nicaragua, c’était plus compliqué avec le problème des Miskitos [peuple originaire dont le nombre varie de 90 000 à 150 000 selon les sources vivant de sur la côte atlantique du pays] et de Bluefields [ville de la côte atlantique]. Là peut-être effectivement que les Sandinistes, en ne traitant pas de manière spécifique et en n’apportant pas de réponses spécifiques pour les indigènes de la côte de Bluefields ont entrouvert une porte à leur instrumentalisation car, sans faire de parano, il y avait quand même tout un appareil d’ethnologues dans les services de la CIA pour instrumentaliser les questions ethniques, et ça a joué.
***
Chili, les souvenirs d’un amnésique (2003)
Le coup d’État militaire du 11 septembre 1973 n’est pas la sanction d’une « fuite en avant » de la gauche chilienne, mais une contre-révolution préventive, préparée.
Dans un bref entretien publié par le journal Le Monde (12 septembre 2003), Marco Aurelio Garcia, ancien militant du MIR chilien, aujourd’hui conseiller diplomatique personnel du président Lula, revient sur les leçons du coup d’État chilien.
1. La « principale leçon à retenir » serait « qu’un projet de transformation politique a besoin d’un système d’alliance fort ». Soit. Marco Aurelio se demande en conséquence pourquoi l’alliance large entre l’Unité populaire et la démocratie chrétienne, esquissée en 1970 à l’occasion de l’assassinat du général Schneider, commandant de l’armée, n’a pas été confirmée et consolidée par la suite. Comme si la question des alliances était séparable de celle des politiques suivies et comme si pouvait être mise entre parenthèses la logique conflictuelle de la lutte des classes.
Devant la radicalisation du mouvement, l’extension de l’ère de la propriété sociale en 1972, les tentatives d’autodéfense de masses (notamment au lendemain de la tentative avortée de coup d’État de juin 1973 annonçant le coup réussi du 11 septembre), les partis bourgeois ont logiquement défendu l’ordre bourgeois contre l’extension des conquêtes sociales, l’organisation des soldats dans l’armée, la centralisation des cordons industriels et des commandos communaux. Marco Aurelio aurait-il oublié qu’après la crise d’octobre 1972, la réponse fut précisément un « élargissement de l’alliance » sous forme d’intégration des généraux au gouvernement. Le secrétaire général du PC, Luis Corvalan, déclarait alors : « Il ne fait aucun doute que le cabinet où sont représentées les trois branches des forces armées constitue une digue contre la sédition » ! Le scénario s’est répété lors de la crise de juin 1973, Pinochet en personne accédant alors au gouvernement pour mieux préparer son sinistre coup.
2. La question devient alors de savoir s’il fallait sacrifier à cet improbable élargissement des alliances une politique de réformes visant à consolider le soutien populaire au gouvernement Allende. C’est ce que suggère Marco Aurelio Garcia, en incriminant « la fuite en avant » d’une bonne partie de la gauche chilienne, comme si cette gauche radicale portait ainsi la moindre responsabilité d’un coup d’État fomenté par la réaction et la CIA (c’est aujourd’hui largement documenté et établi) dans le cadre du sinistre plan Condor, dès la victoire électorale d’Allende. Le sabotage illustré par la grève patronale de l’automne 1972 illustre la pression croissante de l’impérialisme et l’étranglement imposé à une économie dont le taux de croissance est passé de 14 % en 1971 à 2,4 % en 1972.
3. Cette façon de rendre la gauche radicale responsable de l’échec fait écho bien sûr à des polémiques actuelles au sein de la gauche. Pour Marco Aurelio Garcia, la faute du MIR (mouvement de la gauche révolutionnaire, principale organisation de l’extrême gauche) aurait été de « se cantonner dans une position erronée, voulant constituer une alternative absolue au lieu d’être le versant critique de l’Unité populaire ».
Marco Aurelio sait pourtant fort bien que le MIR a soutenu la victoire de l’UP et, sans y participer, le gouvernement Allende (allant jusqu’à assurer la garde personnelle du président). En 1973, le Mir envisagea même d’entrer au gouvernement, mais il renonça devant le cours droitier en matière de politique économique et d’alliances impulsé par le Parti communiste.
La question est ailleurs, dans l’hypothèse stratégique de guerre populaire prolongée qui guidait alors l’action du MIR. Le Mir s’attendait à un renversement du gouvernement mais sous la forme d’une défaite limitée qui donnerait le coup d’envoi de cette guerre prolongée. Dès lors, il se préparait davantage aux tâches imaginaires du lendemain ou du surlendemain qu’à la tâche de l’heure : l’affrontement dont la menace se précisait tout au long de l’année 1973. C’est d’ailleurs sur ce point que revient aujourd’hui l’un des rares survivants de la direction du MIR, Andrès Pascal, estimant que l’erreur stratégique fut de ne pas tenter de répliquer au Tankazo (le coup avorté de juin 1973) par une contre-offensive insurrectionnelle, sociale et armée.
4. Marco Aurelio Garcia juge illusoire cette « problématique du double pouvoir » selon laquelle les cordons industriels pouvaient constituer des embryons de soviets. C’est toute la question. La centralisation des cordons et des commandos communaux, combinée à des expériences démocratiques larges comme l’assemblée populaire de Conception, pouvait-elle déboucher sur la formation d’un pouvoir populaire constituant ? Il ne suffit pas de constater les faiblesses ou les forces. Elles dépendent en partie des stratégies et des volontés en présence. Et si, comme l’affirme Garcia, il n’y a « quasiment pas eu de résistance au coup d’État » (jugement pour le moins expéditif et unilatéral), il faut s’interroger sur la manière dont cette résistance a été préparée et sur les mots d’ordre qui n’ont pas été lancés le jour où Pinochet a fait bombarder la Moneda.
Bien sûr, pour poser le problème dans ces termes, encore faut-il admettre que la radicalisation d’un processus révolutionnaire n’est qu’une réponse, dans une escalade aux extrêmes, à une contre-révolution en marche. L’hypothèse tranquille d’un consensus social avec la bourgeoisie et d’une bénédiction de l’impérialisme est tout aussi irréelle que celle d’une stabilisation démocratique du gouvernement Kerensky entre février et octobre. Les Kornilov et les Pinochet ne l’ont jamais entendu de cette oreille.
5. Pour faire bonne mesure, Le Monde publie, dans son numéro du 12 septembre, un article de Jorge Castaneda (ancien ministre mexicain des relations extérieures du gouvernement de Vicente Fox) décrétant imprudemment que « l’ère des révolutions est close » (et celle des contre-révolutions ?), ainsi qu’un article de Paulo Antonio Paranagua tendant à réduire les expériences stratégiquement fort diverses (de Cuba au Nicaragua et au Salvador, en passant par la Bolivie, le Pérou, ou l’Argentine), à une « pulsion de mort » (sic !) des militants. Qu’il entre une part d’ombre dans les motivations individuelles, c’est une banalité universelle. Cela n’autorise nullement à psychologiser et à dépolitiser les engagements et leur sens politique au cliché journalistique de la fuite en avant suicidaire, comme il devient de bon ton de le faire, notamment à propos de la mort du Che en Bolivie.
6. Élargissant la portée des leçons du Chili, Marco Aurelio Garcia rend hommage à la lucidité « du dirigeant communiste italien Enrico Berlinguer » qui « a remarqué d’emblée qu’on ne peut pas gouverner avec une faible majorité ».
L’expérience chilienne a en effet aussitôt servi d’argument (d’alibi) à la gauche respectueuse européenne pour prêcher le « compromis historique »1 ou le « pacte de la Moncloa »2. Un quart de siècle plus tard, quel est leur bilan ? Le compromis historique a contribué à désarmer le mouvement ouvrier italien et conduit à la débâcle de l’Olivier [coalition de centre-gauche dirigée par Romano Prodi, au pouvoir entre 1996 et 2001] et à l’avènement de Berlusconi. Berlinguer et ses héritiers (comme Robert Hue) ont sacrifié l’alternative aux alliances. Ils ont ainsi évité les coups d’État, mais au prix d’un renoncement à tout changement social sérieux, d’un enfoncement dans la crise, et d’une capitulation en rase campagne devant la contre-réforme libérale.
7. Ce retour pour le moins étrange en forme d’oraison funèbre sur l’expérience chilienne permet à Marco Aurelio Garcia d’établir un parallèle entre le « modèle chilien » et le « modèle brésilien », entre le gouvernement Allende et le gouvernement Lula, à l’avantage écrasant du second bien sûr. Mieux vaudrait « laisser du temps au temps ». Nous avons à l’époque adressé des critiques (parfois peut-être excessivement sévères) à Salvador Allende. Il n’empêche que le personnage mérite le respect et tiendra dignement son rang dans l’histoire. Si la politique libérale suivie depuis le début de l’année (au nom des alliances les plus larges) par le gouvernement Lula continue, il n’est pas sûr, hélas, que, d’ici quelques années, le « modèle brésilien » n’apparaisse pas comme un exemple de plus d’une capitulation sans grandeur devant l’ordre dominant. Il paraît que Lula est obsédé par l’idée de ne pas finir comme Walesa. Rien ne dit en effet qu’il parvienne à l’éviter. (Septembre 2003)
*
Les notes en bas de pages sont de Contretemps. Nous remercions Patrick Le Moal de son aide.
Notes
[1] Ce texte est repris, dans une variante légèrement remaniée, dans son ouvrage Penser Agir, Paris, Lignes, 2008, p. 165-198. On lira également en complément ses textes « Stratégie et politique : de Marx à la 3e Internationale » et « Front unique et hégémonie », repris dans le recueil publié à titre posthume par Antoine Artous La politique comme art stratégique, Paris, Syllepse, 2011, p. 53-91 et p.93-106.
[2] Le président bolivien José Torres a pris le pouvoir en 1970 en s’appuyant sur les étudiants, les travailleurs et les syndicats. Il institue une Assemblée du peuple, véritable organe consultatif qui compte dans ses rangs des leaders de gauche radicaux, et nationalise les monopoles étrangers (compagnie Bolivian Gulf, expropriation de l’industrie du sucre). Torres est écarté du pouvoir à l’été 1971 par une rébellion des militaires dirigée par Hugo Banzer, ancien chef de l’académie militaire.
[3] Mouvement d’Action Populaire Unitaire, courant chrétien de gauche radicale, qui se détache de la Démocratie chrétienne et devient une composante de l’Unité populaire. Jacques Chonchol, le ministre de l’agriculture des gouvernements Allende, en était issu.
[4] Mouvement de la Gauche Révolutionnaire, fondé en 1965 qui, tout en prônant une voie révolutionnaire incluant l’action armée, offre un soutien critique au gouvernement d’Allende.
[5] Il s’agit d’une référence aux Statut des garanties constitutionnelles, texte exigé par la Démocratie chrétienne pour ratifier l’élection d’Allende par le Plein Congrès (Chambre des députés et Sénat), au sein duquel l’Unité populaire était nettement minoritaire. Ce Statut comprenait 9 amendements constitutionnels, censés garantir la permanence d’un régime démocratique. Il s’agissait brièvement de la garantie de l’existence des partis politiques, de la reconnaissance de la liberté de la presse et du droit de réunion, de la liberté de réunion et de l’enseignement, de l’inviolabilité de la correspondance, de la « liberté du travail » et de mouvement, de l’assurance de la participation des groupes communautaires et du respect du caractère professionnel des Forces armées et des carabiniers.
[6] Organisation Latino-Américaine de Solidarité, conférence de partis et mouvements révolutionnaires d’Amérique latine qui se réunit à La Havane en 1967.
![Chili 73 : un coup d’État qui permit la contre-révolution néolibérale [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/golpe-chile-1973-150x150.jpg)