
Décentrer l’Occident. Entretien avec Thomas Brisson
À propos de : Thomas Brisson, Décentrer l’Occident. Les intellectuels postcoloniaux, chinois, indiens et arabes, et la critique de la modernité, Paris, La Découverte, 2018.
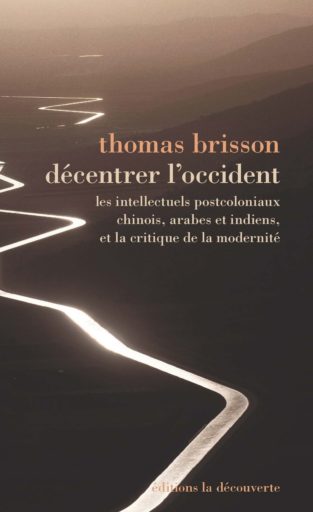
Comment est née l’idée d’écrire Décentrer l’occident (La Découverte, 2018) ? Pourriez-vous revenir sur le contexte intellectuel français de réception des études postcoloniales ?
L’idée est née un peu par hasard. J’ai été amené à enseigner dans une université en Asie pendant plusieurs années. Je cherchais alors un sujet de recherche sur cette aire culturelle et politique que je connaissais très mal. Je suis tombé sur les penseurs néo-confucéens, des intellectuels chinois installés aux États-Unis, dont l’un des intérêts, très pragmatiquement, était que leurs textes étaient en anglais et donc aisément accessibles pour moi. Assez vite, la ressemblance avec des intellectuels sur lesquels j’avais déjà travaillés et que connaissais mieux – les intellectuels arabes en France ou aux Etats-Unis – est apparue frappante. Ces femmes et ces hommes présentaient des trajectoires sociales relativement comparables ; par ailleurs, toutes et tous avaient développé des formes d’interventions intellectuelles critiques semblables. De tout cela a émergé l’idée d’un terrain comparatif sur le déplacement des intellectuels postcoloniaux en Occident et, finalement, de l’ouvrage aux éditions La Découverte.
Le fait de commencer ce terrain d’enquête loin de la France m’a permis de prendre un peu de distance vis-à-vis de la réception française des études postcoloniales qui connaissait, disons au tournant des années 2000-2010, des évolutions sensibles. C’est à ce moment que quelques grands textes, comme Provincialiser l’Europe de Dipesh Chakrabarty, ont été traduits, et que d’autres (Edward Saïd, Gayati Spivak) ont été retraduits ou mieux connus. C’est aussi le moment où plusieurs numéros de revues ou d’ouvrages, parfois issus de colloques importants, sont parus sur la question. Mais c’est aussi à cette occasion qu’un certain nombre de voix opposées aux postcolonial studies se sont fait entendre. Or ces dernières étaient souvent celles d’intellectuels reconnus, qui avaient œuvré depuis longtemps pour une meilleure compréhension des mondes non-occidentaux – je pense à Jean-Loup Amselle et Jean-François Bayart entre autres – c’est-à-dire des chercheurs dont le travail ouvrait de nombreuses pistes pour réfléchir aux conséquences de la colonisation.
C’est d’ailleurs cette situation paradoxale – la présence importante de spécialistes français des anciens mondes coloniaux sceptiques quant aux présupposés engagés par les études postcoloniales nord-américaines – qui me semble expliquer nombre de polémiques et de malentendus qui en ont marqué la réception française.
Qu’apporte, selon vous, une approche de sociologie politique aux études postcoloniales ? Pourquoi avoir décidé de vous pencher plus spécifiquement sur la sociologie des intellectuels postcoloniaux ?
Il y a deux manières de répondre à votre question, selon que l’on considère une telle sociologie des intellectuels postcoloniaux avant tout dans le champ de la sociologie politique, ou bien comme une contribution à la réception des études postcoloniales en France, sur laquelle portait votre question précédente. Pour commencer par ce second point, j’espère que ce que peut apporter l’ouvrage est une forme de recul, autorisée par les outils que nous donnent les sciences sociales et qui nous rappellent combien il est important de prendre en compte des trajectoires précises, des temporalités complexes, de même que les rapports de force ou tout simplement les multiples négociations et ambiguïtés qui sont la trame de la vie socio-politique quotidienne. A mon sens, cela devrait permettre de poser un peu le débat et d’éviter les réactions quelque peu épidermiques et automatiques que l’on a vu se multiplier sur le (post-)colonialisme en France.
Par exemple, retracer les carrières intellectuelles des grands noms des postcolonial permet de voir que ces derniers n’ont pas toujours été les thuriféraires de cette hyper-radicalité que les uns encensent et que les autres adorent détester. Spivak, Said et bien d’autres furent longtemps – et aussi – des intellectuels « orthodoxes », grands connaisseurs de musique classique ou d’écrivains figurant dans le panthéon de la littérature occidentale. Ils devinrent (plus qu’ils ne furent) des intellectuels critiques à un certain moments de leur carrière, en fonction de débats et de positionnements institutionnels qu’il faut pouvoir décrire précisément.
Comme le rappelle justement Jean-Louis Fabiani, ce sont les débats qui font les intellectuels (plutôt que les intellectuels qui font les débats…) car à cette occasion on se fait un nom, on est amené à radicaliser ses arguments, à prendre des positions affirmées qui n’étaient que latentes auparavant, etc. C’est tout à fait le cas avec les Postcolonial Studies : celles-ci sont loin d’être la tradition monolithique, réductible à un ensemble partagé de thèses, que l’on se plait parfois à décrire. Retracer les débats et les trajectoires permet de redonner toute leur place à des voix multiples, aux hésitations, au fait que les intellectuels postcoloniaux eux-mêmes sont loin d’être d’accord les uns avec les autres (on oublie la virulence des échanges entre les intellectuels indiens, par exemple). Tout simplement, cela permet de rappeler que l’on ne dit pas la même chose à différents moments de sa vie, dans un meeting politique à Jérusalem ou Calcutta ou dans un séminaire érudit à New York ou Singapour, etc.
Cela peut paraitre une idée assez simple mais elle éclaire d’un jour nouveau les productions postcoloniales : pendant la première partie de leurs carrières, nombre d’intellectuels étaient engagés dans des directions de recherche différentes et finalement classiques (Spivak et Said, respectivement spécialistes de Yeats et Conrad, seraient assez représentatifs de cette tendance) ; nombreux, également, sont celles et ceux qui ont exprimé des réserves à l’égard d’études postcoloniales qui, en s’institutionnalisant, ont perdu de leur vivacité critique et heuristique originale pour se transformer en un discours plus convenu. Finalement, cette attention aux trajectoires et aux transformations induites par le temps historique, qui est le b.a.ba de la sociologie politique, permet peut-être de complexifier le tableau d’études postcoloniales qui, lorsqu’on les critique, sont réduites à un ou deux ouvrages (L’Orientalisme de Said ou bien Provincialiser l’Europe de Chakrabarty) alors que l’on trouve, chez ces auteurs ou chez d’autres, quantité de thèses qui vont bien au-delà du résumé que l’on en fait.
Pour revenir brièvement sur le premier point – que pourrait apporter cette fois un ouvrage sur les intellectuels postcoloniaux à la sociologie politique – je pense que ce dernier s’inscrit dans une série de travaux plus larges sur les questions transnationales. Pour le dire très vite, une grande partie des théoriciens classiques de la sociologie et des sciences politiques ont pensé leurs objets dans une perspective nationale – ce serait en grande partie le cas de Pierre Bourdieu, dont les travaux ont considérablement contribué à façonner notre conception des champs intellectuels et dont j’ai repris un certain nombre d’outils d’analyse dans l’ouvrage. Or on porte aujourd’hui une attention beaucoup plus grande à ce qui érode ce cadre national et remet en cause l’image de sociétés nationales contenues dans des frontières politiques et culturelles nettement définies. Que devient notre conception des intellectuels (comme d’autres phénomènes socio-politiques) lorsqu’on la replace dans une perspective globale ? Les travaux sur les exils intellectuels avaient déjà enfoncé un coin ; ceux sur la (post-)colonie poursuivent cette tendance, en rappelant combien nombre d’intellectuels « français » sont liés aux mondes arabes, musulmans, africains, etc.
L’idée va un peu plus de soi aux États-Unis, sur lesquels porte la majeure partie de l’ouvrage, car le multiculturalisme est une notion clé de la fabrique politique américaine depuis la fin des années 1970 ; mais ici encore il me semblait intéressant de voir comment l’idée de nation est devenue bien plus instable à mesure que se multipliaient ce qu’Arjun Appadurai nommait des « idéoscapes » : soit des espaces d’échanges culturels et politiques globalisés, qui permettent une diffraction sans précédent des allégeances et des identités. Précisément parce que ce phénomène gagne à être appréhendé en dehors du discours de célébration sur l’hybridité globale – un discours aussi sympathique qu’il est partial et peu explicatif – il me semble qu’une sociologie des intellectuels postcoloniaux contribue à reposer le problème de manière plus sobre : quels sont les espaces de circulations globales des idées, et des femmes et des hommes qui les portent ? De quelles ressources faut-il disposer pour y circuler ? Par quelles asymétries ces espaces sont-ils structurés ? Quelles relations entretiennent-ils avec un capitalisme lui-même globalisé ou avec des espaces nationaux, à la fois menacés et robustes ? etc.
Pourquoi avoir décidé, dans un ouvrage sur les intellectuels postcoloniaux, de faire se croiser des traditions aussi différentes que le néoconfucianisme chinois, les études subalternes indiennes ou encore les études postcoloniales arabes ? Et comment expliquer que ces courants se soient développés aux Etats-Unis, dans un contexte de diaspora ?
L’idée m’est venue précisément parce que je recherchais une manière plus systématique de faire une sociologie des intellectuels postcoloniaux. Les néo-confucéens chinois, en effet, ne se rangent absolument pas sous l’étiquette du « postcolonialisme » et ceux avec qui je me suis entretenu étaient très étonnés quand je leur présentais le projet sous la forme d’une enquête sur les intellectuels postcoloniaux.
Il faut dire que l’appellation « intellectuel postcolonial » peut avoir des sens sensiblement différents. Au sens restreint, elle regroupe les intellectuels qui ont fondé ou ont participé aux postcolonial studies depuis les années 1980 – essentiellement des Indiens (un certain nombre d’historiens, qui étaient membres du collectif de recherche des Subaltern Studies) et des Arabes (Said, principalement), toutes et tous installés aux États-Unis ou en contact étroit avec l’espace universitaire anglo-saxon. Mais dans un sens plus large, tel que l’ouvrage la fait fonctionner, cette même appellation désigne tous les intellectuels non-occidentaux qui ont été exposés aux impérialismes de l’Occident et qui ont cherché à en penser les conséquences (épistémologiques et politiques, au premier chef). On peut donc imaginer que nombre d’intellectuels africains, sud-américains, musulmans, asiatiques, etc. soient regroupés sous cette appellation un peu vague – quand bien même, encore une fois, ils ne se retrouvent pas derrière la barrière des « études postcoloniales » au sens strict.
Or le léger flou qui entoure cette dénomination était précisément ce qui permettait de voir des choses ou de poser des questions nouvelles. Il autorisait par exemple la comparaison que vous soulignez, relativement contre-intuitive au premier abord tant les profils de ces intellectuels sont différents. Les postcoloniaux indiens et arabes sont en effet dans une lignée radicale néo- ou post-marxiste (la filiation souvent soulignée avec Gramsci – encore qu’elle soit exagérée, à mon sens – en serait un signe) ; par ailleurs ils sont nourris de philosophie française (Derrida, Foucault, etc.) et portent une grande attention aux études littéraires et à la textualité comme lieu de domination. La radicalité intellectuelle et politique est, chez eux, parfaitement assumée, d’autant plus qu’elle prend place dans le contexte des réformes néo-libérales de Reagan, qu’elles dénoncent fortement.
A l’inverse, les néo-confucéens chinois, dont beaucoup ont fui la Chine populaire, sont très méfiants à l’égard des utopies politiques. Le capitalisme est, pour eux, une réalité qu’il peut certes s’agir de policer mais qu’ils ne condamnent pas en tant que tel (une partie du mouvement néo-confucéen s’est même crée pour penser les conséquences de la modernité et de la puissance de l’Asie lorsque celle-ci, à partir des années 1970, s’est imposée comme un partenaire majeur de l’économie capitaliste globale). Les néo-confucéens sont donc des libéraux (au sens politique/anglo-saxon du terme) et leurs références se trouvent du côté de la philosophie politique nord-américaine (Rawls, Taylor, MacIntyre, etc.) avec qui ils discutent (parfois de manière critique). En bref, on aurait bien du mal à trouver ce qui rapproche des philosophes chinois libéraux, intéressés par une revivification de l’antique tradition impériale du confucianisme, d’intellectuels radicaux indiens et arabes, soucieux quant à eux de poursuivre la critique tiers-mondiste à un moment où cette dernière patinait devant un capitalisme de plus en plus mondialisé.
Pourtant, plusieurs convergences émergeaient dès que l’on regardait, au prisme de la sociologie politique, leurs trajectoires. Toutes et tous avaient été éduquées – dès leur enfance en Chine, en Palestine mandataire ou en Inde coloniale – dans les langues et les savoirs des Européens ; toutes et tous, ensuite, avaient migré en Occident – en Europe mais surtout aux États-Unis qui, dans les années 1960, détrônèrent les anciennes métropoles coloniales (Londres, Paris, Amsterdam, etc.) pour ce qui est de l’accueil des étudiants issus des anciens territoires dominés. Installés en Occident, ces femmes et ces hommes commencèrent des carrières intellectuelles classiques, qui n’avaient souvent aucun rapport avec leurs mondes d’origine. Mais, dans les années 1970, une série de ruptures biographiques les amena à progressivement mettre en avant une « identité » non-occidentale qu’ils avaient soigneusement euphémisée auparavant.
Cette tendance correspondit au moment où les espaces académiques américains s’ouvrirent à la question de la « différence » : à la fois parce que les campus apparaissent comme les lieux centraux où se façonnèrent les différences à la norme dominante (dans les départements d’étude de genre, de gay studies, black studies, etc.) et parce que la société américaine dans son ensemble évolua vers la reconnaissance d’une forme de « pluralisme volontaire » (soit la possibilité donnée aux citoyens de mettre en avant leurs origines diverses : afro-américains, italo-américains, sino-américains, etc.). Les intellectuels postcoloniaux se trouvaient donc engagés dans un mouvement plus vaste de politisation de l’identité, auquel il participèrent activement via les ressources symboliques que leur donnaient leurs savoirs, leurs positions dans des universités souvent prestigieuses, leurs connexions diasporiques, leur capacité à se constituer en porte-paroles de communautés migrantes, etc.
En bref, ce que révélait la comparaison entre les Chinois du néo-confucianisme et les Postcoloniaux indiens et arabes, c’est à quel point l’expérience du déplacement, de la distance ou encore de l’exil, joue un rôle fondamental à la fois dans la critique d’un monde centré autour de l’Occident et dans la réinvention (dans un sens non-péjoratif du terme) d’identités multiples et globales. C’est bien parce que tous ces intellectuels non-occidentaux se sont installés en Occident qu’ils ont pu en questionner la prééminence (selon des modalités certes diverses) et en faire la critique. De ce point de vue, le déplacement physique induit par l’éloignement de son monde d’origine, est solidaire d’une capacité à déplacer les cadres généralement acceptés pour penser le réel (c’est-à-dire à remettre en cause ce qui va de soi et donc à produire de la critique).
A sa manière l’ouvrage poursuit donc une ligne de travail ancienne (celle qui fait des « laboratoires de l’émigration » les lieux où se recrée de la différence politique) ; mais il le fait en liant cette question à celle, plus spécifique, de la critique : qu’on le déplore ou qu’on s’en félicite, la critique aujourd’hui, tout autant qu’elle prend les formes classiques de la dénonciation des inégalités socio-économiques et celles (plus récente) des rapports de genre et entre sexualités, a intégré la question de la différence culturelle (sous tous ses aspects, y compris ceux de la religion ou des processus de racialisation).
Dans Postcolonial Theory and the Specter of Capital (récemment traduit sous le titre La théorie postcoloniale et le spectre du capital), Vivek Chibber reproche, entre autres choses, aux études subalternes de « ressusciter l’orientalisme » en attribuant à l’Occident « la science, la rationalité, l’objectivité et d’autres propriétés similaires, au lieu de les considérer comme des éléments communs aux deux cultures » (pp. 423-424) : que pensez-vous d’une telle critique[1] ?
On peut tout d’abord signaler que Chibber n’est pas le premier à adresser cette critique aux postcolonial studies : un certain nombre d’auteurs – Arif Dirlik aux Etats-Unis, François Pouillon ou Alain Roussillon en France – avaient déjà pointé ce qu’ils considéraient comme une dérive possible des études postcoloniales vers un néo-orientalisme.
Les critiques les plus tranchantes ont même émané d’intellectuels qui ont parfois été très proches du projet subalterne/postcolonial à ses débuts : c’est le cas de Sumit Sarkar, qui a écrit dans les premiers recueils collectifs des Subaltern Studies, avant de se dissocier radicalement de la tournure (qu’il juge postmoderne et culturaliste) prise par les travaux de ses collègues indiens, une fois ces derniers installés aux États-Unis. Sarkar estime ainsi que l’influence de Said et des études littéraires/culturelles a amené les travaux postcoloniaux indiens à perdre de vue les complexités de l’histoire sociale et à homogénéiser les traditions et les cultures indigènes d’une manière qui rappelle le regard orientaliste et colonial le plus classique. (Pour la petite histoire, son nom a été complètement effacé des anthologies et des histoires officielles que les membres du collectif des études subalternes et postcoloniales ont produites sur le mouvement, ce qui, pour des historiens qui entendent exhumer la voix de ceux que le pouvoir a rejeté dans le silence et l’oubli, est assez ironique).
Tout en signalant, donc, que Chibber n’est pas le premier à soulever la question, que peut-on dire de sa critique ? Encore une fois, le problème est que nombre de mises en cause contre les « études postcoloniales » procèdent de manière très englobante alors qu’elles ont en réalité un ou deux textes précis dans le viseur (sans toujours le dire explicitement). Or ce que l’on peut dire de tel ou tel argument, dans tel ou tel texte, est souvent infirmé ou nuancé dans tel autre texte, parfois du même auteur. Il me semble important de redire combien les études postcoloniales n’ont pas l’homogénéité que leur prêtent leurs adversaires (mais aussi nombre de ceux qui s’en réclament).
Ainsi, la critique toucherait sûrement juste sur certains textes – y compris certains textes du fondateur des Subaltern Studies, Ranajit Guha, dont on a pu montrer qu’ils « fabriquaient » un sujet subalterne homogène qui rappelait étrangement les spéculations orientalistes sur « la personnalité » ou la « conscience » indiennes. Mais ce même Guha a su entendre les critiques et plusieurs de ses textes ultérieurs cherchent à poser la question autrement. Certes, d’autres textes dichotomisent les catégories « Indien » vs. « Occidental » et l’on rappelle souvent qu’un des chercheurs dont la carrière avait débuté dans le sillage des études postcoloniales s’est ensuite rapproché de l’extrême droite hindoue, qui puise, elle, allègrement dans un argumentaire essentialiste et néo-orientaliste. Mais on ne saurait oublier que cette même extrême-droite a (parfois physiquement) menacé nombre de chercheurs des Subaltern/Postcolonial Studies, et que ces derniers, restés très majoritairement engagés à gauche, se sont amplement expliqué sur l’usage stratégique qu’il y avait à manier les grandes catégories de l’orientalisme pour mieux les déconstruire.
Sur la question plus particulière du fait que les études postcoloniales renverraient paradoxalement la science et la rationalité du côté de l’Occident, il me semble que la meilleure réponse à cette critique se trouve dans l’ouvrage de Gayan Prakask intitulé Another Reason. Prakash montre tout d’abord comment nombre de disciplines scientifiques européennes « modernes » et « rationnelles » se sont constituées en contexte colonial, avec l’apport décisif des lettrés locaux.
Ceci dit, il est vrai que son ouvrage va plus loin et s’interroge sur la manière dont, dans les colonies, science et raison furent soumises à une forme de torsion et de travestissement (d’où le titre de l’ouvrage). Mais je ne suis pas certain que cela veuille dire que la science est occidentale et l’irrationalité orientale, comme le suppose Chibber. Tout d’abord parce que ce que décrit Prakash est de l’ordre d’un rapport de pouvoir (l’Occident refuse aux colonisés la raison qu’il prétend incarner). Et surtout parce que ce à quoi amène la réflexion de Prakash c’est à mettre en question l’idée qu’existerait une rationalité moderne et occidentale qui soit homogène et cohérente.
Une manière théoriquement plus intéressante, ou en tous cas plus généreuse, de lire les études postcoloniales consisterait à les faire dialoguer avec ce que Bruno Latour montre sur les découpages modernes auxquels s’est livrée la science occidentale, dont il signale les multiples apories. On pourrait ainsi répondre à Chibber que ce qui est en partage entre les deux cultures n’est sûrement pas une science ou une rationalité commune, mais une façon d’interroger le réel sur laquelle l’empreinte laissée par l’Occident moderne se doit d’être réinterrogée.
Dans la partie de votre ouvrage consacrée à L’Orientalisme d’Edward Said, vous écrivez que « l’optique critique que Said adopte sur l’orientalisme pose l’impossibilité d’isoler le domaine du savoir de celui du pouvoir, science et politique étant indissociablement mêlées » (p. 176). Il est intéressant que, la même année que la publication de la traduction française du livre de Said (1980), un intellectuel français comme Maxime Rodinson, tout en reconnaissant la qualité du travail d’Edward Said, pointait le risque qu’en « poussant à la limite certaines analyses et (…) formulation de Said, on tombe dans une doctrine toute semblable à la théorie jdanovienne des deux sciences » (La fascination de l’Islam, p. 15). Que pensez-vous de l’évolution des études postcoloniales depuis L’Orientalisme ?
La référence à Maxime Rodinson est d’autant plus intéressante que ce dernier a été l’un des premiers intellectuels français à s’engager, dans le sillage de la guerre d’Algérie, pour que la voix des peuples et des intellectuels arabes soit désormais systématiquement intégrée à la manière dont on parle du monde arabe. Pendant la majeure partie de la colonisation, en effet, tout s’est passé de telle sorte que seuls les professeurs orientalistes français parlaient de manière autorisée du monde arabe et des Arabes. Après 1962, ceux qui n’étaient que les « objets » d’un discours en sont devenus les « sujets », pour reprendre les termes d’Anouar Abdel-Malek.
Dans ce mouvement de redistribution de la parole scientifique et politique, Rodinson n’a pas été le seul spécialiste du monde arabe engagé du côté de son objet d’étude, puisque même les très conservateurs orientalistes parisiens ont soutenu la décolonisation (Louis Massignon, qui appartenait aux milieux catholiques, visitait ainsi chaque semaine ceux qu’il appelait ses « frères algériens » emprisonnés). Mais il a été l’un des premiers à prendre acte du fait que la prise de parole des Arabes allait transformer la manière dont on parlerait du monde arabe et que la décolonisation aurait des conséquences épistémologiques.
Lui-même était très bien placé puisque, marxiste, il avait déjà développé une manière d’analyser les cultures arabes et musulmanes qui intégrait systématiquement l’économie, les rapports de pouvoir, les déterminations matérielles. Or ce fut l’une des transformations radicales du regard occidental pour laquelle les nouveaux intellectuels arabes allaient plaider après la fin de la décolonisation : que l’on arrête de parler du monde arabe au seul prisme des textes classiques, sans égards pour les relations de pouvoir, les transformations socio-économiques, le présent politique, etc. En d’autres termes, Rodinson avait anticipé une manière renouvelée de parler, de l’intérieur des sciences sociales françaises mêmes, du monde arabe.
Ces éléments sont importants pour comprendre sa critique contre Said à laquelle vous faites référence. En France, le tournant scientifique postcolonial s’est négocié autour d’une idée forte, à savoir qu’il était certes nécessaire d’aménager l’appareil des sciences sociales occidentales (en favorisant l’arrivée des chercheurs arabes et en intégrant les apports des sciences sociales et humaines qui, dans ces mêmes années 1960, étaient en plein renouveau), mais que cela ne remettait pas en cause la pertinence d’une science des sociétés arabes ou musulmanes menée depuis Paris, Londres ou Berlin. En d’autres termes, l’idée a été de recomposer de l’intérieur le cadre scientifique occidental, d’y faire une place pour les scientifiques arabes (ce qui fut le cas dans une large mesure) mais certainement pas d’invalider la pertinence de ce cadre et encore moins de le remplacer par une science du monde arabe faite exclusivement par les Arabes.
Or aux Etats-Unis, lorsque Said relance le débat postcolonial au début des années 1980 – vingt ans après que celui-ci se soit posé en France – ses écrits ouvrent une voie différente : en filigranes, on y trouve l’idée d’une intervention des intellectuels postcoloniaux à la fois en tant que tels et à rebours du discours occidental (qu’il s’agirait de dissoudre ou de déconstruire). La différence avec ce qui s’est passé en France est donc double : à la fois l’identité des intellectuels est mise en avant comme telle et le cadre scientifique occidental est radicalement réinterrogé. Ce qui pointe – au moins comme possibilité – c’est effectivement une recherche postcoloniale divergente de celle menée en Occident ou par les Occidentaux. Je pense que c’est ce que Rodinson avait en tête en parlant du penchant jdanovien de Said.
Il me semble que pour bien appréhender ces enjeux, et pouvoir répondre à la question que vous posez sur les études postcoloniales aujourd’hui, il faut donc garder ces contextes en tête. Lorsque Said écrit L’Orientalisme, non seulement les Français estiment que le débat a été réglé chez eux vingt ans auparavant et qu’il l’a été dans un sens bien plus satisfaisant que ce que propose leur collègue américano-palestinien. Ils disposent d’un argument fort qui est que la plupart des pays arabes qui ont cherché à mener une décolonisation scientifique complète se sont heurtés à des difficultés quasi-insurmontables : assez rapidement, il a fallu se rendre à l’évidence qu’une partie des travaux menés par les Européens pendant les colonisations restaient indispensables, qu’il était impossible de se couper des échanges scientifiques internationaux, que le fait de provenir de la culture que l’on étudiait n’offrait pas grand avantage épistémologique sans une solide formation scientifique, etc.
A la lumière de ces faits, Rodinson qui était par ailleurs un érudit d’une envergure absolument exceptionnelle et dont les positionnements politiques sur la décolonisation furent sans ambiguïté, pouvait donc s’opposer à Said. Pour être tout à fait juste à l’égard de ce dernier, cependant, précisons qu’il perçut lui-même très vite le danger souligné par Rodinson puisque, dès la préface à la première réédition de l’Orientalisme (l’année qui suivit sa publication), il s’empressa de se dissocier des lectures identitaires de son ouvrage phare, écrivant explicitement qu’il ne croyait pas du tout que seuls les Noirs puissent parler des Noirs, les Arabes des Arabes, etc. Et il faudrait également rappeler que les derniers textes de Said offrent une vigoureuse défense de l’université, de la littérature et de la culture humaniste, et se placent sous le patronage d’Auerbach et d’Adorno – à l’opposé, donc, d’une conception jdanovienne des sciences humaines.
La propre évolution de Said fournit probablement un élément de réponse sur la situation des études postcoloniales depuis la parution de L’Orientalisme, au moins en ce qu’elle montrerait la persistance et la cohabitation de régimes épistémiques divers.
D’un côté, un critique postcoloniale toujours active, même si, encore une fois, il faudrait prendre en compte des différences, par exemple entre l’institutionnalisation du discours dans les universités anglo-saxonnes (le « radicalisme chic » de quelques professeurs très bien payés est une réalité, qui produit une critique paradoxalement à la fois hyper-radicalisée et convenue, probablement du fait des contradictions inscrites au cœur de la position de leurs auteurs), et l’invention de programmes de recherche beaucoup plus novateurs, tels que ceux, par exemple, qu’ont initiés récemment des intellectuels africains depuis Dakar.
D’un autre côté, force est de constater que l’appareil scientifique occidental se porte bien, contrairement à ce que pouvait laisser penser (ou espérer ?) certains discours postcoloniaux. On mentionne souvent Provincialiser l’Europe de Chakrabarty comme le signe de la fin imminente de la domination épistémologique de l’Occident. Mais on oublie non seulement que Chakrabarty lui-même est très sceptique quant à cette hypothèse et que, en réalité, les sciences sociales européennes ne se sont jamais aussi bien portées : un rapport sur les sciences sociales mondiales produit par l’Unesco au début des années 2010 montrait ainsi que la part des articles en sciences sociales et humaines écrits par les Européens avait augmenté de plus de 50% en dix ans, et qu’avec les nord-Américains, ces derniers publiaient près de 85% de tout ce qui était produit dans ses même sciences sociales et humaines.
Cela veut-il dire que la critique postcoloniale contre les sciences occidentales resterait ultra-minoritaire ou peu pertinente ? Je ne crois pas. A mon sens, cela montre au contraire que face à un appareil scientifique aussi complexe et puissant que celui des sciences humaines, tel qu’il s’est originellement inventé en Europe, les stratégies les plus intéressantes sont celles qui cherchent à en exploiter les plis, les potentialités critiques inexplorées, les tensions créatrices, etc. En tous cas, penser que l’on provincialisera l’Europe en se coupant de ce que cette dernière a produit intellectuellement pour inventer une science ou un discours plus authentique, me semble une déroute.
Personnellement, je me désole de voir ce genre d’arguments refleurir à l’occasion – je pense à des interventions récentes que l’on a regroupées sous l’étiquette des mouvements « décoloniaux » : à la fois parce que cela affaiblit un propos politique plus large qui mérite d’être entendu, mais aussi parce que, scientifiquement, c’est une pensée qui part en vrille. Cela donne lieu à des discours très appauvris. Ceux sur le monde arabe, que je connais le moins mal, en donnent une image fantasmée et sans nuances. Pour cette branche des postcolonial studies, tout se passe comme s’il n’y avait ni sociologie, ni histoire, ni science politique du monde arabe ; comme si la vie des sociétés arabes n’était ni complexe, ni contradictoire, ni créatrice autant qu’elle peut parfois être terrible.
La question du points de vue situé (qui parle ?), qui est une question importante pour les sciences sociales, fait ici l’objet d’une interprétation maximaliste et finalement obsidionale, où seules les minorités peuvent parler des cultures minoritaires : on retombe sur une argumentation qui a connu un certain succès au moment des décolonisations mais qui s’est ensuite révélée être une impasse totale. A ce niveau, les critiques de Chibber ou de Rodinson que vous évoquiez auparavant s’appliqueraient sûrement. Mais il ne s’agit, encore une fois, que d’un courant très minoritaire d’études postcoloniales que leur diversité devrait nous interdire de qualifier de manière univoque, et dont la pertinence pour penser une époque où la centralité de l’Occident est effectivement recomposée, reste intacte.
Propos recueillis par Selim Nadi.
NOTES
[1] Pour une bonne recension française du livre de Chibber, voir : http://revueperiode.net/que-faire-des-postcolonial-studies%E2%80%89-a-propos-de-vivek-chibber-postcolonial-theory-and-the-specter-of-capital/









