
À lire : un extrait de « Violences conjugales », de Pauline Delage
Pauline Delage, Violences conjugales. Du combat féministe à la cause publique, Paris, Les Presses de Sciences Po, coll. « Académique », 2017, 262 p.
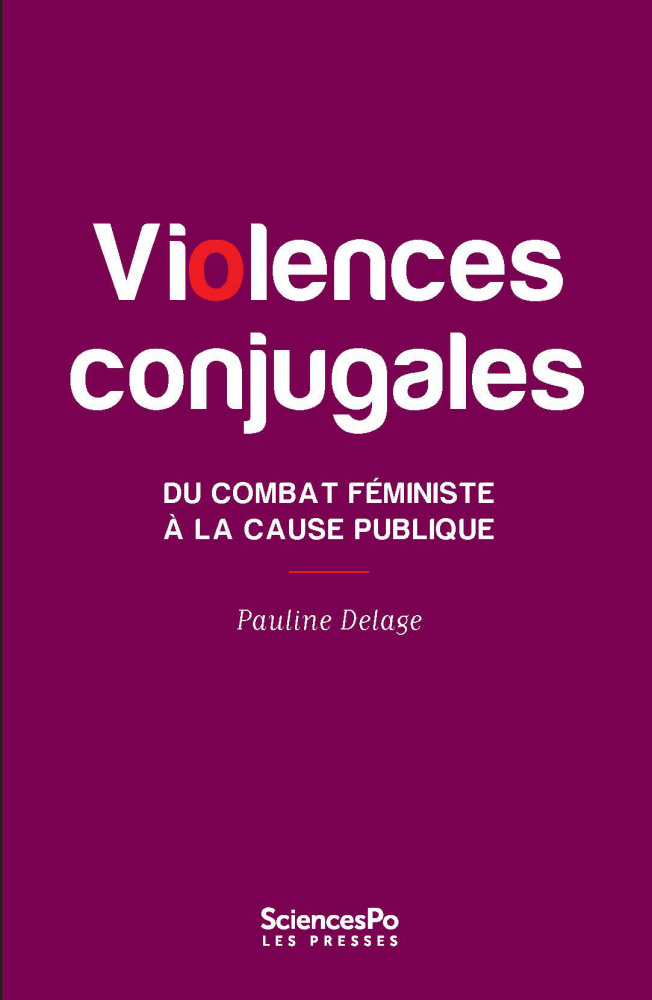
Si elle est très médiatisée aujourd’hui, l’apparition de la question des violences faites aux femmes est le fruit d’une longue histoire militante. Depuis les années 1970, des militantes féministes ont rendu visible cette question dans l’espace public, elles ont créé des espaces pour écouter et accompagner les femmes, et ont interpellé les pouvoirs publics pour que ceux-ci développent des politiques publiques.
Comment ces violences sont-elles devenues un problème dans la société ? Et quels sont les effets de cette institutionnalisation sur les groupes militants qui l’ont porté ? Pour répondre à ces questions, Pauline Delage a retracé l’évolution du traitement des violences conjugales par les groupes féministes en France et aux Etats-Unis, plus particulièrement en ile de France et dans le comté de Los Angeles, des années 1970 à aujourd’hui. Son ouvrage donne donc à voir comment les transformations des mouvements féministes, leur rapport à la professionnalisation et à l’institutionnalisation, influent sur la manière de comprendre la question des violences.
Ainsi si les féministes ont associé les violences dans le couple aux inégalités structurelles entre hommes et femmes, cette grille d’analyse est l’objet de controverses. A ce titre, la question des « hommes victimes de violence » constitue l’un des motifs récurrents utilisés par les actrices des associations héritières des mouvements féministes ou des acteurs extérieurs pour disqualifier, plus ou moins explicitement, la formulation et le traitement féministes de la violence conjugale.
La violence conjugale à l’épreuve des hommes victimes
La question des hommes victimes illustre plus frontalement une entreprise de dénégation de la cause ; dans le même temps, les réponses qui lui sont données révèlent les arrangements et les contradictions entre une approche insistant sur la disproportion entre les femmes victimes et les hommes, et celle dénonçant plus largement les violences dans le couple. Or les professionnelles n’y apportent pas nécessairement les mêmes réponses : alors qu’elles défendent une définition féministe de la violence en France, la question des hommes victimes est incluse dans la formulation et le traitement de la violence conjugale aux États-Unis. Bien qu’elles reconnaissent l’existence d’une minorité de victimes masculines, les professionnelles des associations françaises ne réclament pas leur prise en charge, même partielle. Leur façon de penser la violence conjugale fonde la légitimité d’une action tournée uniquement vers les femmes et leurs enfants. Certes, quelques hommes peuvent appeler la ligne d’écoute de la FNSF[1], mais leur faible proportion ne suscite pas de débats sur l’utilité d’un accueil, voire d’un hébergement pour hommes. Au moment de l’enquête, les associations françaises affirment ouvertement leur spécialisation dans l’accueil et l’accompagnement des femmes. Certaines professionnelles évoquent toutefois des conflits à ce sujet et regrettent que l’accueil des hommes victimes demeure un « tabou ». C’est le cas de Véronique, éducatrice à l’Abri[2] :
Parce que maintenant on a des représentations… Au fond de moi, je me dis que ça peut arriver que des hommes soient victimes. C’est un mode de fonctionnement à deux, alors pourquoi pas dans l’autre sens. Effectivement, il n’y a pas le même rapport de forces.
Le même rapport inégalitaire ?
Oui, alors si tu veux, c’est la compréhension sociologique qui est faite par le militantisme qui m’apparaît un peu réductrice dans la mesure parfois où il faut aussi comprendre le psychologique. Cela me dérange un peu parce que ce n’est pas que comme ça.
Une approche militante, associée à une approche sociologique et une vision structurelle de la violence, peut entrer en conflit avec les impératifs d’accueil et d’accompagnement du travail social. Penser ou non aux hommes victimes, nuancer ou non le mode de compréhension féministe du problème découle de la place accordée à une analyse macrosociale et généralisante.
Des enquêtes comparatives montrent que les problèmes sociaux sont plus facilement rattachés à des enjeux globaux en France qu’aux États-Unis[3]. En France, les formes d’institutionnalisation du problème public et la position relativement marginale des groupes masculinistes dans l’espace médiatique et politique jusque dans les années 2010 ont favorisé la persistance d’un mode de compréhension de la violence conjugale en termes de rapports sociaux. Dans les politiques publiques en France, la violence conjugale reste entendue avant tout comme une violence faite aux femmes, une approche légitimée par un ensemble de définitions forgées par des instances internationales comme l’ONU. L’affirmation de pratiques centrées sur les femmes est également liée à une institutionnalisation plus faible, générant une moindre attention des pouvoirs publics et des réactions moins marquées des groupes masculinistes. Fondés pendant les années 1990, des groupes comme SOS Papa et SOS Divorce se sont avant tout concentrés sur les droits parentaux, le divorce et la séparation, même si certains textes publiés sur leurs sites évoquent aussi la violence conjugale. La rhétorique mobilisée par ces groupes veut que la question des hommes victimes ait été cachée par les féministes et que la misandrie soit largement répandue dans la société, où juges, forces de l’ordre, services sociaux font preuve de beaucoup de complaisance à l’égard des femmes et les protègent davantage. Plusieurs colloques sur les hommes battus ont récemment été organisés[4]. Selon certaines militantes, après la promulgation de la loi du 9 juillet 2010, la catégorie de violence psychologique et la mesure d’ordonnance de protection se sont retournées contre des femmes, certains hommes auteurs de violences, soutenus par des groupes d’hommes, ayant pu grâce à elle poursuivre leurs épouses. De même, lors des débats sur la loi de Najat Vallaud-Belkacem sur l’égalité femmes-hommes en 2013, des groupes masculinistes ont œuvré pour faire déposer des amendements, l’un pour imposer la garde alternée des enfants, l’autre pour demander le syndrome d’aliénation parentale – un concept, largement décrié, forgé dans les années 1980 par le psychiatre Richard Gardner pour montrer comment, au cours des séparations de couples, les mères alièneraient leurs enfants pour que ceux-ci se retournent contre leurs pères, voire fassent de fausses allégations de pédophilie ou de maltraitance : ainsi, les plaintes pour violences ou maltraitances des enfants pourraient être interprétées comme un syndrome, et donc discréditées dans les tribunaux. À la suite de cette proposition d’amendement, la FNSF s’est mobilisée et a lancé une pétition intitulée « Stop aux revendications masculinistes au Sénat[5] ». Grâce à la publication de témoignages, largement relayés par les medias, les groupes masculinistes occupent une place grandissante dans l’espace public et politique, sans que l’on puisse encore en mesurer l’impact discursif et institutionnel. En perdant son potentiel de transformation sociale, la notion d’égalité sert dès lors au maintien d’un statu quo. Cette dynamique apparaît plus clairement aux États-Unis.
À Los Angeles, où les mobilisations masculinistes et des dynamiques idéologiques valorisent l’inclusion de tous plutôt que la dénonciation des inégalités, la question des hommes victimes a sa place dans le discours des professionnelles des associations. Pendant les formations et les entretiens, toutes reconnaissent systématiquement la possibilité que des hommes soient victimes de violence conjugale, même si elles insistent sur des différences dans la fréquence des situations. Elles diront par exemple « la majorité des victimes sont des femmes, et la majorité des auteurs, des hommes », avant d’ajouter « mais je ne dis pas que les hommes victimes n’existent pas ». Cette manière de présenter le problème explique et justifie la priorité qu’elles continuent d’accorder aux femmes. Toutes les professionnelles insistent sur le fait que les hommes victimes ne sont pas a priori exclus des associations de Los Angeles, même si les femmes y demeurent prioritaires. Le témoignage de Marcia, travailleuse sociale à Sunny, cette approche :
Ça arrive que des hommes viennent ici. On en a déjà accepté dans le centre d’hébergement, mais ils ne sont jamais venus. Donc, on n’a jamais vraiment eu de victime homme dans le refuge, mais parfois dans le centre d’accueil. Il n’y en a pas assez pour faire un groupe de parole, donc on essaie de privilégier les séances individuelles.
Entre promotion des droits des femmes et aide aux victimes, quel que soit leur genre, deux conceptions du traitement de la violence conjugale s’affrontent. L’articulation délicate entre ces deux dimensions reflète la stratégie implicite des organisations de lutte contre la violence conjugale pour parer les résistances des groupes masculinistes.
Très développés aux États-Unis, notamment autour du combat pour le droit de garde des enfants, des groupes et une rhétorique masculinistes se sont progressivement immiscés dans la lutte contre les violences conjugales[6]. Ils sont particulièrement bien intégrés dans les espaces institutionnels à Los Angeles. L’un des militants du Men’s Health Network assiste ainsi systématiquement aux réunions du Los Angeles Domestic Violence Council. À l’occasion de l’une d’entre elles, il invite d’autres membres du Council à organiser une commission sur les violences envers les hommes et raconte son action auprès de l’Office on Violence Against Women pour que les financements soient accordés sans cibler un genre spécifique. De même, la Los Angeles Domestic Violence City Task Force réunit plusieurs commissions, dont l’une, consacrée aux populations underserved, alerte les associations sur l’infériorisation ou la minimisation des besoins des femmes migrantes, racisées… et des hommes ! En renversant la rhétorique féministe égalitaire, ranger les hommes du côté des populations marginalisées soustrait la violence conjugale aux rapports structurels de domination.
Outre un discours diffus, les mobilisations en faveur des hommes ont également pris la forme de procès pour discrimination. En 2003, dix centres d’hébergement du comté de Los Angeles ont été poursuivis par un homme, soutenu par plusieurs associations masculinistes, dont la National Coalition for Free Men[7]. L’avocat du requérant mobilise alors les lois contre la discrimination afin que les associations d’accompagnement des victimes de violences conjugales qui n’accueillent pas les hommes ne soient plus financées par des fonds publics. Les juristes du Women’s Law Center assureront la défense des associations incriminées en démontrant qu’elles ne refusent pas d’accompagner des hommes, mais qu’elles ne sont pas en capacité de le faire[8]. On comprend mieux la volonté des actrices des associations de dissiper tout soupçon quant à l’exclusion des hommes.
Selon les groupes masculinistes, si la question des hommes battus est occultée, c’est en raison de l’inscription historique de la violence conjugale dans une approche féministe. En niant l’asymétrie statistique et sociale qui perdure entre hommes et femmes, il est aisé de conclure à une prétendue discrimination envers les hommes. Les textes de la National Organisation for Men, l’une des plus anciennes associations masculinistes aux États-Unis, sont exemplaires de ce mouvement argumentatif qui réévalue la prévalence des hommes victimes et souligne le déni des politiques publiques, ainsi que le prétendu mythe de la légitime défense des femmes utilisé parfois pour expliquer les meurtres d’hommes par leurs compagnes. Certaines professionnelles, comme Judith, dénonce le poids grandissant du discours et des groupes « pour les droits des hommes » :
Tu vois, je suis féministe, je me préoccupe du sort des femmes. C’est la grande majorité des personnes que l’on voit ici. Mais il y a une grosse poussée des mouvements pour les droits des hommes, qui veulent montrer que les hommes sont autant, voire plus, battus que les femmes ; ils veulent que le problème soit neutre (gender neutral), que l’argent soit partagé entre les organisations et ils rejettent le Violence Against Women Act.
Les organisations masculinistes sont devenues des interlocuteurs possibles pour les médias et pour les pouvoirs publics. Lorsque le VAWA[9] a été reconduit en 2000 et 2005, les groupes masculinistes s’en sont pris plus directement aux subventions des associations d’accueil des femmes victimes, revendiquant un partage égal entre organisations dédiées aux hommes et celles destinées aux femmes[10]. Sans s’opposer au discours égalitaire, voire en se l’appropriant, les groupes masculinistes donnent un sens strictement formel à la notion d’égalité pour imposer un principe de neutralité des associations et de l’action publique. Comme le rappellent Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déry à propos du Québec, si le masculinisme est hétérogène, il « récupère à son profit l’analyse et le mode d’organisation des féministes pour en renverser le sens : l’analyse des rapports sociaux des sexes cherche maintenant à identifier les hommes comme victimes des femmes dominantes (…) »[11]. Cette rhétorique peut séduire, dans la mesure où la notion d’égalité y est reformulée en mettant en équivalence les individus, quel que soit leur genre, et en occultant les rapports de domination structurels : il n’y aurait plus d’inégalités entre hommes et femmes, mais un renversement d’inégalités passées, et des individus dont les propriétés sociales s’effaceraient dans les relations interindividuelles, en particulier de couple. L’« illusion de l’égalité »[12], que la juriste Martha Fineman a étudiée à partir des réformes du divorce, traverse différentes strates de la société ; elle reflète et renforce des représentations libérales des individus qui tendent à gommer toute différenciation et toute hiérarchisation sociale. Le discours des « droits humains » est, dans une telle approche, pleinement mobilisable.
La délégitimation d’une pensée en termes d’inégalités et de rapports sociaux ne prend pas uniquement la forme d’une réaction politique, plus ou moins organisé ; elle est diffuse et participe à reconfigurer les programmes des associations. Si, comme on l’a vu, certaines professionnelles regrettent la remise en cause de la perspective féministe, d’autres revendiquent au contraire une approche élargie du phénomène de la violence conjugale et de sa prise en charge. L’idée d’être et de se montrer « inclusives » constitue un élément phare de leur discours. Ainsi, Mary, directrice adjointe chargée du community outreach, à Hogar, souhaite ouvrir une chambre pour héberger des hommes. L’idée d’inclusion est omniprésente dans le discours des professionnelles états-uniennes. Comme l’illustre le changement de nom de For Peace[13], selon Gloria, sa directrice.
On a changé le nom parce que nous voulions qu’il inclut tout ce que nous faisons, toutes les personnes que nous aidons : les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les ados, les handicapés, les personnes âgées.
Être inclusive et intégrer les hommes seraient un signe de progrès et reflèteraient la volonté de s’adapter aux évolutions sociales. Si l’attention portée aux hommes victimes est partagée par les associations, les données sur les violences dans les couples hétérosexuels rappellent que ce phénomène touche plus de femmes que d’hommes. Liés à des rapports de domination, il ne constitue donc pas un acte isolé, mais s’inscrit dans une répétition dont les conséquences sont plus graves pour la santé psychique et physique des femmes. L’importance accordée à cette question traduit un malaise, voire un rejet explicite de la formulation d’un problème public en termes d’inégalités sexuées et d’asymétrie des pouvoirs dans le couple. Qu’il s’agisse de formes de contournement, de résistance aux attaques masculinistes ou d’appropriation de leur discours, les associations ont largement intégré des versions plus ou moins nuancées du mode de compréhension de la violence conjugale, adaptées aux valeurs libérales égalitaires promues, et valorisables dans l’espace public et auprès des financeurs. La pensée en termes de rapports sociaux et l’asymétrie de genre est constamment soumise à des tensions qui sont elles-mêmes façonnées par l’institutionnalisation de la cause.
Notes
[1] Fédération Nationale Solidarité Femmes. Organisation féministe rassemblant les structures spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes.
[2] Les noms des associations ont été changés.
[3] Michèle Lamont et Laurent Thévenot, « Introduction : toward a renewed cultural sociology », in Michèle Lamont et Laurent Thévenot (dir.), Rethinking comparative cultural sociology. Repertoires of evaluation in France and in the United States, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 15.
[4]http://www.sospapa-yvelines.fr/actualites/actualites-et-evenements, consulté le 23 août 2013 ; http://sospapaparis.wordpress.com/2013/02/21/colloque-sos-hommes-battus/, consulté le 23 août 2013.
[5]Fédération Nationale Solidarité Femmes, SOS Maman, Collectif Abandon de Famille – Tolérance Zéro, « Stop aux revendications masculinistes au Sénat », 18 septembre 2013, http://www.solidaritefemmes.org/ewb_pages/a/actualite-883.php, consulté le 10 février 2014.
[6]Voir Leora N. Rosen, Molly Dragiewicz et Jennifer C. Gibbs, « Fathers’ Rights Groups. Demographic Correlates and Impact on Custody Policy », Violence against women, vol. 15, n° 5, mai 2009, pp. 513-531 ; Jocelyn E. Crowley, Defiant dads. Fathers’ rights activists in America, New York, Cornell University Press, 2008.
[7]Voir les procès Blumhorst v. Jewish Family Services of Los Angeles, 2003 ; Booth v. Hvass, 2002 analysés dans Molly Dragiewicz, Equality with a Vengeance. Men’s rights groups. Battered women, and antifeminist backlash, Boston, Northeastern University Press, 2011.
[8]California Women’s Law Center, « Lawsuit against women’s shelters dismissed : A victory for common sense and justice », 2003, cité dans Leora N. Rosen, Molly Dragiewicz et Jennifer C. Gibbs, « Fathers’ Rights Groups : Demographic Correlates and Impact on Custody Policy », Violence against Women, 15 (5), mai 2009, p. 513-531.
[9] Violence Against Women Act, loi fédérale sur les violences faites aux femmes, promulguée en 1994.
[10]Jocelyn E. Crowley, op. cit., pp. 261-262 ; Molly Dragiewicz, « Patricarchy Reasserted, Fathers’ Rights and Anti-VAWA Activism », Feminist Criminology, vol. 3, n 2, avril 2008, p. 121-144.
[11] Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri, Le mouvement masculiniste au Québec. L’antiféminisme démasqué. Montréal, Remue-Ménage, 2ème ed, 2015, p. 18.
[12]Martha A. Fineman, The illusion of equality : The rhetoric and reality of divorce reform, Chicago, University of Chicago Press, 1994.
[13] Auparavant appelé Los Angeles Group Against Violence against Women.









