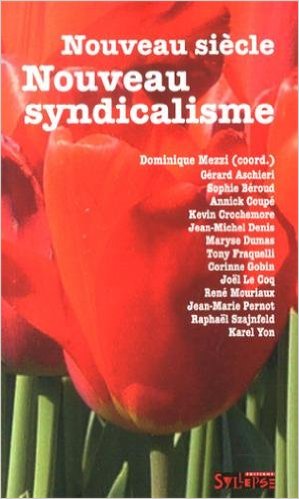
Extrait et rencontre autour de l’ouvrage : « Nouveau siècle, nouveau syndicalisme »
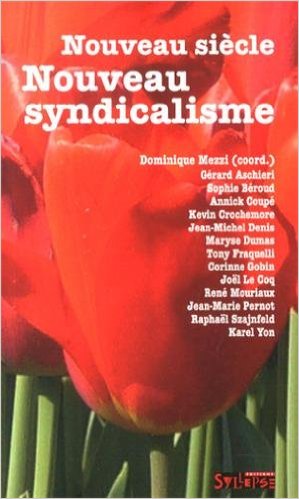
Le mercredi 22 janvier 2014, à partir de 18h, à la Bourse du travail de Paris (3 rue du Château d’eau, salle André Tollet) aura lieu une rencontre avec Jean-Marie Pernot (chercheur à l’IRES), suivie d’une discussion avec les auteur•e•s de Nouveau siècle, nouveau syndicalisme dont vous trouverez l’introduction ci-suit.
Le syndicalisme, un « mouvement social » !
Une introduction de Dominique Mezzi
Les contributions réunies dans ce « Cahier de l’émancipation » visent à éclairer le débat autour de l’actualité et du devenir du syndicalisme (en France, avec un éclairage transnational) comme mouvement historique et comme acteur social global, donc politique au sens fort. Le « contexte » de ce travail est pris ici dans son sens le plus large (une époque nouvelle), dépassant la nouvelle situation en France avec le gouvernement Hollande, ou les débats d’actualité, aussi vifs soient-ils.
Le titre même de cette introduction indique un parti pris : situer le syndicalisme comme mouvement social, et non comme « agence sociale » (Rosanvallon, 1988), ou comme institution chargée de réguler les rapports conflictuels entre monde du travail et classe patronale, conflits qui feraient périodiquement « mouvement » de manière plus authentique, avec d’autres ou parmi d’autres (mouvements des femmes, des chômeurs, mouvements de défense des droits, collectifs mis en place à l’occasion de combats écologiques, etc.). Il est en effet devenu courant dans un certain champ de la sociologie (Touraine, 1985), mais aussi dans des publications se situant dans une perspective de changement radical du monde, de juxtaposer, voire de dissocier, le (vieux) syndicalisme et les (nouveaux) mouvements sociaux.
Cette approche peut se comprendre. Elle a pour point de départ une interrogation sur le rôle aujourd’hui occupé par la classe ouvrière, telle qu’elle faisait autrefois référence comme acteur central des conflictualités. La place manque ici pour traiter cette question dans sa globalité. Il ne fait pas de doute que si une certaine classe ouvrière, issue d’une phase du capitalisme au 20e s iècle, a pu pendant plusieurs décennies être au zénith de sa puissance et de sa capacité à centraliser et même hiérarchiser les conflits sociaux, et en porter le sens au plan politique national, il n’en va plus de même aujourd’hui. Des défaites importantes ont été subies, trop connues et ne seront pas rappelées ici. Et surtout, il s’est produit une restructuration sociologique dans la composition du salariat avec des phénomènes aussi importants que : la salarisation massive des femmes (certes souvent à temps partiel) ; le retard à l’entrée des jeunes dans la pleine reconnaissance salariale (déniée dans la précarité, donc dans l’infantilisation prolongée pour l’accès aux mêmes droits que leurs aînés, et cela malgré un niveau de culture ascendant) ; le démantèlement des usines et des collectifs ouvriers des traditions industrielles ; l’irruption d’un salariat de sous-traitance ou de services externalisés, doublement, voire triplement dominé et exploité ; l’apparition de métiers obscurs des centres villes (restauration), ou de la construction, occupés par des jeunes étudiants ou des sans-papiers invisibles, etc.
Mais de tels changements et renouvellements du prolétariat (le vocable de précariat est une terminologie qu’il est courant aujourd’hui de préférer pour marquer une nouveauté qui n’en est pas vraiment une, si l’on s’en tient à la vraie définition du prolétariat) se sont déjà produits dans l’histoire. On pourrait même dire qu’ils sont consubstantiels à celleci – par exemple entre le 19e siècle des compagnons et métiers et les grandes concentrations ouvrières du Front populaire –, même si la globalisation économique en modifie considérablement l’échelle, avec des manifestations d’abord moléculaires de résistance, de solidarité, de luttes et de mouvements innovants ; pour parfois déboucher sur une syndicalisation de type nouveau se frayant un chemin à la fois dans les formes anciennes et/ou en dehors. Non sans conflits et bousculades !
Le mouvement de la lutte des classes n’est donc ni historiquement fini, ni jamais le même. Les classes sociales ne sont pas des choses, elles bougent, vivent et se recomposent : le haut de l’échelle, le bas, le milieu, interagissent. Elles s’enrichissent de prises de consciences nouvelles (rapports sociaux de sexes…) ou de régressions inquiétantes (racialisation des problèmes sociaux ou des différences religieuses). Les régimes de socialisation eux-mêmes se diversifient et de cette abondance des intérêts et des passions naissent aussi des mouvements et des formes associatives, dans lesquels les syndicats, ou les projets politiques, ont tout intérêt à se plonger.
Citons ici un passage de l’immense travail récent des historiens Michel Pigenet et Danielle Tartakowsky dans leur Histoire des mouvements sociaux en France :
Moins dense et homogène qu’autrefois, la contestation radicale subsiste cependant, plus profonde peut-être qu’elle ne l’était jadis, lorsqu’elle privilégiait les rapports d’exploitation et l’objectif de conquête du pouvoir politique. […] Le décloisonnement des champs et de leurs acteurs qu’opère la diversification des luttes crée les conditions d’interactions et de solidarités jadis inimaginables entre sphères publique et privée, domaines de la production et de la consommation, du travail, du non- et du hors-travail, échelles locale et globale, temps présent et futur » (Pigenet & Tartakowski, 2012).
Donc, s’il fallait résumer, nous pourrions dire que les nouveaux mouvements sociaux ne sont pas des « mobilisations collectives ontologiquement distinctes du mouvement ouvrier » (Béroud, 2004), et que le syndicalisme, tantôt s’en nourrit ou doit s’en nourrir, tantôt se révèle être lui-même un puissant facteur de mouvement social potentiel (1995- 2003-2006-2010), avec une tendance ponctuelle à la généralisation (en France surtout). Ce sont donc bien les changements du syndicalisme, les transitions d’une époque à l’autre, qui seront examinés ici.
L’ouvrage comprend deux parties : l’une d’analyses et de diagnostics, l’autre d’interrogations prospectives et de propositions.
Diagnostics
Il s’agira donc d’abord de faire le point sur le rapport contemporain du salariat au fait syndical, par comparaison avec ce qu’il a pu être dans des années perçues rétrospectivement comme plus fastes (années 1930, 1950, 1960). La conquête syndicale peut s’apparenter à une conquête du « collectif », depuis un début de1 9e s iècle où il est nié et réprimé jusqu’à un début de 20e s iècle qui parvient à penser la République et le travail autrement que dans le rapport faussé de la seule égalité formelle des « contractants ». Mais la conquête collective, si elle a porté des fruits nombreux, et si elle a donné à la classe ouvrière une légitimité dans la vie politique nationale (Code du travail, grandes conquêtes sociales, « institutions » du salariat qui ainsi n’est pas « nu » dans le capitalisme), s’est peu à peu enrichie, non sans tensions et parfois régressions, d’une demande d’appartenances à des collectifs multiples et, peut-être, au final d’une nouvelle forme d’individualité plus autonome et plus authentique.
La jeunesse d’aujourd’hui ne regarde peut-être plus le syndicalisme avec le même besoin qu’auparavant de s’inscrire dans un sillage. Le chômage et le déracinement de la socialisation professionnelle sont une question trop durable, malheureusement, qui précarise le rapport de confiance aux organisations. La salarisation massive des femmes apporte un regard critique sur les fonctionnements collectifs dominés autrefois par des leaders masculins. Jean-Marie Pernot introduit donc ce Cahier en éclairant comment le salariat-prolétariat moderne vit son rapport aux organisations collectives qui sont censées le représenter ou l’organiser, et explicite pourquoi la syndicalisation, notamment, ne parvient pas (pas encore ?) à retrouver sa solidité ; si ce n’est sa massivité, que l’on sait éphémère et relative en France.
Il ne manque pas d’auteurs pour décrire l’« institutionnalisation » du syndicalisme comme responsable de la désyndicalisation. Cela tombe sous le sens : le temps passé en réunions, c’est autant de temps en moins passé avec les salarié·es. La question est cependant plus complexe. Il est certain que la reconnaissance du collectif, et donc le développement de la fonction syndicale, avec ses multiples lieux de négociations ou de concertation, se sont aussi transformés en une inscription institutionnelle, laquelle au fil des décennies occupe une part de plus en plus prédominante dans le fonctionnement quotidien1. Et ce, d’autant plus que la complexification des questions sociales et sociétales appelle à embrasser continuellement des thématiques nouvelles : politiques territoriales, « hauts conseils » de ceci ou de cela, logement, pauvreté, école, nourriture, culture, e tc.…Mais la qualité de la relation entre « représentants » et « représentés » ne s’en ressent-elle pas ? Si oui, n’a-t-elle pas des effets pervers où, d’un côté des appareils puissants (État ou patronat) mobilisent l’attention, l’énergie militante et offrent aussi des occasions de carrières, et d’un autre côté le salarié « lambda » qui finit par avoir une relation de type clientéliste avec ce que devrait être « son » organisation (l’association du salariat) devenue gérante de droits.
Dans leur contribution, Sophie Béroud et Karel Yon nous invitent cependant à bien distinguer institutionnalisation et bureaucratisation, dont ils décrivent la « dialectique » possible. On rejoint aussi l’éternel débat entre réformes, réformisme, conservatisme bureaucratique des réformes acquises, et nécessité, même dans une optique syndicale de transformation radicale (ou révolutionnaire), d’être reconnu dans les lieux institutionnels de visibilité pour accroître son influence politique. Personne n’échappe à ce dilemme !
On n’y échappe encore moins à l’échelle internationale. Face à la mondialisation et à ses institutions (Organisation mondiale du commerce), à ses relais régionaux (Europe), comment construire une puissance syndicale en mesure d’agir à la hauteur des enjeux ? Il y a cependant un paradoxe : le syndicalisme mondial paraît de plus en plus unifié, alors qu’en France, par exemple, les composantes adhérentes de la Confédération syndicale internationale (CSI) peinent à définir un cadre commun minimum d’unité pour défendre le contrat de travail (accord ANI du 11 janvier 2013) !
Le 14 novembre 2012, pour la première fois, une grève générale d’une journée a paru s’organiser, au moins à l’échelle de l’Espagne, du Portugal et de la Grèce, relayée par un appel à une journée d’action de la Confédération européenne des syndicats (CES). Est-ce une première qui portera loin ou un essai sans avenir ? Il est certain que la très institutionnelle CES (dont l’histoire fait corps avec les institutions européennes) sent sa légitimité menacée sous les coups de boutoirs de la troïka (Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds monétaire international) dont la mission est de détruire méthodiquement les acquis des « États sociaux » en Europe,c e qu’elle a largement commencé à faire en Europe du Sud. Ce n’est qu’en 2012 que, pour la première fois, la CES a pris position contre un traité européen (TSCE). Corinne Gobin et Kevin Crochemore nous retracent l’histoire de cette dualité ou dialogue entre l’Europe et la CES et l’aveuglement qui a été jusqu’ici le sien face à l’atteinte à la légitimité syndicale que constituent les menaces que la jurisprudence que la jurisprudence européenne fait peser sur le droit de grève. Au-delà, notamment à travers l’imbrication des fédérations professionnelles opérant à l’échelle mondiale et celles opérant sur le cadre régionalisé de l’Europe, les deux auteurs montrent l’extraordinaire difficulté à définir une politique cohérente et à « faire syndicat » dans les dimensions transnationales : barrières des traditions de luttes, des cultures, adossées à l’histoire institutionnelle, et donc aux ensembles géopolitiques (Est-Ouest-Sud).
Mais si l’écosystème « syndicalisme-mouvement social » change, il subit aussi des crises, des cassures, suivies par l’apparition de nouvelles formes. Il est donc utile d’observer comment certaines séquences historiques ou certaines évolutions sociologiques profondes, précédées ou accompagnées de clivages idéologiques internes aux organisations, finissent par produire des typologies syndicales émergentes. Celles-ci peuvent être minoritaires dans un premier temps,puis en phase avec une demande sociale forte, et finir par s’imposer. René Mouriaux examine ici la naissance de la CFDT, à partir d’une double poussée, politico-idéologique et sociale : celle du puissant débat interne à la CFTC (dèsavant la Seconde Guerre mondiale et réactivé à la Libération) et celle de la radicalisation du jeune salariat formé par les développements économiques des « trente glorieuses » jusqu’à 1968. Raphaël Szajnfeld décrit ensuite la même articulation de conflits dans la Fédération de l’éducation nationale (FEN) – où une véritable bureaucratie n’hésite pas à casser un outil pour des projets politiques très explicites –, avec une demande syndicale dynamique que la jeune Fédération syndicale unitaire (FSU) a su très vite capter, dès sa naissance, avant le conflit fondateur de 1995 contre des réformes touchant la protection sociale, et qui voit émerger avec force à la fois une résistance au libéralisme et une demande syndicale. C’est d’ailleurs de cette période que date l’enregistrement dans les enquêtes d’opinion sur le syndicalisme (et notamment l’enquête annuelle de CSA pour la CGT), d’une courbe ascendante de confiance, mais aussi d’exigences.
De même, sans s’attarder sur les conditions précises des exclusions et scissions dans certaines fédérations de la CFDT (Poste, cheminots, santé), Jean-Michel Denis restitue comment, avec l’Union syndicale Solidaires, la demande de régénérescence syndicale authentique se combine aussi, plus tard, avec une certaine institutionnalisation nécessaire à la consolidation de l’outil.
Prospectives, propositions
Cette deuxième partie aborde des questions qui font controverses pour l’avenir. Seront traitées ici les rapports entre syndicalisme et politique, la question unitaire et la réforme de la représentativité. Le Cahier se conclut par des interrogations sur la CGT dont la longévité et la position centrale forcent au débat prospectif, par exemple sur l’hypothèse d’une « nouvelle forme » confédérale unitaire.
La conquête du collectif a débouché sur l’inévitable rapport du syndicalisme à la société et donc sur le rapport au « projet » (et donc aux partis) politique. Mais la puissance acquise du collectif a aussi reçu pendant des décennies des réponses différentes, selon les pays et leur histoire, à propos de la hiérarchisation entre les types d’organisation. Parti politique voulu et projeté par le syndicalisme lui-même, recherchant au parlement une représentation des travailleurs (Grande-Bretagne) ou, inversement, syndicalisme dominé par le savoir « avant-gardiste » et stratégique du parti (social-démocratie allemande et stalinisme français ou italien) ? L’historien Stéphane Sirot montre que la France, on l’oublie souvent, est riche de toutes ces combinaisons dans l’histoire de son offre syndicale, notamment dans les fédérations professionnelles, comme par exemple celle des mineurs et leur rapport actif à la politique à la fin du 19e siècle (Sirot, 2010). S’y ajoute évidemment l’originalité fondatrice de la charte d’Amiens de la CGT (1906) qui a voulu répondre, en quelque sorte, aux typologies « anglaises » ou « allemandes »en ne choisissant ni l’une ni l’autre ! La charte explique que la besogne est double : « quotidienne et d’avenir ». Ce qui veut dire que le syndicat est certes l’instrument de défense quotidien, mais en même temps prépare l’avenir en remplissant aussi les fonctions d’un « parti ouvrier », en quelque sorte.M ais cela peut aussi signifier que le syndicalisme ne doit pas se confronter au politique, et surtout pas aux partis, puisqu’il est « autonome ». Facteur de tensions à rebondissements multiples, ces questions ont été particulièrement riches en controverses. J’essaie donc de reprendre cette question à bras-le-corps, y compris par un retour utile à la tradition de Marx et de l’Association internationale des travailleurs (où partis et syndicats cohabitaient). Pour conclure, je pose la question suivante : ne faut-il pas, pour l’avenir, « amender » la charte d’Amiens ?
Comment fonder la légitimité du collectif ? Surtout lorsque celui-ci, depuis que l’État reconnaît le fait syndical et le fait social, peut produire des règles ayant force de lois, ce que sont par exemple les conventions collectives. La question est posée dès 1919 : quel syndicat peut être représenté au nouveau Bureau international du travail (BIT) ? C’est l’État qui répond en nommant les « organisations les plus représentatives » (CFTC et CGT pour participer au BIT). Sur cette lancée, l’État a continué en 1945, puis en 1964 (quand il a fallu adjoindre la CFDT à la liste, d’abord contre la CFTC) et à nouveau en 1966 (quand la CFTC est reconnue à nouveau). Jacques Chirac avait également adoubé la FEN comme représentative dans son domaine. Depuis la naissance de nouveaux faits syndicaux (Solidaires, FSU, Unsa), l’État a été avare de nouvelles prises en compte (sauf Édouard Balladur qui a intronisé l’Unsa en 1994 dans le champ de la fonction publique) ; ce système d’octroi par l’État est d’ailleurs contesté par presque tous les acteurs, hormis FO et la CFTC.
Comme le montrent Karel Yon et Sophie Béroud, en donnant une légitimité au syndicalisme par le vote à la base (de type « citoyen » en quelque sorte), comme la loi d’août 2008 l’introduit, on peut très bien distendre encore plus les liens d’organisation sur le terrain, alors qu’on voulait paraît-il les renforcer. Ou peut-être voulait-on au contraire (Nicolas Sarkozy expliquant clairement en 2008, avoir une politique syndicale ; ou François Hollande avec son idée de « constitutionnalisation du dialogue social », la conférence sociale de juillet 2012 débouchant sur l’accord du 10 janvier 2013, brisant le contrat de travail) introniser l’annexion définitive du syndicalisme au jeu contractuel « donnantdonnant », en le rendant prisonnier des rapports de force d’entreprise, là où le patronat règne en maître et où les suffrages exprimés ne peuvent être considérés comme semblables aux joutes politiques « libres » dans l’arène du suffrage universel. Alors piège ou vaste malentendu ? Dans ce cas, comment réagir ?
L’étude approfondie des implications attendues et inattendues de la loi du 20 août 2008 permet aussi de réfléchir à ce qui mériterait d’être changé dans le nouveau dispositif pour renforcer véritablement une activité syndicale militante, non nécessairement indexée à l’activité de négociation. Là encore, c’est le syndicalisme « mouvement social » qui semble avoir été oublié. L’article de ces deux auteurs pousse à ce débat.
Suivent des contributions sur l’unité syndicale et sur l’hypothèse de l’unification syndicale, qui peine à émerger à nouveau comme débat public, tant les dissensions stratégiques sont fortes entre les huit confédérations et fédérations.
Pour autant, même lorsque l’unité d’action tient le haut du pavé – comme en 2006 contre le CPE (avec une victoire à la clé !), au début 2009 contre les premiers effets de la crise (avec une esquisse de plate-forme commune), ou en 2010, contre la réforme des retraites –, aucune voix syndicale forte ne propose d’aller très au-delà de la routine. La CGT poursuit le « rassemblement du syndicalisme ». Solidaires a cependant proposé à l’automne 2008 un débat public sans recevoir de réponse. La FSU n’a pas formulé de nouvelles propositions depuis l’échec du comité de liaison unitaire proposé après 1995. Dans ces quatre tribunes, Gérard Aschieri (ancien secrétaire général de la FSU), Annick Coupé, porte-parole nationale de Solidaires, Maryse Dumas, ancienne secrétaire confédérale de la CGT, et Joël Lecoq, ancien secrétaire général de la FGTE-CFDT, donnent leur point de vue et font des suggestions en répondant à un même petit questionnaire: l’unité d’action, comment ? L’unification est-elle souhaitable et possible ?
Enfin, le rapport du syndicalisme au « travail » doit être distingué du rapport à l’« emploi », quasi exclusif dans une tradition revendicative trop mutilante, mais qui peine aussi à échapper à l’empire des urgences et des détresses. Parmi les bouleversements des vingt ou trente dernières années, la place du travail comme coeur du rapport social capitaliste et carrefour de dominations multiples, mais aussi paradoxalement comme lieu d’émancipation possible, doit être comprise comme un enjeu vital. Si quelqu’un l’a compris, c’est le « capital » qui, dès l’après-68, puis par l’emprise néolibérale, n’a cessé d’inventer de nouvelles méthodes d’assujettissement au travail, tout en affrontant franchement la question du « sens » et en lui donnant sap ropre réponse, non sans faire appel à des ressorts inattendus (l’art, la beauté, la réalisation individuelle, la création, etc.).
La gauche a perdu la première phase de la bataille idéologique sur ce terrain, à tel point qu’un Nicolas Sarkozy a pu sans vergogne en 2007 reprendre à son compte la « valeur travail » et capter l’attention des couches ouvrières les plus
délaissées. Mais des équipes syndicales (notamment CGT, Solidaires, FSU, mais aussi CFDT) ont commencé à réagir, en interaction avec l’interpellation trop longtemps isolée des chercheurs en sociologie, en psychologie sociale et en psychodynamique du travail. La contribution de Tony Fraquelli, syndicaliste cheminot et nouveau diplômé en psychologie du travail, est au coeur de cette réflexion et des contradictions du vécu et du militantisme. Comment un syndicaliste éprouve-t-il le besoin d’un ressourcement des connaissances pour enrichir la problématique syndicale de l’apport des sciences sociales, pour affronter la « résistance du travail concret », ou pour inventer des règles collectives implicites, socialisées de fait mais non discutées ?
Des interrogations croisées sur l’avenir de la CGT terminent ce Cahier, René Mouriaux rebondissant sur un questionnement de l’auteur de ces lignes, qui s’efforce de problématiser les questions lancinantes que beaucoup se posent sur la première confédération : la primauté historique en fait-elle toujours le coeur du syndicalisme ?
Ces contributions sont donc autant d’éclairages pour réfléchir à un projet contemporain de consolidation ou de refondation syndicale, alors même que les formes organisées se multiplient (associations, mouvements), s’interpellent (qui prend en charge quoi ?), voire s’interpénètrent (intégration des thématiques diverses dans un projet qui donne sens ou simple juxtaposition sans point commun évident ?).
La proposition est qu’on peut encore appeler mouvement ouvrier cette force en mouvement qui, malgré les crises de toute nature, se renouvelle sous l’aiguillon du capitalisme… et de l’espérance humaine.
Bloguons « collectif » !
syndicollectif.wordpress.com
Gérard Aschieri, Sophie Béroud, Éric Beynel, Patrick Brody, Annick Coupé, Christophe Delecourt, Tony Fraquelli, Catherine Lebrun, Christian Mahieux, Dominique Mezzi, Jean-Marie Pernot. Jean-Marie Roux, Denis Turbet-Delof, Alain Vrignaud, Karel Yon.
Pour prolonger le travail d’élaboration de ce livre, un blog est proposé. Il s’appelle syndicollectif, clin d’oeil à la revue du même nom qui, pendant dix ans (1986-1996), unissait dans une réflexion commune des syndicalistes CGT, CFDT, FO, FEN puis FSU, SUD et Groupe des Dix puis Solidaires, ainsi que des chercheurs et des universitaires. Ce blog se fixe les buts suivants :
- Nourrir le débat que ce livre entend susciter en offrant un espace de libre expression pour réagir aux différents chapitres, controverser, contre-argumenter, apporter des éclairages supplémentaires ou manquants ;
- Compléter ce qui manque, ou qui n’est que survolé dans l’ouvrage : le rôle des femmes dans le syndicalisme (de la « base » aux « sommets ») et dans les luttes ; le défi de la jeunesse ; la question d’un syndicalisme de couleur et de brassages culturels ; la place des travailleurs immigrés, des chômeurs, des cadres ; les relations du syndicalisme aux autres mouvements sociaux, du local au global ; la lutte contre l’extrême droite…
- Partager des expériences de luttes en problématisant ce qui vient du « terrain » : les élaborations revendicatives, les formes de lutte, les choix démocratiques.
- Argumenter sur le fond et anticiper : où sont passées les revendications de salaire ? Comment remettre à flot la réduction du temps de travail au vu du passif accumulé ? faut-il distinguer travail et emploi ? Comment redonner du souffle à la protectio sociale ? Comment la financer : par le salaire socialisé ou l’impôt ? Quelle industrie, quels services publics ? Comment les défendre et les étendre ? Faut-il renationaliser ? Comment reconvertir des secteurs industriels polluants ? Nous souhaitons que le blog syndicollectif soit utile aux équipes syndicales de toutes appartenances, afin de dialoguer, partager des idées, s’imprégner des cultures militantes diverses, dépasser les frontières d’organisation.
à voir aussi
références
| ⇧1 | D’aucuns confondent cette institutionnalisation avec une bureaucratisation, au sens de formation d’une couche de professionnels qualifiés, dont lagestion procure des avantages matériels et symboliques, au point de se préserver ou se distancier, s’il le faut, du mouvement dérangeant dessalarié·es. |
|---|







