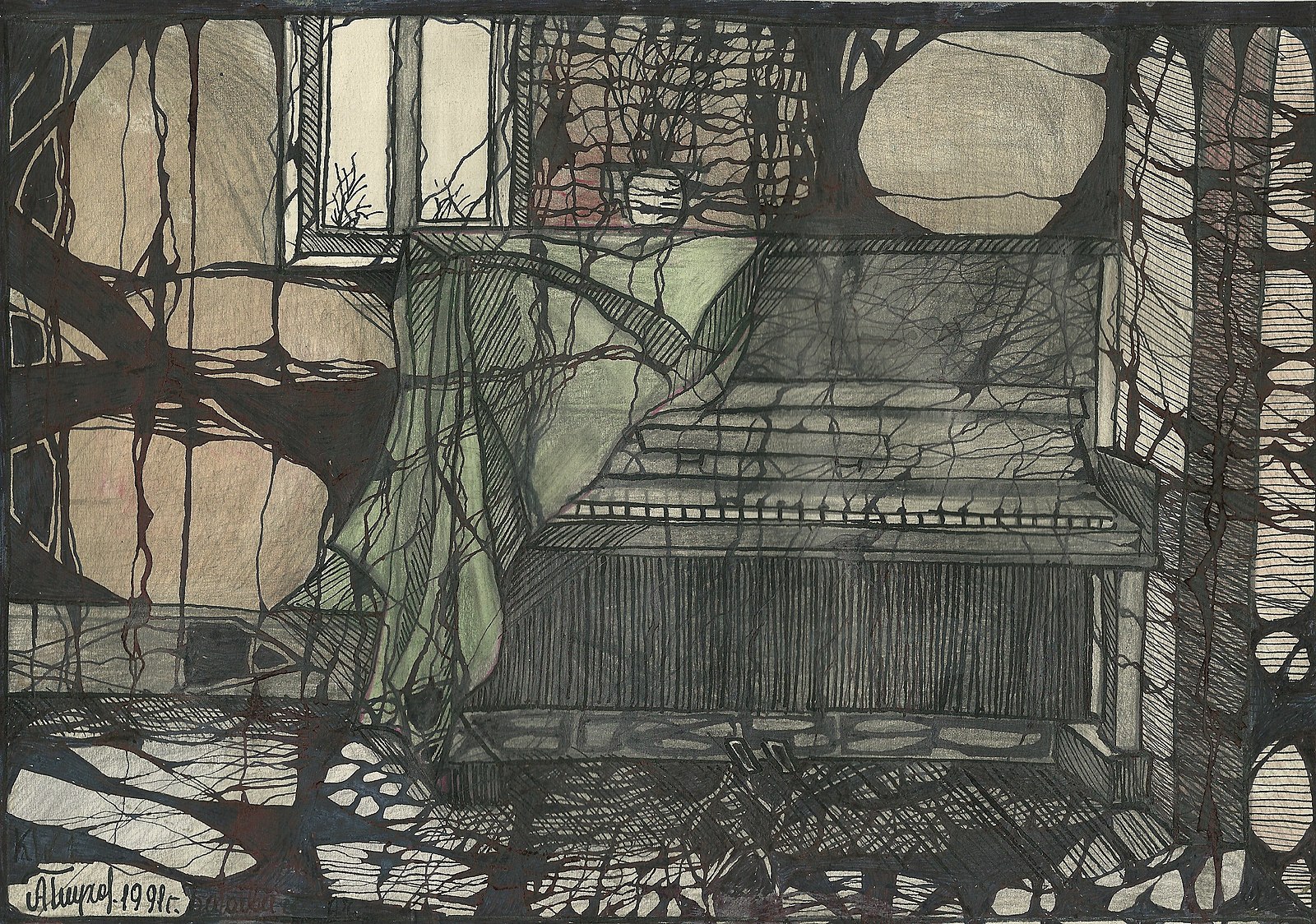
Contre la tyrannie du bonheur
Au cœur du capitalisme dans sa phase néolibérale, le bonheur s’impose comme un outil de marketing et un produit de vente. Des manuels, des techniques managériales et des gourous aux méthodes high tech le pétrissent d’injonctions, de normes de « bien-être » qui se monnaient. Tout cela évidemment ne manque pas d’être adéquat aux besoins du capital : pour une efficacité productive, le sourire est de mise. Cet entretien avec Edgar Cabanas et Eva Illouz, auteurices du livre Happycratie (Premier Parallèle, 2018), montre comment le bonheur est devenu une marchandise.
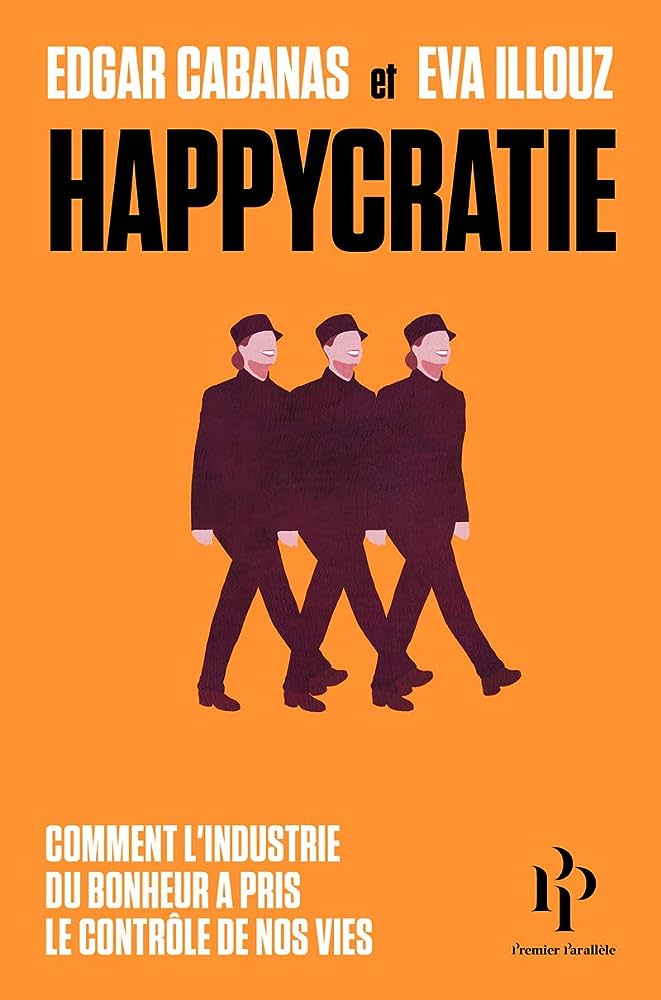
Les gourous de l’entraide et les psychologues positifs nous disent que nous devrions nous entraîner au bonheur. Les sourires peints qu’ils veulent nous vendre sont un substitut pathétique à l’amélioration réelle de nos sociétés.
Le bonheur semble être une bonne chose. En effet, de nombreuses personnes sont prêtes à nous le vendre. L’industrie des livres, conférences et vidéos de développement personnel, qui représente 12 milliards de dollars par an, nous parle des petits changements que nous pouvons tous faire pour parvenir à l’insaisissable existence heureuse, de la visualisation du succès futur à la perte de poids, en passant par le nettoyage de nos chambres.
Depuis la fin des années 1990, cette industrie s’est dotée d’un pendant prétendument scientifique : la « psychologie positive » promue par l’ancien président de l’American Psychological Association, Martin Seligman. Ses idées sur l' »optimisme acquis », ainsi que des concepts tels que la « pleine conscience », font désormais partie des idées de bon sens sur la manière d’améliorer notre existence.
Certains de ces discours sont assez cultissimes et ressemblent plutôt à un appel à avaler les réalités dont nous ne sommes pas très satisfaits. Il suggère que nos problèmes sont tous dans notre tête, tout comme la voie à suivre pour devenir de meilleures personnes. Il n’est donc pas étonnant qu’elle soit de plus en plus utilisée sur les lieux de travail pour nous faire sourire en faisant ce qu’on nous dit de faire.
Eva Illouz et Edgar Cabanas sont les auteurs du livre Happycratie. Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, qui étudie comment les nouvelles disciplines de l' »économie du bonheur » et de la « psychologie positive » fonctionnent comme de nouveaux mécanismes de contrôle social. David Broder, de la revue Jacobin, s’est entretenu avec eux sur le culte du « bonheur », le type de citoyen.es qu’il nous fait devenir et les effets plutôt moins heureux du nouvel individualisme. Nous vous proposons une traduction de cet entretien.
***
DAVID BRODER : L’un des thèmes clés du livre est l’autodiscipline individuelle inhérente au culte du « bonheur », -en fait, l’idée que la seule façon d’améliorer notre vie est de travailler à produire de meilleures versions de nous-mêmes. Dans quelle mesure cette idée est-elle nouvelle d’un point de vue historique ?
EDGAR CABANAS ET EVA ILLOUZ : C’est du vieux vin dans de nouvelles bouteilles. En effet, le nouveau culte du bonheur pourrait n’être rien de plus que le vieux culte de l’individu autodidacte, déguisé en science positiviste et doté de prétentions neutres et universalistes. Il s’agit d’une idée issue d’une longue tradition, profondément convaincue que le bonheur et la souffrance, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie sont des propriétés individuelles et que les clés du succès résident dans la capacité des individus à se prendre en main, à devenir plus forts dans l’adversité et à développer leur potentiel intérieur.
Cette idée a été diffusée par de puissantes institutions conservatrices, la culture d’entreprise et la littérature d’entraide tout au long du XXe siècle, mais aussi, à partir des années 1960, par des penseurs néolibéraux, en particulier aux États-Unis. Le domaine de la psychologie positive est l’un des représentants les plus récents de cette tradition individualiste.
Toutefois, l’apparition de ce domaine il y a deux décennies a véritablement changé la donne, car pour la première fois, toutes ces hypothèses semblaient acquérir une légitimité scientifique. C’est peut-être la seule véritable nouveauté. Mais cela implique également une différence critique, non seulement parce que ces idées et d’autres similaires ont fait leur entrée en force dans le monde universitaire, devenant ainsi un sujet de recherche scientifique, mais aussi parce que la recherche du bonheur est rapidement passée d’une devise politique et idéologique presque exclusivement étatsunienne à une prétendue question « scientifique » d’importance mondiale.
Néanmoins, la science qui sous-tend la psychologie positive a été sérieusement remise en question. De nombreux et importants détracteurs ont contesté les hypothèses fondamentales du domaine, notamment ses affirmations décontextualisées et ethnocentriques, ses simplifications théoriques excessives, ses tautologies et ses contradictions, ses lacunes méthodologiques, ses graves problèmes de reproductibilité, ses généralisations exagérées, et même son efficacité thérapeutique et son statut scientifique. Il devient donc de plus en plus évident que la psychologie positive n’aurait pas pu prospérer sur la base de sa seule science. C’est l’une des raisons pour lesquelles, dans ce livre, nous nous attachons à fournir une explication sociologique et économique au succès généralisé de ce domaine et de ses idées.
DAVID BRODER : Vous décrivez la montée en puissance d’instruments tels que le rapport mondial sur le bonheur des Nations Unies ou l’initiative « Une vie meilleure » de l’OCDE, qui cherchent à fournir des indices du bonheur humain dans divers domaines. Ces initiatives peuvent être perçues comme un moyen d’élargir les indicateurs utilisés pour orienter les priorités politiques, au-delà des indicateurs étroitement économiques tels que les chiffres du PIB. En quoi ces rapports sont-ils eux-mêmes « idéologiques » ? Le problème réside-t-il dans les indicateurs spécifiques sur lesquels ils s’appuient ou dans l’idée même d’indicateurs objectifs et universels du bonheur ?
EDGAR CABANAS ET EVA ILLOUZ : Les deux. Tout d’abord, l’affirmation des scientifiques du bonheur selon laquelle le bonheur est un bien évident, ainsi que l’objectif le plus crucial à poursuivre pour toute société, est posée plutôt que prouvée, une hypothèse purement idéologique et utilitaire plutôt qu’un fait scientifique. Il n’existe aucun moyen de prouver une telle affirmation, il suffit donc d’y croire. Il est également nécessaire de tenir pour acquis que le bonheur est une question subjective, psychologique, indépendante d’autres indices sociaux et économiques. C’est une façon très individualiste de conceptualiser le bonheur et c’est précisément le cadre dans lequel le bonheur est « mesuré ».
Il n’est pas surprenant que les experts du bonheur constatent régulièrement qu’en dépit d’autres facteurs socio-économiques et politiques, l’individualisme est la variable la plus fortement liée au bonheur. Mais qu’est-ce que le bonheur ? Ils ne le définissent jamais. Apparemment, le bonheur est ce que mesurent les questionnaires de bonheur et les items de ces questionnaires de bonheur ne concernent que les sentiments, les attitudes et les perceptions, et non les conditions sociales ou économiques.
En ce qui concerne leurs méthodes, les scientifiques du bonheur s’appuient principalement sur des auto-évaluations pour mesurer le bonheur, c’est-à-dire qu’ils demandent aux gens s’ils se sentent heureux. Ces auto-évaluations posent plusieurs problèmes. Par exemple, il n’est pas certain que les mesures du bonheur soient comparables entre les individus, entre les nations ou même entre un même individu à des périodes différentes.
Comment savoir si la note de 7 sur 10 obtenue par une personne dans un questionnaire sur le bonheur est équivalente à la note de 7 sur 10 obtenue par une autre personne ? Comment savoir si la note de 7 obtenue par un Irlandais est supérieure ou inférieure à la note de 6 ou 8 obtenue par un Cambodgien ou un Chinois ? Quel est le degré de bonheur d’une personne ayant obtenu un score de 5 par rapport à une personne ayant obtenu un score de 3 ? Que signifie un score de 10 en matière de bonheur ?
Un autre problème est que cette méthodologie limite considérablement l’éventail des réponses informatives que les gens peuvent fournir lorsqu’ils évaluent leur bonheur. Ce point est important car les réponses fermées peuvent non seulement favoriser un biais d’auto-confirmation de la part des chercheurs, et des chercheuses mais aussi négliger des informations importantes lorsqu’il s’agit d’utiliser ces indices de bonheur pour prendre des décisions politiques.
Les indices de bonheur sont également idéologiques dans la manière dont ils sont utilisés. Comme nous le montrons dans ce livre, ces indices ont souvent servi d’écrans de fumée pour dissimuler des déficiences politiques et économiques importantes et structurelles, c’est-à-dire pour détourner l’attention d’indicateurs socio-économiques de bien-être plus objectifs et plus complexes tels que la redistribution des revenus, les inégalités matérielles, la ségrégation sociale, l’inégalité entre les sexes, la santé démocratique, la corruption et la transparence, les opportunités objectives par rapport aux opportunités perçues, les aides sociales ou les taux de chômage.
Nous illustrons ce point avec les exemples du Royaume-Uni, du Chili, de l’Inde, d’Israël et des Émirats Arabes Unis (EAU). Dans ce dernier cas, il est très révélateur qu’un pays caractérisé par une pauvreté généralisée, des violations constantes des droits de l’homme et des taux élevés de malnutrition, de mortalité infantile et de suicide ait adopté des « mesures du bonheur » en tant qu’initiative politique de premier plan, afin d’évaluer l’impact de ses politiques nationales. C’est peut-être parce que les Émirats Arabes Unis obtiennent de bien meilleurs résultats dans les classements sur le bonheur que dans les autres facteurs susmentionnés : selon le World Happiness Report, ils figurent parmi les vingt pays les plus heureux du monde. Si le bonheur était conceptualisé et mesuré différemment, le résultat serait tout autre.
Ces indices ont également été utilisés pour régler des questions politiques et économiques délicates d’une manière prétendument non idéologique. L’inégalité est l’un des exemples les plus récents et les plus frappants : certains défenseurs du bonheur affirment que l’inégalité des revenus pourrait être plus bénéfique pour le bonheur des gens qu’on ne le pensait auparavant. L’inégalité s’accompagnerait non pas d’une diminution des opportunités, mais d’un « facteur d’espoir » selon lequel les pauvres percevraient la réussite des riches comme un signe avant-coureur d’opportunités. Cela augmenterait leur espoir et leur bonheur, ce qui serait lié à la plus grande motivation des pauvres à s’épanouir.
Comment ne pas y voir une affirmation idéologique basée sur des hypothèses idéologiques ? Apparemment, ces affirmations sont étayées par des données. Cependant, comme Betsy Stevenson et Justin Wolfers l’ont montré à propos de la relation entre le bonheur et le revenu, le même corpus de données peut donner lieu à de nombreuses interprétations différentes et peut même conduire à des résultats opposés.
En fin de compte, le principal problème des indices de bonheur n’est pas qu’ils sont idéologiques, il est certain que tout indice visant à mesurer le progrès est idéologique, à commencer par la notion même de progrès ; le principal problème est que les indices de bonheur tentent d’agir comme des critères objectifs et neutres dépourvus de contenu moral, politique ou idéologique. Comme nous le montrons dans ce livre, cette prétendue neutralité doit être rejetée.
DAVID BRODER : Le livre évoque l’avènement de la psychologie positive à la fin des années 1990, sous l’impulsion du président de l’American Psychological Association Martin Seligman : un projet que vous décrivez en termes d’épiphanie, d’apôtres, de révélation et de « born again« (nouvelle naissance). Son développement est également lié à l’essor des livres d’auto-assistance et à diverses idées sur la réalisation de son propre potentiel. Qu’est-ce que la psychologie positive et l’industrie du développement personnel ont en commun avec les sectes et l’évangélisme religieux ? Que penser de sa prétention « scientifique » à étendre la psychologie au-delà du seul terrain de la maladie mentale ?
EDGAR CABANAS ET EVA ILLOUZ : Bien que les psychologues positifs se soient efforcés à plusieurs reprises de minimiser leur ethnocentrisme et leurs racines spirituelles, la vérité est que leurs liens institutionnels et leurs revendications révèlent de profonds présupposés spirituels et religieux.
Aucune autre institution, comme la Fondation John Templeton, fondée en 1978 par un ancien presbytérien, un investisseur en bourse et un philanthrope, Sir John Templeton, n’a plus activement plaidé en faveur du rapprochement de la science et de la religion, une quête dans laquelle Templeton lui-même a investi des centaines de millions de dollars. L’implication financière de Templeton dans la fondation et la diffusion de la psychologie positive a été cruciale.
À elle seule, sa Fondation a investi des dizaines de millions de dollars dans les programmes de recherche de la psychologie positive pour l’étude de la santé positive, de l’éducation positive, de la résilience et de la pleine conscience ; des neurosciences positives, de la transcendance et de la spiritualité ; de l’espoir et du pardon ; ou du pouvoir de la volonté et de la persévérance dans la réalisation d’un objectif, pour n’en citer que quelques-uns. Martin Seligman lui-même a reconnu à plusieurs reprises le rôle crucial de la Fondation Templeton dans le succès de la psychologie positive.
Cela comprend la création du Positive Psychology Center en Pennsylvanie, la création d’un réseau institutionnel mondial de revues et de publications scientifiques, de programmes de doctorat et de maîtrise, de cours spécialisés en psychologie positive, de symposiums et d’ateliers, ainsi que de bourses et de prix généreux pour les jeunes chercheurs.ses et les chercheurs.ses confirmé.es,, sous le nom de Templeton Prize for Positive Psychology, considéré comme le prix le plus important d’un point de vue financier jamais décerné en psychologie.
Dans cette ligne, par exemple, l’un des principaux axes de recherche du Positive Psychology Center, coordonné par Martin Seligman et développé par George Vaillant, avait deux objectifs principaux. Premièrement, combiner l’intégration des résultats de l’anthropologie culturelle, de l’imagerie cérébrale et de l’évolution avec l’étude des vies individuelles qui reflètent une composante profondément spirituelle et deuxièmement, s’interroger sur le rôle de la spiritualité dans une vie réussie. De nombreux autres psychologues positifs ont activement défendu la relation entre la spiritualité, la santé et le bonheur.
Par exemple, dans son livre The How of Happiness : A New Approach to Getting the Life You Want, Sonja Lyubomirsky affirme que les personnes religieuses sont plus heureuses, en meilleure santé et se remettent mieux des traumatismes que les personnes non religieuses. Lyubomirsky ne tient pas compte des preuves que le plus grand bonheur des personnes religieuses est lié au soutien mutuel, au sens de la communauté ou aux soins institutionnels, et défend la spiritualité et la religion comme une question individuelle, affirmant que le simple fait d’avoir une foi religieuse augmentera la santé et le bonheur des gens.
Dans le même ordre d’idées, il n’est pas surprenant que des exercices tels que compter les bénédictions, écrire des lettres de pardon, exprimer sa gratitude ou pratiquer régulièrement la méditation figurent parmi les conseils de psychologie positive les plus récurrents, proposés à la fois comme des remèdes aux problèmes des gens et comme des clés psychologiques pour mener une vie plus épanouissante et réussie. Il ne s’agit là que de quelques exemples, mais il y en a beaucoup d’autres. On trouve également des affirmations similaires dans la littérature d’entraide.
DAVID BRODER : Vous citez Margaret Thatcher pour dire que le néolibéralisme n’est pas seulement un projet économique, mais qu’il utilise l’économie pour remodeler l’esprit et le cœur des gens. En effet, l’idée d’ « auto-assistance » semble être une idéologie puissamment individualisante, qui renvoie à l’individu la responsabilité de ses chances et de ses choix dans la vie ; si nous sommes malheureux, ce n’est pas la faute de la société, mais la nôtre.
Quels sont les liens entre l’économie du bonheur, la psychologie positive et l’industrie de l’entraide, d’une part, et les forces politiques organisées, par exemple les groupes de réflexion et les unités politiques néolibérales, d’autre part ?
EDGAR CABANAS ET EVA ILLOUZ : Il existe deux liens principaux. Le premier est politique et tient au fait que de nombreux psychologues positifs et économistes du bonheur, y compris, bien sûr, leurs figures de proue, ne sont pas de simples chercheurs, mais occupent des postes importants de pouvoir et d’influence. Et pas seulement dans le monde universitaire, mais aussi dans des institutions économiques et sociales influentes du monde entier. D’autres sont fréquemment sollicités en tant que conseillers principaux dans les domaines de l’économie et de l’éducation. D’autres encore sont sollicités par de grandes entreprises, et certains ont même mené des initiatives très médiatisées au sein de l’armée des États-Unis.
La seconde est d’ordre idéologique. Prenons l’exemple du domaine de l’éducation. L’éducation positive repose sur deux préceptes principaux et interdépendants : premièrement, la promotion des « compétences psychologiques pour le bonheur » chez les jeunes est non seulement un objectif souhaitable en soi, mais aussi le moyen le plus important de prévenir les maladies mentales, d’améliorer l’apprentissage et de favoriser la réussite scolaire ; deuxièmement, les facteurs psychologiques sont des facilitateurs et des obstacles à la réussite scolaire plus fondamentaux que les facteurs sociologiques ou contextuels.
Entre 2008 et 2018, l’éducation positive s’est progressivement imposée comme une priorité éducative majeure dans de nombreux pays du monde. Un nombre croissant d’associations privées et publiques, de groupes de réflexion, de consultants et de réseaux mondiaux ont vu le jour pour persuader les décideurs politiques de modifier leurs cadres politiques afin que les praticiens soient encouragés à éduquer au caractère et au bien-être dans le monde entier. C’est, par exemple, l’objectif du Réseau International d’Éducation Positive, créé en 2014.
De telles initiatives ont besoin d’un soutien scientifique et le rôle des psychologues positifs et des économistes du bonheur a été crucial à cet égard. Ces derniers ont soutenu que l’éducation positive implique un changement révolutionnaire dans la manière dont les étudiant.es devraient être éduqué.es, en avançant le raisonnement selon lequel l’éducation axée sur le bonheur s’avère être non seulement une bonne éducation, mais aussi une bonne économie. Ils affirment que la réorientation des établissements d’enseignement vers l’éducation positive, en changeant les attitudes des enseignant.es, des élèves et des parents, permettrait de prendre des initiatives moins coûteuses pour résoudre les problèmes d’éducation. Les psychologues positifs soutiennent que le bonheur devrait être enseigné dans les établissements d’enseignement comme antidote à la dépression, comme moyen d’accroître la satisfaction dans la vie et comme aide à une pensée plus créative.
Certes, aucune preuve scientifique ne vient étayer les affirmations selon lesquelles l’éducation positive contribue à élever les normes éducatives, notamment en améliorant les résultats et l’apprentissage des élèves. Au contraire, de nombreux examens critiques, rapports et méta-analyses soulignent les limites et les problèmes graves de l’éducation positive en ce qui concerne les lacunes théoriques et méthodologiques, le manque de reproductibilité et d’études comparatives, l’insuffisance des preuves empiriques ou les résultats médiocres, voire contre-productifs. Une fois de plus, il semble donc que le succès de ces idées soit davantage lié à des questions idéologiques qu’à la qualité de la recherche.
DAVID BRODER : Vous évoquez la formule du bonheur postulée par Seligman, selon laquelle les facteurs génétiques sont décisifs à 50 % dans la détermination de notre bonheur, 40 % seraient dûs à des facteurs cognitifs et émotionnels et à nos propres choix et seulement 10 % à d’autres facteurs externes comme l’éducation et les ressources matérielles.
Cela nie évidemment l’importance des conditions sociales dans la formation de notre bonheur. Mais qu’en est-il du fondement idéologique de cette formule, qui attribue une telle importance non seulement à nos choix subjectifs, mais aussi à notre patrimoine génétique ?
EDGAR CABANAS ET EVA ILLOUZ : Le temps a prouvé que cette soi-disant formule n’a aucune validité scientifique. Même les psychologues positifs se sont rétractés.
D’une part, le fait d’associer le bonheur à la constitution génétique des individus a permis non seulement de conférer aux études sur le bonheur le vernis d’une science dure et positive, mais aussi de différencier ce que le domaine pouvait offrir de ce que faisaient les auteurs et autrices d’ouvrages de développement personnel et autres expert.es du bonheur (par exemple, les coachs et les conférenciers motivateurs).
D’autre part, l’association du bonheur aux gènes n’était qu’une autre façon de souligner l’idée principale, à savoir que les facteurs non-individuels jouent un rôle plutôt insignifiant dans le bien-être d’une personne (environ 10 %). En effet, minimiser, quand ce n’est pas tout simplement négliger, le rôle que les circonstances objectives peuvent jouer dans la détermination du bonheur des gens a été l’une des caractéristiques de la discipline depuis sa fondation.
Cependant, si ce que les psychologues positifs affirment est vrai, une conclusion directe s’impose : pourquoi alors blâmer les structures sociales, les institutions ou les mauvaises conditions de vie pour les sentiments de dépression, de détresse ou d’anxiété face à l’avenir ? Pourquoi même reconnaître que des conditions de vie privilégiées contribuent à expliquer pourquoi certaines personnes se portent et se sentent mieux que d’autres ? Serait-ce une autre façon de justifier l’hypothèse méritocratique selon laquelle, en fin de compte, chacun reçoit ce qu’il mérite ? Après tout, les variables non individuelles étant presque entièrement éliminées de la formule, quoi d’autre que le mérite, l’effort et la persévérance des individus pourrait être tenu pour responsable de leur bonheur ou de leur absence de bonheur ?
DAVID BRODER : Vous parlez de « capital psychologique » et de l’injonction à maintenir un optimisme constant pour progresser en tant qu’ « auto-entrepreneur ». Mais s’il s’agit là de forces disciplinaires, cherchant à façonner des citoyens néolibéraux qui ne se voient que comme des individus sur le marché. Avons-nous besoin d’autres formes d’optimisme collectif, comme la croyance, défendue historiquement par le mouvement socialiste, que nous pouvons en effet choisir la voie du bonheur, mais pas sur une base individuelle ? Ou faut-il faire une critique plus générale de l’objectif du bonheur lui-même ?
EDGAR CABANAS ET EVA ILLOUZ : L’un des principaux domaines que nous développons dans le livre est la relation entre le bonheur, le management, l’esprit d’entreprise et le travail. Nous développons l’argument selon lequel le bonheur est devenu une stratégie utile pour justifier les hiérarchies organisationnelles implicites de contrôle et de soumission à la culture d’entreprise.
Alors que les lieux de travail promettent plus d’autonomie et d’émancipation par rapport au contrôle de l’entreprise, un examen plus approfondi des réalités organisationnelles montre que la promotion du « bonheur au travail » s’est avérée particulièrement efficace pour faire précisément le contraire. Le bonheur au travail s’est en effet avéré utile pour faire descendre la responsabilité vers le bas, rendant ainsi les employé.es plus responsables de leurs propres succès et échecs, ainsi que de ceux de l’entreprise.
Le bonheur au travail s’est également avéré pratique pour obtenir davantage d’engagement et de performances de la part des travailleurs.ses souvent pour des récompenses relativement moindres ; pour mettre de côté l’importance des conditions de travail objectives lorsqu’il s’agit de la satisfaction au travail, y compris les salaires ; ou pour encourager les employé.es à agir de manière autonome tout en étant obligé.es de se conformer aux attentes de l’entreprise, de s’identifier aux valeurs de l’organisation et de faire preuve d’acquiescement et de conformité à l’égard des normes de l’entreprise.
Plus important encore, le bonheur au travail s’est avéré utile pour rendre les contradictions professionnelles et l’auto-exploitation plus tolérables et même acceptables pour les employé.es. Aujourd’hui, on n’attend pas seulement des travailleurs.ses qu’ils et elles s’adaptent par leurs propres moyens aux exigences et aux besoins en constante évolution de l’entreprise, faisant face personnellement aux circonstances défavorables, aux revers inévitables et aux charges de travail plus lourdes, et qu’ils et elles adoptent un rôle plus actif, plus créatif et plus autonome dans l’accomplissement de leurs tâches.
On attend également des travailleurs.ses un amour pour leur travail le considérant non pas comme une nécessité, mais comme une source de plaisir et d’épanouissement personnel. Cependant, alors que les travailleurs.ses ne semblent pas avoir tiré de grands bénéfices de la promotion du bonheur au travail, celle-ci s’est certainement avérée bénéfique pour les organisations.
Certes, ce qui rend les entreprises heureuses n’est pas forcément la même chose que ce qui rend les travailleurs.ses heureux.ses. Cela ne signifie pas que les entreprises ne se soucient pas de leurs employé.es, mais il serait naïf de penser que les mécanismes de contrôle ont disparu dans la sphère organisationnelle : ils ont simplement été internalisés.
Cela dit, et tout bien considéré, s’il s’avère finalement que le bonheur est cette chose que les entreprises, les faiseurs de revendications néolibérales et l’énorme industrie du bonheur trouvent si utile à leurs fins, alors la réponse à la question est que la poursuite du bonheur pourrait nous coûter trop cher, puisqu’il est très probable que tôt ou tard, elle se retourne contre les plus vulnérables. Néanmoins, si le bonheur n’est pas cela et il s’avère que les entreprises, les faiseurs de revendications néolibérales et l’industrie du bonheur se sont approprié le mot à leur profit, nous suggérons non pas d’abandonner le bonheur, mais de repenser le terme dans une perspective plus sociale et culturelle.
Nous avons certainement besoin d’espoir et d’objectifs qui valent la peine d’être poursuivis, mais sans l’optimisme abrutissant, tyrannique, conformiste et presque religieux qui accompagne le bonheur. Nous avons besoin d’un bonheur fondé sur l’analyse critique, la justice sociale et l’action collective, qui ne soit pas paternaliste, qui ne décide pas à notre place de ce qui est bon pour nous et qui ne se retourne pas contre les plus vulnérables. Nous avons besoin d’un bonheur qui ne consiste pas à être obsédé par notre intériorité et notre moi intérieur, parce que l’intériorité n’est pas l’endroit où nous voulons construire et passer notre vie et ce n’est certainement pas l’endroit d’où nous pourrons réaliser des changements sociaux significatifs non plus.
*
Cet entretien a été publié par Jacobin et traduit en français par Christian Dubucq pour Contretemps.
Edgar Cabanas est titulaire d’un doctorat en psychologie de l’Université Autonome de Madrid. Il est actuellement chercheur postdoctoral « Tomás y Valiente » à l’Université Autonome de Madrid (UAM) et au Madrid Institute of Advanced Studies (MIAS). Eva Illouz est sociologue et directrice d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris.
David Broder est rédacteur en chef de la revue Jacobin pour l’Europe et historien du communisme français et italien.







