
Donner du temps aux hommes, et rien de plus ?
À propos de : La journée de travail et le ″règne de la liberté″ d’Olivier Besancenot et Michael Löwy, Paris, Fayard, 2018.
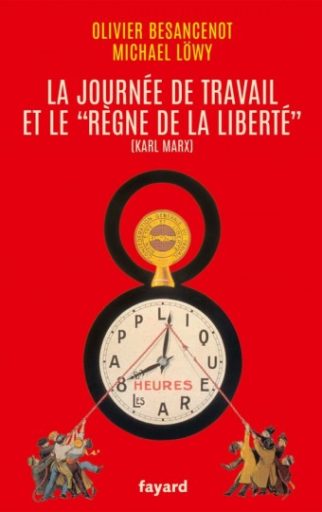
J’appartiens à la même famille de pensée qu’Olivier Besancenot et Michael Löwy, celle du marxisme libertaire et non dogmatique auquel ils ont consacré un récent ouvrage[1]. Nous partageons la confiance dans la créativité populaire, l’égalité des intelligences et la démocratie réelle, la méfiance envers l’État et le marché, l’engagement pour un écosocialisme autogestionnaire et féministe. Je crois aussi, comme ils le font dans leur dernier livre commun[2], que la gauche radicale doit brandir haut le drapeau de la liberté, trop souvent abandonné aux soi-disant « libéraux ». Je suis pourtant en profond désaccord avec la thèse principale de leur livre, celle d’une supposée contradiction entre travail et liberté qui ferait de la réduction du temps de travail la clé de l’émancipation. Olivier et Michael confirmant à mes yeux le sous-titre de mon récent livre[3], je voudrais ici montrer les risques politiques qu’il y a à opposer travail et liberté.
Dans le titre de l’ouvrage, La journée de travail et le ″règne de la liberté″, les guillemets renvoient à la célèbre citation de Marx dans le Capital, qu’il importe de rappeler d’emblée :
« le règne de la liberté commence seulement là où finit le travail déterminé par le besoin et les fins extérieures : par la nature même des choses il est en dehors de la sphère de la production matérielle. La liberté dans ce domaine ne peut consister qu’en ceci : l’être humain socialisé, les producteurs associés, règlent rationnellement ce métabolisme avec la nature, le soumettant à leur contrôle collectif, au lieu d’être dominé par lui comme par un aveugle pouvoir ; ils l’accomplissent avec les efforts les plus réduits possibles, dans les conditions les plus dignes de leur nature humaine et les plus adéquates à cette nature. C’est au-delà de ce règne que commence le développement des puissances de l’être humain, qui est à lui-même sa propre fin, qui est le véritable règne de la liberté, mais qui ne peut s’épanouir qu’en s’appuyant sur ce règne de la nécessité. La réduction de la journée de travail est la condition fondamentale ».
Nécessité contre liberté ?
Selon Besancenot et Lowy (B&L par la suite),
« Marx distingue donc deux domaines de la vie sociale, le ″règne de la nécessité″ et le ″règne de la liberté″ : à chacun correspond une forme de liberté » (p. 16).
« Par la nature même des choses », comme dit Marx, dans le « règne de la nécessité », le travail est « déterminé par le besoin et des fins extérieures » : on ne travaille pas pour le plaisir ni par libre choix mais pour produire des biens et des services nécessaires à la survie humaine. Dans cette sphère, une première forme de liberté peut exister, mais, nous disent B&L,
« c’est une liberté limitée, prise dans le cadre des contraintes imposées par la nécessité : il s’agit du contrôle démocratique, collectif, des êtres humains socialisés sur leurs échanges matériels – leur « métabolisme » – avec la nature. En d’autres termes ce dont Marx nous parle ici est la planification démocratique » (p. 16).
Il s’agit donc d’une liberté essentiellement négative, celle de ne pas être dominé par les forces du marché. Puisque le travail est déterminé par le besoin, la liberté dans la sphère de la production ne peut pas consister à l’organiser librement mais seulement à décider démocratiquement ce qu’on va produire plutôt que de laisser faire la loi du profit. La liberté de décider des finalités du travail, mais pas la liberté dans le travail.
B&L hésitent néanmoins devant la radicalité de cette thèse, qui contredit manifestement leur expérience personnelle de travailleurs intellectuels. C’est sans doute pourquoi ils introduisent une curieuse exception à la règle de l’antagonisme entre travail et liberté :
« certaines formes de libre activité peuvent être considérées comme une sorte de ‘travail’ : faire de la théorie ou créer une œuvre d’art ; si elles appartiennent au ″royaume de la liberté″ c’est parce qu’aucune contrainte extérieure ne les détermine » (p. 23).
Voilà qui laisse perplexe : le théoricien ou l’artiste ne sont-ils vraiment déterminés par « aucune contrainte extérieure », pas même les propriétés de la matière qu’ils manipulent ou les règles de leur métier – quand bien même ils maltraiteraient les unes ou les autres ? Et si Marx ou Van Gogh ne travaillaient pas, en effet (et ils en ont payé le prix !), pour satisfaire un patron ou un marché, peut-on en dire autant de chercheurs comme Jean Tirole (« prix Nobel » d’économie) ou d’artistes comme Jeff Koons (pitre de l’art contemporain) ? La liberté est-elle vraiment « l’absence de toute contrainte extérieure » ? « Nécessité » et « liberté » sont-elles si radicalement incompatibles ? Les artistes et les théoriciens sont-ils les seuls travailleurs qui déploient autonomie et inventivité dans leur travail ?
On voit bien la fragilité de ces assertions. Pourtant elles sont nécessaires pour considérer, comme le dit Marx, et à sa suite Besancenot et Lowy, que la vraie liberté ne peut s’épanouir qu’hors de la nécessité et donc du travail. Le « règne de la liberté » ne commencerait donc que quand
« les êtres humains pourront développer toutes leurs potentialités par des activités dont le seul objectif est l’épanouissement humain », puisque « l’objectif ultime du communisme » serait « la libre disposition du temps pour des activités qui ne sont plus un moyen mais une fin en soi » (p. 23).
L’abolition de la nécessité, rendue possible par les progrès de la science et de la technique qui « font jaillir avec abondance les sources de la richesse collective » (Marx) : n’est-ce pas une perspective bien contradictoire avec ce que nous savons désormais du caractère fini des ressources et de la fragilité des écosystèmes, qui nécessitent absolument qu’on en prenne soin ?
« Travailler moins pour vivre plus »
B&L rappellent les descriptions terribles que Marx et Engels donnaient de la condition salariale au XIXème siècle, les bagnes-usines, le travail des femmes et des enfants jusqu’à ce que mort s’ensuive : l’organisation capitaliste du travail faisait des usines un lieu d’« immolation d’hommes », de « tortures de l’enfer ». Ils évoquent aussi nos temps modernes, avec les 500 morts par an du fait d’accidents du travail, l’intensification du travail, l’épidémie de troubles musculo-squelettiques et de problèmes de santé mentale, le management néolibéral et la précarisation. Ils moquent « l’adaptation patronale du slogan ″le travail c’est la santé″ qui tourne en boucle sur les ondes, tel un lointain écho des devises du sinistre ministère de la propagande du roman de George Orwell 1984, proclamant ″la guerre c’est la paix″; ″la liberté c’est l’esclavage″; ‘l’ignorance c’est la force’ ” (p. 111).
Face au travail mortifère la priorité absolue est la lutte pour réduire sa durée :
« chaque heure de vie gagnée par le travailleur sur le capital est une avancée de la liberté humaine, une victoire contre la dictature du capital, une brèche ouverte dans les murs de la prison usine, un grain de sable dans les engrenages de l’esclavage salarié » (p. 40).
Un chapitre est dédié à l’évocation, illustrée par une riche iconographie, de deux siècles d’incessantes luttes ouvrières pour la réduction de la journée de travail.
Certes, reconnaissent-ils, le temps ainsi libéré n’est pas nécessairement émancipateur :
« le temps libre dans les limites du capitalisme est un temps souvent manipulé par les puissances marchandes, un temps contrôlé, domestiqué, aliéné, corrompu. Du point de vue capitaliste, les ‘activités de loisir’ – ou comme le disait Erich Fromm les ‘passivités de loisir’ – n’ont qu’une seule fonction : la consommation » (p. 41).
Mais, ajoutent-ils, « comme le montre l’histoire du mouvement ouvrier, le temps libre ne contient pas moins le potentiel d’une auto-affirmation du travailleur, dans la vie quotidienne, dans l’amour, dans l’auto-organisation, dans la lutte ».
Et citant Dionys Mascolo,
« la seule fin du mouvement communiste c’est de donner du temps aux hommes. Et rien de plus. Et sans se demander à l’avance, sans leur demander à quoi ils l’emploieront » (p. 25).
La réduction du temps de travail est donc à la fois le moyen et la finalité de la lutte pour la liberté :
« c’est précisément dans le combat des travailleurs pour réduire la durée de leur journée d’esclavage salarié que sont semées les graines du futur émancipé » (p. 51).
En une formule,
« la devise de la société éco-communiste de l’avenir sera: ‘travailler moins pour vivre plus’ » (p. 33).
Mais cette devise définit-elle vraiment un horizon émancipateur ?
L’ambivalence du travail
Personne ne nie, bien sûr, que la réduction du temps de travail, la journée de 8 heures, les congés payés, la retraite…, n’aient amélioré de façon décisive la condition salariale. Elles nous ont permis d’échapper à l’envahissement de la vie par le travail aliéné, de dégager du temps pour nous reposer, nous distraire, nous cultiver. Pour autant, si nous avons fait reculer la durée du travail en France de 500 heures depuis 1950[4], sommes-nous aujourd’hui plus libres ? Moins asservis au cycle du capital, moins inquiets pour notre avenir et celui de nos enfants, moins astreints au consumérisme ? Plus combatifs, plus soucieux de solidarité, plus maîtres de notre destin individuel et collectif ? Rien n’est moins sûr. L’équation magique “temps libre = liberté” semble bien trop simpliste. Tout comme celle, en miroir, selon laquelle ″travail = aliénation″.
On trouve en fait chez Marx deux visions antagoniques du travail. Celle que privilégient B&L est bien présente, mais d’autres citations indiquent le caractère potentiellement émancipateur du travail : dans une étonnante anticipation de la dialectique de la souffrance et du plaisir au travail théorisée récemment par Christophe Dejours (cf ci-dessous), Marx observe à la fois que l’activité du travailleur se heurte toujours aux « obstacles à surmonter en fonction du but à atteindre »:
« le renversement de ces obstacles constitue en soi une affirmation de liberté (…), la réalisation de soi, l’objectivation du sujet, donc sa liberté concrète qui s’actualise précisément dans le travail »[5].
Le communisme ne suppose alors pas nécessairement la quasi-disparition du travail, au contraire: « l’épanouissement universel des individus » suppose d’éliminer « l’asservissante subordination des individus à la division du travail et, par la suite, l’opposition entre travail intellectuel et travail corporel » de façon à ce que « le travail (devienne) non seulement le moyen de vivre, mais encore le premier besoin de la vie »[6].
L’ambivalence marxienne reflète l’ambivalence du travail lui-même. En tant qu’il suppose un effort, une confrontation à la résistance du monde, et aussi bien souvent – en particulier sous le capitalisme – une soumission à des rapports de pouvoir, il est d’abord une souffrance. Mais comme le dit Marx, et comme le confirment les sciences du travail[7], il peut aussi permettre, à certaines conditions, la réalisation de soi et l’expérience de la liberté concrète. A cause des liens sociaux et de solidarité qui s’y tissent souvent, à cause aussi de la reconnaissance monétaire ou symbolique qu’on y trouve. Mais surtout, comme le dit Dejours, par
« la mobilisation de l’intelligence, de la créativité, de l’inventivité qui va permettre, souvent, de dépasser la difficulté. Travailler, c’est précisément cela : se confronter à la résistance du réel et trouver des solutions. C’est pourquoi la souffrance est première. Le plaisir vient après. La souffrance peut se muer en plaisir si l’on parvient à surmonter l’obstacle, si l’on parvient à se transformer soi-même pour le dépasser »[8].
Puissance du travail vivant
Des centaines d’études ergonomiques et sociologiques l’ont confirmé: il n’y a pas que les artistes ou les musiciens qui peuvent trouver du plaisir au travail, mais cela arrive aussi, à certaines conditions, à des infirmières, des jardiniers, des auxiliaires de vie, des maçons… ou des facteurs. Ces études ont surtout établi l’écart irréductible entre travail prescrit et travail réel: quelle que soit l’organisation du travail, le capital doit quand même mobiliser “l’intelligence, la créativité, l’inventivité”, bref le travail vivant. Aussi rigoureuses que prétendent être la prescription, les consignes, les procédures, aussi étroit soit le contrôle que veut exercer le travail mort – le capital – sur les salarié.es, le déploiement du travail vivant, cette “liberté concrète qui s’actualise dans le travail”, demeure toujours nécessaire pour la production. L’exécution à la lettre des consignes, cela s’appelle la grève du zèle, et cela paralyse la production. En un mot, travailler c’est désobéir.
Marx en avait par instants l’intuition, mais ne pouvait connaître les avancées des sciences psycho-sociales du XXè siècle à propos du travail réel. Plus surprenant, la quasi-totalité des marxistes, même critiques, les ont largement ignorées[9]. Comme si la dynamique politique concrète des rapports de travail pouvait ne pas avoir de conséquences sur la stratégie d’émancipation. Dès 1959 dans Socialisme et Barbarie, Castoriadis s’appuyait notamment sur ces travaux pour dépasser les apories du marxisme: « la contradiction fondamentale du capitalisme » n’est pas la baisse du taux de profit ou le conflit entre forces productives et rapports de production, mais « se trouve dans la production et le travail »:
« c’est la contradiction contenue dans l’aliénation de l’ouvrier : la nécessité pour le capitalisme de réduire les travailleurs en simples exécutants, et son impossibilité de fonctionner s’il y réussit ; son besoin de réaliser simultanément la participation et l’exclusion des travailleurs relativement à la production (comme des citoyens relativement à la politique, etc.) »[10].
La dialectique du travail et de la démocratie
La fin de la citation précédente connecte l’aliénation dans le travail et la dépossession dans la politique, tant il est clair qu’il ne peut y avoir de démocratie politique sans démocratie dans le travail. Des travailleurs auxquels on inculque toute la journée qu’ils n’ont pas les compétences pour organiser eux-mêmes leur travail et qu’ils doivent obéir scrupuleusement aux chefs et aux consignes, peuvent difficilement devenir le week-end des citoyens critiques et autonomes. Même si en pratique, souvent de façon clandestine voire inconsciente, les travailleurs doivent désobéir pour produire, il n’en demeure pas moins que les normes politiques du travail – le rapport de subordination – contaminent nécessairement la sphère civique. Plusieurs études récentes confirment le lien entre recul de l’autonomie au travail et montée de l’abstention et de l’extrême-droite.
Besancenot et Löwy affirment que
« en disposant de plus de temps nous aurons le loisir de décider et d’arbitrer les choix qui touchent à nos conditions de travail comme à nos conditions de vie » (p. 121).
Mais ils ne nous expliquent pas comment on passe d’une réduction quantitative du temps de travail à un changement de la qualité démocratique du temps libre. Simone Weil[11] objectait il y a déjà longtemps que
« faire du peuple une masse d’oisifs qui seraient esclaves deux heures par jour n’est ni souhaitable, quand ce serait possible, ni moralement possible, quand ce serait possible matériellement. »
Critiquant rudement la vision, chantée dans l’Internationale, d’un prolétariat qui passerait du “rien” au “tout” par la magie de la transmutation révolutionnaire, elle notait que
« avec les bagnes industriels que constituent les grandes usines, on ne peut fabriquer que des esclaves, et non pas des travailleurs libres, encore moins des travailleurs qui constitueraient une classe dominante ».
La dégénérescence bureaucratique des révolutions prolétariennes du XXème siècle ne lui a pas donné tort.
Avoir du temps pour délibérer, dans et hors l’entreprise, est bien sûr une condition nécessaire de la démocratie; mais totalement insuffisante si l’on reste prisonnier des rapports hiérarchiques dans l’entreprise et du consumérisme à l’extérieur. Le chaînon manquant entre réduction du temps de travail et démocratie, c’est celui d’une pratique et d’une politique de la liberté du travail: une réappropriation par les travailleuses et les travailleurs de l’organisation et des finalités de leur travail. Je n’évoquerai pas ici[12] les multiples pratiques sociales contemporaines, syndicales, associatives, coopératives, voire même managériales, inspirées par les logiques du care et du commun, qui fondent la possibilité d’une telle politique. Face aux pathologies infligées par l’organisation néolibérale du travail aux êtres humains, à la démocratie et à la nature, la société résiste et multiplie les expériences d’auto-organisation dans le travail. Et s’il est vrai que « l’objectif de la politique n’est pas le bonheur, c’est la liberté » (Castoriadis), il importe aujourd’hui de penser, à partir des expérimentations en cours, une politique de la liberté du travail.
Notes
[1] Affinités révolutionnaires. Pour une solidarité entre marxistes et libertaires, Mille et une nuits, 2014.
[2] La journée de travail et le ‘règne de la liberté’, Fayard, 2018
[3] Libérer le travail. Pourquoi la gauche se moque et pourquoi ça doit changer, Le Seuil, 2018.
[4] La durée annuelle du travail a baissé de 1900 heures à 1400 heures. Voir “Soixante ans de réduction du temps de travail dans le monde”, Insee Première, n°1273, janvier 2010.
[5] K. Marx, Principes d’une critique de l’économie politique, Œuvres II, Paris, Gallimard, 1968, p. 289-290.
[6] K. Marx, Critique du programme de Gotha, http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/critique_progr_gotha/programme_gotha.pdf, p. 32.
[7] Je propose dans Libérer le travail une synthèse des apports de l’ergonomie, de la psychologie, de la sociologie et de l’économie du travail quant aux relations complexes entre travail, santé, efficacité et autonomie politique.
[8] Interview de Christophe Dejours, https://www.changerletravail.fr/plaisir-et-souffrance-au-travail
[9] Jean-Marie Vincent, l’un des penseurs marxistes les plus attentifs à la question de l’activité de travail, tendait à considérer le travail comme une activité purement mécanique et aliénée, entièrement subordonnée à la valeur ; mais il a aussi su percevoir que « la victoire du travail abstrait sur l’activité captée n’est jamais complète parce que la captation ne peut être l’annihilation complète de la pluridimensionnalité de l’activité humaine » (« Flexibilité du travail et plasticité humaine », in J. Bidet et J. Texier, La crise du travail, PUF 1995).
[10] Cornelius Castoriadis, « L’expérience du mouvement ouvrier, Vol. 2 ; Prolétariat et organisation », Ed. 10 / 18, 1979.
[11]Simone Weil, La condition ouvrière, Folio Essais, Gallimard, 2002
[12]Je renvoie à mon ouvrage cité ci-dessus.








