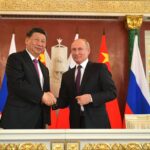Une histoire populaire du surf
Depuis ses origines hawaïennes jusqu’à l’engouement de l’après-guerre pour le surf, ce sport a été un défi à l’éthique calviniste du travail et aux pressions commerciales du capitalisme. Mais ces forces sociales délétères pourraient finalement réussir à éteindre l’esprit du surf.
***
Depuis plus de deux siècles, le capitalisme industriel occidental mène une guerre contre l’âme du surf. Depuis ses origines en tant que loisir indigène hawaïen jusqu’à l’apogée de la contre-culture, le surf a résisté à une série d’attaques, mais les avancées technologiques du capitalisme tardif et la brutale logique de marché du néolibéralisme pourraient sonner le glas du surf tel que nous l’avons connu.
La commercialisation du surf en tant que marchandise a une résonance culturelle beaucoup plus large. Comme le dit Cornel West (Californien d’origine, mais pas surfeur pour autant que nous le sachions) : « L’une des façons dont le capitalisme se reproduit est la marchandisation de tout et de tous ». L’histoire du surf en est un exemple.
Surfer sur les vagues
Il est pratiquement impossible d’expliquer le surf. Seul un imbécile essaierait de mettre des mots sur cette expérience. Écrire sur le surf exige des connaissances en géographie, en physique et en poésie.
Les surfeurs et surfeuses surfent sur des impulsions d’énergie qui se déplacent dans l’océan. Ces impulsions sont créées par de violentes tempêtes au-delà de l’horizon. En se déplaçant sur des milliers de kilomètres en haute mer (ce qu’on appelle le « fetch« ), elles se regroupent en séries de vagues. Lorsque cette énergie s’approche d’une côte, qu’il s’agisse d’une plage de sable, d’une pointe rocheuse ou d’un récif corallien, les vagues se replient sur elles-mêmes ou « déferlent ».
Les surfeurs.ses, qui se positionnent à un endroit très précis, utilisent leur force physique, leur mémoire musculaire inconsciente et leur connaissance du lieu pour pagayer dans la direction de la vague déferlante afin d’en capter l’énergie. À ce moment-là, souvent quelques secondes, mais à certains endroits rares, jusqu’à une minute ou un peu plus, la vague est praticable. Le surfeur est propulsé vers l’avant par l’interaction de l’énergie de la vague avec les caractéristiques topographiques sous-marines.
Puis l’énergie se dissipe. L’instant est passé. Cette vague, cette bande d’énergie singulière, n’existera plus jamais et la balade du surfeur est terminée.
Qu’est-ce que cette brève balade ? Une danse ? De la poésie ? Une communion avec la nature et les forces de l’univers ? C’est frivole, inutile et souvent même égoïste. Le surf n’a aucune utilité matérielle, si ce n’est de soigner l’écologie psychologique du surfeur.
L’acte de surfer sur les vagues est profondément satisfaisant, d’une manière qui nous conduit vers des explications métaphysiques. Des générations de surfeurs, accros à ces moments de bonheur transcendantal, ont fait des sacrifices matériels pour être là, dans l’eau, sur une plage, une pointe ou un récif spécifique, au moment exact où les vagues seront les meilleures. Le surf a créé des communautés d’outsiders qui s’éloignent des motivations capitalistes traditionnelles et vivent délibérément en marge de la société terrienne.
Il y a aussi ceux qui voient le surf comme un sport : un jeu, une compétition avec des règles et des juges pour distinguer les gagnants des perdants. D’autres y voient un mode de vie qui peut être commercialisé et vendu à des fins lucratives.
Le capitaine Cook et les Kānaka Maoli
Diverses formes de surf remontent à des siècles dans ce qui est aujourd’hui le Pérou et l’Afrique de l’Ouest, mais les origines de ce que la plupart des gens considèrent comme le surf, s’allonger sur une planche et pagayer avec les bras dans une vague, sont indéniablement hawaïennes. Le récit de la « découverte » malheureuse des îles par le capitaine James Cook (complété à titre posthume par James King) contient la plus ancienne description occidentale du surf :
Avec cela devant eux, ils nageaient jusqu’à la brèche la plus extérieure, puis un ou deux y entraient et, opposant l’extrémité émoussée à la vague déferlante, se précipitaient avec une rapidité incroyable. Parfois, ils sont presque ramenés sur le rivage.
Les femmes et les hommes de toutes les classes sociales pratiquaient le surf, mais certains affirment que les meilleures vagues étaient réservées aux ali’i, l’élite sociale indigène de Hawaï. Sans romancer le passé, il n’est pas difficile d’imaginer la joie de ces surfeurs précoloniaux.
Bien que la mission de Cook ait été un voyage scientifique, il a accumulé des connaissances pour l’Empire britannique afin de faciliter son expansion économique mondiale et a ouvert les vannes du contact occidental avec Hawaï. En l’espace d’une génération, Honolulu et Lahaina devinrent des ports d’escale très fréquentés par les flottes baleinières européennes et étatsuniennes.
Les conséquences furent désastreuses. En mer, les chasseurs rapaces massacrent les plus grands mammifères de la planète pour leur huile et leurs os. Sur terre, les haole (étrangers ou Blancs) répandent une multitude de maladies parmi les Kānaka Maoli ou peuples indigènes. La variole, la tuberculose et le rhume ont fait des ravages, tout comme les maladies sexuellement transmissibles et les maladies redoutables telles que la lèpre.
L’effondrement démographique qui s’ensuivit plongea la culture hawaïenne dans le chaos. Les communautés physiquement et psychologiquement déstabilisées étaient des cibles de choix pour les missionnaires protestants. Arrivés dans les années 1820, une série de sévères missionnaires de la Nouvelle-Angleterre expliquèrent aux Kānaka Maoli que ces fléaux étaient une punition de Dieu pour leurs péchés.
Calvinisme et conquête
À mesure qu’ils gagnaient en influence politique parmi les ali’i, les arrivants chrétiens supprimèrent la religion et la culture traditionnelles, notamment la hula (danse) et le mele (chant ou chanson). Méfiants à l’égard de la chair humaine, ils ont imposé le port de vêtements de style occidental dans la chaleur tropicale. De toute évidence, les missionnaires n’approuvaient pas le surf tel qu’il se pratiquait dans la nudité.
Mais le surf était aussi perçu par ces calvinistes nord-américains comme une perte de temps frivole. Ils méprisaient le surf sur les vagues et d’autres aspects du mode de vie athlétique des indigènes, qu’ils considéraient comme de la paresse et de la folie païennes. La répression du surf s’est inscrit dans un assaut culturel et économique plus large contre les traditions hawaïennes, qui a culminé avec le Grand Māhele de 1848 : l’imposition de la propriété privée sur les terres hawaïennes.
Soudain, la terre devint une marchandise, rendant impossible la tradition de subsistance communautaire et forçant les Kānaka Maoli à travailler comme salarié.es dans les nouvelles plantations de sucre appartenant aux haole, à récolter du bois ou à travailler dans les villes portuaires en pleine expansion. Cette doctrine de choc du XIXe siècle, enveloppée dans un moralisme calviniste, a porté un coup presque fatal au surf.
Cependant, lorsque le roi David Kalākaua monta sur le trône dans les années 1870, il fit renaître le surf. Dans un effort calculé pour défendre Hawaï contre les rapaces impérialistes occidentaux, Kalākaua chercha à revitaliser la santé et l’esprit de son peuple en promouvant le hula et d’autres traditions indigènes telles que le surf sur les vagues.
En fin de compte, ses efforts échouèrent, car les capitaux étatsuniens trouvèrent des rendements impressionnants dans l’industrie sucrière en pleine expansion. Les colons haole renversent la monarchie en 1893 et instaurent une république de colons suprémacistes blancs. En 1898, les États-Unis ont officiellement, bien qu’illégalement, annexé l’archipel. Privés de leurs droits politiques et marginalisés sur le plan économique, les Kānaka Maoli ont continué à souffrir d’un déclin démographique alors que les propriétaires de plantations haole importaient de la main-d’œuvre du Japon, de Chine et des Philippines.
Il a fallu un peu plus d’un siècle au capitalisme occidental pour transformer la communauté indigène en une minorité appauvrie et privée de tout pouvoir. L’historien Isaiah Helekunihi Walkeer affirme que de nombreux Kānaka Maoli ont trouvé refuge dans les vagues d’Hawaï pour échapper à cette horreur.
La suprématie du surf
Comme l’a montré Scott Laderman, c’est ironiquement le capital occidental qui a relancé le surf au début du XXe siècle. Alors que les îles productrices de sucre devenaient un territoire étatsunien, des entrepreneurs haole firent la promotion de l’archipel, en particulier de la plage de Waikiki à Oahu, en tant que destination touristique. Leurs campagnes présentaient les vagues hawaïennes comme une expérience que les riches voyageurs blancs pouvaient acheter et qui était rendue sûre et accessible grâce aux services de Waikiki Beach Boy.
Lorsque Alexander Hume Ford, un homme d’affaires de Caroline du Sud issu d’une famille de propriétaires de plantations, s’est installé à Hawaï en 1907, il a été captivé par le surf. Bien qu’il ait atteint l’âge mûr et qu’il soit un malihini (terme méprisant pour les nouveaux arrivants), il devient rapidement un surfeur compétent. En 1908, il fonde l’Outrigger Canoe Club pour promouvoir le surf et d’autres sports nautiques hawaïens.
Malgré son ouverture aux activités indigènes, l’Outrigger était ségrégué. Ce club d’élite privé est resté un bastion de la suprématie blanche à Hawaï tout au long du XXe siècle. Il comptait parmi ses dirigeants de nombreuses personnalités politiques et hommes d’affaires qui avaient orchestré le renversement de la monarchie hawaïenne. La vision de Ford d’une Hawaii « rachetée à l’Orient, fortifiée et américanisée comme elle devrait l’être » s’est manifestée dans l’Outrigger Canoe Club.
Alexandre Hume Ford utilisa le surf pour attirer les investisseurs occidentaux sur le territoire. Le surf était un complément de puissance douce à ses autres efforts de promotion, tels que la Pan-Pacific Union, une organisation conçue pour encourager les flux transocéaniques de capitaux, et son Mid-Pacific Magazine.
Dans un article paru en 1909 dans Collier’s, Ford avait du mal à maîtriser son enthousiasme pour le surf, l’impérialisme et la suprématie blanche :
Lors des récents carnavals de surf organisés en l’honneur des visites de la flotte américaine de cuirassés puis de croiseurs, pratiquement tous les prix offerts aux plus experts en sports nautiques hawaïens ont été remportés par des garçons et des filles blancs, qui n’ont maîtrisé que récemment l’art que l’on a cru pendant si longtemps ne pouvoir être acquis que par les Hawaïens de souche à la peau foncée.
Lors du concours de Noël, pour la troisième fois, un garçon blanc âgé de quatorze ans remporta la médaille décernée au surfeur le plus expert ; il arriva à une centaine de mètres devant un rouleau monstrueux qui se tenait sur sa tête.
L’homme et le garçon blancs font beaucoup à Hawaii pour développer l’art du surf. Des jeux et des exploits jamais imaginés par les autochtones sont mis à l’essai..
Entrepreneurs de plage
Ford a promu le surf comme une forme de compétition raciste et darwinienne, mettant l’accent sur le fait d’être le meilleur, par opposition à une appréciation égalitaire de la joie collective ou à la célébration des possibilités métaphysiques du surf sur les vagues :
À Hawaï, les enfants japonais sont plus nombreux que les blancs et les autochtones réunis ; les enfants chinois sont aussi nombreux, et les Portugais, qui forment une classe à part, sont plus nombreux que les enfants nés aux États-Unis à Hawaï ; pourtant, seuls les enfants blancs ont réussi à maîtriser les sports hawaïens.
J’ai été plus qu’amusé, lors de l’apprentissage de la planche de surf, de constater que les Japonais semblaient ne jamais pouvoir acquérir le difficile savoir-faire, alors que le petit garçon blanc devenait très vite plus habile que l’autochtone lui-même.
Si la tradition hawaïenne du surf a joué un rôle central dans la promotion inlassable d’Hawaï en tant que paradis tropical, Ford a présenté le « Sport des Rois » comme entièrement colonisé et commercialisé. Les visiteurs de la plage de Waikiki, dont Jack London, pouvaient désormais payer des « Beach Boys » hawaïens pour leur apprendre à surfer.
Les promoteurs immobiliers de Californie du Sud s’emparent de la stratégie de Ford, qui consiste à utiliser le surf pour attirer des capitaux. En vacances dans les îles, le magnat des chemins de fer Henry Huntington aperçoit le jeune George Freeth en train de profiter des vagues de Waikiki. Il recrute le hapa haole (métis) hawaïen-irlandais pour faire des démonstrations quotidiennes de surf dans la station balnéaire de Huntington à Redondo Beach. Pour parfaire la fétichisation de Freeth et du surf, les visiteurs fortunés pouvaient engager Freeth pour des leçons privées de surf. Il meurt en Californie pendant la pandémie de grippe espagnole.
Avec la célébrité ultérieure du médaillé olympique Duke Kahanamoku, l’image de Freeth a popularisé le surf sur le continent américain. Cependant, les planches de surf en bois fabriquées à la main, peu maniables (qui pesaient jusqu’à 45 kilos et les températures froides de l’eau en Californie ont fait du surf un sport de niche, pratiqué par une poignée de courageux et uniquement dans quelques localités balnéaires.
Le boom du surf
La popularité du surf a explosé dans les années 1960, lorsque les baby-boomers sont entrés dans l’adolescence. Le complexe militaro-industriel américain a créé de nouvelles technologies, telles que la mousse de polyuréthane ou de polystyrène, qui ont transformé la pratique matérielle du surf. La mousse recouverte de fibre de verre et scellée avec de la résine de polyester a permis de fabriquer des planches de surf plus légères, moins chères et plus maniables, ce qui a considérablement abaissé les barrières à l’entrée.
Motivé par le désir de passer plus de temps à surfer dans les eaux glaciales de la Californie du Nord, Jack O’Neill a commencé à fabriquer et à vendre des combinaisons de surf en néoprène en 1952 dans son garage de San Francisco. Soudain, deux heures de surf à Santa Cruz ou dans l’hiver de Los Angeles n’étaient plus une menace pour la vie. À l’époque, peu de gens se sont rendu compte de l’ironie qu’il y avait à utiliser ces produits pétrochimiques incroyablement toxiques, souvent fabriqués par des sociétés telles que Dupont et Dow Chemical Company, pour communier avec l’océan.
La culture du surf s’inscrivait parfaitement dans l’éthique générale de la liberté et de la rébellion des jeunes. Nombreux sont ceux qui ont romancé l’image du surfeur comme étant l’ultime décrocheur. Tournant le dos au consumérisme étatsunien, les surfeurs et les surfeuses vivaient en harmonie avec la nature et refusaient de s’attacher à un travail de huit heures par jour… L’insolente série Gidget a popularisé la culture balnéaire de la Californie du Sud, mais c’est le film de Bruce Brown, The Endless Summer (« L’été sans fin »), sorti en 1965, qui a fait connaître cette mythologie à l’Amérique moyenne.
Il est devenu cool de ressembler à un surfeur, même si l’on ne sait pas de quel côté de la planche mettre la wax. Hollywood a continué à tirer profit de la popularité du surf grâce aux suites de la sitcom Gidget, ainsi qu’à la litanie de films sur le surf de la fin des années 1960. Soudain, les petites communautés de surfeurs et surfeuses ont vu le pouvoir d’un capital organisé transformer en marchandise et vendre leur culture locale et organique de la plage.
Des figures de la contre-culture et de l’anti-héros, comme Miki Dora de Malibu, se sont ouvertement opposées à la popularité de masse du surf, alors que des novices amateurs de sports nautiques, souvent issus des communautés méprisées des vallées intérieures, envahissaient leurs plages bien-aimées. Le nombre de vagues pouvant être surfées étant une ressource limitée, l’affluence croissante a donné lieu à une concurrence féroce et parfois violente dans l’eau.
Dans une série d’événements tristement célèbres, Miki Dora, surnommé « Da Cat », a frappé des surfeurs qui lui avaient « volé » sa vague avec sa planche de surf, a fait des gestes obscènes à l’encontre de photographes de surf, a posé comme s’il était crucifié sur une croix de planches de surf et s’est inscrit à un concours uniquement pour exposer son postérieur nu aux juges. Comme Miki Dora l’a dit lui-même :
Je ne fais du surf que pour le plaisir. Le professionnalisme sera complètement destructeur de tout contrôle qu’un individu peut avoir sur le sport à l’heure actuelle. Les organisateurs prendront les décisions et encaisseront les bénéfices, tandis que le surfeur fera tout le travail et ne recevra pas grand-chose. De plus, comme l’alliance du surf avec les intérêts décadents des grandes entreprises n’est conçue que comme un frein temporaire à un effondrement financier total, la conclusion d’un tel partenariat ne servira qu’à accélérer la disparition de l’art. Un surfeur devrait réfléchir sérieusement avant de vendre son être à ces « gens », car il signe son propre arrêt de mort en tant qu’entité personnelle.
La déclaration de Da Cat était une contre-attaque face à la guerre du capitalisme pour l’âme du surf.
Contre-culture et commerce
De nombreuses tactiques de Miki Dora sont critiquables. Si son flirt avec les symboles nazis révèle un racisme profondément ancré, il faut surtout y voir une rage alimentée par la testostérone et une provocation à l’égard des normes sociales bourgeoises. Sans la moindre complaisance pour ses actes proprement odieux, nous devons reconnaître que Miki Dora détestait la marchandisation de la culture surf et qu’il a donc tenté de la sauver en la rendant invendable.
Pourtant, même Miki Dora a été personnellement impliqué dans la marchandisation en jouant le rôle de surfeur cascadeur dans le premier film de Gidget et en obtenant des rôles dans tous les grands films hollywoodiens de surf-exploitation. D’autres icônes du surf, comme Greg Noll et Hap Jacobs, ont plus facilement accepté la tendance, se positionnant pour s’inscrire dans le tourbillon des ventes et engranger des parts de marché.
Horrifiés par l’augmentation des foules et la commercialisation de leur mode de vie, les surfeurs étatsuniens et australiens privilégiés partent à la recherche de leur propre idylle estivale sans fin : des vagues parfaites et vides dans des pays étrangers exotiques. Les communautés côtières du Mexique, d’Amérique centrale et d’Asie du Sud-Est ont été déconcertées par l’afflux de jeunes hommes blancs risquant leur vie dans des conditions maritimes manifestement dangereuses que les pêcheurs locaux évitaient depuis des générations.
Pour les vrais surfeurs, Morning of the Earth (1972) d’Alby Falzon et David Elfick a été l’apothéose du surf en tant que rébellion contre-culturelle. Tourné en Australie rurale, sur le célèbre North Shore d’Oahu et dans l’Indonésie exotique, le film met en scène des hippies bronzés et aux cheveux dorés qui vivent un mode de vie alternatif dans des fermes coopératives, explorent le végétarisme et fabriquent leurs propres planches de surf dans des granges (tout en ignorant superbement les effets potentiels de leur équipement sur la santé). Des séquences de vagues incroyablement parfaites se brisant sous les temples hindous spectaculaires d’Uluwatu à Bali, associées à une puissante bande-son folk-psychédélique, ont convaincu un nombre incalculable d’Américains désabusés que les voyages de surf pouvaient être un acte spirituel éclairant.
Ces surfeurs voyageaient avec un budget limité et exploitaient la force relative du dollar américain ou australien par rapport au peso mexicain ou à la roupie indonésienne. Le plaisir de découvrir des vagues loin des foules étouffantes de Los Angeles ou du Queensland étant en grande partie lié à l’hébergement et au transport, il s’agissait d’un véritable défi. À cette époque, les explorateurs du surf logeaient souvent dans des familles, mangeaient de la nourriture locale et passaient des accords avec des pêcheurs sceptiques pour se rendre sur des récifs et des plages éloignés.
Mais voyager indéfiniment sans emploi finit par épuiser vos fonds. Dans Thai Stick: Surfers, Scammers, and the Untold Story of the Marijuana Trade :
Surfeurs, escrocs et l’histoire inédite du commerce de la marijuana) Peter Maguire et Mike Ritter expliquent comment certains se sont tournés vers la contrebande d’herbe pour financer leurs aventures. D’autres trafiquaient des produits plus rentables, mais plus dangereux, comme l’héroïne d’Asie du Sud-Est et la cocaïne d’Amérique latine.
De manière surréaliste, l’une des vedettes de The Endless Summer, Mike Hynson, fait une apparition dans le « documentaire » Rainbow Bridge (1971) sur Jimi Hendrix. Dans ce film, il montre inexplicablement comment lui et d’autres trafiquants font passer de la drogue par des compartiments secrets à l’intérieur de leurs planches de surf. Ce film bizarre et incohérent soulève de nombreuses questions, mais les raisons qui ont poussé Hynson à révéler un tel savoir-faire restent sans réponse.
Le lien entre le surf et le narcotrafic a rendu l’image du surfeur rebelle encore plus cool. Pourtant, l’argent facile du trafic de drogue a injecté une dose fatale d’avidité et de matérialisme.
Résistance à Hawaï
Le surf hawaïen continue d’attirer les surfeurs. Avec l’accession au statut d’État en 1959, le tourisme a connu un essor sans précédent. En l’espace d’une décennie, un gigantesque boom de la construction a transformé Waikiki. Cependant, dans les années 1970, ce ne sont plus les vagues relativement douces de Waikiki qui attirent les surfeurs, mais les vagues d’hiver beaucoup plus grosses, difficiles et mortelles de la côte nord, à Sunset Beach, Banzai Pipeline et Waimea Bay.
Alors que les haoles de Californie et d’Australie envahissaient la petite ville de Haleiwa, faisaient grimper les loyers de la communauté rurale et s’entassaient sur les 11 kilomètres de côte qui abritent certaines des vagues les plus emblématiques du monde, la communauté locale devint de plus en plus agacée et hostile.
L’assaut du tourisme néocolonial a coïncidé avec une renaissance du nationalisme hawaïen. De nombreux Hawaïen.ness se sont senti.es exclu.es du boom économique provoqué par l’avènement des compétitions professionnelles de surf, couvertes par la télévision nationale et sponsorisées par de grandes entreprises telles que la vodka Smirnoff.
En 1975, un groupe de surfeurs hawaïens, pour la plupart autochtones, a fondé le Hui He’e O Nalu, un club destiné à protéger le surf hawaïen. Ses membres étaient vêtus de shorts noirs assortis d’une bande rouge et jaune, couleurs qui, culturellement, signifiaient l’appartenance aux classes dirigeantes indigènes de l’ali’i, qui avaient considéré certains spots de surf comme kapu, réservés à elles seules, ou interdits aux roturiers sous peine de mort. Ils ont adopté des tactiques musclées à l’encontre des surfeurs haole qu’ils considéraient comme irrespectueux.
Le journaliste de surf Chas Smith a expliqué comment Da Hui, comme on l’appelle, a forcé le surf professionnel à donner une part du gâteau aux surfeurs hawaïens. L’historien Isaiah Helekunihi Walkerprésente le travail de Da Hui comme une forme de résistance anticoloniale et un défi à la commercialisation capitaliste du surf.
L’image de marque
Le surf professionnel a eu des origines plutôt modestes dans les années 1970. Buzzy Kerbox, un jeune haole d’Hawaï, se souvient que lorsqu’il a commencé à participer à des compétitions internationales, son premier sponsor lui a offert un T-shirt et quelques barres de cire (« wax »). Au fil des années 1980, l’argent a commencé à affluer.
Les surfeurs professionnels gagnaient un peu d’argent en remportant des compétitions, mais leurs véritables revenus provenaient de leurs sponsors vestimentaires. Si la vente de matériel de surf, comme les planches et les accessoires, n’était pas particulièrement lucrative, les marques de vêtements liées au surf ont connu un véritable essor pendant une vingtaine d’années.
Le surf est difficile, tout le monde ne peut pas le pratiquer correctement et la plupart des gens vivent trop loin de la plage pour avoir ce style de vie idéal. Mais il est facile de ressembler à un surfeur. N’importe qui peut entrer dans un centre commercial à Honolulu, Los Angeles ou Chicago et acheter des vêtements de surf.
La nouvelle « industrie du surf » a banalisé ce qui était autrefois une sous-culture. Le véritable travail des surfeurs professionnels consistait à poser comme mannequins pour de grands groupes de mode dont le lien avec le sport était de plus en plus ténu.
Kelly Slater, un jeune Floridien doté d’un talent qui lui a permis de remporter onze titres de champion du monde, a été la première star du surf. Jusqu’à ce qu’il devienne prématurément chauve, l’allure de beau gosse de Slater en faisait un modèle idéal pour l’industrie de la mode du surf. Homme d’affaires avisé, il a su tirer parti de son palmarès impressionnant pour décrocher un rôle dans la série télévisée Baywatch (« Alerte à Malibu ») et de très nombreuses opportunités d’investissement.
Kelly Slater est devenu l’ultime initié de l’industrie. En se concentrant sur le surf en tant que compétition et sur sa réussite financière personnelle, il incarne une nouvelle génération de surfeurs professionnels entièrement « corporate » qui n’ont pas grand-chose en commun avec l’éthique de la contre-culture de l’époque du Morning of the Earth (Matin de la Terre).
L’afflux de capitaux a transformé les voyages de surf. Des entrepreneurs établissent des camps de surf sur des spots isolés du Pacifique et de l’océan Indien. Au départ, il s’agissait d’opérations spartiates, mais au milieu des années 1990, des destinations comme Tavarua aux Fidji pouvaient offrir un hébergement de luxe, une nourriture haut de gamme et un accès exclusif à certains spots de surf pour ceux qui étaient prêts à payer des milliers de dollars pour une semaine de surf.
En Indonésie, où les surfeurs louaient autrefois des bateaux de pêche en bois et mangeaient tout ce que l’équipage pouvait attraper, les yachts haut de gamme équipés de l’air conditionné, de télévisions à écran plat et d’un approvisionnement abondant en bière glacée sont devenus la norme. Ceux qui se rendent aujourd’hui au Salvador du président de droite Nayib Bukele sont accueillis à l’aéroport, conduits dans des complexes sécurisés en bord de mer et protégés par des hommes armés de fusils automatiques. La richesse permet à ces surfeurs de ne pas avoir à s’inquiéter de la criminalité de rue notoire, de la pauvreté endémique ou de l’histoire du soutien étatsunien aux escadrons de la mort de l’extrême droite.
Technologie et transformation
La technologie actuelle transforme le surf à un rythme effréné. Le résultat final pourrait être un loisir sans âme qui n’aurait plus qu’un rapport très superficiel avec ses racines hawaïennes.
Auparavant, les voyages de surf étaient une entreprise risquée qui nécessitait du temps et de la patience, ainsi que des connaissances locales et de la chance. Les meilleures vagues étant générées par des tempêtes imprévisibles à des milliers de kilomètres de là, les risques de ne pas trouver les conditions parfaites étaient élevés. Le voyage de surf classique était une entreprise de longue haleine, puisqu’il fallait disposer d’une fenêtre suffisamment large pour s’assurer du succès. De nombreux surfeurs avaient un engagement professionnel ambigu ou cherchaient un travail saisonnier dans des domaines tels que la construction, l’hôtellerie ou la pêche en Alaska.
Cependant, les progrès de l’imagerie satellitaire et des prévisions météorologiques ont tout changé. Aujourd’hui, il est possible de s’abonner à des services qui prédisent l’arrivée de la houle et les conditions de vent jusqu’à une semaine ou plus à l’avance. Les surfeurs suffisamment fortunés peuvent payer le prix fort pour des billets de dernière minute, arrivant avec la houle et repartant lorsqu’elle tombe à plat. Les connexions à large bande dans les villages reculés d’Amérique centrale et sur les petites îles de l’océan Indien permettent aux membres de la classe dirigeante professionnelle d’honorer leurs obligations.
Fini le temps de l’été sans fin, le fantasme du voyage indéfini. Aujourd’hui, les surfeurs parlent de « strike missions » (missions éclairs) de trois ou quatre jours avec des itinéraires soigneusement planifiés. Avec une telle logistique et une telle connectivité mondiale, les voyages de surf d’élite ne sont plus une aventure harassante vers l’inconnu ou un échange culturel instructif. Il s’agit plutôt d’une expérience organisée, réservée à l’avance et à l’abri des conditions de vie quotidiennes sur place.
Les prévisions de surf de haute technologie ont également modifié la culture du surf dans l’Occident industriel. En raison du manque de fiabilité de l’océan, les surfeurs ont toujours dû vivre à proximité de la côte. La vérification quotidienne des vagues le matin était la norme. S’il y avait des vagues, le travail était remis à plus tard…
De nombreux entrepreneurs ont appris à ne pas embaucher de surfeurs ou à tenir compte de leur instabilité. Une vie rythmée par les cycles de la mer fait qu’il est difficile pour les surfeurs dévoués de se conformer aux trajectoires de carrière traditionnelles des cols blancs, ce qui confère à la culture de la plage une ambiance de cols bleus.
Les prévisions de surf à but lucratif ont révolutionné la capacité de la classe des cadres à surfer. Le fait de savoir qu’il y aura des vagues de qualité une semaine ou dix jours à l’avance permet de programmer des activités en fonction du surf. Pour les cols blancs vivant à une heure ou plus de la côte, il s’agit là d’un progrès considérable.
Ce fut également un désastre pour ceux qui vivaient sur la côte et gagnaient leur vie dans la construction, le secteur des services ou la pêche. La technologie de prévision permet aux surfeurs sans lien géographique avec les communautés côtières d’accéder aux meilleures vagues sans les sacrifices consentis par les membres de ces communautés.
Le surf contre la nature
La déformation technologique du surf est illustrée par l’avènement de la piscine à vagues. En 2015, une vidéo a choqué le monde du surf. On y voyait Kelly Slater surfer une vague incroyablement parfaite et exceptionnellement longue dans un lac artificiel. La méga-star du surf professionnel a révélé le projet secret : le Kelly Slater Wave Ranch à Lemoore, en Californie, dans la vallée poussiéreuse et enclavée de San Joaquin, à une centaine de kilomètres de l’océan.
L’argent impliqué dans cette entreprise est stupéfiant. Pour 50 000 dollars par jour, il est possible de louer le site qui ressemble à un country club. De Palm Springs, en Californie, à Waco, au Texas, les promoteurs s’empressent d’ouvrir une multitude de nouveaux parcs à vagues, tandis que les spéculateurs immobiliers font grimper la valeur des propriétés locales.
Les vagues artificielles, aussi parfaites et séduisantes soient-elles, soulèvent de sérieuses questions philosophiques sur la nature du surf, qui rejoignent les observations de Walter Benjamin dans son essai « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (1936). Le fait de surfer sur une vague fabriquée en usine peut-il avoir quelque chose en commun avec le lien métaphysique avec le monde naturel que tant de surfeurs ont décrit ?
Que signifie le fait qu’une machine puisse produire à plusieurs reprises exactement la même vague ? Que signifie surfer sur une vague exempte des imperfections de la nature ? Est-ce encore du surf ? Que signifie vendre ces vagues en tant qu’unités spécifiques d’une marchandise ? Quelle est la valeur marchande d’une vague ?
Le fait de pouvoir « surfer » en l’absence d’un océan en bonne santé a de graves répercussions sur l’environnement. Le lien entre le surf et le monde naturel a permis d’établir une relation immersive avec l’environnement océanique. Cette relation a conduit les surfeurs à devenir les gardiens des écosystèmes locaux, en protégeant les lieux où ils vivent et se divertissent.
Mais que se passera-t-il si les parcs de surf deviennent le nouveau voyage de rêve des surfeurs, comme l’ont été les îles Mentawai en Indonésie dans les années 1990, et si le rêve des générations futures de surfeurs est complètement dissocié de la nature ? Les surfeurs, qui ont été les premiers à protester et à protéger l’environnement océanique dans le passé, ne sont peut-être plus aussi investis dans la lutte pour protéger les océans de leur profanation rampante au service de l’exploitation capitaliste mondiale.
Le développement et l’exploitation de ces parcs sont extrêmement gourmands en énergie et en ressources. Les taux de consommation d’énergie des machines à vagues sont des secrets bien gardés et les entreprises de relations publiques font de l’écologie dans l’industrie, mais le nombre de projets actuellement proposés dans le monde est stupéfiant.
Le jouet de Zuckerberg
Sans surprise, c’est peut-être la Silicon Valley qui éloigne complètement le surf de ses racines. Comme beaucoup de jeunes hommes de l’industrie technologique, Mark Zuckerberg a été attiré par l’attrait des vagues, mais il n’avait pas les années d’expérience nécessaires pour devenir un surfeur compétent. Mais pour ceux qui ont au moins 12 000 dollars à dépenser, il existe un raccourci.
Les novices peuvent utiliser des planches de surf à bobines électriques, appelées e-foils, pour se propulser artificiellement dans les vagues. Mark Zuckerberg est tellement séduit par le style de vie des surfeurs qu’il a acheté un immense complexe en bord de mer sur l’île de Kaua’i. Faisant écho à l’utilisation de George Freeth par Henry Huntington, le magnat de Meta paie certains des surfeurs les plus accomplis du monde pour qu’ils lui donnent des cours dans l’océan.
Le 4 juillet de l’année dernière, Zuckerberg a publié une vidéo montrant ce qu’un riche surfeur débutant peut ou ne peut pas acheter. La courte vidéo le montre en train de faire de l’e-foiling en tenant un grand drapeau américain. S’il pratique une forme de surf, il est clair que le style, l’authenticité et l’âme ne sont pas à vendre.
Comme si cela ne suffisait pas, Zuckerberg a fusionné son nouveau hobby avec ses projets techno-futuristes pour nous tous. Lorsqu’il a dévoilé le métavers à l’automne 2021, la vidéo promotionnelle surréaliste contenait une séquence bizarre du PDG de Meta et de la star du surf Kai Lenny en train de surfer dans un jeu vidéo.
À l’instar des parcs à vagues, le « surf » dans le métavers risque de déconnecter les surfeurs en herbe de l’océan réel. Mais cette perspective est encore plus déconcertante et sinistre, car il est facile d’imaginer un avenir pas si lointain dans lequel nous prendrons des métavacances pour échapper à l’enfer qu’est devenue notre planète ravagée par le changement climatique.
Les performances de Zuckerberg, que ce soit avec son entourage de flagorneurs rémunérés qui l’aident à prendre des vagues qu’il ne peut pas prendre lui-même, ou dans son monde imaginaire de réalité virtuelle où il peut surfer aussi bien que Kai Lenny, pourraient signaler la victoire du capitalisme sur ce qui était autrefois salué comme le Sport des Rois. La mise sur le marché d’expériences de surf numérisées résonne avec l’observation de Cornel West sur la « marchandisation de tout et de tous » par le capitalisme.
Le passage aux piscines à vagues industrielles et au monde virtuel signale un abandon potentiel de la géographie traditionnelle du surf en tant qu’espace de réalisation transcendantale de soi, d’autonomisation, de construction communautaire et de perturbation potentielle des structures de pouvoir terrestres existantes des hiérarchies sociopolitiques et capitalistes. Les vagues ont toujours agi comme un grand égalisateur. Mais si l’avenir du surf se situe en dehors de l’océan, alors la guerre de deux cents ans pour l’âme du surf pourrait bien être perdue.
*
Michael G. Vann est professeur d’histoire à l’Université d’État de Sacramento et auteur, avec Liz Clarke, de The Great Hanoi Rat Hunt : Empire, Disease, and Modernity in French Colonial Vietnam.
Trey Highton est doctorant en littérature à l’université de Santa Cruz. Ses études doctorales utilisent le surf pour appréhender les contextes de l’Anthropocène. Il a travaillé comme guide de surf en Indonésie et en Amérique centrale.
Cet article a d’abord été publié en anglais par Jacobin, et traduit en français par Christian Dubucq pour Contretemps.
Illustration : Wikimedia Commons.