
Retour sur l’histoire du « santé-mentalisme »
Les mouvements récents dans le champ psychiatrique nécessitent de revenir sur les décennies précédentes avec la mise en place d’un dispositif nommé « santé-mentaliste » par Mathieu Bellahsen, dans son ouvrage La santé mentale. Vers un bonheur sous contrôle, paru aux éditions de la Fabrique en 2014. Nous publions ici le chapitre 5 de cet ouvrage qui traite du santé-mentalisme et de sa déclinaison en France dans les pratiques politiques qu’elles soient celles des politiques publiques en général ou celles plus spécifique de santé voire de « santé mentale ».
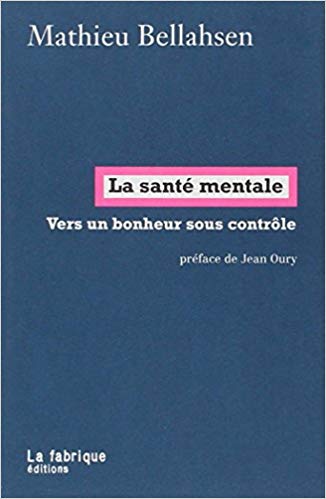
Mathieu Bellahsen, La santé mentale. Vers un bonheur sous contrôle, La Fabrique, 2014, 186 p., 13 euros.
Classer, gérer, normaliser
La phase d’expansion de la santé mentale débute dans les années 1980. La conquête de nouveaux terrains est légitimée par des classifications internationales des maladies et des troubles mentaux. Dès sa création, l’OMS se dote de la « Classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès ». En 1949, cette Classification internationale des maladies (CIM) fait pour la première fois une place aux troubles mentaux. Trente ans plus tard, la volonté d’homogénéisation du champ psychiatrique se répand chez les cliniciens de la psychiatrie et ne se limite plus seulement aux chercheurs. La troisième version du Manuel diagnostique et statistique (DSM en anglais) suscite un engouement lors de sa présentation au 7e congrès international de psychiatrie à Vienne (Autriche) en 1983. Le contexte est propice à la psychiatrie biologique qui fonde ses espoirs sur une classification stable facilitant les études pharmacologiques solides. Aux États-Unis, le mouvement est d’autant plus encouragé par l’Association de psychiatrie américaine (APA) que le système de santé américain ne rembourse les soins qu’en fonction du diagnostic DSM. À partir de ce moment-là, les grands cadres nosographiques classiques de la psychiatrie (névrose, psychoses…) laissent la place à une multiplicité de « troubles » ou « désordres ». Là où la nosologie classique visait plutôt à unifier l’ensemble des symptômes et syndromes derrière l’étiquette d’une seule maladie, cette nouvelle classification s’en écarte et fait apparaître quantité de désordres. La catégorie d’hystérie est, par exemple, supprimée au profit d’un morcellement de troubles : trouble somatoforme, trouble de la personnalité histrionique, trouble conversif, etc. La prolifération de ces diagnostics prend de plus en plus d’importance dans les années suivantes. Des classifications sont créées, comme la « Classification internationale des handicaps et de santé mentale » publiée par l’OMS en 1980, et d’autres sont mises à jour régulièrement avec, à chaque fois, une augmentation du nombre de troubles. Par exemple, la vieillesse deviendra dans le DSM-5 un « trouble cognitif mineur ».
Ces nouvelles entités diagnostiques sont symptomatiques du rapport de la société aux luttes politiques et des rapports entre l’individu, le collectif et la société. Elles ont des effets directs sur les pratiques de soins et sur les pratiques sociales. Ce passage de quelques pathologies psychiatriques à de nombreux troubles est dû à des instances réputées « scientifiques[1] » ayant un pouvoir d’influence dans les milieux politiques et professionnels. La science, la recherche, la gestion, l’évaluation, les médias constituent les différents niveaux discursifs légitimant ces nouvelles catégories, ces nouveaux « troubles ». Les classifications internationales construisent de nouvelles catégories sociales se frayant un chemin vers la reconnaissance par les politiques. Le milieu scientifique s’en saisit aussi comme objet de recherche en direction de la biologie, de la génétique et bientôt des neurosciences. Dans le champ de la recherche clinique, il devient de plus en plus difficile de publier sans en passer par les critères des classifications internationales et de l’« evidence-based medicine » (la médecine fondée sur la preuve). Les revues scientifiques sont friandes des articles à haut « impact factor » qui feront parler d’eux dans la communauté et augmenteront d’autant la visibilité de la revue. Les chercheurs étant soumis à des impératifs de publication, ils sont eux-mêmes pris dans une logique contrainte[2] et se conforment à ce qui est susceptible de plaire aux revues. Dès lors les cliniciens sont de plus en plus formatés aux diagnostics des nouvelles classifications et à leur traitement par les « nouvelles » molécules.
Ce modèle classificatoire s’est également fondé sur une convergence d’intérêts entre l’industrie pharmaceutique et le système assurantiel nord-américain. Le morcellement des troubles permet qu’une seule personne soit atteinte de plusieurs d’entre eux et augmente d’autant le nombre de médicaments prescrits. De nouvelles molécules et/ou de nouvelles indications apparaissent pour de nouveaux troubles. Pour augmenter le nombre de personnes à traiter, il suffira d’abaisser les seuils de ce qui est considéré comme pathologique. Dans la dernière version du DSM, une tristesse qui persiste pendant plus de quinze jours (deux mois dans l’ancienne version) après le décès d’un proche sera considérée comme un deuil pathologique susceptible d’indiquer un traitement par antidépresseur[3].
C’est la démarche clinique fondée sur l’expérience qui aura le plus à pâtir des classifications. Une même personne pourra être diagnostiquée déprimée (épisode dépressif majeur : antidépresseur), angoissée (attaques de panique : anxiolytique), insomniaque (trouble du sommeil : hypnotique) sans que soit pensé ce qui lui arrive de particulier dans sa vie. Les cliniciens en concevant ces classifications comme un manuel clinique vont perdre la raison. Bien souvent, des erreurs massives de diagnostics puis de thérapeutiques se produisent quand le clinicien oublie son impression personnelle ainsi que l’expérience existentielle que traverse le patient. Or ce qu’il faut construire avec toute personne en proie au délire ou à la dépression, c’est la possibilité d’une vie plus supportable selon ses propres critères plutôt que selon une norme dictée par autrui. Le modèle colporté par les classifications dépossède la personne et le clinicien de la problématique subjective présente dans toute pathologie psychiatrique. Si la dépression n’est qu’un rapport avec le taux de sérotonine ou l’activation de telle ou telle zone du cerveau – donc avec la mise en place de tel traitement antidépresseur ou de telle technique de remédiation cognitive –, la personne ne peut en faire une expérience qui lui soit propre.
De plus, ces panacées sont souvent beaucoup plus chères et pas forcément plus efficaces que les traitements classiques[4]. Utilisant l’attrait pour la nouveauté (que ce soit pour les troubles ou pour les médicaments), le marketing de l’industrie pharmaceutique se fixe pour but de démontrer que dans telle entité particulière ce nouveau traitement sera bien plus efficace. Des campagnes médiatiques à destination des professionnels et du grand public en font la promotion, ce qui pousse à la prescription de ces nouveautés. Or, bien souvent, les études pour les nouveaux psychotropes sont faites avec un placebo plutôt qu’avec le médicament de référence ! Cela signifie que les firmes préfèrent comparer le nouveau médicament à une gélule sans principe actif (placebo) plutôt que de le comparer au traitement de référence, c’est-à-dire celui qui a déjà fait preuve de son efficacité[5]. Les nouveaux psychotropes seront souvent vantés pour leurs moindres effets secondaires comparés aux vieux médicaments alors qu’ils en auront d’autres tout aussi délétères mais non pris en compte par les études, voire carrément camouflés par les firmes pharmaceutiques[6].
En réalité, bien loin de soigner la pathologie en elle-même, les thérapeutiques médicamenteuses servent plutôt à entrer en contact avec la personne afin d’apaiser une souffrance trop vive et de permettre un travail de mise en sens. Cette dimension, la plus ardue, est pourtant la plus passionnante pour les cliniciens et la plus importante pour les patients. Si l’on prend l’exemple d’une personne reçue pour une bouffée délirante aiguë qui exprime la difficulté de son rapport aux siens et au monde qui l’entoure, dans une perspective DSM, le rôle du clinicien est de faire taire le délire pour amender le symptôme. Le clinicien s’arrête là où le travail psychiatrique commence : comprendre pourquoi cette personne délire à ce moment-là, sur ce thème-là. Cette conception tronquée de la pathologie mentale, véhiculée par le DSM, simplifie le rôle du psychiatre : prescrire des traitements, réadapter les patients aux normes sociales dominantes. En simplifiant également le rôle des équipes soignantes, il leur fait perdre le sens de leur travail et érige le renoncement au rang de science objective.
Ainsi appliqué à la clinique psychiatrique, le modèle classificatoire induit une individualisation de problèmes qui devraient d’abord et avant tout être traités politiquement et collectivement. Prenons l’exemple connu du stress au travail et autres burn-out. L’ornière actuelle est de considérer cette problématique sous l’angle exclusif du rapport entre le travail et l’individu, appelé « risque psycho-social ». En acceptant ce cadre classificatoire qui part des « vulnérabilités » de l’individu dans son rapport au travail, il devient possible de négliger le contexte sociopolitique dans lequel se trouvent pris le travail et l’individu. Il n’existe pas dans le DSM de « trouble de l’organisation du travail » ou autre « trouble de la politique de management »… Pourtant, bien souvent, les politiques de management et de mise en concurrence des individus sont en cause[7].
Ainsi, le « Livre vert » sur la santé mentale, édité par la Commission européenne, fait apparaître que
« jusqu’à 28 % des travailleurs européens se disent exposés au stress sur leur lieu de travail. Les mesures qui visent à améliorer les capacités personnelles et à réduire l’effet des facteurs de stress au travail sont bénéfiques pour la santé et le développement économique […] Un faible statut social et économique accroît la vulnérabilité à la mauvaise santé mentale. La perte d’un emploi et le chômage risquent de nuire à l’estime de soi et de conduire à la dépression. L’aide aux catégories plus vulnérables est de nature à améliorer la santé mentale, consolider la cohésion sociale et éviter les charges économiques et sociales associées à cette vulnérabilité[8]. »
Grâce à ces constructions que sont les classifications diagnostiques et les « risques psychosociaux », les interventions politiques peuvent prétendre s’effectuer au nom de la science et effacer le choix de société inhérent à toute politique. Les instances gouvernementales seront là pour mettre en place des dispositifs « experts » censés soutenir l’individu sans modifier le milieu du travail. Les anciens rapports de force entre les travailleurs, leurs organisations et les entreprises s’effacent au profit d’un rapport direct entre l’individu et l’entreprise, évacuant par là même toute la question des collectifs de travail[9]. Les « tickets psy » pour les salariés en proie à la souffrance au travail et aux suicides répétés de leurs collègues en sont un paradigme contemporain. Mis en place à la suite des suicides survenus dans les grandes entreprises françaises (Orange, Renault…), ils sont basés sur le même modèle que les tickets-restaurant[10]. Des cabinets de psychologues sont payés par l’intermédiaire de ces tickets pour écouter les salariés « en souffrance ». Le nombre de séances est calibré par avance.
Présenté comme apolitique et athéorique, le modèle classificatoire est cohérent avec une vision néolibérale du monde où l’individu est sommé de s’adapter. Son utilisation implique l’acceptation d’un certain cadre de pensée du monde et de la société. Le rôle des responsables politiques n’est plus de négocier le contrat social de manière globale mais d’apporter des réponses individualisées aux vulnérabilités particulières décrites dans le DSM sous la forme de cellules psychologiques ou d’écoutes diverses et variées. Pour le clinicien, le risque est de ne pas mettre en perspective les symptômes produits par le patient avec le contexte sociopolitique dans lequel il se trouve. Pourtant, dans le cas des personnes qui consultent pour des dépressions liées au travail, par exemple, il est aussi important de penser la désubjectivation produite par le cadre de travail que la façon dont la personne y réagit. Dans de nombreuses situations, il est même plus important, dans les premières consultations, de penser la folie du travail avant la souffrance de la personne pour l’aider à sortir du carcan stigmatisant des « vulnérabilités individuelles ». Intriquer clinique et politique est une gageure. C’est précisément ce qu’occulte le modèle classificatoire en laissant le champ libre à une utilisation supposée « objective » des troubles mentaux.
Ainsi, il existe une boucle d’autolégitimation qui s’alimente par différents points d’entrée : les classifications, la recherche, l’industrie pharmaceutique, les outils de gestion des hôpitaux, les pratiques cliniques, les experts autoproclamés, la formation des professionnels. Les pratiques non classifiables ou non évaluables avec ces critères se voient délégitimées et disparaissent progressivement des publications puis des pratiques – ce qui renforce leur illégitimité –, d’où une autre boucle, inverse de la précédente. Les débats tournant autour de la psychanalyse et de son évaluation en sont de bons exemples.
***
Progressivement, la psychiatrie voit ses pratiques se standardiser, ses théories s’homogénéiser pour être en conformité avec le modèle économique dominant. L’expansion de la santé mentale soumet le champ de la psychiatrie (soins, accompagnement, social) à un processus industriel de traitement de la souffrance psychique. La santé mentale opère une normalisation puis une aseptisation du champ et s’impose de manière hégémonique. Les effets de formatage sur les pratiques sont multiples.
En France, ce dispositif de normalisation se construit. Il est composé d’agences de contrôle qui édictent des normes contraignantes, d’une politique gestionnaire au service de la démocratie libérale et sanitaire (autrement dit la forme contemporaine du capitalisme), d’outils informatiques et de recherche pour traiter la population en masse. La rationalisation des soins se fait de façon progressive au fur et à mesure des rapports gouvernementaux.
Des agences d’évaluation sont créées pour rationaliser l’offre de soin dans le sens d’une « bonne » gestion. En septembre 1989, le ministère de la Santé met en place l’Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale (ANDEM), « un organisme scientifique et technique indépendant qui a pour objet la conduite de toute action dans le domaine de l’évaluation médicale, des soins et des technologies médicales ayant un impact en termes de santé publique[11] ». Suite aux ordonnances Juppé de 1997, elle devient l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES). L’ANAES reprend les missions d’évaluation de l’ANDEM enrichies de nouvelles actions : « l’accréditation des établissements de soins, la nomenclature et l’évaluation d’actions et des programmes de santé publique. L’accréditation est une procédure externe à un établissement de soins, indépendante de celui-ci ou de ses organismes de tutelle, effectuée par des professionnels évaluant l’ensemble de son fonctionnement et de ses pratiques. Cette évaluation vise à assurer la sécurité et la qualité des soins donnés au malade et à promouvoir une politique de développement continu de la qualité au sein de l’établissement[12] ». L’ANAES sera remplacée à son tour par la Haute Autorité de santé (2004). À partir de cette évaluation présentée comme positive puisqu’elle est garante de la « qualité des soins », ces agences de contrôle auront pour rôle d’édicter des recommandations visant l’organisation des structures de soins, les pratiques de soins et la formation des professionnels. Dans cette version gestionnaire, l’évaluation est l’outil princeps pour orienter tous les domaines qui échappent encore à la norme concurrentielle. De façon plus spécifique, dans le champ de la santé mentale, c’est la santé publique qui sera le vecteur pour traiter en masse les nouvelles souffrances psychiques de la population et orienter les politiques.
***
La santé publique est un enjeu de gouvernement reconnu depuis longtemps. Elle va fournir des moyens et un cadre discursif pour en créer un nouveau, la santé mentale, qui, comme le répètent les documents officiels, est « une priorité de santé publique ». Comprendre comment et pourquoi la santé mentale devient une priorité de santé publique est un point central pour déconstruire ce discours récurrent et les pratiques qu’il engendre afin d’ouvrir à des alternatives possibles.
Les dix premières années du XXIe siècle voient publier quantité de documents relatifs à la santé mentale. L’OMS édite en 2001 une brochure qui fait le constat de divers problèmes mentaux censés s’accroître « considérablement » dans un futur proche :
« 450 millions de personnes de par le monde ont des problèmes mentaux, neurologiques ou comportementaux à un moment ou à un autre. Il est prévu que ces problèmes s’accroissent considérablement dans les années à venir. […] Les problèmes de santé mentale sont communs à tous les pays ; ils sont cause d’immenses souffrances humaines, d’exclusion sociale, d’incapacité et d’une qualité de vie médiocre. Ils augmentent également la mortalité et leur coût économique et social est effarant[13]. »
L’argument de santé publique (450 millions de personnes concernées) fait autorité et crée une obligation d’intervention.
Cette même année, l’OMS organise la deuxième édition de l’« Année mondiale de la santé mentale ». L’objectif est d’inscrire la santé mentale comme composante clé de la santé en général, de mobiliser l’ensemble des acteurs (politiques, sociétés civiles, professionnels) autour de cette thématique « trop longtemps négligée » en insistant d’une part sur « l’énorme fardeau humain et économique de la santé mentale » et d’autre part sur la perspective du « bien-être mental des populations ». Pour remplir ce double objectif, il est créé un programme d’action mondial pour la santé mentale qui va devenir un enjeu financier pour les gouvernements et un enjeu de légitimité pour l’OMS. Au niveau des États, la promotion de la santé mentale s’infiltre dans de nombreux domaines comme ceux de l’éducation, de l’emploi, de la justice, des transports, du logement, de l’environnement, de la protection sociale[14].
En janvier 2005, à Helsinki, 52 États membres de la région européenne de l’OMS signent « la déclaration et le plan d’action sur la santé mentale pour l’Europe ». L’axe économique est énoncé dans le préambule de la déclaration :
« La santé mentale et le bien-être mental sont des conditions fondamentales à la qualité de la vie, à la productivité des individus, des familles, des populations et des nations, et confèrent un sens à notre existence tout en nous permettant d’être des citoyens à la fois créatifs et actifs[15] ».
Deux autres textes sont particulièrement significatifs : « Le Livre vert. Améliorer la santé mentale de la population : vers une stratégie sur la santé mentale pour l’Union Européenne » et le « Pacte européen pour la santé mentale et le bien-être[16] ».
Le Livre vert paraît en octobre 2005, aboutissant à une résolution de la Commission européenne en septembre 2006 indiquant qu’« une bonne santé mentale est la condition de la bonne santé et du bien-être généraux des citoyens européens, mais aussi d’une bonne santé de la situation économique dans l’Union européenne ». La prise en compte de la santé mentale permet également « d’améliorer la disponibilité des ressources économiques ». Ce travail de lobbying portera ses fruits puisque dans le « Pacte européen pour la santé mentale et le bien-être », la santé mentale a l’honneur d’être érigée en droit inaliénable :
« La santé mentale est un Droit de l’homme. Elle est indispensable à la santé, au bien-être et à la qualité de la vie. Elle favorise l’apprentissage, le travail et la participation à la société ».
En France, plus récemment, les premières lignes du « Rapport parlementaire de la mission d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie », paru le 19 décembre 2013, établissent le constat suivant :
« Une personne sur quatre est susceptible de développer au cours de sa vie un trouble en santé mentale […] Nous sommes donc face à un véritable enjeu de santé publique[17]. » Plus loin : « Il n’en reste pas moins qu’au vu des taux de prévalence et du coût médico-économique, la santé mentale est un enjeu à la fois sanitaire, social et économique. C’est pourquoi elle figure au nombre des priorités fixées par la ministre des Affaires sociales et de la Santé dans le cadre de la stratégie nationale de santé présentée le 23 septembre 2013[18]. »
Cette démarche, qui consiste à faire une place à la santé mentale au sein de la santé publique, peut se résumer en plusieurs étapes.
Tout d’abord, un problème, qui n’était pas reconnu jusqu’alors, est identifié. Des données nouvelles, un nouvel intérêt stratégique ou politique, de nouveaux instruments de mesure concourent à la reconnaissance de ce problème. Le modèle épidémique est convoqué : il existe une épidémie qui est passée jusque-là inaperçue mais qui provoque des répercussions importantes sur la société, sur les individus et surtout sur l’économie. Or, il existe de nouvelles méthodes qui peuvent aider à résoudre le problème. Il faut s’attaquer au mal par la racine et mettre en place des dépistages précoces et larges dans de nombreux espaces sociaux. Pour cela, la recherche doit être financée afin de rattraper le retard accumulé et de mettre en place des procédures scientifiquement valides. Les discours médiatiques actuels sur l’autisme, les risques psychosociaux, l’hyperactivité ou les troubles bipolaires illustrent bien ce type de processus.
La campagne de 2013 « Santé mentale et troubles psychiques : Grande Cause nationale » s’inscrit dans ce type de discours :
« La santé mentale et les troubles psychiques constituent un enjeu majeur de société et de santé publique. En France, les pathologies relevant de la psychiatrie se situent au 3e rang des maladies les plus fréquentes. Principales causes d’invalidité et d’arrêt maladie en France, elles altèrent les aptitudes sociales, économiques, relationnelles de la personne souffrant de troubles psychiques. Elles ont donc un impact direct sur la vie du malade (souffrance, stigmatisation, désocialisation, perte d’emploi, précarisation…) mais également sur les proches (détresse, incompréhension, isolement, besoin de soutien…). Leurs retentissements sur la société sont d’une telle envergure que l’ONU a reconnu la Santé mentale comme une priorité internationale. En juin 2011, le Conseil de l’Union européenne a invité les États membres « à considérer la santé mentale et le bien-être comme une priorité sanitaire[19]».
Pour légitimer ce discours, les chiffres donnés sont toujours plus édifiants et construisent une problématique sociale :
« Les formes de mauvaise santé mentale les plus couramment observées dans l’Union européenne sont les troubles anxieux et la dépression. Celle-ci devrait devenir, d’ici à 2020, la première cause de morbidité dans l’ensemble des pays développés » ; « À l’heure actuelle, sur le territoire communautaire, quelque 58 000 personnes se suicident chaque année. Ce chiffre dépasse le nombre annuel des homicides ou des décès consécutifs aux accidents de la route ou au VIH/sida » ou encore : « La mauvaise santé mentale a de multiples répercussions. Elle coûte à l’Union européenne de 3 à 4 % du produit intérieur brut, essentiellement par suite d’une perte de productivité. Les démences sont l’une des principales causes des départs à la retraite anticipés ou des mises en invalidité. Les troubles de la conduite et du comportement qui surviennent durant l’enfance entraînent des dépenses pour les systèmes social, éducatif, pénal et judiciaire. »
Nous voyons ici comment la santé publique construit son discours à partir de l’épidémiologie. Elle crée des données chiffrées utilisables par les gouvernants et perçues comme scientifiques et donc incontestables par le grand public. Autre exemple :
« Les troubles mentaux représentent près de 12 % de la charge de morbidité mondiale et, d’ici à 2020, ils seront responsables de près de 15 % de la perte d’années de vie corrigées de l’incapacité. C’est chez les jeunes adultes, tranche d’âge la plus productive de la population, que cette charge est maximale. Dans les pays en développement, les troubles mentaux risquent d’augmenter de façon disproportionnée dans les décennies à venir. Les personnes atteintes de troubles mentaux sont l’objet de stigmatisation et de discrimination dans toutes les parties du monde[20]. »
Ces arguments de santé publique, servant aussi bien dans le champ de la santé mentale psychiatrique que dans le champ de la santé mentale positive[21], renforcent la légitimité et l’impact de la nécessité d’une intervention politique qui n’est donc plus vécue comme un choix mais comme le résultat d’une obligation intimée par les progrès de la science. Mais sur quelles données se base-t-on pour créer ces statistiques édifiantes : 20 à 25 % de la population concernée, 3 à 4 % du PIB impacté, etc. ?
***
La santé publique entre dans une démarche dite scientifique dont l’analyse et l’action s’inscrivent dans un projet politique. Donner la priorité à tel ou tel thème de prévention ou de recherche est, en soi, un choix politique. Aujourd’hui « les priorités de santé publique » s’imposent dans le débat public comme des données naturelles indiscutables. De nouveaux thèmes apparaissent au fur et à mesure du temps à grand renfort de documentaires télévisés, comme le harcèlement à l’école, les troubles « dys » (dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, etc.).
Or ces priorités de santé publique sont décidées par les instances politiques. En appelant la science comme instance de légitimation de cette politique, c’est à la naissance de « la politique fondée sur les preuves » que nous assistons[22]. En témoigne cette déclaration des différents ministres de la Santé de l’OMS Europe en 2006 : « Nous souscrivons à l’idée selon laquelle il ne peut y avoir de santé sans la santé mentale. La santé mentale étant une composante centrale du capital humain, social et économique des nations, elle doit donc être considérée comme une partie intégrante et essentielle d’autres domaines d’intérêt public tels que les droits de l’homme, l’aide sociale, l’éducation et l’emploi. Par conséquent, nous, ministres responsables de la santé […] nous engageons à reconnaître le besoin d’adopter des politiques de santé mentale intégrées et fondées sur des preuves scientifiques[23] ».
On ne pourrait être plus clair.
Dans cette perspective, le concept de « santé mentale publique », apparu quelques années plus tôt au Canada, est l’aboutissement de la logique de « santé mentale, priorité de santé publique ». Une organisation non gouvernementale comme « Mental Health Europe », créée en 1985 et active à différents niveaux comme il est indiqué sur son site Internet[24], précise clairement les enjeux du réagencement stratégique de la santé publique pour créer une « santé mentale publique » :
« La santé mentale publique est un cadre conceptuel destiné au développement de politiques et de pratiques en faveur de la promotion d’une santé mentale positive, de l’identification précoce des problèmes de santé mentale, de la réduction de l’incidence de la maladie mentale et du suicide […] La promotion de la santé mentale couvre tout un ensemble de stratégies, que l’on peut classer en trois catégories selon leur sphère d’intervention : 1) Individu – en encourageant la personne à développer ses ressources, son estime de soi, sa capacité d’adaptation, son autonomie. 2) Collectivité – en augmentant l’inclusion sociale et la cohésion, en développant des structures de prise en charge qui promeuvent la santé mentale dans différentes enceintes, par exemple à l’école et sur le lieu de travail. 3) Gouvernement – en réduisant les obstacles socio-économiques à la santé mentale au niveau national[25]. »
En silence, le renversement qui s’opère est le suivant : les gouvernements renoncent au politique pour se soumettre aux exigences de « la science » promue par certains experts (personnalités médiatiques, scientifiques, fondations, lobbys, etc.) à grand renfort de données et de statistiques « objectives ». Cependant, pour aborder un problème particulier, il existe toujours plusieurs angles d’attaque possibles, suivant la méthodologie usitée, le courant scientifique dans lequel on s’inscrit, l’idéologie par laquelle on est traversé, etc. Les sciences construisent leurs objets de recherche de multiples façons mais ne sont pas déprises du contexte dans lequel elles se situent (que ce soit pour obtenir un financement ou pour se créer une légitimité auprès de la communauté scientifique, du grand public et des politiques). Toute donnée scientifique a donc une dimension construite suivant sa façon de découper le réel, de l’analyser et de le partager en dehors de la communauté scientifique. Cela s’applique aussi à la santé publique.
Idéalement, toutes les conclusions de recherches pouvant être utiles pour gouverner devraient être mises en question, dans une perspective critique, par les décideurs politiques. La décision serait prise après avoir soumis les travaux au débat démocratique, elle ne serait pas immédiatement court-circuitée par l’autorité des experts[26]. De manière générale, il existe un raccourci flagrant entre les conclusions d’un domaine de connaissance et de recherche, ses résultats et ses applications, et la décision politique. L’instrumentalisation des avancées d’un domaine comme celui de la santé publique se fait au profit d’intérêts divers, qu’ils soient politiques, de légitimité, de lobbying… Les décideurs politiques abandonnent alors leur rôle pour de telles « évidences scientifiques » et leur vérité révélée.
La science, dans son agencement et ses applications, constitue un vecteur de dépolitisation voire d’apolitisation. Si « les statistiques ne mentent pas[27] », il est possible de les utiliser au gré de la vérité que l’on souhaite mettre en valeur[28]. Pour autant, cette place centrale de la santé publique dans un ensemble toujours plus vaste de domaines indique qu’il y a eu une mutation de sa fonction de manière à ce qu’elle soit sollicitée en permanence. La santé publique est l’instrument qui, à l’échelle de la population, peut intervenir directement sur le corps de chaque individu. En intégrant la santé mentale à la santé publique, le biopouvoir pourra agir sur les âmes, ce qui intéressera d’autant plus la rationalité néolibérale. C’est sur cette toile de fond du santé-mentalisme qu’est inscrite la santé mentale au rang des « priorités de santé publique ».
En France, des fondations et des instituts sont créés, certains subventionnés par l’État, pour que le modèle industriel et biopolitique de la santé mentale se diffuse auprès du grand public : c’est le cas de la fondation FondaMental, qui est un des instruments officiels pour fonder les politiques publiques sur les « preuves » supposées de la science.
Poussée par la « démocratie sanitaire[29] » et le contexte mondial d’expansion de la santé mentale, à partir de 2001, la psychiatrie française doit, elle aussi, aller « vers la santé mentale[30] ». Ce qui implique une homogénéisation des pratiques par le biais de protocoles et de choix en termes de financements et d’orientations de santé publique. En 2007, à l’instar de la fondation Alzheimer pour les démences et de différentes fondations pour le cancer, l’État finance à hauteur de plusieurs millions d’euros la création de la fondation FondaMental qui a pour objet « le soutien à la recherche scientifique en santé mentale ». Le but est de « 1) animer un réseau national de centres experts pour permettre des diagnostics exhaustifs (psychiatrique, somatique, cognitif, social et professionnel) et le dépistage de trois pathologies : troubles bipolaires (maladie maniaco-dépressive), schizophrénie, syndrome d’Asperger (autisme de haut niveau) ; 2) développer la recherche en santé mentale ; 3) former et informer les professionnels et le grand public sur les maladies mentales[31]. »
Sa présidente, Marie-Anne Montchamp, expose le projet politique présent derrière ces prétentions à une recherche scientifique, « qui est de créer les conditions pour que la personne puisse produire à sa manière avec ses stratégies propres, pour parvenir au résultat que l’on attend d’elle[32]. » On ne saurait mieux définir la gouvernementalité.
Dans toute la France des centres prétendument experts émergent, qui conçoivent les pathologies mentales comme analogues aux pathologies somatiques dans leur acception la plus organiciste. Le modèle diagnostique et thérapeutique sera le même que celui actuellement promu pour des maladies chroniques comme le cancer, le diabète, l’obésité. Le but est de mettre en place des diagnostics et des interventions précoces de type médicamenteux (avec par exemple la prescription de neuroleptiques pour les adolescents présentant un « syndrome pré-psychotique »). Une fois diagnostiquée, la personne n’a pas d’autre choix que de considérer sa maladie comme chronique, de prendre un traitement « à vie » et de bénéficier d’une « psychoéducation » et d’une « éducation thérapeutique » pour bien prendre ses comprimés. Les laboratoires pharmaceutiques créent des associations et des formations pour expliquer à ces patients rendus captifs l’intérêt de prendre et donc d’acheter les traitements quotidiennement. La collusion entre la plupart des services universitaires de psychiatrie et les laboratoires pharmaceutiques est à son comble.
Ce courant dominant valorise la recherche tournée exclusivement vers le cerveau qui devient l’organe de référence des troubles de santé mentale. Au psychisme est substitué le cerveau, à la psychiatrie est substituée la neurologie. C’est dans ce contexte que les questions de santé mentale deviennent l’un des points d’action de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), créé en 2006 sur le site de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Jamais totalement abandonnées, les hypothèses d’organicité des troubles mentaux poursuivent leur retour en force, grâce à l’essor d’un discours triomphaliste dont témoigne le professeur Marion Leboyer, directrice scientifique de la fondation FondaMental :
« Si la piste immuno–inflammatoire ouvre une nouvelle perspective de compréhension de certaines maladies psychiatriques, elle ouvre aussi de réelles perspectives de traitements novateurs pour ces maladies. L’aspirine ou certains AINS (anti-inflammatoires) sont ainsi étudiés en traitement adjuvant dans la schizophrénie ou les troubles bipolaires, en attendant peut-être des traitements plus spécifiques[33]. »
L’imagerie cérébrale (IRM fonctionnelle notamment) associée à la recherche génétique est censée permettre la révolution qui trouvera ces nouvelles pistes diagnostiques et thérapeutiques pour la santé mentale, axée sur le cerveau en tant qu’organe.
Par ailleurs, un angle de développement porteur du santé-mentalisme sera le lien entre santé mentale et travail. Dans le documentaire de Philippe Borrel, Un monde sans fous[34], le directeur de Manpower intervient à un congrès de promotion de FondaMental pour expliquer que ce n’est pas tellement le changement qui pose problème mais plutôt la façon dont l’individu s’y adapte. On voit ici à quel point les discours sur la santé mentale positive sont au service de l’entreprise de soi.
Les politiciens français s’appuient de plus en plus sur cette vision partielle des affaires psychiatriques. Un rapport de l’Office parlementaire pour l’évaluation des politiques publiques (OPEPS) reprend à son compte l’ensemble de l’idéologie de la santé mentale standardisée, promue par FondaMental, pour faire de la psychiatrie « une médecine de pointe[35] ». Dans la lettre introductive à ce rapport, le sénateur Alain Milon écrit :
« Le mouvement de mai 68, porteur notamment de ces critiques, a tenté d’émanciper la psychiatrie des pratiques chirurgicales inadaptées et d’une vision jugée trop étroite de la maladie. Il a abouti, par l’arrêté du 30 décembre 1968, à la séparation de la psychiatrie et de la neurologie auparavant réunies au sein de la neuropsychiatrie. Cette division en deux spécialités se révèle aujourd’hui regrettable en raison de la révolution qu’ont connue les neurosciences et l’imagerie médicale et des connaissances acquises depuis lors dans ces disciplines. Leurs applications pratiques dans le traitement des maladies mentales commencent déjà à apparaître, notamment dans le cas de l’autisme. À l’inverse, les pratiques des psychiatres, des infirmiers psychiatriques et des psychologues exerçant en clinique sont mal connues et souvent dénoncées au nom de stéréotypes anciens dont tous, malheureusement, ne sont pas dépourvus de fondement[36]. »
Si l’ère sarkozyste a pour programme de liquider l’héritage de mai 68, cela se traduit, pour la psychiatrie, par son retour dans le giron de la neurologie avec la supposée avancée des neurosciences. Mais en dépit de ces déclarations, aucun progrès important ne s’est traduit concrètement dans les pratiques. Instiller la suspicion sur ce qui fut des pratiques émancipatrices permet de s’en débarrasser à bon compte pour laisser la place à une santé mentale industrielle et formatée.
Ainsi les politiques publiques appuient la refonte du secteur sur le dispositif de la nouvelle santé mentale en désavouant tout ce qui n’est pas compatible avec elle. Cependant l’influence de ces modèles basés sur les neurosciences dépasse la sphère de la santé mentale puisque le Centre d’analyse stratégique va s’appuyer sur les travaux de recherche en neurosciences pour penser ses campagnes de prévention (la neuro-santé publique)[37], la réforme du système pénal (les neurolois)[38] voire pour soutenir une nouvelle sous-branche de l’économie (la neuro-économie). Ainsi le cerveau devient un nouvel enjeu pour gouverner et fonder une neuropolitique[39].
De leur côté, les professionnels de santé se voient proposer des formations initiales et continues imprégnées de cette vision réductrice et gestionnaire de la psychiatrie. Le leitmotiv est toujours le même : améliorer la qualité des soins, mettre en place des procédures d’acquisition de compétences certifiées et transparentes, traçables et évaluables. Depuis 2013 le Développement professionnel continu (DPC) est instauré avec pour fonction de centraliser les offres de formations continues, de former les professionnels aux modèles et compétences validés par la Haute Autorité de santé (HAS). Toutes les formations ou pratiques n’entrant pas dans le moule du DPC sont sommées de disparaître ou de s’aligner sur le modèle dominant de la santé mentale industrielle. Cela concerne notamment toutes les pratiques progressistes nées depuis l’après-guerre, et bien évidemment la psychanalyse.
Notes
[1] La collusion de l’American Psychiatric Association avec l’industrie pharmaceutique n’est plus à démontrer. Stuart Kirk et Kutchins Herb, Aimez-vous le DSM ? : le triomphe de la psychiatrie américaine, Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo pour le progrès de la connaissance, collection « Les empêcheurs de penser en rond », 1998.
[2] François Gonon, « La psychiatrie biologique : une bulle spéculative ? », in Esprit, novembre 2011, p. 54-73.
[3] Voir le mouvement « Stop DSM » créé et animé par Patrick Landman à l’occasion de la parution du DSM-5 en 2013.
[4] Un neuroleptique retard, la palipéridone, qui n’apporte rien de nouveau dans la palette thérapeutique, coûte 509 euros par mois au plus haut dosage (150 mg) alors qu’un traitement de référence comme l’halopéridol décanoate coûte moins de 20 euros ! Disponible en ligne < http://www.vidal.fr/Medicament/xeplion-106106-prescription_delivrance_prise_en_charge.htm > (dernière consultation le 7 janvier 2014).
[5] « Duloxétine – Cymbalta°. Dépression, neuropathies diabétiques : trop d’effets indésirables », in Prescrire, 2006, tome XXVI, n° 274, p. 486.
[6] « Effets indésirables métaboliques de l’olanzapine : procès en cascade aux États-Unis », in Prescrire, 2008, tome XXVIII, n° 293, p. 224-226.
[7] Patrick, Coupechoux, La Déprime des opprimés : enquête sur la souffrance psychique en France, Paris, Le Seuil, 2009.
[8] Direction générale Santé et protection des consommateurs de la Commission européenne, Livre vert, « Améliorer la santé mentale de la population : vers une stratégie sur la santé mentale pour l’Union européenne », Bruxelles, 14 octobre 2005. Disponible en ligne < http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_fr.pdf > (dernière consultation le 14 décembre 2013).
[9] Yves, Clot, Le Travail à cœur : pour en finir avec les risques psycho-sociaux, Paris, La Découverte, 2009.
[10] Marie-Joëlle Gros, « Chaud divan ! », in Libération, 21 janvier 2009. Disponible en ligne < http://www.liberation.fr/vous/2009/01/21/chaud-divan_304268 > (dernière consultation le 8 janvier 2014).
[11] Claire Chabannes-Gurvil, « ANDEM/ANAES. Fonds de l’évaluation médicale (1987-2000) ». Disponible en ligne < http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/andem_anaes.pdf > (dernière consultation le 10 janvier 2014).
[12] Ibid.
[13] Organisation mondiale de la santé, Département santé mentale et toxicomanies. Groupe des maladies non transmissibles et santé mentale. Disponible en ligne < http://www.who.int/mental_health/media/en/398.pdf > (dernière consultation le 15 décembre 2013).
[14] OMS, Aide-mémoire 220, « La santé mentale : renforcer notre action », septembre 2010.
[15] Organisation mondiale de la santé, « Déclaration sur la santé mentale pour l’Europe. Relever les défis, trouver des solutions ». Disponible en ligne < http://www.who.int/mental_health/media/en/398.pdf > (dernière consultation le 15 décembre 2013).
[16] Union européenne, « Pacte européen pour la santé mentale et le bien-être ». Disponible en ligne < http://ec. europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_fr.pdf > (dernière consultation le 13 décembre 2013).
[17] Commission des Affaires sociales, rapport concluant la mission sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie, p. 7. Disponible en ligne < http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1662.asp > (dernière consultation le 10 janvier 2014).
[18] Op. cit., p. 9.
[19] http://www.santementale2014.org
[20] « La Situation de la santé mentale », in Guide des politiques et des services de santé mentale, Organisation mondiale de la santé, 2004, p. 1. Disponible en ligne < http://www.who.int/mental_health/policy/Situation_de_sante_mentale_final.pdf > (dernière consultation le 8 janvier 2013).
[21] Voir le chapitre « La santé mentale positive ».
[22] Communication orale de Pierre Dardot lors des Assises pour l’hospitalité en psychiatrie et dans le médico-social, organisées par le collectif des 39 et les CEMEA, Villejuif, 1er juin 2013.
[23] OMS Europe, « Santé mentale. Relever les défis, trouver des solutions », 2006. Disponible en ligne < http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/98918/E88538.pdf > (dernière consultation le 10 janvier 2014).
[24] Http://www.mhe-sme.org/fr/a-propos-de-sante-mentale-europe/qui-nous-sommes.html
[25] Http://www.mhe-sme.org/fr/notre-travail/promotion-de-la-sante-mentale-et-prevention-des-troubles/promotion-de-la-sante-mentale-cadre-conceptuel.html.
[26] Didier Tabuteau, « Les interdictions de santé publique », in Les Tribunes de la santé, 2007/4, n° 17, p. 21-38.
[27] Http://www.articles-lib.com/statistiques-de-tdah-ne-mentent-pas-connaitre-les-faits-afin-que-vous-pouvez-prendre-les-bonnes-decisions.html.
[28] Il suffit de penser aux statistiques sur la délinquance, le chômage et leurs utilisations dans les débats politiques.
[29] Jean-Luc Roelandt, « La démocratie sanitaire dans le champ de la santé mentale. La place des usagers et le travail en partenariat dans la cité », rapport remis à la ministre déléguée à la Santé, avril 2002. Disponible en ligne < http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/024000189/0000.pdf > (dernière consultation le 10 janvier 2014).
[30] Éric Piel et Jean-Luc Roelandt, « De la psychiatrie vers la santé mentale », rapport de mission, juillet 2001. Disponible en ligne < http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000522/0000.pdf > (dernière consultation le 10 janvier 2014).
[31] Http://www.centre-francais-fondations.org/annuaire-des-fondations/2191.
[32] Philippe Borrel, Un monde sans fous, Nîmes, Champs social, 2010.
[33] Christian Trichard, Immuno-inflammation : une nouvelle piste pour comprendre les troubles de l’humeur et le troubles psychotiques, Congrès français de psychiatrie, 2013. Disponible en ligne < http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/congres-paris-2012/immuno-inflammation-une-nouvelle-piste-pour-comprendre-les-troubles-de-lhumeur-et-les-troubles-psychotiques/ > (dernière consultation le 16 décembre 2013).
[34] Philippe Borrel, Un monde sans fous, documentaire, 2010, 52 minutes.
[35] Office parlementaire pour l’évaluation des politiques publiques, « Rapport sur la prise en charge psychiatrique en France », 2009. Disponible en ligne < http://www.senat.fr/rap/r08-328/r08-3281.pdf > (dernière consultation le 16 décembre 2013).
[36] Alain Milon, Rapport pour l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé, « La psychiatrie en France : de la stigmatisation à la médecine de pointe », 2009. Disponible en ligne < http://www.senat.fr/rap/r08-328/r08-328_mono.html > (dernière consultation le 10 janvier 2014).
[37] Http://www.strategie.gouv.fr/content/programme-%C2%AB-neurosciences-et-politiques-publiques%C2%BB-du-centre-d%E2%80%99analyse-strategique#para-2.
[38] Centre d’analyse stratégique, « Analyse : impacts des neurosciences. Quels enjeux éthiques pour quelles régulations ? », in Note de veille n° 128, mars 2009, 10 p.
[39] Centre d’analyse stratégique, séminaire « Crise financière, les éclairages de la neuroéconomie et de la finance comportementale », 14 avril 2009.









