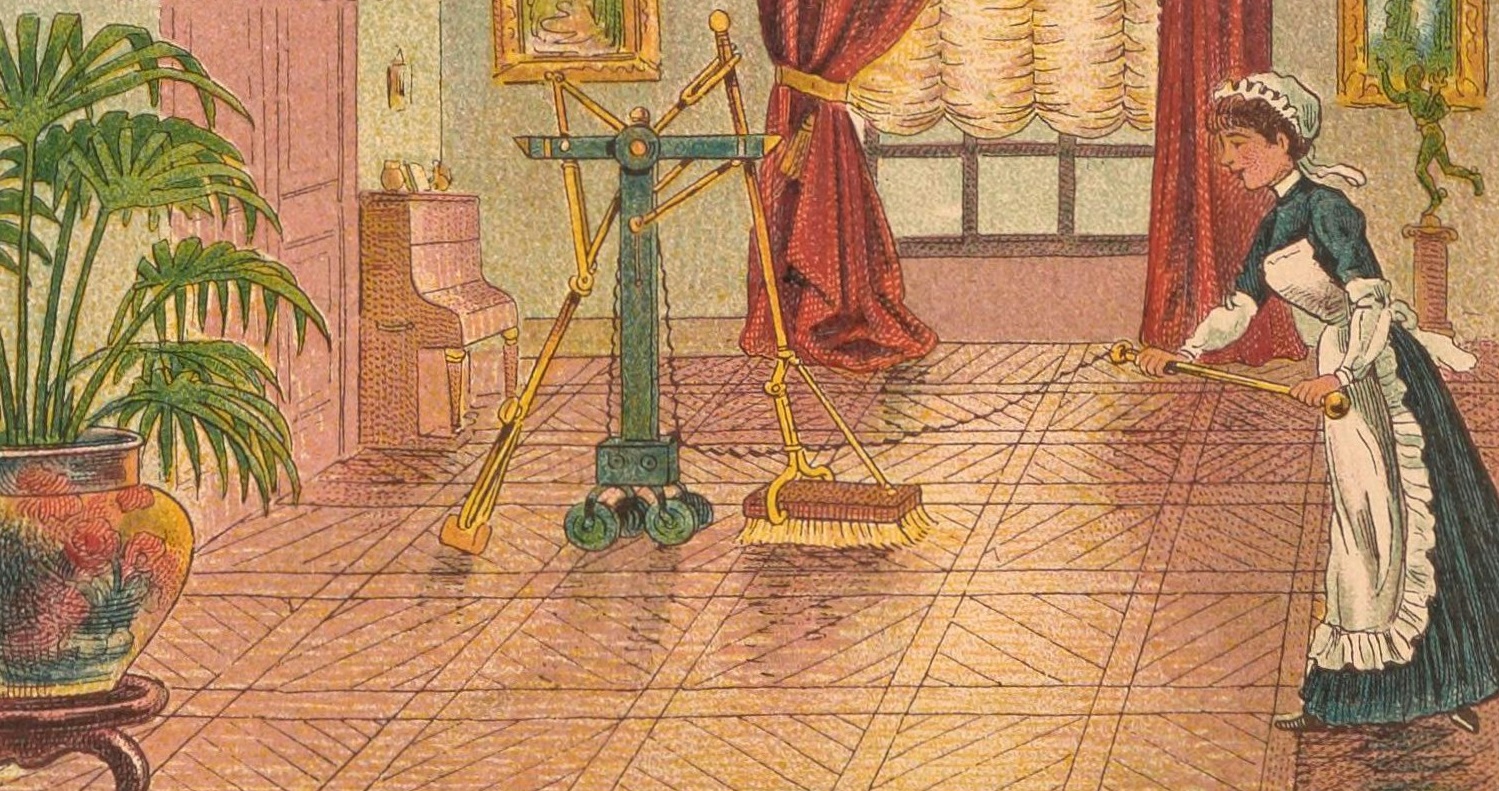
Résistances du travail sensible
La critique de l’exploitation n’est pas seulement un exercice théorique. Elle s’exerce également dans la pratique, par exemple lorsque des salariées s’écartent des exigences managériales qui les éloignent de ce qui fonde leur travail. Elles tentent alors de redéfinir les finalités de leur activité. On découvre au travers de leurs récits comment des pensées et des pratiques autonomes s’élaborent à l’hôpital, dans des consultations psychosociales, dans le nettoyage…
C’est sur de tels récits que s’appuie Nicolas Latteur, sociologue, auteur de Critique populaire de l’exploitation. Ce que devient le travail, Éditions Le Bord de l’eau, 2023, dont est extrait ce texte, pour analyser les transformations en cours, les formes contemporaines de management, les politiques néolibérales et les résistances qui leur font face.
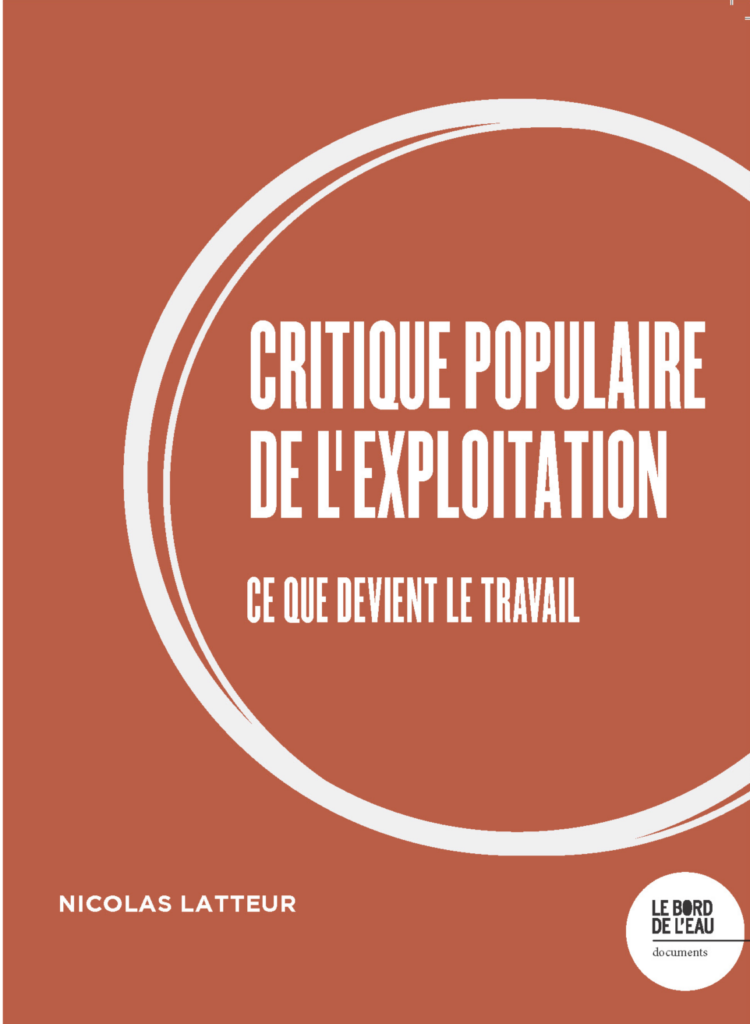
La réflexivité s’avère indispensable à la préservation de la santé et à la construction de perspectives d’émancipation. Souvent confrontées à des situations douloureuses, les professionnelles revendiquent des espaces d’échange et entendent recréer des collectifs. Elles font l’objet de formes de disqualification et de mépris. Mais cela ne les empêche pas d’investir ce que deviennent le travail du care et de reproduction sociale. Elles naviguent entre contraintes, subordinations, dominations, autonomies et affirmations de leurs qualifications.
Des salariées mettent en question les approches promues dans les institutions. Porteuses d’autres conceptions, elles s’invitent dans le champ politique, là où se règlent des modes de relation et de traitement des populations.
Autonomie et engagements multiples
Tout à la fois source de réalisation de soi, de passion, de désillusion ou de ressentiment, investi d’idéaux et chargé de contraintes, le travail ne se limite jamais à une tâche à exécuter. Les salariées s’y impliquent et se confrontent à de nombreuses contradictions. Leurs savoirs se heurtent fréquemment à des normes promues par des réorganisations incessantes. Les travailleuses tentent néanmoins de se réapproprier le contenu de leur travail. L’activité autonome des équipes est souvent prise à partie par les pratiques d’une bureaucratie managériale qui ne voit qu’une addition d’individus dont il faudrait standardiser les performances.
Mais cette autonomie n’en est pas pour autant brisée. Des réponses se construisent. Elles tentent de pallier la carence des moyens disponibles ou transgressent des prescriptions jugées illégitimes. Elles s’inventent aussi pour protéger des situations les plus confrontantes ou pour donner vie à un engagement personnel et politique.
Cette autonomie nécessite souvent la mise à distance des hiérarchies formelles. Elle est au cœur d’un processus de réappropriation. C’est dans celui-ci que se joue la constitution d’une identité sociale. Elle est toujours précaire car sa légitimité peut être mise en cause.
« J’embellis »
La créativité s’avère indispensable. Caroline a 63 ans et preste [accomplir une tâche ou un service] entre 50 et 60 heures par mois comme « technicienne de surface » dans un centre funéraire pour compléter son revenu mensuel de 900 euros. Cela lui permet d’obtenir un complément de 350 euros par mois. Les tâches sont répétitives mais nécessitent une attention importante.
« Je lave les sols et je prépare la chambre funéraire pour que l’on puisse accueillir le défunt et sa famille dans de bonnes conditions. Je vais souvent aussi voir dans les pièces, même quand les personnes sont là, s’il n’y a pas quelque chose à y faire, comme enlever quelques feuilles qui sont tombées des gerbes par exemple. Quand je nettoie, c’est à quatre pattes avec une serpillière, en faisant les coins. J’embellis, ce n’est pas comme les jeunes qui prennent juste la raclette. Moi, c’est à l’ancienne. Je veux que les gens soient bien quand ils arrivent dans la pièce. »
La confrontation avec la mort est quotidienne.
« C’est douloureux. On voit des familles abasourdies. On a plein de situations tragiques. On a eu une dame qui était enceinte. Elle a perdu son fœtus après 15 semaines. L’année d’après, elle a vécu la même chose après 17 semaines de grossesse. Vous êtes là et vous voyez ce petit cercueil. C’est dur et ça fait mal. »
Comment faire pour rester vivante parmi les morts ? Caroline invente à partir de ce qu’elle éprouve et des engagements éthiques qui fondent son travail.
« Il y a des gens qui vont dire que ce que je fais n’est pas normal. Moi, quand je vois un mort, je lui parle ou je chante. Je dis “bonjour Monsieur, comment est-ce que vous allez ? Vous êtes quand même parti tôt. Tu es bien habillé. Je vais bien te remettre tes fleurs”. Quand je quitte la pièce, je lui dis “à demain, si on se voit encore”. Évidemment, je sais qu’il ne va pas me répondre. »
Caroline considère qu’il est important pour elle de ne pas s’effondrer à chaque fois qu’elle rentre dans une chambre funéraire en se disant « en voilà encore un qui est parti. Si je fais cela, cela va me poursuivre. Je vis seule et je n’ai personne à qui me confier. C’est la manière que j’ai trouvée pour que cela soit vivant et pour ne pas avoir le moral à zéro ».
Freddy, 59 ans, est ouvrier dans une entreprise de pompes funèbres. Le métier est lui aussi confrontant. Il met également en place des pratiques pour se protéger et prendre soin des défuntes et de leurs familles.
« Le métier d’ouvrier dans des pompes funèbres est confrontant. On y côtoie quotidiennement des cadavres. Le soin apporté aux défunts est au cœur de la déontologie que nous nous construisons. Il faut bien évidemment apprendre à s’occuper d’un défunt. On doit également savoir comment s’adresser aux familles mais aussi accomplir des démarches administratives. Quand on doit s’occuper d’un cadavre, il faut faire les soins : le laver, l’habiller et faire la mise en bière. Quand vous vous occupez d’un corps, vous devez y aller. Lorsque sa bouche est ouverte, tout risque de ressortir. Mon travail consiste aussi à ouvrir et fermer les caveaux. Je dois ouvrir le marbre, puis la porte et entrer dans le caveau. Je dois regarder s’il y a des réparations à faire ou s’il y a à cacher. On peut retrouver des gens momifiés parce que le cercueil est passé outre et qu’il n’y a plus rien. »
Il s’agit d’inventer ce qui rendra psychiquement supportable la proximité avec la mort.
« Je n’ai pas été habitué à rencontrer cela. J’ai appris à ne pas photographier ce que je fais pour oublier. Je savais qu’un jour je tomberais en ouvrant un caveau sur un cadavre momifié, sur le squelette d’une personne, ou sur un corps qui n’est pas en décomposition. C’est ce qui m’est arrivé. J’ai eu face à moi une famille complète. Je suis un être humain alors j’ai regardé leurs noms. J’ai dit au père de famille “voilà Joseph, je vois que tu es né en 61. Je venais de naître et je ne te connaissais pas”. J’ai ensuite dit “condoléances” à tout le monde. C’est une façon d’extérioriser ce que l’on vit et de ne pas penser à ce que l’on fait. Quand je m’occupe d’un défunt, je lui parle par respect et parce que c’est une façon d’extérioriser ce que je vis. Je peux ensuite arrêter à la fin de la journée sans être poursuivi par ce que j’ai vu. »
Caroline va intervenir également sur la manière dont les familles sont accueillies dans le centre funéraire.
« Moi, souvent, lorsque je ferme les pompes funèbres, je me retrouve face à des gens qui sont face à la porte d’entrée et qui cherchent des renseignements. Ma patronne m’a dit que je ne pouvais pas leur ouvrir. Mais je ne vais quand même pas regarder les gens et leur montrer un numéro de téléphone sur une affiche. Je ne saurais pas faire comme ça. J’ouvre la porte et je demande si je peux aider. Je les fais entrer et je vais chercher la patronne. J’attends parfois avec eux. C’est l’occasion pour qu’une personne me dise : “Mon fils est parti.” Je tente alors de la réconforter. »
L’implication de Caroline la conduit à redéfinir fondamentalement les tâches qu’elle effectue. Son travail ne consiste pas seulement à exécuter des actes techniques. Il se construit à partir de perceptions sensibles et de valeurs morales. Elle inclut différentes questions pour en redéfinir l’objet et l’utilité : comment prendre soin des défuntes et de leurs familles, comment se protéger de la confrontation avec la mort, comment contribuer à apaiser des personnes touchées par le deuil, comment prendre part à l’organisation du service… Avec Caroline, l’utilité de l’activité est en jeu, la redéfinition de ses finalités et le sens même de ses gestes sont réfléchis.
Cet investissement subjectif est au cœur d’une multiplicité d’engagements moraux, psychiques, personnels, politiques, etc. D’autres professions du care et d’autres emplois liés à la reproduction sociale en témoignent.
Aider, protéger et défendre
Corinne est aide-familiale dans un service de soins et d’aide à domicile. La proximité qu’elle peut construire avec les bénéficiaires est déterminante. Elle situe l’utilité de son travail dans les liens sociaux qu’il crée et dans la promotion des droits des populations qui éprouvent des difficultés à les exercer.
« On a un travail très relationnel avec souvent un public fort fragilisé. Nous avons des gens qui n’ont ni famille ni enfants. Nous sommes alors leur seul lien. Certaines personnes sont du quart-monde. On a aussi des gens qui sortent tout juste de l’hôpital, notamment durant la période Covid, où les hôpitaux ont été surchargés. Nous avons des familles nombreuses. Il y a aussi beaucoup de personnes âgées, de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques et qui sortent d’institutions. Des femmes enceintes qui doivent rester alitées et que nous venons aider. C’est comme si on faisait partie de la famille, on y est inclus. »
Le travail d’aide familiale peut s’inscrire dans la défense des droits de personnes qui ne les connaissent pas et qui n’en ont jusqu’ici pas été informées.
« On a des personnes qui sont aussi parfois très peu informées de leurs droits. On a eu un couple de personnes âgées. Le monsieur souffrait d’un cancer. Il avait droit à des remboursements plus importants de ses soins étant donné ses revenus. Mais il n’était pas au courant et payait des sommes importantes en plus. Cela fait partie de nos tâches de guider les gens pour qu’ils exercent leurs droits. »
Bien plus que nettoyer
Maria a 58 ans. Elle se définit comme « femme d’ouvrage » même si la direction de la maison de repos pour personnes âgées de la région liégeoise qui l’emploie l’appelle « auxiliaire d’entretien ». Elle a préféré mener l’activité de nettoyage en maison de repos. Elle lui permet de rencontrer ses propres aspirations. « J’ai choisi de travailler en maison de repos pour le contact humain. Les résidents m’apportent plein de choses et moi aussi je peux leur en apporter. On a un travail qui dépasse largement la mission d’entretien qui nous est confiée. Quand une résidente est perdue, je viens près d’elle. Je lui demande si elle cherche quelque chose. Je la guide jusqu’à sa chambre tout en la rassurant. Il arrive qu’un résident quelque peu désorienté s’inquiète de savoir s’il peut rester dormir à la maison de repos. Un jour, une dame m’a dit : “Qu’est-ce que je ferais sans toi ?” Cette complicité est possible parce que l’on se connaît depuis longtemps. C’est là un aspect important ! »
Cet engagement relationnel est souvent ignoré, notamment par sa direction. Cette méconnaissance peut garantir un espace de liberté mais également témoigner d’une forme de mépris. « Durant la pandémie, notre direction a remercié le personnel soignant ou les ergothérapeutes. Ils faisaient bien évidemment un travail formidable envers les résidents. Mais elle nous a complètement oubliés alors que nous étions en première ligne, à être également très attentives aux personnes, à vouloir leur remonter le moral. »
Des savoirs pratiques se constituent pour rencontrer des besoins qui ne peuvent être appréhendés que grâce à une présence de tous les instants qui est justement l’apanage de professions telles que celles du nettoyage, de l’aide à domicile, etc.
Sexologie, mutations sociales et militance
L’engagement peut s’accompagner d’une réflexion sur les représentations du public rencontré. Nathalie est sexologue dans un Centre de Planning Familial (CPF) en Wallonie. « J’ai des consultations individuelles dans ce cadre. Je suis accueillante IVG parce que j’accompagne des femmes et des couples en demande d’avortement. Je suis animatrice dans des activités d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. »
L’implication professionnelle vise à la promotion de droits et à l’accompagnement dans des dynamiques émancipatrices.
« J’adore le travail que je fais avec les patients, j’ai vraiment l’impression de leur redonner du pouvoir. Cela peut être des personnes qui sont dans des situations de domination conjugale. Elles peuvent reprendre confiance en elles et reprendre leur vie en main. Elles arrivent à s’exprimer et à s’affirmer. Cela peut aussi permettre à des personnes, lors de consultations sexologiques, de s’interroger sur leur sexualité et prendre leurs distances par rapport aux normes qui imposeraient à quelqu’un de devoir nécessairement donner du plaisir, en avoir, ou être performant. Je travaille pour leur permettre d’être à l’écoute de ce qu’elles ressentent et de construire leur sexualité en accord avec qui elles sont et non pas en fonction des normes en vigueur. Redonner du pouvoir aux gens peut aussi passer par le fait d’aider quelqu’un à s’approprier sa décision d’IVG, de lui donner du sens, de comprendre dans quel contexte s’exprime cette demande d’avortement afin que cela ne soit pas qu’un acte. J’ai remarqué que la demande d’IVG n’arrive généralement pas par hasard dans la vie des femmes et des couples. Cela vient dire des choses. Comment elles se vivent en tant que femme ? Leur redonner du pouvoir, c’est leur permettre de pouvoir être à l’écoute de ça. »
Comment rencontrer les demandes des personnes qui s’adressent au Centre de planning ? Comment comprendre leurs réalités ? Comment prendre part à des dynamiques émancipatrices ? Ces questions nécessitent un cheminement qui est au cœur de son engagement professionnel. « On est dans une société à mutations rapides. On a besoin d’un regard extérieur pour pouvoir appréhender la manière dont les patients abordent toutes une série de questions affectives, relationnelles et sexuelles. Par rapport à la sexualité, il y a le développement des nouvelles technologies qui font que les personnes se construisent différemment. Elles structurent leurs identités ou vivent leur sexualité à travers notamment internet et les réseaux sociaux. On doit pouvoir rencontrer ces situations, comprendre ce qui se passe et le travailler avec les personnes. » Car, aujourd’hui, « comment construit-on son identité en s’exposant sur des réseaux sociaux ? Quelle intimité construire ? Quelles identités se structurent au travers de ces transformations dans la vie affective ? Toutes ces questions sont au cœur de ce qui se noue aujourd’hui. J’ai dû y trouver des réponses, pas uniquement dans des formations, mais aussi au travers d’un cheminement personnel ».
C’est au fil de ce dernier qu’elle est amenée à ses propres pratiques.
« Par rapport aux personnes trans et intersexes, on a aujourd’hui des éléments qui me laissent penser qu’on a été pendant longtemps à côté de la plaque en collant des identités. Même avec un questionnement sur les inégalités de genre, on était en train de catégoriser de manière inadéquate. Cela pouvait être lié à la volonté d’attribuer un sexe à quelqu’un ou au fait de développer un accompagnement trop hétérocentré. Ce sont nos propres schémas qui sont en cause. Je me suis rendu compte que l’on avait une approche trop fermée. On n’était pas ouverts à certaines réalités. Cela pose la question de la pratique que j’ai construite puisque j’en interroge certains schémas. »
Cette implication dans la rencontre de ce qui se vit dans l’intimité des relations est multiple. Elle dessine l’identité tant personnelle que professionnelle.
« Mon Centre a été créé autour de l’accès à la contraception et à l’avortement. À la base, les gens étaient bénévoles et faisaient cela dans l’illégalité. C’était une pratique purement militante. Au fur et à mesure, les plannings familiaux ont été reconnus, le droit à l’avortement également et on a été subsidié pour cela. Je suis arrivée après la reconnaissance des plannings. Il y avait des tensions entre celles qui s’impliquaient bénévolement depuis des années et celles qui sont arrivées après. Des tensions existaient aussi parce que le centre fonctionnait sur le principe de l’égalité salariale. Sauf que, confrontés à la réalité des subsides, on n’a pas réussi à maintenir cela. L’institution commençait à être en déficit. On a dû en sortir. Je me raccroche à ces valeurs militantes et solidaires. J’ai ce profil, je m’investis pour les gens que je vais recevoir mais aussi pour l’institution dans laquelle je travaille. Je me suis construite dans l’aide. Je suis militante pour les droits sexuels, reproductifs, pour le droit à l’avortement, contre les violences faites aux femmes. »
Cette défense du droit à l’avortement se traduit très concrètement durant la crise sanitaire.
« On s’est posés la question de savoir ce qui était fondamental à maintenir. On y a répondu en garantissant le maintien de l’accès à l’avortement. D’autant que les hôpitaux fermaient leurs portes à tout ce qui n’était pas du Covid. Et qu’ils renvoyaient les demandes d’IVG vers les centres de planning. On a eu une demande accrue venant de femmes qui craignaient de ne pas avoir accès à l’IVG, car il y a toujours un délai à respecter pour avorter. On s’est donc engagés pour que ce droit reste bien effectif et pour que les femmes y aient accès. C’est le cas de notre planning et de ceux qui nous entourent. On s’est réunis entre plannings et on a toutes pris cette décision. »
Des transgressions raisonnées
Le travail sensible est également le théâtre de transgressions multiples. C’est souvent la condition pour le rendre possible, pour se sentir en concordance avec l’éthique professionnelle que l’on entend promouvoir mais aussi pour définir un positionnement déontologique et politique. Elles s’affirment comme des résistances aux décisions arbitraires du management ou des pouvoirs publics.
La gestion de la crise sanitaire offre de nombreux exemples à cet égard. Elle a entraîné une multiplication des normes. Leur mise en œuvre a fait l’objet de multiples redéfinitions. Leur adaptation et leur transgression se sont avérées parfois indispensables.
Maria, engagée comme « auxiliaire d’entretien » dans une maison de repos, a contribué à assouplir les règles qui interdisaient aux résidentes de la maison de repos de sortir de leur chambre. Il fallait selon ses propres termes « composer et compenser ».
« On n’a pas suivi toutes les règles en faisant à chaque instant tout ce qu’il fallait faire. Parce que cela n’était pas vivable pour les résidents. Mais nous avons veillé à ne pas mettre en danger. Les résidents n’avaient plus de communs et devaient rester dans leur chambre. Ils devaient y manger, y boire et y dormir. Dès que l’un sortait, ce qui arrivait notamment avec des personnes démentes qui ne comprenaient pas les règles, le personnel intervenait pour leur rappeler qu’il était interdit d’en sortir. En voyant des personnes dans les communs alors qu’elles ne devaient pas s’y trouver, je faisais parfois semblant de rien. Je me disais qu’il fallait que je les laisse un peu, elles étaient sans arrêt seules dans leurs chambres. Ce n’est qu’après quelque temps que je les accompagnais pour qu’elles y retournent. Je crois que ce “composer et compenser” fait vraiment partie de notre travail. »
Noa, psychologue dans une unité de court séjour gériatrique dans un hôpital public du Sud-est de la France, a considéré particulièrement illégitime que des personnes mourantes ne puissent plus recevoir la visite de leurs proches lors des premières semaines du confinement.
« Ce qui a été terrible pour moi et insensé, c’est que l’on interdise aux familles de pouvoir rendre visite à leurs proches qui allaient décéder. Je me suis retrouvée à organiser la mise en lien par vidéoconférence de patients mourants et de leur famille. C’est ce qui me poursuit aujourd’hui, c’est le fait que l’on ait dû empêcher les familles d’accompagner un proche. » Cette règle était tellement inhumaine à ses yeux qu’elle décide dans certaines situations où cela s’avère possible de permettre une dernière rencontre entre une personne mourante et ses proches. « Je me suis arrangée pour faire venir des patients dans mon bureau de consultation. Des collègues kiné ou infirmiers m’ont aidé pour des patients qui ne pouvaient plus se mettre debout. Mon bureau étant au rez-de-chaussée, j’ouvrais la fenêtre et il pouvait une dernière fois parler avec leur famille à qui on avait donné rendez-vous. »
C’est la règle en tant que telle qui fait l’objet d’un questionnement critique à partir d’un positionnement professionnel et politique.
« J’ai été impressionnée de la vitesse à laquelle on (un gouvernement – une hiérarchie) pouvait décider très rapidement qu’on ne pourrait plus être entouré de nos proches quand on allait mourir. J’ai questionné cette règle qui me paraissait insensée. Je me souviens d’une fille qui allait rendre visite tous les jours à son père qui était en fin de vie. Du jour au lendemain, on lui a dit qu’elle ne pourrait plus venir. »
Qui élabore les règles ? Avec quelle considération pour les populations censées les mettre en oeuvre ? Des salariées ont été sommées de se conformer à des dispositions qui allaient parfois à l’encontre des fondements de leurs pratiques professionnelles. D’où des transgressions et des pratiques créatives qui visent à dépasser ce que les interdits ont produit d’insoutenable. Noa s’est ainsi retrouvée à chercher « les moyens pour qu’une personne en fin de vie qui souhaitait absolument contacter ses enfants et sa compagne puisse le faire ».
Lorsque la règle est assouplie, sa légitimité n’en est pas moins interrogée.
« Il faut une autorisation du médecin pour qu’un patient en fin de vie puisse voir une personne. C’est lorsque l’on est face à une situation de mort imminente. Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Je travaille avec des patients qui sont en fin de vie. Au nom de quoi est-ce que, à un moment donné, il peut être décidé qu’il est en fin de vie ou qu’il n’est pas en fin de vie. Cela peut être fort subjectif et peu indiqué de ne remettre cela qu’entre les mains d’une seule personne, fut-elle médecin. »
Mais les transgressions ne sont pas toujours partagées. Des collectifs ont construit des rapports moins autonomes face aux normes édictées. Ils peuvent à ce moment s’en faire les ambassadeurs zélés et tenter de contrecarrer ce que les transgressions tentaient de construire. D’autre part, certaines d’entre elles peuvent être jugées inadéquates et susciter d’importants clivages.
Des salariées politisées
De nombreuses professionnelles s’investissent et délibèrent des finalités de leur travail. Les savoirs qu’elles constituent les portent à développer des éléments d’une critique des normes établies.
Les logiques managériales tentent de dépolitiser le travail en le réduisant à une question technique. Ce n’est pas le moindre de ses paradoxes de produire dans certaines situations l’effet inverse. Des salariées – individuellement mais aussi collectivement – en viennent à mettre en cause les normes et à identifier les tentatives de détournement.
Noa se situe dans cette logique. Elle a tenté en tant que psychologue d’apporter concrètement son soutien aux soignantes confrontées à la crise sanitaire et à l’état de délabrement des institutions hospitalières. « J’ai lancé des groupes de parole afin de permettre au personnel soignant de s’exprimer sur les épreuves qu’il rencontrait. Cela a permis à des personnes de prendre la parole même si cela ne changeait pas leur situation. » Des soignantes, notamment Yasmina, ont souligné à quel point de tels lieux étaient indispensables et faisaient souvent cruellement défaut.
Mais Noa raconte également que ces groupes font l’objet d’une récupération managériale. Ils sont érigés en porte-drapeau de l’institution. « J’en ai gardé un drôle de goût en bouche. Cela a été récupéré par la GRH qui a signifié qu’à son initiative et celle de la psychologue, ce groupe avait été créé. Alors que la finalité était autre et que je ne souhaitais pas que cela soit repris comme quelque chose de glorieux pour la direction. Je voulais même faire quelque chose qui était plutôt à l’opposé de ce que faisait les GRH. » Car la direction organisait depuis de nombreuses années le sous-effectif des soignantes et le just-in-time dans les prestations à accomplir.
Noa nous dit également que cette créativité des salariées s’aventure dans un environnement hostile qui pourra tenter de reprendre à son compte les critiques qui lui sont portées. Les récits portent cette connaissance des pratiques de récupération et de neutralisation. Ils sont également riches de tentatives pour s’en dégager.









