
En Israël, le suprématisme juif domine les élections
Le 23 mars dernier se tenaient en Israël des élections législatives sur fond d’une crise politique contestant l’actuel Premier ministre Benyamin Netanyahu. Chercheur indépendant en histoire contemporaine, Thomas Vescovi revient pour Contretemps sur le contexte politique et social de ces élections et en analyse les résultats. Il est l’auteur de deux ouvrages sur la société israélienne, dont L’échec d’une utopie. Une histoire des gauches en Israël qui vient de paraître aux éditions La Découverte.
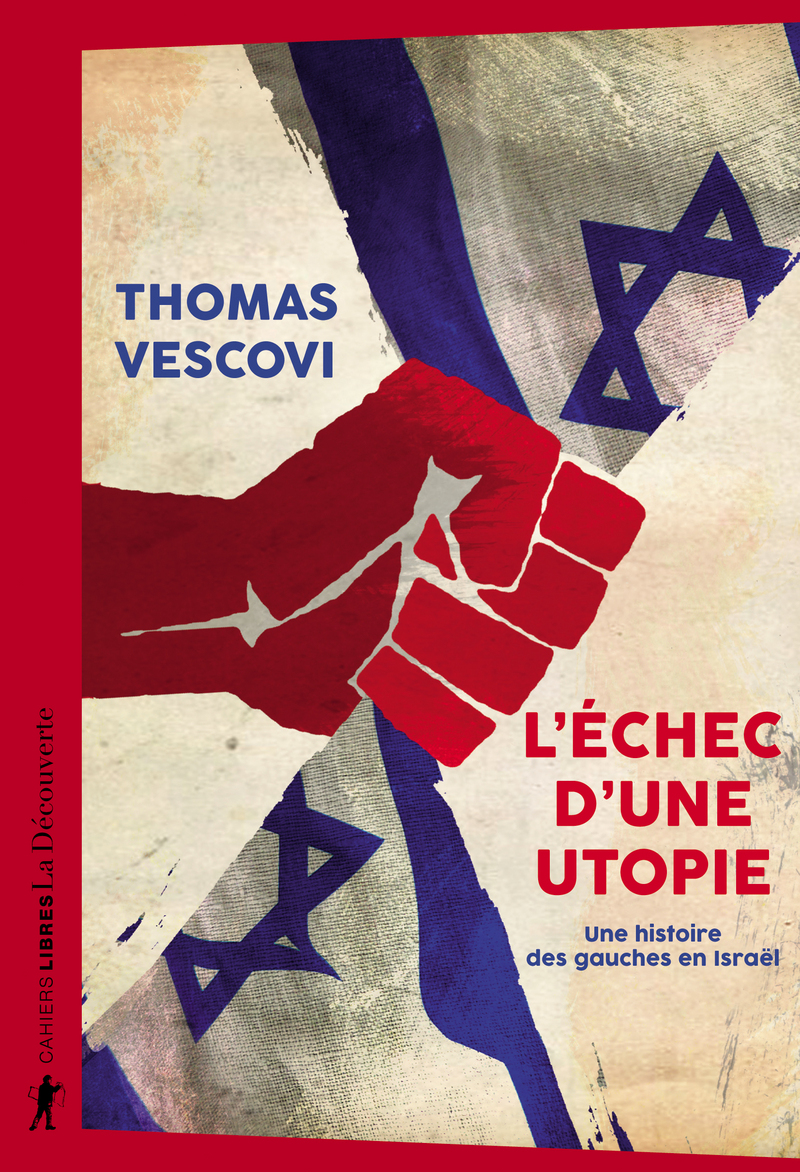
Le vote d’une loi sur l’État-nation en 2018 renforçant la situation d’apartheid, puis la succession de quatre scrutins en deux ans où la droite est sortie toujours plus renforcée, révèlent l’état actuel d’Israël et de sa société : toujours plus colonial, nationalo-religieux et suprématiste.
Les limites du « Tout sauf Netanyahu »
Depuis son accession au poste de Premier ministre en 2009, Benyamin Netanyahu donne le tempo et dicte l’agenda politique, de son camp comme de ses opposants. Pour cette dernière campagne électorale, la quatrième en deux ans, le leader du parti de droite nationaliste Likoud a su instrumentaliser en sa faveur un contexte politique qui lui est pourtant défavorable. S’il détient le record de longévité à la tête du pays, son aura ne cesse de s’effriter, pour au moins trois raisons.
D’abord, Netanyahu est sous le coup d’une triple inculpation pour abus de confiance, corruption et malversation. Une quatrième affaire liée à l’achat de sous-marins allemands semble en passe d’alourdir son dossier judiciaire. Ensuite, son obstination à demeurer l’unique chef de file de son camp et de vouloir placer son immunité judiciaire dans la balance des négociations pour la formation d’un gouvernement, crispent au sein même de son parti. Ainsi, en décembre dernier, son ancien ministre, et actuel député, Gideon Sa’ar, rompt avec le Likoud au profit de sa propre formation Tikva Hadasha (« Nouvel espoir »). Enfin, Netanyahu fait face à un mouvement de contestation politique inédit dans l’histoire d’Israël, par son ampleur et sa durée.
Sauf que pour le renverser, ses opposants doivent être crédibles aux yeux de l’électorat et capable de s’entendre entre eux. Pour la première condition, seuls deux candidats semblent avoir pu inquiéter l’actuel Premier ministre lors des quatre derniers scrutins : Benny Gantz, ancien général et chef de file de la liste Kahol Lavan (« Bleu-blanc », référence aux couleurs du drapeau israélien) ; et Yaïr Lapid, centriste et figure des laïcs, à la tête de son propre parti Yesh Atid (« Il y a un futur »). Cependant, l’hétérogénéité du camp anti-Netanyahu rend complexe la réalisation de la deuxième condition, empêchant l’un comme l’autre de rassembler le nombre de députés suffisant pour former un gouvernement.
Les 120 députés de la Knesset, l’unique assemblée parlementaire, sont élus tous les quatre ans au scrutin proportionnel plurinominal. Pour obtenir des mandats, chaque liste doit atteindre le seuil électoral de 3,25 %. Au terme du vote, les formations s’engagent dans des négociations pour espérer rassembler au moins 61 députés et pouvoir ainsi former un gouvernement. Lors des trois derniers scrutins, ni Netanyahu ni ses opposants n’y sont parvenus. En mars 2020, face notamment à la pandémie de Covid-19, Gantz avait accepté la formation d’un gouvernement d’union nationale avec le Likoud, mais cela n’a tenu que neuf mois.
« Crime minister », « Votez pour la vérité », « Plus rien ne pourra l’arrêter »… Si les slogans électoraux des opposants à Netanyahu étaient tous, à juste titre, plus alarmistes les uns que les autres, ils participaient à leur manière au renforcement de l’hégémonie du leader du Likoud. Une majorité de débats ou de meetings s’est polarisée autour de Netanyahu quand celui-ci étalait sereinement ses réalisations : campagne de vaccination et accords d’Abraham qui normalisent les relations d’Israël avec plusieurs pays arabes, notamment.
S’il peut compter sur le soutien des ultra-orthodoxes, cela reste insuffisant pour permettre au Likoud de former un gouvernement. Netanyahu a donc poussé plusieurs formations d’extrême-droite à s’allier, sous la bannière du Parti sioniste religieux, afin de leur permettre d’obtenir le nombre de voix nécessaires pour entrer à la Knesset. Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir incarnent les deux figures de cette liste héritière de la pensée du rabbin Meir Kahane. Ce dernier était parvenu à se faire élire à la Knesset en 1984. À chacune de ses interventions, l’assemblée se vidait pour ne pas cautionner ses propos. Belliqueux, provocateur et raciste, le parti de Kahane fini par être interdit en 1994 pour « incitation au terrorisme ».
Ben Gvir et Smotrich résident dans des colonies de Cisjordanie, dont celle d’Hébron pour le premier, particulièrement connue pour rassembler les colons parmi les plus extrémistes. Homophobes et racistes, ils défendent l’expulsion des Palestiniens, la mise en place d’une théocratie et ne cachent pas leur souhait de voir démolir l’esplanade des mosquées à Jérusalem, au profit de la reconstruction du Temple juif. En obtenant six députés le 23 mars dernier, le Parti sioniste religieux peut désormais prétendre siéger dans un gouvernement dirigé par Netanyahu.
Deux crises et aucun gouvernement
La prochaine coalition gouvernementale devra affronter deux crises. La première est sociale. Derrière sa vitrine de paradis pour jeunes cadres dynamiques et entrepreneurs spécialisés dans les nouvelles technologiques, la « start-up nation » israélienne fait surtout office de modèle d’inégalités : au sein de l’OCDE, Israël est le deuxième pays le plus inégalitaire, derrière le Mexique. Les mesures sanitaires pour faire face à la Covid-19 ont encore davantage paupérisé la population : en mars 2020, suite au premier confinement, près d’un million de salariés ont été licenciés. Le taux de chômage dépasse les 10 %, contre 3,4 % en 2019. Cinquante mille ménages sont passés sous le seuil de pauvreté et cent mille autres ont vu leur niveau de vie drastiquement baisser, la demande d’aide alimentaire a été multipliée par 2,5 tandis que les services sociaux ont connu une augmentation de 60 % des dossiers à traiter.
La deuxième crise est diplomatique. Que valent les accords d’Abraham en l’absence du parrain Donald Trump à la Maison Blanche ? Pis, le nouveau président des États-Unis Joe Biden a multiplié les signes, certes limités, d’un rééquilibrage : les colonies sont « illégales », l’UNRWA doit être financée et la mission palestinienne à Washington doit rouvrir, sans pour autant remettre en cause l’alliance essentielle avec Israël dans la stratégie états-unienne au Proche et Moyen-Orient.
Pour faire face à ces crises, la prochaine coalition gouvernementale nécessitera une ligne politique claire et crédible. Or, si les enjeux diplomatiques semblent de plus en plus voir s’opérer une synergie entre toutes les forces du champ politique sioniste, la question socio-économique demeure clivante. Netanyahu n’est pas qu’un adversaire des droits du peuple palestinien, c’est aussi un défenseur du néo-libéralisme à la sauce Reagan-Thatcher. Ses deux principaux challengers à droite, Bennett et Sa’ar, témoignent du même attachement à ces dogmes économiques, appelant à profiter du ralentissement de l’économie lié aux trois confinements pour engager un « électrochoc » économique et libéral.
Pour mettre fin à l’ère Netanyahu, ils devront s’allier au centre et à la gauche. Si des convergences sont visibles avec les centristes Gantz et Lapid, qui cumulent à eux deux vingt-cinq députés, il faudra trancher lequel de leurs programmes ou des partisans d’une forme de retour de l’État dans l’économie doit céder. Parti travailliste et Meretz, les deux partis héritiers du sionisme de gauche, défendent un modèle d’État protecteur, revalorisant les pensions, allongeant les durées de congé parental ou renforçant les droits des salariés, notamment féminins.
Deux sociétés juives face à face
Parallèlement aux affrontements sur la poursuite ou la fin du règne de Netanyahu à la tête d’Israël, le champ politique israélien se divise entre les libéraux « laïcs », qui aspirent à reprendre en main l’État et les ministères que le Likoud s’est habitué à laisser aux ultra-orthodoxes, et ceux qui au contraire estiment que les religieux ont toute leur place au sein des institutions pour faire d’Israël l’« État du peuple juif ».
Deux sociétés se font face. La première, laïque et libérale, s’appuie sur Tel-Aviv et d’autres villes ouvertes sur l’extérieur. La seconde peut compter sur les villes religieuses, comprenant Jérusalem-Ouest, et la « périphérie » habitée par les Israéliens les plus touchés par la pauvreté, généralement mizrahim (juifs orientaux), falashas ou russophones. Pourquoi cette population, appauvrie et malmenée par la politique de la droite, vote-t-elle pour ses bourreaux ?
Les militants de la gauche sioniste ou du centre ont de multiples expressions pour qualifier cet électorat, pauvre et religieux : « instinct de troupeau », « fanatisée », « manipulée »… Pour le sociologue israélien Nissim Mizrachi, cette approche explique en partie l’incapacité de ce camp à être audible auprès des couches populaires : « Avant de se demander pourquoi ces gens votent contre leurs intérêts, demandons-nous pourquoi devraient-ils voter pour vos valeurs ? »[1] .
Concevoir un « État pour les juifs » implique de définir la judéité dans toute sa pluralité. Or, si pour les pionniers du sionisme, largement ashkénaze (européen), le judaïsme était d’abord une identité, il n’en n’est pas de même pour les communautés juives du monde musulman (mizrahim) ou d’Afrique de l’Est (falasha) : être juif renvoie d’abord à une religion. Les inégalités socio-économiques, la restriction des libertés pour les ONGs, les droits des LGBT ou l’accès à l’IVG sont autant d’idées et de valeurs qui mobilisent la gauche juive. Sauf qu’elle reste aux antipodes des principales préoccupations de l’électorat de droite : faire d’Israël un État juif.
Ainsi, face à la menace d’une croissance démographique arabe égale ou dépassant celle des populations juives, ou du risque de voir intégrer à l’État des millions de palestiniens en cas d’annexion d’une partie ou de la totalité de la Cisjordanie, Netanyahu a uni son camp autour de la loi sur l’État-nation, votée en juillet 2018. L’article 1 suffit à saisir l’objectif majeur : « L’exercice du droit à l’autodétermination nationale dans l’État d’Israël est spécifique au peuple juif. »
La gauche reste inaudible et silencieuse. L’historique Parti travailliste, bien conscient de devoir tirer un trait sur son hégémonie d’antan, n’entend pas proposer de modèle de société radicalement différent. Merav Michaeli, l’actuelle leader du parti, est une figure de la gauche israélienne et du mouvement féministe. En 2020, alors députée, elle avait refusé de suivre la direction de son parti qui validait l’entrée des travaillistes dans le gouvernement d’union nationale dirigé par Netanyahu, au profit de la mobilisation contre le maintien au pouvoir de celui-ci.
Le Meretz, gauche « radicale » sioniste, et le Parti travailliste sont confrontés à un état de fait : le camp juif progressiste est minoritaire. Dans une enquête du centre de recherche indépendant Israel Democracy Institute, réalisée en février 2020, 69,9 % des Juifs israéliens âgés de 18 à 24 ans se définissent comme « de droite » et 59 % d’entre eux s’opposent à la création d’un État palestinien. Surtout, la gauche sioniste a réalisé les plus mauvais scores de son histoire, passant de vingt-quatre députés en 2015 à six en 2020 puis treize en 2021. Si la gauche sioniste n’apparait plus au premier plan, c’est entre autres parce qu’elle ne parait plus en capacité de rivaliser avec le Likoud. Ainsi, entre 2019 et 2020, l’électorat laïc et libéral a semblé préférer soutenir Gantz puis Lapid. Ces dynamiques poussent les directions du Meretz et du Parti travailliste à s’allier ou s’ouvrir vers le centre, renforçant naturellement la droitisation du pays en l’absence d’offre politique alternative.
La division du camp palestinien
L’ancien député communiste Dov Khenin pose l’équation de cette manière : militer à gauche et en dehors du champ sioniste en Israël est un dilemme permanent car, pour rassembler l’électorat palestinien, il faut refuser sans ambiguïté le sionisme ; pour recueillir un nombre de voix conséquent chez les Juifs, il ne faut pas se focaliser sur la critique du sionisme. Ancienne figure de la Liste unie, qui se compose des principaux partis palestiniens d’Israël, allant des nationalistes arabes du Balad au Mouvement islamique, ainsi que du Hadash (Front démocratique pour la paix et l’égalité), dont est membre le Maki (Parti communiste d’Israël), Khenin comprend l’importance de « s’adresser à tous ».
Entre 2019 et 2020, la Liste unie, sous la direction du communiste arabe Ayman Odeh, a sans aucun doute incarné la seule dynamique à gauche. Dans les quartiers sud de Tel-Aviv, où vivent dans la précarité les Juifs falashas, les affiches de la Liste unie proposaient : « Votre vote contre les discriminations ». Dans les quartiers juifs ultra-orthodoxes : « Votre vote contre le service militaire obligatoire ». En mars 2020, la Liste unie obtient quinze députés soit le meilleur résultat jamais obtenu par une alliance non sioniste dans l’histoire d’Israël. Son succès s’appuie à la fois sur des records de voix dans les principales villes arabes avec 85 % à 90 % des suffrages, mais aussi sur une partie de l’électorat juif progressiste, désabusé́ face au choix stratégique de la gauche sioniste, préférant s’allier au centre. Ainsi, à Haïfa ou Tel-Aviv, la Liste unie obtient dans les quartiers juifs environ vingt-cinq mille bulletins.
Surfant sur cette dynamique, Odeh avait jugé bon de s’immiscer dans les négociations parlementaires, pensant devenir le faiseur de roi et tombeur de Netanyahu. Au lendemain du scrutin de mars 2020, Odeh affirme son soutien à Gantz comme Premier ministre contre un engagement de celui-ci sur plusieurs questions décisives allant du retrait de la loi sur l’État-nation à l’abrogation de la loi Kamenitz qui, votée en 2017, facilite les destructions dans les villes arabes de toute construction bâtie sans l’accord des autorités israéliennes. La Liste unie obtient même la présidence de la commission parlementaire. Parallèlement, le camp de centre-gauche, mené par Gantz, s’agite et finit par plier : au moins trois députés refusent de cautionner une alliance gouvernementale n’ayant pas de majorité juive.
Quelques semaines après la formation du gouvernement national mené par Netanyahu, la Liste unie montre ses premières divisions. Cette alliance historique des partis palestiniens d’Israël aux côtés de la gauche juive non sioniste ne doit pas cacher les divergences idéologiques internes. Déjà pour certains, comme les cadres du Balad, la stratégie d’Odeh visant à s’allier à la gauche ou au centre sioniste pour faire barrage au Likoud et à l’extrême droite religieuse, a été difficilement acceptée, si tant est qu’elle ait sincèrement été validée. Sur les droits des minorités, LGBT notamment, sur l’appartenance nationale (intégration à la société israélienne ou au nationalisme palestinien) voire sur la place à accorder à la lutte des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, les communistes et écologistes du Hadash, les nationalistes de Balad ou les musulmans conservateurs de Ra’am peinent à faire converger leurs positions.
Mansour Abbas est le représentant de la branche sud du Mouvement islamique en Israël et figure de la « Liste arabe unie » nommée Ra’am en hébreu. Son choix de rompre avec Odeh pour les élections de 2021 ne peut se comprendre qu’en revenant sur l’histoire de la politisation des Palestiniens d’Israël. Devenus en 1948 citoyens d’Israël, ils ont été soumis jusqu’en 1966 à un gouvernement militaire. Au lendemain de la Guerre des Six Jours de 1967, une nouvelle génération s’engage dans le jeu politique israélien afin de mettre l’institution sioniste face à ses prétentions démocratiques : « nous avons la citoyenneté mais pas les mêmes droits que les Juifs ». Cette dynamique s’opère parallèlement à l’arrivée sur le devant de la scène d’un mouvement national palestinien représenté par l’Organisation de Libération de la Palestine et incarné par Yasser Arafat.
Cette politisation hybride, à la fois de rattachement au nationalisme palestinien et à la revendication d’une pleine égalité entre citoyens israéliens, dure jusqu’aux années 1990 et se caractérise par une volonté de porter une voix arabe autonome. À partir des années 2000, la droitisation d’Israël accélère la marginalisation du sionisme de gauche et fait naitre chez une partie des cadres Palestiniens d’Israël une nouvelle orientation stratégique. D’une part, l’absence durant le processus d’Oslo d’un intérêt de l’OLP à leur égard illustre la nécessité pour les Palestiniens d’Israël de s’émanciper par eux-mêmes, sans rien attendre de la direction nationale palestinienne. D’autre part, la gauche sioniste, ayant perdu son influence, ne peut plus tourner le dos à une alliance avec les Palestiniens d’Israël. Ainsi, Odeh affirme qu’il suffirait que « 30 % de citoyens juifs se joignent aux 22 % de citoyens arabes pour constituer une majorité́ en faveur de la paix. Seuls, ajoute-t-il, nous ne pouvons agir sur les questions liées à la guerre, à la ségrégation, omniprésente en Israël. Mais sans nous, il n’y aura pas de changement sur ces sujets essentiels ».[2]
Pour Abbas, le refus de Gantz d’être allié à la Liste unie signifie l’échec de la stratégie d’Odeh, quand dans le même temps l’image d’un Netanyahu prêt à s’allier à des pays musulmans pour une convergence d’intérêt laisse à penser que le clivage droite/ gauche n’est plus opérant. Après avoir multiplié les signes d’un rapprochement avec la droite et plus particulièrement avec le Premier ministre, il annonce que son parti Ra’am se ralliera au candidat le mieux placé pour former une coalition. Il ne s’agit plus de promettre au centre-gauche un ralliement des Palestiniens contre la droite, mais de faire monter les enchères parmi l’ensemble des candidats, de la gauche à la droite, et obtenir les politiques les plus avantageuses pour la population arabe, notamment pour enrayer la criminalité qui a déjà provoqué près de trente meurtres depuis janvier 2021 parmi la jeunesse palestinienne.
Si la Liste unie obtient six sièges, classée naturellement dans le camp « anti-Netanyahu », Abbas en obtient quatre et se place en véritable décideur de l’issue des élections, refusant de se positionner pour ou contre le Premier ministre sortant. Dès lors, Netanyahu avance sur une ligne de crête en cherchant à s’allier d’un côté avec les ultra-orthodoxes et les kahanistes, représentant ensemble cinquante-deux députés, et d’un autre côté avec les islamistes de Ra’am.
Une alternative arabo-juive ?
Nul doute que la gauche sioniste porte une responsabilité dans cette division du camp palestinien ainsi que dans ses propres échecs. Si le Meretz porte un discours égalitaire et progressiste, et met en avant deux palestiniens sur les cinq premiers de sa liste, son refus de dialoguer pour faire front commun avec la Liste unie, au profit d’un ralliement avec les Travaillistes, montre la réalité de la hiérarchie des valeurs. Avec Odeh, le Meretz partage une volonté de paix et d’égalité au-delà des particularismes communautaires. Avec les travaillistes, le Meretz défend l’attachement au sionisme, c’est-à-dire à un État où les Juifs auraient toujours un peu plus de droit et de légitimité, quand bien même les institutions seraient d’inspiration socialistes.
La mobilisation politique contre Netanyahu qui a débuté en 2019 et se poursuit, dans une moindre mesure, jusqu’à présent, ne se cantonne pas aux traditionnelles sphères de la gauche sioniste. L’unité se fait contre la figure du Premier ministre, que tous souhaitent voir quitter le pouvoir pour des motifs parfois différents : accusations de corruption, gestion du Covid-19 et de ses retombées économiques, explosion de la pauvreté et de l’exclusion sociale… En revanche, comme lors du mouvement social de 2011, la participation des Palestiniens d’Israël au mouvement reste anecdotique. Si en 2020 les orateurs qui souhaitent dénoncer l’occupation ou les projets d’annexion de la Cisjordanie reçoivent un accueil plus chaleureux, une interrogation demeure : jusqu’où les Juifs israéliens sont-ils prêts à aller ? Sont-ils en quête de « changement cosmétique » ou d’un nouveau système offrant une justice égale pour tous ?
Dans l’actuelle composition de la Knesset, issue des élections du 23 mars, au moins 65 députés sur les 120 que comptent la Knesset sont favorables à l’annexion de terres palestiniennes en Cisjordanie. Au moins 97 parlementaires se prononcent pour la poursuite de la colonisation et autant sont défavorables à l’établissement d’un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, donc opposés à l’application du droit international. La travailliste Michaeli ne s’oppose pas à la poursuite de la colonisation en Cisjordanie et elle a sévèrement jugé la décision de la Cour pénale internationale (CPI) d’ouvrir une enquête sur les crimes commis dans les territoires occupés. Pire encore puisqu’elle a donné du grain à moudre à tous les nationalistes qui ciblaient Nitzan Horowitz, tête de liste du Meretz. Celui-ci s’était au contraire félicité, sur les réseaux sociaux, de la décision de la CPI.
La principale manifestation contre le projet d’annexion de territoires palestiniens, organisée le 6 juin 2020, n’a rassemblé que quelques milliers d’Israéliens. Et pourtant, une semaine auparavant, des gardes-frontières israéliens avaient tué Iyad al-Hallaq, un Palestinien autiste de 32 ans, dans la vieille ville de Jérusalem alors qu’il se rendait à son travail dans un centre spécialisé. Perpétré cinq jours après celui de George Floyd, aux États-Unis, qui provoqua un mouvement de contestation mondial contre l’impunité des crimes policiers et le racisme, le meurtre d’Al-Hallaq n’a entraîné aucune mobilisation significative en Israël. De tout cela, les Palestiniens d’Israël comme de Cisjordanie et de Gaza en sont conscients.
Plus que jamais, le véritable enjeu politique pour la gauche israélienne est de déterminer la nature de l’État auquel elle aspire. Un État pour les Juifs sur des bases socialistes, à l’origine de l’utopie sioniste de gauche, continue d’être une perspective réaliste pour celles et ceux qui s’attachent davantage à l’idéal sioniste qu’aux valeurs de gauche. Ainsi, ils participent à leur manière à cautionner la dérive de cet État, toujours plus colonial et suprématiste, en refusant l’émergence d’un camp progressiste arabo-juif et en favorisant l’ascension des conservateurs arabes prêts à s’allier avec les nationalistes religieux juifs. Une autre voie peut être tracée, à condition d’accepter la perte de ses privilèges pour un État de tous ses citoyens, et une prise en compte sincère de l’aspiration des Palestiniens d’Israël comme ceux du reste de la Palestine occupée.
*
Illustration : Fouad Abgaria art.
Notes
[1] Carolina Landsmann, « The Real Reason Mizrahim Vote for Netanyahu, and Why the Left Can’t Win Them Over », Haaretz, 11 janvier 2020.
[2] Catherine Gouëset, « Israël : « Nous voulons constituer un large bloc pour défaire l’extrême droite » », lexpress.fr, 17 octobre 2017.









