
Italie : un concentré de l’histoire du monde. Entretien avec David Broder
Historien spécialiste du communisme en France et en Italie, David Broder a récemment publié un court ouvrage intitulé, First they took Rome, aux éditions Verso. Il s’y interrogeait sur la trajectoire politique de la Péninsule au cours de ces trente dernières années. Un livre efficace et pertinent pour aller au-delà de l’image trop souvent véhiculée des « anomalies latines ».
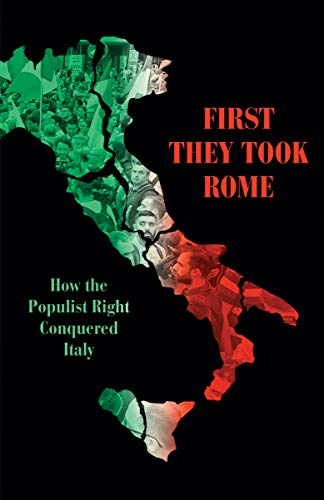
Tu as écrit un petit livre très efficace sur l’Italie contemporaine, en réfutant les lieux communs souvent invoqués sur les « raisons » des difficultés que traverse la Péninsule. Le point de départ, j’imagine, était les élections de mars 2018 mais ton ambition est bien plus grande. Quels sont selon toi les éléments clés qui permettent de comprendre comment nous en sommes arrivés au désastre actuel ?
La façon dont les médias italiens dominants parlent du populisme de droite n’est pas si différente de ce que nous voyons dans d’autres pays occidentaux – une histoire d’électeurs de la classe ouvrière, laissés pour compte, perdants de la mondialisation et ainsi de suite, qui se rallient aux forces racistes d’extrême droite, peut-être aussi poussés par les fake news, les médias sociaux, leur « analphabétisme fonctionnel » et ainsi de suite.
Mon livre cherche à corriger ce récit de deux manières principales. Premièrement, en montrant que des partis comme la Lega et Fratelli d’Italia, bien qu’ils aient leur propre culture politique et leur propre histoire organisationnelle, radicalisent le plus souvent des Italiens dont on pouvait généralement s’attendre à ce qu’ils votent pour des partis de droite. Ce n’est pas parce qu’une « région rouge » historiquement devient verte pour la Lega que les anciens électeurs communistes sont passés à l’extrême droite. Et bien sûr, il y a toujours eu des travailleurs de droite, en particulier ceux qui sont étroitement liés à leurs employeurs dans les petites entreprises, les personnes non syndiquées, beaucoup de ceux qui sont soumis au chantage du marché noir, etc. J’essaie également de montrer que la Lega, même sous la direction de Matteo Salvini, n’est pas seulement réductible au racisme, mais qu’elle fait partie, depuis le tournant des années 1990, d’un projet thatchérien visant à démanteler ce qu’elle considère comme le « corporatisme » de l’Italie d’après-guerre et sa constitution « catho-communiste ».
Ceci est lié à mon deuxième point : le glissement vers la droite sur le terrain politique italien, ces trois dernières décennies, est une synthèse frappante de ce qui arrive à une démocratie une fois que les institutions du mouvement ouvrier, leur horizon idéal et leur promesse disparaissent. En Italie, cela s’est produit de manière particulièrement soudaine, également en raison de facteurs internes à la culture du parti communiste et de sa relation avec la chute du bloc de l’Est et le projet européen naissant. À maintes reprises, à l’approche des élections, les libéraux (qu’il s’agisse des dirigeants des Démocrates ou des initiatives de la base) tentent d’utiliser la menace de l’extrême droite pour mobiliser l’ancienne base de la gauche. Mais cela est de moins en moins efficace, et les jeunes Italiens qui n’ont pas connu d’exemples inspirants de solidarité de classe et d’action collective réussie sont de moins en moins susceptibles de voter, et encore moins de s’engager réellement politiquement. Bien sûr, on peut citer quelques mouvements, mais il s’agit d’un pays qui comptait un parti communiste de 1,5 million de membres avec 30 % des voix il y a seulement trois décennies, et qui a maintenant une sphère publique désertifiée et une grande coalition de libéraux et d’extrême droite.
Tu fais une analyse très fine de la situation économique que traverse la Péninsule depuis les lointaines années 1970. A ton avis quelles en sont les caractéristiques principales ? Sont-elles particulières ? Si oui en quoi ?
Lorsque Mario Draghi a été nommé Premier ministre (sans aucun mandat populaire, même indirect) en février 2021, la quasi-totalité des médias italiens et internationaux se sont extasiés sur l’arrivée de Super Mario pour sauver la situation grâce à des dépenses massives via des prêts du Fonds européen de relance économique. Mais comme Emiliano Brancaccio et d’autres l’ont souligné, il s’agit d’une goutte d’eau dans l’océan, comparée à la chute du PIB pendant la pandémie ou à la dette publique de 2 400 milliards d’euros que l’Italie avait avant la pandémie. Mais quelles sont les raisons structurelles pour lesquelles l’Italie avait un PIB plus faible en 2019 qu’en 1999 ? Quels sont les facteurs à l’origine de la dette elle-même ?
Comme je l’affirme dans le livre, cette dette avait beaucoup moins à voir avec des « gouvernements très dépensiers » ou des « Sudistes paresseux qui gaspillent leur argent » qu’avec les dommages causés à l’économie italienne par son intégration dans le système monétaire européen à la fin des années 1970. En substance, ce projet d’élite visant à européaniser l’Italie sur la base d’une monnaie surévaluée (comme l’ont déclaré explicitement des personnalités telles que Mario Monti) revenait à utiliser l’austérité permanente d’abord pour discipliner la classe ouvrière (un grand succès), puis pour moderniser son appareil productif et sa culture d’entreprise (comme l’a dit Federico Rampini de la Repubblica, une « germanisation » de choc de l’Italie). Mais la zone euro n’a clairement pas fait cela – elle a exacerbé les différentiels de productivité et d’investissement et a poussé l’Italie à dépendre d’emplois à bas salaires et peu qualifiés et du tourisme (et donc des loyers), tandis que sa capacité industrielle a diminué d’environ un quart.
Rien de tout cela n’est propre à l’Italie, même si cela se produit de différentes manières à travers les frontières nationales. Elle fait partie d’un projet européen qui a été utilisé partout pour ancrer et même codifier constitutionnellement des règles néolibérales réduisant l’espace pour des politiques économiques alternatives, ou même pour des investissements publics sérieux.
Tu analyses le long processus de désagrégation du « bloc bourgeois » en Italie. Quel est selon toi le rôle qu’ont pu jouer dans cette configuration particulière le M5S et la Lega ?
L’idée du « bloc bourgeois » est parfaitement illustrée par Stefano Palombarini et Bruno Amable, tant en France qu’en Italie. En substance, l’argument est qu’il existe un projet d’élite pour mener à bien les réformes économiques structurelles, qui ne bénéficie que d’un soutien minoritaire ou passif au sein de la population générale. Cela exige la création d’une force politique capable de mener à bien ces réformes quoi qu’il arrive – le bloc bourgeois – d’où la coexistence curieuse en Italie (1) de décennies de tentatives de réformes électorales visant à créer un système bipolaire excluant les petits partis et (2) de la montée des alliances entre les Démocrates et Berlusconi dépassant les clivages gauche-droite, notamment mais pas seulement en soutenant des gouvernements « non partisans » et technocratiques. C’est ce que nous avons vu pendant la majeure partie des années 2010.
Les partis que tu mentionnes ont fait une percée lors des élections générales de 2018 parce qu’ils promettaient quelque chose de différent de cette combinaison centriste : la Lega a principalement puisé dans les partisans d’autres partis de droite avec une ligne anti-immigration dure, et le M5S largement dans le type d’Italiens habituellement associés au centre-gauche et/ou aux non-votants, en utilisant un certain welfarisme tiède mais, beaucoup plus visiblement, un langage visant à donner une voix aux laissés pour compte et aux non-représentés. Mais ni l’un ni l’autre ne remettent fondamentalement en cause les réformes néolibérales promues par le bloc bourgeois, et même dans les mois précédant l’élection de 2018, ils ont mis un frein à leur précédente dénonciation de l’euro. Au gouvernement, ils n’ont pas du tout été à la hauteur de la rhétorique « souverainiste » en termes de politique économique, même si leur participation à Belt and Road[1] aura agacé l’administration Trump.
La Lega se présente depuis longtemps comme une « opposition au gouvernement », c’est-à-dire qu’elle soutient les principales mesures du gouvernement tout en utilisant des moyens médiatiques extravagants pour tenter d’affirmer sa différence. Le dépérissement du parti de Berlusconi dans les années 2010 a donné à Salvini la perspective de devenir le leader global de la coalition de centre-droit, bien que la formation postfasciste Fratelli d’Italia met désormais fortement en question cette place maintenant qu’elle constitue la principale force d’opposition parlementaire à l’administration de Draghi. Quant au M5S, alors qu’au cours de sa première décennie, il insistait régulièrement sur le fait qu’il ne rejoindrait « jamais » des coalitions avec « les partis », au cours des trois dernières années, il a formé toutes les alliances parlementaires possibles et fait maintenant partie de l’administration Draghi, sans influence malgré sa masse de députés et de sénateurs. Je serais surpris qu’aux prochaines élections générales, il obtienne la moitié du score qu’il a obtenu en 2018. Ainsi, le M5S était plus un épiphénomène de l’impopularité du bloc bourgeois, qu’une force capable de le déstabiliser de manière durable.
L’un de tes chapitres se concentre plus particulièrement sur le PD et son éloignement toujours plus évident des classes populaires qui en fait au fil des ans le parti de la bourgeoisie. Question de personnel politique ? Héritage du PC ? Transformation du monde du travail ? Qu’en est-il selon toi ?
Tout au long de l’histoire du PCI après 1945, une tendance – un courant important mais non hégémonique – a cherché à le transformer en un « parti travailliste » ou, par la suite, en une « social-démocratie à l’européenne ». Ce courant est antérieur à l’eurocommunisme, dans la pensée de personnages comme Giorgio Amendola, mais il s’accélère à la fin des années 1970, également en relation spécifique avec le projet d’intégration européenne et le rejet par le PCI du socialisme du bloc de l’Est.
Pour schématiser, le problème est que le PCI s’est transformé en une force sociale-démocrate (changeant de nom en 1991) à la fin de la guerre froide, à une époque où la « social-démocratie européenne » signifiait de plus en plus la troisième voie de Clinton et le traité de Maastricht. En fait, comme la dissolution formelle du PCI et la scission de la gauche ont coïncidé avec l’optimisme néolibéral, le nouveau parti s’est identifié de manière encore plus unilatérale au social-libéralisme que des partis comme le Labour ou le SPD qui conservaient des éléments réformistes résiduels. Il y avait aussi une tendance à l’auto-flagellation, par exemple en avalant les fables anticommunistes sur les méchants partisans staliniens qui assassinaient des innocents dans le nord-est de l’Italie.
La crise de la Démocratie Chrétienne a rendu ce saut vers le centre libéral encore plus attractif, et par son soutien à des premiers ministres technocrates et centristes (par exemple Romano Prodi) ainsi que par son intégration d’anciens fragments démocrates-chrétiens, le parti qui est finalement devenu le Parti Démocrate en 2007 a pu se détacher de sa base d’origine. Il est clair que le déclin général de la main-d’œuvre industrielle de masse a facilité ce processus – en affaiblissant le poids social de la gauche ouvrière – tout comme le retrait de la génération de la Résistance de la vie publique au profit d’une couche de personnel politique de bien moindre qualité, élevée non pas en tant que tribuns ou organisateurs populaires mais en tant que fonctionnaires du parti issus des universités. Cependant, une telle conclusion doit être nuancée de deux manières.
Tout d’abord, le centre-gauche doit lui-même être tenu pour responsable d’une longue série de mesures d’austérité et de contre-réformes, qui ont accéléré la pulvérisation de cette classe ouvrière. Bien que je ne veuille pas blâmer un seul responsable, la haine ouverte pour les syndicats affichée par Matteo Renzi dépassait de loin celle de quelqu’un comme Tony Blair à son apogée, et bien que Renzi se soit maintenant brouillé avec les Démocrates, ce n’est pas comme s’il y avait eu beaucoup de protestations à ce sujet de la part des députés démocrates à l’époque.
Deuxièmement, nous ne devons pas avoir une image statique ou irénique de la « vieille classe ouvrière fordiste » qui était autrefois organisée au sein du PCI. L’atelier de FIAT Mirafiori et les industries qui y étaient liées étaient certainement importants et constituaient un point de référence symbolique pour un parti de classe. Mais le succès du PCI a toujours été de rallier une base socialement fragmentée – métayers, habitants des bidonvilles, artisans, petits entrepreneurs, intellectuels – autour d’une vision commune qui transcendait leurs seuls lieux de travail. La présence de bataillons de travailleurs dans des « forteresses rouges » a aidé à projeter l’idée du pouvoir des travailleurs, mais les annonces de la « mort de la classe ouvrière » sont elles-mêmes un projet politique.
Un absent tout de même dans ton livre, mais il est vrai ce n’était pas le sujet : qu’en est-il de ce que l’on nomme la gauche radicale ? On se souvient des espoirs qu’avait suscité Rifondazione comunista en 2001 ; nous en sommes très loin aujourd’hui. Mais vois-tu une lumière possibile au bout du tunnel ? Quel serait le rôle de cette gauche ?
La gauche radicale ne représente qu’une petite partie du livre car elle ne joue pas un rôle important dans la politique nationale. Elle n’est pas présente au Parlement : même les députés les plus à gauche seraient Verts ou des partis similaires dans d’autres pays, et n’ont pas la dimension conflictuelle de Corbyn et Sanders, comme nous le voyons dans l’opposition extrêmement tiède à l’administration Draghi, même de la part de ceux qui ne la soutiennent pas activement. Mais aussi – et c’est lié à cela – les mouvements sociaux ne fixent pas de lignes de partage politique dans la société dans son ensemble.
Nous pourrions citer de nombreuses initiatives bonnes et nécessaires que l’on pourrait qualifier de contre-tendances. Ces dernières années, on a assisté à de grandes manifestations féministes, en particulier contre la violence sexiste ; à une augmentation de l’organisation des travailleurs agricoles, notamment parmi les migrants d’Afrique subsaharienne dans le centre-sud de l’Italie ; à la syndicalisation des travailleurs d’Amazon et des plateformes de livraison de nourriture ; aux efforts des militants en solidarité avec les réfugiés, souvent en collaboration avec les églises et les administrations locales ; ou, si l’on remonte plus loin, au référendum de 2011 contre la privatisation de l’eau.
Mais je pense que l’on dit trop souvent que, malgré les nombreuses trahisons et les échecs de la politique des partis, l’énergie créative des mouvements d’en bas soulèvera tous les bateaux. Au lieu de cela, les deux dernières décennies, depuis l’apogée de Rifondazione, ont vu le milieu de la gauche radicale devenir de plus en plus culturellement subalterne au libéralisme, moins critique à l’égard du caractère fondamentalement et structurellement antidémocratique de l’Union Européenne, et plus éloigné de la classe ouvrière et de l’humeur populaire. Si, dans les années 2000, Rifondazione n’avait qu’une faible influence sur les gouvernements de centre-gauche et ne disposait pas d’un projet clair pour la société dans son ensemble, depuis lors, les campagnes et les luttes existantes se sont encore moins intégrées dans une telle vision. Ce qui prédomine, c’est plutôt une méfiance fondamentale à l’égard de l’action de l’État, ou de la politique parlementaire en tant qu’élément autre que l’opportunisme et les marchandages des élites (dont les exemples sont innombrables).
Cette absence de projet unificateur est en partie un effet de l’affaiblissement des leviers du gouvernement national. Mais elle est renforcée par les mœurs culturelles au sein de l’espace de la gauche radicale – une méfiance obsessionnelle à l’égard de la récupération et de la centralisation institutionnelles, alliée au langage élitiste qui accompagne souvent un mouvement défait qui parle avant tout de lui-même. C’est surtout le cas du milieu post-opéraïste, dont la représentation dans les médias internationaux ne correspond pas à l’intérêt des Italiens de la classe ouvrière.
Selon toi quel est le chemin politique que trace l’expérience italienne ? Tant en termes d’alternatives possibles que sur les craintes réelles et tout à fait fondées d’une montée d’une extrême droite qui peut constituer un port sûr pour une bourgeoisie attirée par un libéralisme autoritaire ?
Je pense avoir donné un début de réponse à la première question, dans le sens où la véritable image qu’elle offre est celle d’une démocratie occidentale en proie à une stagnation économique à long terme, à un affaiblissement de la souveraineté nationale et à une dépression de toute forme de participation politique de masse – en substance, un évidement de la démocratie elle-même.
J’ai récemment participé à un débat sur podcast portant sur le pays dont l’histoire depuis 1900 nous renseigne le plus sur le monde dans son ensemble, et j’ai plaidé pour l’Italie. Non pas parce que l’expérience des Italiens au cours du siècle dernier est représentative de la masse de l’humanité – elle ne l’est pas, en termes de souffrance, de violence coloniale ou de privations. Mais plutôt parce que, depuis l’unification dans les années 1860, le débat politique et la vie intellectuelle italiens ont généralement été organisés autour de l’idée d’ « imiter » divers modèles étrangers de construction de l’État, qu’il s’agisse de l’Allemagne wilhelmienne, des empires coloniaux, de la démocratie de consommation de masse à la mode américaine, de l’UE (ou même, pour une minorité, du socialisme soviétique). Je pense que ce qui est différent dans la situation actuelle, c’est que l’UE et l’hégémonie états-unienne sont tellement en crise qu’elles ont même du mal à projeter un modèle à suivre, mais la plupart des Italiens ont perdu leur enthousiasme pour le projet européen alors qu’ils n’ont pas d’alternative évidente.
Dans de nombreux pays occidentaux, nous pouvons observer un retour en arrière politique, notamment par le biais d’un fossé politique croissant entre les générations plus âgées et les jeunes qui ont le sentiment que leur avenir – ce qu’on leur a promis – leur a été volé. Le M5S a en quelque sorte exprimé cette déception, même s’il s’est avéré lamentablement inefficace au gouvernement. Je ne pense pas que l’on puisse dire avec certitude que la désillusion actuelle va nécessairement produire un meilleur résultat : elle peut simplement conduire à la résignation, ou à l’atomisation, et le taux élevé d’émigration est également très révélateur à cet égard. Les prochaines élections verront probablement une nouvelle radicalisation vers la droite, notamment avec la montée des Fratelli d’Italia, et un renforcement de l’autoritarisme, par exemple en criminalisant « l’apologie du totalitarisme communiste ». Il ne s’agit pas d’un effet instrumental de la classe dirigeante italienne qui aurait « besoin » de formes autoritaires de gouvernement, mais d’une combinaison de la pression au sein de la base de la droite et du fait que les gouvernements peuvent maintenant facilement revenir sur les conquêtes passées du mouvement ouvrier.
*
Propos recueillis par Stéfanie Prezioso.
David Broder est historien, spécialiste du communisme en France et en Italie. Il est également le directeur de publication de la branche européenne de Jacobin.
Notes
[1] Belt and Road initiative, ou « nouvelle route de la soie », est le nom du projet de l’État chinois visant à développer des infrastructures de transports et économiques afin d’étendre son influence, en particulier sur les continents africain, européen et asiatique.




![Fratelli d’Italia : qui sont les néofascistes aux portes du pouvoir ? [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Giorgia_Meloni_Quirinale_2019-150x150.jpg)
![Après le 6 février 1934, front antifasciste et débats stratégiques [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/573de12c2d14d-150x150.png)



