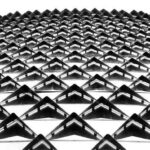Luttes universitaires et luttes des quartiers à Nanterre. Entretien avec Victor Collet
Militant anarchiste et docteur en science politique, Victor Collet est l’auteur d’une thèse, réalisée entre 2005 et 2013, portant sur les luttes de l’immigration à Nanterre, des bidonvilles à aujourd’hui1. Ce travail de recherche, ainsi que les luttes universitaires auxquelles il participe, joueront un rôle important dans sa politisation libertaire. Pendant ces années, Victor et ses camarades œuvrent à faire un lien entre les collectifs de l’Université de Nanterre, alors mobilisés contre les réformes successives de l’ESR, et les réseaux associatifs de la ville, davantage tournés vers les quartiers populaires.
À la fin de sa thèse, Victor obtient un poste d’ingénieur de recherche, mais coupera en partie les ponts avec l’Université après 2016. Il est aujourd’hui libraire et militant dans un café associatif à Marseille, le Manifesten. Dans cet entretien, il revient sur les luttes politiques qui ont traversé l’Université et la ville de Nanterre ces vingt dernières années. Pour lui, les lieux et l’autonomie des luttes qu’ils impliquent sont une question sérieuse. En effet, c’est par les lieux que commencent les répressions, mais c’est aussi à travers eux que s’organisent les résistances et les passerelles entre des collectifs traversés par des histoires différentes.
Nanterre, du bidonville à la cité. Extrait du livre de Victor Collet
Contretemps : Comment se sont déroulées tes premières années de politisation à l’université de Nanterre ?
Victor : Comme l’a récemment écrit Enzo Traverso, « l’expansion du moi implique forcément un rétrécissement du nous »2. Pour parler de mes années à Nanterre, il faut donc parler de l’histoire de la ville, de sa fac, et de ce qui selon moi a été une période de transition, aussi bien pour Nanterre que pour moi. Mes parents sont eux aussi passés par la fac de Nanterre, pendant ou juste après Mai 68. Ma mère a passé son enfance en Algérie, tandis que mon père a grandi dans un petit pavillon familial. Je m’inscris donc dans une autre histoire de la banlieue, que je découvre plus tard à l’Université et sur laquelle je travaillerai pendant ma thèse.
Quand j’arrive à la fac, en 1999, je viens de passer trois ans dans un lycée à Neuilly-sur-Seine à côtoyer et découvrir la « classe dominante », la ségrégation bourgeoise, fermée sur elle-même, s’auto-sélectionnant à ses soirées avec ses codes si particuliers. En retour, et sûrement par réaction, je m’étais mis à fréquenter les rares banlieusards du lycée qui y étaient venus, comme moi. L’arrivée à la fac de Nanterre est donc particulière pour moi : il s’agit avant tout d’un retour à la banlieue que j’avais connue. Mais en même temps, je découvre un lieu qui est encore un beau bordel hérité de Mai 68. La grande barre des Lettres est à l’époque très ouverte, on peut y circuler librement, et plein de gens extérieurs viennent des cités alentour. Il y avait un mélange qui n’était pas vraiment ordinaire. Si la haute bourgeoisie y avait aussi ses quartiers, dans les filières d’économie et de droit notamment, elle n’y était plus du tout majoritaire comme au lycée.
La première fois où je me rends dans la barre des sciences sociales justement, c’est un enchaînement de couloirs, de gens posés sur les bancs qui scrutent les allées et venues. Je me rappelle du hall du bâtiment administratif avec ses bancs vieillis, très sombre, des gens qui tirent sur des bangs, par terre, au milieu de la fac. Quand on y repense, c’était du délire ! Tout le monde fumait dans la cafét’, enfin bref, c’était la fin des années 1990 et forcément, ça marque ! En amphi, il y avait en permanence des interventions de groupes militants, maoïstes et trotskystes, qui venaient politiser les questions étudiantes, en particulier le cas des étudiants étrangers. À l’époque, mes amis et moi n’étions pas vraiment politisés. On se savait juste vaguement de gauche et ça nous faisait marrer de nous balader de temps en temps avec eux. On se sentait un peu concernés par ces questions, mais sans le verbaliser clairement.
Après 2002, je bifurque en science politique, tandis que mes amis restent en droit ou arrêtent. C’est là que cette politisation sous-jacente est progressivement devenue un engagement, notamment au contact de profs que je trouvais bien plus intéressants que ceux de mon ancienne filière. C’était souvent d’anciens militants. Je pense notamment à Jean-Marie Demaldent, un temple d’érudition qui nous faisait un cours sur les théories socialistes, ancien membre du PSU, et qui était déjà le chargé de TD de ma mère et de ma tante juste après 68. À partir de là, le militantisme a donc plus ou moins naturellement suivi. Cette période correspond à peu près au moment des mobilisations autour de la réforme LMD. Nous n’étions alors pas beaucoup, et à l’époque tout fonctionnait en parallèle des luttes et des agendas propres aux organisations politiques présentes à Nanterre. On faisait du tractage, mais on avait l’impression de passer en plein désert, surtout dans le bâtiment de droit et de science politique.
À partir de la maîtrise et du DEA, les choses ont changé. À ce moment-là, mes amis et moi nous préparons à faire une thèse. On fonctionne donc un peu en vase clos. Dans ce cursus, les gens qui sont avec nous sont clairement là pour approfondir les idées. On se retrouve donc dans un truc beaucoup plus militant. On se réunissait en petits groupes, on lançait beaucoup de réflexions au sujet des suppressions de postes dans les universités, on se mêlait un peu avec Sauvons la Recherche, même si on les trouvait trop modérés et centrés sur la question des « moyens de la recherche ». On commençait à faire des banderoles, on les installait dans les salles où on avait cours, comme celle de « Pas touche aux sciences sociales ! ».

À ce moment-là, on évolue encore dans un espace très façonné par les profs, même si on commence à s’en détacher. Il faut dire qu’il y avait des grosses têtes, comme Bernard Pudal, Bernard Lacroix, mais aussi Annie Collovald ou Sandrine Lefranc. Intellectuellement, on voyait qu’ils poussaient quelque chose, mais politiquement ils ne pouvaient le pousser à son terme. Soit parce que c’était lié à leur position de prof, donc ils ne pouvaient pas s’afficher ouvertement, soit parce qu’au même moment on voyait que l’on avait une marge de manœuvre plus grande que la leur. On n’était pas seulement là pour suivre des cours, déconstruire les choses sans y trouver de débouchés réels. On était aussi venu par ras-le-bol de ces cours et donc, pour être en cohérence, faire de la politique, sans que cela soit de la politique politicienne.
En 2005, il y a eu beaucoup de manifestations. D’abord, la lutte autour du « non » au référendum pour la ratification du traité européen, qui a éclairci le jeu politique entre une gauche capitaliste pro-traité et les autres. En février, la loi sur le « rôle positif de la colonisation », qui tentait d’imposer aux historiens de reconnaître ses bienfaits dans les manuels scolaires, a fait un tollé. On a organisé, avec quelques amis du DEA et des doctorants, un débat avec Gérard Noiriel et Gilles Manceron, qui étaient alors à la pointe de la dénonciation de cette loi. L’événement a ramené énormément de monde : c’était blindé ! On y a même retrouvé d’anciens potes de droit, qui étaient certes un peu réacs mais touchés par la question du racisme. Mais peu après, on est retournés dans nos chaumières pour le mémoire et la thèse qui a commencé en novembre 2005. On était trois amis à avoir, contre toute attente, obtenu une bourse de recherche et on s’est donc collectivement retrouvés de l’autre côté de la barrière.
À peine deux mois plus tard, la loi sur le Contrat première embauche (CPE) débarque comme une réponse aux émeutes de novembre. Pendant cette première année de thèse, c’est la folie : je fais absolument tout, sauf mes recherches. Les premières AG et les premières grèves débutent dès fin janvier 2006. Les cours ne démarrent pas, le stress monte, et puis boum, on se retrouve à plein régime dans le CPE. Grèves, blocages même sous la neige, rencontres avec les étudiants de socio, des premières années jusqu’aux profs, manifs à Nanterre avec les lycéens, dans Paris… Ce moment change vraiment la donne, et il y a comme un effet de non-retour. Le CPE réinstalle comme élément central l’occupation comme outil de récupération et de réimposition de notre existence : permanente, de bâtiment, de l’université, de la rue, à la Sorbonne tous les soirs ; temporaire, des ministères, de l’AFP, de l’EHESS et bien d’autres. La richesse des échanges et des rencontres, la profondeur des critiques qui y sont développées font que ce qui devient militant ne retombera jamais et créera un énorme fossé avec les personnes qui tenaient seulement de beaux discours en cours ou en AG, en particulier les profs.
C’est à ce moment que reprend aussi à Nanterre une phase de politisation anarchisante et anti-autoritaire. Pas mal de groupes autonomes et de non-syndiqués reprennent de la vigueur après une longue lutte anti-sécuritaire contre la construction de murs de séparation dans la barre des sciences sociales, la mise en place de dizaines de caméras de surveillance sur toute la fac et l’ascension d’un imposant cortège de vigiles toujours plus armés, entre 2003 et 20043. Les tensions dans les AG sont assez vives, mais l’unité demeure, que cela soit dans les manifestations communes en centre-ville, les cortèges nanterriens vers Paris ou les actions en direction des usines alentour. À la fin du mouvement anti-CPE, le collectif éphémère des Sans-noms a même tenté de poursuivre la lutte en lançant des actions « CROUS gratuit » ou en organisant une semaine « anti-sécuritaire » qui faisait le lien avec le renouvellement urbain des environs.

Contretemps : C’est donc à ce moment que toi et tes amis cherchez davantage à vous tourner vers la ville plutôt que vers l’Université ?
Victor : Non, pas vraiment. En fait, je dirais que cette projection sur la ville naît de différents facteurs : d’abord le fait d’habiter Nanterre après 2005 me permet de constater le décalage des histoires entre faculté, d’un côté, ville populaire et immigrée, de l’autre, ce qui me donne envie de les partager ailleurs qu’institutionnellement ; ensuite, mon travail de thèse me fait rencontrer beaucoup de monde lié à ces histoires ; et enfin, l’obligation de redéfinir des priorités militantes sur la fac en constatant l’échec et l’éternel recommencement des luttes universitaires, notamment liés au fort turn-overétudiant et à la dépolitisation progressive du campus.
À partir de 2005, je découvre les quartiers de Nanterre, leurs histoires et celle des bidonvilles, qui ré-émergent très vite, notamment grâce à l’association Les Oranges, qui milite pour donner des noms de rue et d’édifices publics aux « héritiers de l’immigration ». D’autres luttes ont aussi éclaté peu après, à la frontière de la fac et de la ville, avec la vague de grève des travailleurs sans-papiers après 2008. Pendant ma thèse, le mélange entre les observations, la vie professionnelle, militante et personnelle, est intense. Ce mélange irrigue en permanence mes questionnements et vice-versa. Les discussions avec les doctorants et les anciens amis du CPE nous amènent à critiquer l’académisme, qui empêche l’aboutissement pratique et politique, ainsi qu’à réfléchir à notre impossibilité de faire avec le proche, notre environnement à Nanterre. Cela nous pousse finalement à vouloir agir autrement. On crée aussi un nombre de groupes et de collectifs invraisemblable, mais qui ont une grande difficulté à perdurer. Cela va de la préservation de groupes de TD, au maintien des postes de demi-ATER (lors de la réforme pour généraliser les ATER à temps plein en 2006), jusqu’au Réseau universités sans frontières (RUSF). Mais les luttes entre la fac et la ville peinent encore durablement à se mêler.
Avec la LRU, fin 2007, la configuration va durablement changer. Sarkozy est au pouvoir depuis quelques mois, et après les cheminots, la contre-réforme réactionnaire tombe sur la fac, telle une chape de plomb fascisante. Des profs de droit et d’autres disciplines, qui voulaient leur revanche après les blocages interminables du CPE, font intervenir des vigiles, souvent privés, afin de casser les blocages, arguant notamment du traumatisme de 2006, mais aussi, fait nouveau, de leur vraie « légitimité » face aux étudiants radicaux minoritaires, sinon « extérieurs à la fac », qu’ils voyaient en nous. Certains vigiles lâchent leurs chiens sur quelques étudiants. C’est le début d’une brutalisation politique dans les campus et plus largement dans les mouvements sociaux.
Finalement, la mobilisation contre la LRU échoue : elle est longue, dure, mais ne réussit pas à dépasser le cercle de militants convertis par la lutte contre le CPE. Ni non plus à réinventer ses modes d’action, alors que l’UNEF quitte le mouvement dès fin novembre. L’unité dans les luttes, forgée en 2006, est donc clairement rompue. On se rend compte que le seul blocage des Universités pèse assez peu comparé aux millions de personnes des journées interprofessionnelles du CPE. En face, c’est l’inverse : la Réaction est mieux organisée, plus sûre d’elle-même avec son héraut à sa tête, les flics ont les coudées franches et sont bien plus violents, et des groupuscules de droite et d’extrême droite se reforment. Sur la fac, différents groupes se coalisent, alors qu’ils étaient peu visibles en 2006. Même s’ils sont parfois socialement et culturellement éloignés, ils finissent par collaborer ensemble en vue du maintien de l’ordre universitaire : les uns, tout en haut, pour maintenir leurs positions et le statu quo, les autres dans l’espoir d’y accéder mais aussi par peur d’une dévaluation de leurs diplômes.
La LRU coupe durablement une partie du mouvement de ses militants. Après cette période, nombre de ces derniers s’éloignent, suite à deux années de lutte quasi permanente. Reprendre les cours comme si rien ne s’était passé n’avait aucun sens. Toutes ces réflexions, sur le « bon et légitime » parcours de l’intellectuel, sur la position de la fac dans la structure capitaliste, sur l’horizon professionnel souvent indépassable de la fac menant vers une thèse payée, ou non, par l’État… Pour beaucoup, cela ne fonctionnait plus. Ils avaient envie d’autres horizons. Mais cette période correspond aussi, plus simplement, au moment où certains quittent l’université et où d’autres ressentent la nécessité de se recentrer pour vivre et pouvoir payer un loyer. Ainsi, une partie des gens avec qui on avait évolué pendant le CPE s’efface après 2009-2010.
Dans mes souvenirs, le paysage universitaire s’assombrit un peu à ce moment-là. La LRU passe, et les dispositifs de néolibéralisation avec. Sur le moment, on ne le ressent pas trop, on continue, on lutte mais c’est l’environnement général qui change. D’ailleurs, un peu comme le renouvellement urbain et les politiques de l’ANRU qui changent les populations et les quartiers en ville au même moment : La Défense arrive sur Nanterre, sur la fac rouge et la ville populaire, ce qui apparaît irrémédiablement comme un horizon mental indépassable. Sans mouvement, l’aspect sécuritaire et la fermeture du campus sur lui-même deviennent plus visibles. Derrière les renouvellements présidentiels de l’Université, le service hygiène et sécurité, quant à lui, reste, avec ses restrictions de plus en plus grandes sur les activités militantes.
Or, face à cette offensive, l’unification des groupes militants sur la fac ne vient pas. Les marxistes restent bloqués sur l’idée de massification et des inégalités économiques. Seuls quelques groupes anti-autoritaires et des militants isolés, lassés de demander l’autorisation pour tout et n’importe quoi, résistent face à une administration tentaculaire. Pour ce qui est du travail universitaire, si les relations entre doctorants et chercheurs sont bonnes, l’horizon se dégrade. La concurrence bibliométrique, la productivité et la normalisation des comportements s’instillent lentement. L’accélération des rythmes, l’augmentation des tâches administratives pour les maîtres de conférences, dans les labos, le boulot de super-secrétaire de certains deviennent délirants, ce qui laisse donc peu de temps pour le reste et pour la lutte. Les liens collectifs s’affaissent même en interne. On se croise, mais les situations se vivent plus individuellement. Tout va un peu plus vite, avec toujours moins de moyens.

Pour ce qui est de la vie universitaire, c’est la même chose. La généralisation des stages contraint les étudiants à accepter le travail gratuit, soi disant pour favoriser leur employabilité. Les disciplines managériales explosent dans l’ensemble des filières, jusqu’à créer des cursus offerts par BNP-Paribas. Les circulations entre disciplines se restreignent aussi. L’hétéronomie s’implante à la fac, mais pour tendre les bras aux entreprises. Les profils des nouvelles générations changent aussi très vite. Les sujets de thèse se recentrent sur les enjeux de la discipline, quitte à se dépolitiser, ce qui est un peu paradoxal pour des sciences dites « politiques »… De notre point de vue, les étudiants sont de plus en plus jeunes, et on ne les voit plus durer comme les autres. À cette période, il y a donc toute une pression externe, une transformation macro qui se conjugue avec une forme de déception militante.
Le coup de grâce est donné par la deuxième vague de lutte contre la LRU en 2009, quand est mis en place le décret sur le statut des enseignants-chercheurs. Cette fois, ce sont les profs qui se mobilisent. Beaucoup d’étudiants s’y associent, des premières années jusqu’aux masters, mais la radicalité des éléments plus militants n’a plus sa place, ce qui conduit à des frictions sans fin. Beaucoup encaissent très mal ce retour inattendu des profs, uniquement sur leur statut, deux ans après leur absence quasi complète pendant la première vague de lutte. D’autres voient encore plus mal cette masse d’étudiants envoyés au charbon pour les profs. Les structures militantes étudiantes paraissent à bout de souffle. La grève va être plus longue, plus soutenue, mais elle proposera peu de chose si ce n’est des actions très symboliques, comme des happenings ou des flashmobs… Elle ne bloquera pas grand-chose, sinon rien. Beaucoup de cours se tiennent y compris sous la houlette de profs dits « en grève » (sic). L’imaginaire de la lutte reste embourbé dans des antagonismes de statut, les étudiants d’un côté, les profs de l’autre. Il n’y a pas vraiment d’idéal collectif. On assiste à une sorte de farce mandarinale qui intervient après la tragique défaite deux ans plus tôt. Avec une dose de fatigue militante et/ou d’angoisse sur la thèse qui ne finit pas, c’est le moment où je sens que l’on y croit un peu moins.
Mais cette ambiance morose de la fac contraste fortement avec les luttes auxquelles nous participons au même moment sur Nanterre. Ce sont souvent des luttes plus directes avec les travailleurs et les étudiants sans-papiers, notamment lors de la vague de grève qui démarre en 2008, et redémarre un an plus tard. On se déplace sur beaucoup d’occupations dans le département, à Colombes chez Passion Traiteur, à Neuilly-sur-Seine au Café de la Jatte (le restaurant de Sarkozy où les cuisiniers sans papiers vont être régularisés en deux jours), sur une usine de recyclage des déchets industriels juste derrière l’Université, à Nanterre, ou encore à l’église Saint-Paul, occupée pendant des mois face à l’omnipotente préfecture des Hauts-de-Seine. Sans le formuler ou avoir besoin de le théoriser, nos luttes tentent donc de faire se rejoindre deux univers séparés. On (re)découvre des conditions sordides à deux pas de la fac, les isolements fous d’étudiants étrangers qui ne sortent plus de chez eux à cause d’une traque qui s’intensifie sous l’ère Hortefeux-Sarkozy. Le décalage est trop fort, trop violent même, comparé à l’espace feutré des mobilisations universitaires sans lien avec le sol nanterrien. Continuer à séparer ces deux conditions aussi ouvertement n’avait plus vraiment de sens !
Surtout, la ville de Nanterre apparaît comme un véritable havre de paix pour les militants. Les regards et les échanges sur les marchés, en très grande majorité composées de familles populaires et immigrées, se passaient toujours hyper bien. Nombre de vieux Algériens, des anciens du FLN, parlaient et discutaient avec nous. Ils avaient un peu, voire beaucoup de temps à nous accorder pour échanger. À la fac, on se sent vieillir et de plus en plus être étranger au quotidien des étudiants et enseignants. Au bout du compte, plus personne n’écoute ce que l’on a à dire : l’essentiel est de s’en sortir pour les uns, et de produire pour les autres. En bas de la passerelle ouvrant sur l’Université, les stressés-pressés de la fac jettent les tracts et les hypothèses de lutte à la vitesse où les trains déversent les étudiants chaque matin pour consommer leurs cours. On a donc envie de souffler et besoin de franchir plus souvent cette passerelle pour passer de l’autre côté, en terre communiste, immigrée, où les classes populaires étaient encore majoritaires et où, aussi, les caméras de surveillance et la police municipale n’existaient pas. Au même moment, l’occupation devient très difficile à la fac, car on refuse de demander toute autorisation à l’administration. À l’époque, avec le RUSF, on fait beaucoup d’accueil et d’accompagnement juridiques pour les étudiants sans-papiers, mais on avait du mal à organiser nos permanences de façon stable et pérenne. Nous n’avions ni de local, ni de lieu tout court.

C’est de cette façon que les projets d’installation sur Nanterre ont émergé. De l’idée d’un centre social autogéré, est né le projet de librairie militante dans le quartier des Provinces françaises. C’était une zone où l’on savait qu’un certain nombre de commerces allaient ouvrir dans le cadre du projet de centre commercial rénové et de la nouvelle gare. On voyait d’abord cette idée comme un grain de sable dans l’énorme projet « multimodal », dont l’évidente conclusion était la disparition du patrimoine populaire de la cité du même nom. Notre projet se voulait être un ancrage pour renouveler nos circulations, faire sortir un peu les étudiants de leur enclos universitaire, et avoir une base territoriale non soumise aux aléas de l’administration sécuritaire de la fac. Finalement, il se trouve que cette librairie, qui a pris le nom d’El Ghorba mon amour4, a ouvert dix ans plus tard, en mars 2020, trois jours avant le confinement ! (rires) Avec mon impatience chronique, j’avais quitté le projet depuis longtemps mais Halima et Elsa, elles, ont tenu ferme pendant tout ce temps, malgré les couleuvres des promoteurs et les business plans. Elles ont réussi à maintenir le dialogue avec les élus locaux et à remplir toutes les obligations d’un projet en territoire capitaliste aussi avancé que l’est aujourd’hui cette succursale de La Défense, qui reste pour le moment encore populaire.
La recréation d’une section CNT sur la fac en 2014, deux ou trois ans plus tard, est une sorte de tournant mais aussi l’aboutissement de ces expériences passées. Elle s’est faite à partir d’une lutte un peu anodine qui concernait la baisse du nombre des chargés de TD, la réduction des effectifs en général et les conditions de vie de ce qu’on avait appelé les « petites mains de l’université ». Moi, je n’étais plus chargé de TD d’ailleurs, car j’avais soutenu ma thèse en 2013, mais je restais au bureau des doctorants où je me sentais mieux que dans un bureau isolé. Or, ce qui était assez drôle, c’est que ce sont essentiellement des étudiants qui sont entrés en lutte sur cette question. Très peu de chargés de TD y ont participé. Sans parler des profs… C’est là que nous avons acté qu’il fallait arrêter les conneries à faire des trucs pour les autres, attendre le déluge ou une politisation qui ne viendrait jamais de tel ou tel type de personnel. On s’est dit qu’il fallait faire les choses pour nous, un lieu pour le faire, un groupe plus pérenne qui transcende les statuts. On savait que l’ancienne CNT, tenue par des amis, avait encore un local, au milieu des bâtiments et du quotidien des étudiants et des personnels, ce qui a facilité la décision. Il s’agissait d’un choix très matériel par rapport à SUD qui était aussi en balance.
Des personnes de différents corps se sont vite agrégés, des étudiants en passant par les administratifs, jusqu’aux docteurs et certains maîtres de conférences. Le mouvement était finalement inverse de celui pensé avec le RUSF : on avait un lieu sur la fac, mais nos actions n’y étaient plus du tout pensées comme centrées sur le campus. Le brassage des statuts au sein de la section nous a très tôt ouvert sur des réalités au-delà de telle ou telle lutte corporatiste. Après les petites mains intellectuelles, une des premières luttes de notre section a consisté à soutenir une grève des agents d’entretien et des cuisinières du CROUS. On a donc réalisé des petites enquêtes auprès de ces travailleurs, notamment sur des questions de turnover bizarres et de problèmes de droits non respectés. On s’est alors rendu compte que, contrairement aux tracts que personne ne lisait plus, ceux-là étaient extrêmement lus et débattus, parce qu’ils parlaient du vécu réel et révélaient l’existence des invisibles croisés à toute heure sur la fac.
Mais la diversité des profils avait ses revers : le décalage d’expériences, entre le prof de fac et l’étudiant de première année, impliquait une attention permanente à la circulation des échanges, des savoirs et des pratiques entre nous. C’est ce qui nous a conduit à ouvrir des séances, finalement publiques, d’auto-formation autour de livres afin de confronter les points de vue et les expériences de chacun et chacune, tout en veillant à faire tourner la parole pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui parlent, pensent et fassent. Nous nous sommes ensuite procurés directement des livres moins chers chez les éditeurs afin de se les partager pour préparer les débats. Puis, de séance en séance, les livres et les éditeurs se sont accumulés, nos yeux se sont mis à briller devant tous ces livres, et c’est ainsi qu’est née notre librairie itinérante autogérée. Au bout d’un an, on avait des tables à n’en plus finir qui emplissaient un des halls de la barre des sciences sociales chaque jeudi. On les installait dans les événements militants, mais aussi en ville de temps en temps. C’est là que nous nous sommes rendu compte que les débats intellectuels n’étaient pas morts à la fac, et qu’ils étaient bien plus vivants hors les murs autour de la matérialité du bouquin.
Parallèlement, nous avons pas mal continué l’affichage et le collage dans la fac et dans les quartiers de Nanterre, notamment pour inviter à des projections et à des conférences sur la question des violences policières et de l’antifascisme. Pour certains, l’antiracisme faisait beaucoup plus facilement le lien entre les quartiers populaires de la ville et la réalité de la fac. En 2010 et 2011, il y a eu trois morts, dues à des interventions policières, sur le territoire de Nanterre et de ses environs. Au même moment, le souvenir des massacres du 17 octobre 1961 redevient central en ville, au point parfois de s’institutionnaliser, et ne plus faire lien avec le présent5. On organise donc plusieurs trucs là-dessus, dans les quartiers où les gens étaient les plus touchés tout en faisant venir les gens de l’Université qui étaient aussi très intéressés. Cela débouche en 2014 et 2015 sur les manifestations parallèles aux commémorations officielles en souvenir du 17 octobre 1961. Là, beaucoup de militants plus jeunes participent, et l’année suivante un peu plus de Nanterriens grâce aux réseaux avec lesquels on commence à pas mal bouger, du Mili aux antifas. Celle de 2015 se faisant même interdire puis autoriser et accompagné de dizaines de fourgons de CRS. Une autre manière de recoller avec l’histoire des quartiers (rires).

Entre temps, s’implante à l’été un nouveau bidonville sur les dernières friches du projet d’axe allant de la Seine à l’arche de La Défense. Cette fois-ci, on se retrouve en opposition directe avec la municipalité. Paradoxalement on se retrouve plutôt soutenus côté faculté, et même par certains vigiles plutôt compréhensifs au moment où des copines et copains du collectif accueillent les habitants délogés dans un des amphis de l’Université. Si la lutte a été défaite malgré les occupations de logements, la victoire a au moins été d’en finir avec le silence fait sur cette réalité, en particulier celui de la mairie restée muette depuis le début. Avec l’inauguration de la rue Abdennbi Guémiah en juin 2014, elle est allée jusqu’à commémorer l’histoire des bidonvilles et des cités de transit en niant l’existence du bidonville installé à 300 mètres de là ainsi que sa participation active à l’expulsion ! Moi, je venais de finir ma thèse, je connaissais plutôt bien l’histoire de Nanterre et la gestion communiste des bidonvilles historiques qui, pendant très longtemps, a consisté à reporter la responsabilité du relogement au département et à l’État. En 2014, on ne pouvait que constater que la rhétorique et les pratiques étaient reproduites quasiment à l’identique mais pour quelques centaines de personnes cette fois-ci, plus pour la dizaine de milliers de travailleurs et familles du Maghreb dans les années 1960 ! Du coup, nos tracts et nos actions étaient plutôt salés… C’est là que les choses ont commencé à coincer côté ville, alors que l’on commençait à nous laisser plutôt tranquilles sur la fac. Beaucoup d’élus, voire d’anciens militants, me voyaient alors comme un intellectuel militant qui, de par son travail de thèse sur Nanterre, participait à valoriser ce patrimoine et la reconnaissance de la mémoire municipale. Mais une fois que l’on entre sur le terrain politique du temps présent, on passe un peu de l’autre côté de la barricade…
Contretemps : Pourrais-tu à présent revenir sur les événements qui t’ont conduit à quitter l’Université quelques années plus tard ?
Victor : Entre 2015 et 2016, on était vraiment en surcharge d’activité avec la section CNT. On commençait à faire trop de choses, les gens étaient fatigués, et j’y étais pour beaucoup. On a sombré dans une sorte de productivisme que l’on combattait pourtant par ailleurs, mais il faut dire que ce que l’on faisait marchait pour de bon. Trente-trois ans de vie entre Nanterre et Colombes, à ne plus faire que ça, tout finit par se mélanger : les repères de l’intime, du professionnel, du quartier et du militantisme se brouillent, et tu finis par faire des erreurs, comme ne pas prendre suffisamment de recul. Sur quoi s’invite l’état d’urgence après les attentats du 13 novembre en 2015. À ce moment, tout ce que l’on avait mis en place part en fumée en quelques jours. L’énergie et les allées et venues des gens sur le campus étaient totalement contrôlées. Tout le monde s’y soumettait, les circulations de personnes extérieures étaient réduites. Les embrouilles devenaient quasiment systématiques aux entrées, même pour faire entrer du simple matériel militant. D’ailleurs, on ne connaissait même plus les vigiles qui s’étaient ajoutés aux autres ! Il y avait beaucoup de tensions et de déprime. Les liens étaient bouleversés, et la torpeur totale. Et quand elle n’abdique pas, elle s’accompagne d’une répression très violente.
En effet, la COP 21 arrive quinze jours plus tard, et je suis blessé pour plusieurs mois à la suite de la manifestation. Triple fracture de la main gauche. Je ne peux plus écrire, j’essaie quand même d’avancer sur le manuscrit pour Agone, mais bon, grosse attente et grosse déprime. Suite à une autre rupture, personnelle, je décide de faire un break qui sera en fait définitif. Je pars pour Athènes, parce qu’il fallait bouger. Au début, je n’avais pas trop envie de me remettre dans des trucs militants. Mais bon, s’abriter de la politique dans un quartier aussi militant qu’Exarchia, au milieu de la plus grande vague de réfugiés connue depuis des décennies, bonjour le choix ! Au bout de quelques semaines, on ouvrait et rénovait un vieil hôtel abandonné pour accueillir les réfugiés. Du coup, j’ai recommencé les allers-retours vers Paris pour faire des collectes d’argent afin d’aider à la rénovation des bâtiments, en pleine effervescence des luttes contre la Loi travail, au printemps 2016. Cela faisait dix ans que le CPE était terminé, je pars pour la première fois de ma vie deux mois à l’étranger, et boum ! La Loi travail ! Gros questionnements donc. Y aller ? Rester ? Finir le bouquin quand même ? Finalement, les allers et retours deviennent plus fréquents lors des journées de mobilisation. À Athènes, on organise même des projections en plein air pour le soutien à la lutte en France ! Les images sont en effet hallucinantes, à la torpeur des mois précédents succède une brutalisation impressionnante et une ferveur qui témoigne de la transformation radicale des luttes en dix ans. On est en plein état d’urgence à Paris, et ça pète de tous les côtés ! Un mouvement autonome devient visible comme jamais, et rappelle à certains endroits celui qui se développe depuis des années à Athènes.
Je recroise alors des personnes que je n’avais pas vues depuis dix ans, depuis la période CPE, qui comme moi reviennent sur Paris pour les grosses journées, mais je rentre à chaque fois à Athènes. Jusqu’à la fin juin, après un moment plus long que prévu sur place, je me fais arrêter. S’ensuit une grosse procédure. À ce moment, des anciens de Nanterre et les collègues de travail m’ont particulièrement soutenu, ce qui a beaucoup changé ma perception des solidarités de part et d’autre de la passerelle universitaire. Je m’éloigne alors durablement de la région parisienne en raison de mon contrôle judiciaire, et donc d’Athènes par la même occasion. Je me rapproche de mon éditeur à Marseille, et via un stage par le biais d’un autre éditeur qu’on distribuait sur nos tables, Al Dante, je fais la connaissance du Manifesten, un café associatif, devenu aussi librairie, à tendance très libertaire. Entre temps, le lieu a été transmis à un collectif d’habitants du quartier, d’intellos précaires et de personnes liées de près ou de loin à l’édition indépendante, au livre et au journal CQFD. Je retrouve donc le soleil d’Athènes, et découvre le quartier militant de la Plaine, qui par moment prend des allures d’Exarchia avec ses murs colorés, et une population du marché et du centre-ville marseillais qui rappelle bien plus Nanterre. Bref, un bon cocktail à prendre comme il vient !
Contretemps : Entre le projet de librairie dont tu parlais tout à l’heure, le centre social du Petit Nanterre qui institutionnalise des cours pour les réfugiés à l’université, et le Manifesten de Marseille que tu évoques à présent, on a l’impression que ton militantisme a été marqué par la quête de lieux qui permettent de faire dialoguer les luttes universitaires avec des luttes extérieures ?
Victor : Oui, complètement. En fait, je trouve que les luttes universitaires ont perdu de vue cette dimension des lieux. C’est à cette conclusion qu’on a abouti avec la CNT. À Nanterre, les groupes politiques étudiants recrutaient moins et avaient perdu énormément de visibilité, de force, mais aussi de liens avec les autres étudiants. En partie parce qu’ils se sont laissés déposséder de leurs lieux de sociabilité, et se sont retrouvés hors des lieux qui comptaient réellement. Les choses ont commencé avec l’institutionnalisation des pratiques militantes. À cause des pressions du service d’hygiène et de sécurité, on est progressivement passé du tag partout à l’affichage sauvage, puis de l’affichage sauvage à la restriction d’afficher sur les seuls panneaux légaux, puis à la refonte des panneaux au profit du scotch… Cette pacification des mœurs politiques entraîne une lente intériorisation des interdits. La dépossession est devenue parfaite quand les bureaux associatifs et syndicaux étudiants ont été réorganisés dans un « ghetto » pour groupes militants, la « Maison des étudiants » (sic). Située à l’extérieur des bâtiments, elle était contrôlée par des vigiles, des appariteurs et des portes coupe-feu. Il s’agissait de sortir définitivement la politique du quotidien et de la vie étudiante, pour finalement lui en fermer définitivement l’accès !
Avant, ces espaces étaient implantés dans des espaces situés au milieu des cours. Un local était situé à côté d’une salle de classe. La majorité d’entre eux était en pied de bâtiment, à côté des lieux de sociabilité étudiante, ce qui fait qu’ils pouvaient eux-mêmes le devenir. Ce passage des cours, vers des lieux politiques, des associations, des gens qui viennent là parce qu’ils étudient et qui croisent ensuite des gens qui sont là pour faire d’autres choses, cela montre qu’une fac ce n’est pas que suivre des cours et obtenir un diplôme pour entrer sur le marché du travail ensuite. Il est donc amusant de voir que Mai 68 à Nanterre est né du mouvement inverse : à l’époque il y avait une absence de lieux de sociabilité, ce qui a conduit à une surcharge des rares lieux occupés par les militants, que cela soit au restaurant universitaire, au local de l’UNEF, ou dans les cafés tenus par des Algériens aux alentours de la fac.

Ainsi, tenir les lieux, au double sens d’avoir une présence et d’avoir un espace où se croiser et se rencontrer, est devenu une évidence militante. Cette pratique s’opposait à ces dépossessions vécues sur la fac et aspirait aussi à articuler les luttes universitaires avec d’autres, qui étaient tout autant intellectuelles que les nôtres, car en effaçant les lieux, on efface aussi les mémoires. Ce qui se passe aujourd’hui à l’Université était impensable quelques années auparavant ! La dimension des lieux est donc essentielle, sans quoi on se ferme des horizons. C’est la même chose pour Nanterre et ses quartiers populaires. Entre aujourd’hui et mon arrivée à la fac en 1999, les choses n’ont donc rien à voir. Aujourd’hui tu arrives dans une fac avec des rangées de barrières, tenues par des vigiles en uniforme qui orientent les arrivants dans des bâtiments fermés. J’avais d’ailleurs demandé à des jeunes de quartier qui débarquaient pour leur première inscription s’ils avaient compris qui étaient ces personnes : la plupart pensaient que c’étaient des flics ! Des flics qui te disent où tu dois aller ou non et qui te refusent l’accès si tu n’as pas de convocation préalable… Pour ces personnes-là, en schématisant de mon point de vue, la fac est devenue l’annexe du commissariat, ou de la préfecture pour ce qui est des personnes sans-papiers. Pour les nouvelles générations, c’est un endroit où tu ne vas pas dévier, déambuler, ou perdre ton temps à discuter, à moins que cela soit d’une manière, feutrée et autorisée. C’est un lent processus qui imprime un paysage mental et intellectuel, où le seul truc légitime devient la salle de cours et ton diplôme à la fin.
En 2014 on a essayé de briser ça de façon détournée en lançant des permanences micro-ondes et en réouvrant les portes historiques des bâtiments, fermées depuis le « processus de sécurisation », qui était soi-disant pour la « sécurité-incendie », mais en laissant bien sûr les mêmes portes ouvertes en droit et en économie (ce qui n’est plus le cas depuis 2015 et les attentats). On était alors installés en pied du bâtiment C, un coin complètement perdu, mais sous l’œil des caméras. Les permanences ont commencé à l’intérieur du local CNT, puis nous sommes passés à l’extérieur à côté de la porte, puis dans le couloir, et ensuite en y ajoutant des tables avec des micro-ondes. Finalement, on a carrément fini par faire des bouffes collectives ! D’une fois par semaine c’est passé à deux fois et finalement tous les jours ! Une sorte de guérilla culinaire (rires) avec des affiches peu à peu partout. Cela a été une lente mais certaine réappropriation (ou plutôt réoccupation) des lieux par grappe. Certes, petite à notre échelle. On avait compris que l’on ne pouvait plus, compte tenu du rapport de force, en ville comme à la fac, reprendre l’espace en général, car on se faisait retirer nos matériels immédiatement. L’idée était donc de faire du matraquage de proche en proche et grappiller de l’espace petit à petit. Cela a été très houleux au début, avec des gros coups de pression de la part de la direction, et peu à peu cela s’est imposé dans l’espace comme normalité, et le flux de circulation a rechangé ! L’anti-sécuritaire a recréé de la sociabilité. Et finalement, c’est devenu un mini centre social ! Certains venaient d’ailleurs sans aucun rapport avec la fac, la plupart parce qu’on pouvait y manger à prix libre ou gratuit.
Cette question des lieux s’est aussi posée lorsque l’on a voulu sortir de la fac pour se tourner vers la ville, avec notre idée de librairie. Quand tu milites à la fac, ton monde devient un peu imperméable. On avait du mal à le faire dialoguer avec les luttes extérieures, dans les quartiers, avec des gens qui avaient une situation sociale très différente. Quand tu écoutais les profs pendant les mobilisations, parfois même au quotidien, tu avais l’impression qu’ils allaient crever la bouche ouverte le lendemain et que c’était hyper difficile pour eux. Au fil des luttes quotidiennes, ce discours est vite devenu inaudible au regard des situations vécues et croisées ailleurs ! Les deux étaient donc difficilement articulables, mais c’est quand on a arrêté de vouloir créer nous-mêmes ces passerelles qu’elles sont venues à nous, sans pour autant abandonner cette prétention culturelle et intellectuelle qui nous avait beaucoup apporté : le livre, le débat, le conflit d’idées et la radicalité. On ne voulait pas seulement faire une salle de maraude ou de l’aide alimentaire pour les sans-abris. Partager nos expériences, ce n’était certainement pas pour tomber dans le populisme ou le misérabilisme une fois passés de l’autre côté de la frontière universitaire. Partager des mémoires et faire dialoguer des mondes qui ne se croisaient pas forcément, c’était accepter leur part d’incompréhensions, de conflits et de malentendus. Aujourd’hui, la librairie El Ghorba dont je parlais tout à l’heure s’inscrit dans cette volonté. Le projet a changé entre temps mais je suis convaincu qu’elle deviendra un lieu-refuge central au milieu d’un quartier complètement aseptisé par des buildings de quatorze étages, entourés de grandes chaînes, de Burger King aux fast-food asiatiques, en passant par les pharmacies géantes.
Cette idée des lieux n’était donc pas forcément théorisée. Elle était simplement très visible dans notre manière de faire, puis elle est devenue un véritable enjeu pour faire perdurer la mémoire militante et les échanges d’expériences, à un moment où ces derniers semblaient perdre en vivacité. Il nous fallait des lieux extérieurs aux institutions universitaires et municipales, des lieux dans lesquels ces dialogues et ces échanges pouvaient être possibles.
Contretemps : Avec tes camarades de lutte, j’imagine que vous avez réfléchi au rôle que pouvait avoir l’Université dans une ville comme Nanterre ?
Victor : Oui, on a développé beaucoup de choses pour faire connaître le territoire et rompre avec cette méconnaissance entre les uns et les autres. Quand j’ai eu mon contrat d’ingénieur de recherche, j’ai organisé des ballades urbaines pour les étudiants. Certes, on aurait pu dire que je faisais des ballades de gentrifieurs, mais j’emmenais surtout les étudiants et les nouveaux professeurs dans des endroits où il n’y avait eu, et parfois où il n’y avait encore, que des luttes ou des situations conflictuelles, comme celles des bidonvilles. C’était des endroits très marqués, par leur histoire et son effacement. Car le lessivage des mémoires a son effet pervers pour la domination aussi : l’absence de mémoire de cette fac a provoqué une demande de plus en plus forte du côté du personnel enseignant et technique. Trop de vide appelle de la compréhension et de la mise en cohérence pour des gens qui débarquent à Nanterre avec l’idée d’une fac chargée d’histoire et qui se retrouvent face à des murs blancs.
Ces passerelles ont aussi permis de briser un certain sens commun portant sur les différences, souvent artificielles, entre fac et cités de Nanterre, en particulier cette idée de division entre travail manuel et intellectuel qui, quand même, est un peu à la base de toute cette merde qui régit nos vies.
Au fil des rencontres et des mouvements, désessentialiser les groupes était un truc vraiment important. Les gens ont vite compris qu’il n’y avait pas plus de différence entre un étudiant et un autre, ou qu’entre un étudiant et un habitant de Nanterre, et que dans la lutte, au fond, ce qui compte sont les aspirations et les envies, pas juste notre ancrage et d’où l’on vient. Mais pour arriver à le saisir, compte tenu de la ségrégation, de la séparation des espaces, des identités, il n’y a pas dix mille manières, il faut créer des points de passage, des lieux de discussions, des situations entre des personnes qui n’ont pas l’habitude de se fréquenter, avant de comprendre qu’il y a autant de clivages sur les manières de voir et les aspirations ici que là-bas. Entre temps, cela peut créer un gros bordel, pas mal d’échecs et d’incompréhensions, mais aussi des perspectives et des rencontres improbables. Et c’est plutôt satisfaisant quand ça marche ! Cela peut être sur des choses très infimes, mais qui peuvent derrière déboucher sur des relations durables.
Après, quel rôle peut concrètement avoir l’Université dans une ville comme Nanterre ? C’est compliqué… Elle a rayonné plus particulièrement quand elle a fait tout autre chose que son rôle d’universitaire, en se rendant sur les bidonvilles ou sur les barricades et grèves d’usine. Aujourd’hui, l’effet est inverse, il y a une véritable entrepreneurialisation du monde universitaire et une aseptisation des rapports qui fait que, bizarrement, cela communique à nouveau entre les deux univers mais sur une base a-politique, ou plutôt très politique au sens où elle n’est plus qu’économique. Une réalité qui, évidemment, moi, ne m’intéresse pas. Il y a aussi un versant philanthropique, c’est-à-dire aider les pauvres, redistribuer les cartes des inégalités, participer partout à la hauteur de l’Université pour renforcer sa légitimité à être bien loin, et continuer à participer à ces divisions artificielles entre le manuel et l’intellectuel, tout en rendant sa domination inattaquable en brouillant le système de responsabilités et de causalités, en le rendant plus opaque et difficilement attaquable. Aider les pauvres, c’est un vaste programme dans un système qui les produit à la pelle. Or, oui, ils sont bien plus pauvres au Petit Nanterre, en tout cas pour une partie, mais je pense qu’ils ont beaucoup plus de choses à apprendre aux universitaires que l’inverse si tu veux mon avis ! Non pas dans la version maoïste d’envoyer les intellectuels aux champs pour les redresser, mais parce que ces habitants sont confrontés depuis des décennies à un quotidien dégradé où la débrouille impose des savoirs pratiques, hors des sentiers battus, des formes de solidarité renouvelées dans lesquelles puiser tous les jours. Ce n’est pas le savoir intellectuel qui va résoudre leur situation à lui seul. Donc quel peut être le rôle de l’Université ? Honnêtement, j’ai du mal à voir ce que renferme la question, sans doute aussi parce que j’y suis moins.
Façonner des savoirs intellectuels non connectés à la seule carrière et à la soumission aux exigences du capital, ce serait déjà pas mal, mais malheureusement nous n’en prenons pas la voie. L’idée de librairie, à Nanterre comme ailleurs, s’inscrit dans cette perspective : continuer à aller à la rencontre des gens, abaisser ses prétentions intellectuelles autonomes, faire découvrir des choses et dialoguer avec elles autour de ces savoirs à la frontière des sciences sociales et du monde militant. C’est super important ! Pour moi, l’objectif de l’Université doit être sa propre dissolution dans les mondes qui l’environnent, dans la vie en général. Mais je ne l’entends pas au sens négatif, c’est-à-dire au sens où elle devrait disparaître. Au contraire, elle doit irriguer ! Et pour irriguer, il faut monter des projets pour aller au-devant des gens, parce qu’ils ne peuvent pas y accéder autrement. C’est par exemple faire des conférences comme le font Les Oranges. Il faut faire venir et faire sortir, sinon c’est foutu. Rester sur cette question des savoirs est un enjeu à la fois anti-misérabiliste et anti-populiste. Car au fond, que peut faire l’Université ? Aller faire des colis alimentaires pour les pauvres ? Ce n’est pas sa vocation. Même si les gens peuvent le faire à titre individuel ou avec des groupes militants s’ils en ont envie. L’Université, elle fait du savoir, elle apprend des techniques pour se repérer là-dessus, elle offre un temps en partie détaché des impératifs de production et c’est très bien ! Donc parlons de ces savoirs et de ces méthodes avec les gens qui n’y passent pas forcément ! Ils en ont plein d’autres, il faut travailler avec eux pour articuler ces types de savoirs, de sensibilités et de méthodes, et voir comment ils peuvent dialoguer pour s’alimenter et s’enrichir.
Par exemple, avec l’événement mondial autour du meurtre de George Floyd, comment expliquer que l’on se retrouve avec des dizaines de milliers de personnes devant le Tribunal de grande instance de Paris à Porte de Clichy ? Pour beaucoup de militants, c’était imprévisible, et ça a débordé de tous les cadres traditionnels. Cela veut donc bien dire qu’il y a des choses qui marchent, des savoirs et des mémoires qui s’alimentent quand d’autres ne marchent pas ou plus. Les choses flottent en permanence. Et des petites actions s’implantent et égrainent durablement pensées et pratiques. L’émotion, l’isolement et le déferlement d’images peuvent évidemment jouer, voire retomber. Mais jusqu’où ? Et jusqu’à quand ? Les gens étaient très jeunes, les images extrêmement choquantes mais cela traduisait en même temps de sacrées réflexions de fond, de l’auto-information et de la transmission des savoirs qui passent par d’autres canaux.
L’université de Nanterre, comme moi je l’ai connue, a permis plein de choses, du fait de son histoire justement et de cette porosité, une porosité qui est d’ailleurs peut-être en train de revenir. Aujourd’hui, j’ai l’impression que l’on revient à une situation où la vie politique et sociale s’est durcie un peu partout et le Covid a certainement accentué encore les choses. Or, la brutalité avec laquelle le monde militant et intellectuel a été traité depuis dix ans a créé des rapprochements inattendus avec la façon dont les classes populaires en banlieue sont traitées depuis toujours. Et, au milieu, les Gilets jaunes sont venus perturber tout le dispositif du « à chacun sa place, à chacun son rôle » avec leurs manières imprévisibles d’envahir l’espace. Les intellectuels ne peuvent plus ignorer ou être insensibles à cette violence.
En 2016, je n’étais pas là au moment de la création du Comité Justice et Vérité pour Adama, car je n’étais plus sur Paris. Mais j’ai vu son développement, comme les manifestations pour Théo qui se déroulaient de plus en plus loin de Paris, notamment à Marseille, où certaines soirées de soutien se sont tenues justement à Manifesten. Cela faisait des années que l’on essayait de créer ces convergences ! Cela n’arrivait pas à prendre, mais les petites choses accumulées ici et là ont fait des émules. En fait, les petites luttes locales ne sont pas vaines. À la fac, les groupes militants se sont longtemps perdus dans des luttes internes permanentes ou des horizons trop larges. Aujourd’hui, j’ai l’impression que les nouveaux arrivants font différemment. C’est beaucoup plus humble et ça communique beaucoup plus. Je pense que ces choses-là vont revenir et je pense même que c’est déjà revenu. Quand je suis repassé sur le campus récemment, j’ai vu des affiches de luttes, de liens extérieurs avec la fac qui réapparaissaient un peu partout, une mémoire imprévue de vieilles luttes croisée avec des questions très nouvelles. Des ponts existent, reste à savoir si, comme en 2018, ils resteront superficiels ou s’ils s’autonomiseront réellement, en ancrant leurs pensées et leurs pratiques dans les murs, le quotidien, sans s’effacer à chaque retombée. À titre personnel, mon travail de recherche et mon militantisme s’articulent pour faire revivre les absents, les oubliés, des luttes souvent martyrisées par l’histoire dominante, d’hier et d’aujourd’hui, sans oublier d’en rappeler les aspects positifs et les plus sombres, venger sincèrement les vaincus en ancrant leurs mémoires, leurs questionnements et leurs errements dans les luttes du présent, en évitant d’en faire seulement un panthéon.
*
Propos recueillis par Antoine Lalande.
Illustration : (c) agence Im’Media.
à voir aussi
références
| ⇧1 | Ce travail a donné lieu à la publication Nanterre, du bidonville à la cité, Agone, 2019. |
|---|---|
| ⇧2 | Enzo Traverso, Passés singuliers. Le « Je » dans l’écriture de l’histoire, Montréal, Lux, 2020, p.206 |
| ⇧3 | Sur cette période, voir la brochure en ligne « Fac de Nanterre : détruire un mur, construire une lutte », https://infokiosques.net/lire.php?id_article=1554 |
| ⇧4 | Le nom de la librairie est inspiré du concept de ghorba, développé par le sociologue Abdelmalek Sayad, qui en arabe signifie « exil ». Tout en évoquant la mémoire de l’immigration dans laquelle s’inscrit le quartier de la librairie, Elsa et Halima ont voulu coupler ce mot chargé d’histoire d’une connotation plus positive en reprenant le titre du film d’Alain Resnais de 1959, Hiroshima mon amour. |
| ⇧5 | Sur cette histoire, voir Collet, Victor, « Le 17 octobre 1961 à Nanterre, « un passé qui ne passe pas » » http://www.article11.info/?Le-17-octobre-1961-a-Nanterre-un |