
« La guerre, sans qu’on lui demande, se charge toujours de nous trouver un ennemi » – Petit Pays, de G. Faye
À propos de : Gaël Faye, Petit Pays, Paris, Grasset, 2016.
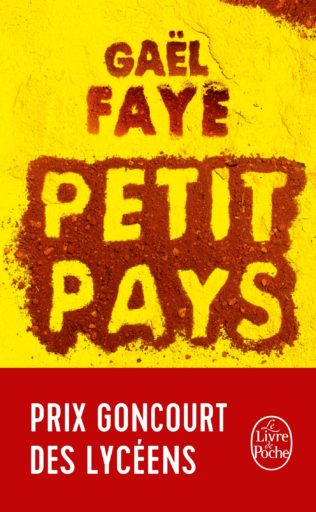
La littérature contemporaine est souvent taxée de nombrilisme. Tournée vers son auteur, son autrice ou sur elle-même plutôt que vers son lectorat, elle aurait remplacé les évènements du monde par les micro-évènements d’un « je » de plus en plus restreint à un petit milieu. Cette critique n’est pas dénuée de toute pertinence. Cependant, les écrits contemporains sont pluriels. Loin des récits autocentrés ou cyniques qui se complaisent dans une lucidité sans débouchés nous voudrions, dans cette chronique, mettre en valeur d’autres littératures : celles qui ne renoncent pas à dire le monde, ses luttes, ses échecs et ses espoirs.
***
Petit Pays, premier livre[1] de l’auteur-compositeur et interprète Gaël Faye, est souvent présenté comme un livre sur la guerre civile au Burundi. Le narrateur, Gaby, fils d’un père français et d’une mère tutsi rwandaise, réfugiée au Burundi, voit son enfance brisée par la guerre civile et les affrontements meurtriers entre Hutus et Tutsis. Mais Petit Pays, avant d’être un livre sur la violence, la mort et la folie, est un livre de tendresse.
Un hommage au « petit » pays, celui du cocon de l’enfance, de la saveur, de la musique, de la couleur de ces journées de liberté à Bujumbura, où les gamins chapardent des mangues, fabriquent des cannes à pêche avec des roseaux de bambous ou des bateaux avec des troncs de bananiers, observent les oiseaux, jouent au football et subtilisent quelques cigarettes et quelques bières. Sous la plume de Gaël Faye ressurgit toute la richesse d’un monde qui ne se limite pas aux journées de guerre ou de chaos, aux divisions entre ceux « qui n’ont pas le même nez ».
La violence est annoncée, attendue, et elle finit par éclater : en 1993, après les premières élections libres depuis l’indépendance du Burundi, le président hutu Ndadaye et plusieurs membres de son gouvernement sont assassinés, l’armée reprend le pouvoir, et les exactions entre Hutus et Tutsis se succèdent[2]. Mais même lors de la peinture des pires massacres, cette violence reste comme assourdie, étouffée, mise à distance. Elle est repoussée par l’enfant qui veut rester enfant, qui refuse de se laisser entraîner dans des camps et déclare à ses amis :
« Je ne suis ni hutu ni tutsi (…) Ce ne sont pas mes histoires. Vous êtes mes amis parce que je vous aime et pas parce que vous êtes de telle ou telle ethnie. Ça, je n’en ai rien à faire! »
Mais ce refus recèle une part d’ambiguïté : peut-on refuser la violence lorsqu’elle est là ? Cette cécité n’est-elle pas aussi l’expression d’une violence de classe puisque Gaby, le protagoniste, est le fils d’un riche Français et que son paradis est celui d’un univers privilégié ? Les frontières cèdent, la cachette de l’enfance ne dure pas et l’Histoire choisit pour nous lorsqu’elle prend la forme du génocide, cette « marée noire » où « ceux qui ne s’y sont pas noyés sont mazoutés à vie » :
« La guerre, sans qu’on lui demande, se charge toujours de nous trouver un ennemi. Moi qui souhaitais rester neutre, je n’ai pas pu. J’étais né avec cette histoire. Elle coulait en moi. Je lui appartenais ».
Petit Pays peut se lire comme la facette inverse d’Une saison de machettes, de J. Hatzfeld qui plongeait sans détours dans l’enfer du génocide en faisant parler les tueurs. La parole de Gabriel Faye est très loin de la haine. Elle parvient à raconter le pire tout en étant presque réconfortante.
Cette douceur, pleine de pudeur, est notamment due à un choix narratif qui fait résonner la voix de l’enfance même aux moments les plus durs du récit : le jeune narrateur, Gaby, envoie des lettres pleines de naïveté lucide et d’humour à une correspondance française, Laure (« Les présidents militaires ont toujours des migraines. C’est comme s’ils avaient deux cerveaux. Ils ne savent jamais s’ils doivent faire la paix ou la guerre ») ; puis à son cousin, Christian, victime de la guerre. Mais la parole de l’enfance ne peut subsister seule.
Ces lettres, qui ressemblent à des poèmes en prose, se mêlent peu à peu au chant du narrateur adulte et la voix du poète Haïtien Jacques Roumain, qui dit la douleur de l’exil :
« Si l’on est d’un pays, si l’on y est né, comme qui dirait : natif-natal, eh bien, on l’a dans les yeux, la peau, les mains, avec la chevelure de ses arbres, la chair de sa terre, les os de ses pierres, le sang de ses rivières, son ciel, sa saveur, ses hommes et ses femmes… »
Gaël Faye, dans Petit Pays, aborde toutes les violences : celle de la haine ethnique, du racisme, du néo-colonialisme, la violence de classe aussi, mais toujours avec distance. Cette distance n’est pas une édulcoration, elle représente plutôt un espoir. Peut-être est-elle nécessaire pour voir plus loin que le désastre. Pour continuer à lutter, il faut croire que
« le grand amour est fait de confiance » et qu’« [o]n ne doit pas douter la beauté des choses, même sous un siècle tortionnaire ».
Notes
[1]« Petit Pays » est également le titre d’une chanson de Gaël Faye (dans son album Pili pili sur un croissant au beurre)
[2]La situation de Burundi est bien différente de celle du Rwanda. Dès l’indépendance du pays, en 1962, des conflits ont éclaté entre Hutus et Tutsis. Ces conflits se sont poursuivis dans les années 1960 et 1970, avec un premier massacre de masse de l’armée contre les Hutus en 1972, jusqu’à l’éclatement de la guerre civile en 1993 (coup d’Etat contre Melchior Ndadaye, massacre des Tutsis par les civils Hutus, puis répression sanglante de l’armée contre les Hutus). Malgré l’adoption, en 2001, d’une Constitution de transition qui établit une alternance ethnique entre Hutus et Tutsis au pouvoir, les conflits entre les deux communautés se poursuivent jusque dans les années 2010.
![Racisme et néocolonialisme français [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/wikimedia_commons-operation_barkhane_2erei_mali-150x150.jpg)








