
Que faire face à la crise ? Débat entre Michel Husson, Pierre Khalfa, Frédéric Lordon et François Sabado
Comment comprendre la crise économique actuelle ? Quelles sont les alternatives du côté de la gauche anticapitaliste et du mouvement social ?
Nous avons organisé une table ronde avec les économistes Frédéric Lordon et Michel Husson, le syndicaliste Pierre Khalfa de Solidaire et François Sabado de la LCR. A lire, visionner ou podcaster.
Face à la crise 1ere partie (table ronde réalisée le 20/10/2008)
Pour télécharger le son en mp3 : clic droit sur ce lien puis « enregistrer la cible du lien sous ».
1. Contretemps – Quelle est votre appréciation de la crise actuelle ? quelles sont les principaux éléments qui en sont à l’origine ? Bien que la plupart des commentateurs s’accordent à dire que l’on entre en terres inconnues, comment appréhendez vous la période qui s’ouvre ?
Frédéric Lordon – Cette crise est à la fois spécifique, générique, et singulière. Spécifique, elle l’est par les classes d’actifs et les compartiments de marchés qui sont concernés. On a vu débouler tout un tas de produits financiers dont on ignorait l’existence au moment de l’explosion au printemps 2007. Ce sont les produits de la titrisation et de la finance structurée. Néanmoins, il y a des éléments d’un grand classicisme dans cette crise : des crises immobilière il y en a déjà eu. Par exemple, à la fin des années 1980 début des années 1990 aux États-Unis lors de la défaillance des caisses d’épargne. Il y a aussi de fortes composantes immobilières dans la crise japonaise et dans la première crise financière internationale de 1997. Mais tout de même on a une architecture de produits sophistiqués qui est assez inédite.
Et pourtant, la crise est générique. Si on fait abstraction de ses sophistications techniques, on retrouve les mécanismes fondamentaux de fonctionnement des marchés de capitaux déréglementés présents dans toutes les crises indépendamment des compartiments de marché qui sont concernés. Quatre principaux mécanismes sont à l’oeuvre. Premièrement, la polarisation mimétique qui résulte du consensus concurrentiel. En effet, la concurrence ne crée pas du tout de diversité mais au contraire pousse à l’imitation des comportements les plus performants à court terme. Deuxièmement, l’aveuglement au désastre qui conduit les opérateurs à abandonner le modèle notionnel de l’optimisation combinée rendement/risque qu’ils distordent vers de la maximisation simple. Troisièmement, la mobilisation intense des effets leviers. Et, quatrièmement, au moment où la crise éclate, la course à la liquidité.
Spécifique, générique, la crise est singulière également. Cette crise financière n’est pas que financière. Surtout, comme aucune autre auparavant elle exprime les contradictions du régime d’accumulation en vigueur et signale son arrivée aux limites. Il y a peut-être là une divergence conceptuelle entre Michel Husson et la théorie de la Régulation. Est-ce que nous avons affaire à ce qu’on pourrait qualifier en terme aristotélicien d’une entéléchie du capitalisme, c’est-à-dire sa pleine réalisation, son accomplissement parfait, ce que Michel appelle le pur capitalisme. Ou bien, en prenant une lecture régulationniste, est-ce que nous avons affaire à une configuration du capitalisme qui ne jouit d’aucune dignité particulière : c’est une simple configuration, après d’autres et avant d’autres. C’est un débat théorique passionnant qui ne nous empêche pas de considérer ensemble que ce qui s’exprime dans cette crise ce sont les contradictions d’un capitalisme à basse pression salariale. Comme, le capitalisme a besoin de débouchés intérieurs, le problème de l’insuffisance des salaires a été surmonté par l’allongement du temps de travail et le recours intensif au crédit. Solutions qui trouvent aujourd’hui leurs limites.
Si on prend cette thèse au sérieux, proposer un package de reréglementation financière ne nous fait faire que la moitié du chemin. Et cela ne nous fait pas sortir de l’alternative : soit, un capitalisme à basse pression salariale plus une structure financière un peu délirante qui sous certaines conditions nous donne une croissance certes inégalitaire mais relativement intense, soit le même capitalisme à basse pression salariale mais avec une finance reréglementée et qui ne nous donnerait que de la croissance molle. Le vrai objectif serait donc de passer à un capitalisme à haute pression salariale avec croissance plus intense à la clé. Il y a plusieurs objections à un tel raisonnement. La première, c’est de considérer qu’étant donné l’épuisement des ressources la croissance forte n’est pas la solution mais le problème. La seconde, c’est de dire que haute ou basse pression salariale, on est toujours dans le capitalisme or la question du dépassement de ce mode de production et des modalités de ce dépassement est une question qu’on peut avoir envie de poser aujourd’hui.
Pour revenir au déroulé de la crise, les soubresauts de septembre et octobre ont été particulièrement violents. Pour ma part, depuis le début je plaide pour des plans d’intervention publique car je considère que le risque systémique ne nous laisse pas d’autre choix. Mais il y a quelque chose d’insupportable dans ces plans. Ils se présentent comme des packages d’aide unilatérale à la finance ce qui est intolérable d’un point de vue politique. Il y a l’aide mais il n’y a pas les contreparties alors que le secours – la main tendue – et la rétorsion – la paire de claques – devraient être absolument simultanés. Au delà de cet aspect essentiel, je considère que les plans annoncés sont la pire des solutions. Certes, un collapsus majeur nous a été évité, mais malgré les sommes faramineuses investies on n’a absolument pas réglé la situation des banques car on n’a pas réglé le problème originel : l’endettement des ménages, en particulier aux États-Unis. Outre le fait que les plans adoptées soient techniquement très critiquables, il ne vont pas au fond des choses. On a le plan Paulson qui est une structure de cantonnement, on a des plans européens qui sont des mixtes à base de garantie et de recapitalisation. Je pense qu’il existe une troisième option : une caisse de refinancement hypothécaire de la dette des ménages étasuniens. Une telle solution aurait une série d’excellentes propriétés : d’abord, cela permet de lisser l’effort des finances publiques sur vingt ou trente ans ce qui est mieux que de sortir des centaines de milliards d’un coup. Surtout, cela restaure la continuité des paiements sur la dette hypothécaire donc ça amène instantanément tous les titres pourris et leurs dérivés à proximité de leur valeur initiale. Donc cela reconstitue aussitôt les bases de capitaux propres des institutions qui les détiennent et cela dégèle dans l’instant les marchés du crédit.
Au lieu d’une telle solution nous avons à la fois trop et trop peu. Trop peu puisque le vrai problème n’est pas réglé donc on s’apprête à entrer dans une période de digestion des tensions financières qui va être très longue et affreusement douloureuse sur le plan économique et social. Mais nous avons aussi trop, paradoxalement, parce qu’on a reculé du bord du gouffre et que donc disparaissent toutes les incitations à prendre des mesures à la hauteur de la situation. L’emprise des dominants est telle qu’il faut en arriver aux dernières extrémités pour que se forme la volonté politique de transformation radicale.
Nous entrons donc en territoire inconnu. Mais il ne faut pas se méprendre sur la nature de l’inconnue en question. C’est une inconnue fondamentalement politique. Quelle va être la résultante de la confrontation entre des forces antagonistes ? Il y a d’abord, les forces de la conservation financière qui sont déjà extrêmement actives pour tenter de préserver leurs privilèges. Il y a ensuite, les forces de la souveraineté politique. En effet, il existe une logique de la souveraineté politique qui prend de travers le fait qu’on l’ait obligé à faire la démonstration publique qu’il est possible de sortir des centaines de milliards d’euros d’un coup. Les pouvoirs publics vont vouloir se venger de ça. Mais en même temps on sait à quel point l’Etat est poreux aux influences du capital. Il va donc y avoir à l’intérieur même des appareils d’État un arbitrage qui va être rendu. Dernier élément, les forces sociales du corps politique. La crise va avoir un impact tout à fait durable sur ces forces. D’une part, l’obscénité du gain financier est d’autant plus grande qu’elle est rapportée au fait que c’est le contribuable qui est au final appelé au secours. D’autre part, ce qui explose de manière spectaculaire, ce sont les frontières de l’impossible : pourquoi accepter que l’on ne puisse pas trouver 100 millions d’euros pour les profs ou s’inquiéter pour quelques milliards de déficit de la sécurité sociale alors que les gouvernements trouvent instantanément des centaines de milliards d’euros pour les banques. C’est un argument qui se répand comme une traînée de poudre et qui est extrêmement bien fondé. J’ai hâte de voir comment les pouvoirs publics vont gérer ça lors de la prochaine vague de mobilisations.
Michel Husson – Je suis globalement d’accord avec Frédéric. Concernant la question de savoir si le capitalisme aujourd’hui est la réalisation parfaite du capitalisme mon idée est la suivante : la déréglementation, notamment de la sphère financière et du marché du travail, va dans le sens du meilleur fonctionnement possible du capitalisme de son point de vue. Il y a en revanche peut être un point de désaccord concernant l’endettement des ménages. Le fait générateur, c’est le recul de la part salariale. D’autant que le profit additionnel qui provient du recul de la part des salaires n’est pas investi. La question est alors de savoir si ce profit n’est pas réinvesti en raison du rôle joué par la finance ou bien, plus fondamentalement, parce que la satisfaction des besoins sociaux ne permet pas de dégager une rentabilité suffisante. Dans cette dernière perspective, on considère que la sphère financière est nourrie de ces profits non-réinvestis.
Concernant l’endettement des ménages, il y a un modèle qui est particulier aux États-Unis où une sorte de super croissance a été tirée par une consommation plus rapide que la production. Or il est clair aujourd’hui que ce modèle là ne pourra pas redémarrer sur les même bases. Pour autant, il n’y a pas de modèle de rechange disponible spontanément compte tenu de l’état des rapports de forces sociaux. Concrètement, cela signifie qu’il faudrait aux États-Unis mettre fin aux inégalités extrêmes qui sont la contrepartie nécessaire du mode de croissance jusqu’alors en vigueur. Or la situation sociale ne permet pas d’imposer ça et, parmi les options politiques, ce n’est que très marginalement porté par le programme d’Obama. On est donc dans une sorte d’impasse où le modèle qui est central dans l’articulation de l’économie mondiale ne peut plus fonctionner sans qu’il y ait de modèle de rechange immédiatement disponible.
Un modèle envisageable sur le papier serait un nouveau fordisme avec une forte pression salariale, recentré sur la demande intérieure et où les revenus financiers seraient rétrécis comme ils l’étaient dans les années 1960 et 1970. Mais il n’est pas cohérent avec les rapports de forces sociaux actuels et l’on ne peut pas compter sur une auto-réforme des classes possédantes. On ne peut pas non plus compter, comme le suggère Sarkozy lors de son discours de Toulon, sur une capacité à séparer le bon capitalisme entrepreneurial et le mauvais capitalisme financier car ils sont complètement imbriqués. Par exemple, si les grandes entreprises versent beaucoup de dividendes elles en reçoivent aussi beaucoup. La césure entre l’industriel et le financier qui rendrait possible un retour vers un capitalisme productif est dès lors strictement impossible et strictement contradictoire aux intérêts des dominants.
François Sabado – Une question essentielle est de savoir si cette crise représente un tournant historique. En suivant l’approche par la longue durée proposée par d’Ernest Mandel, on peut se demander si l’on ne touche pas aux limites historiques du système. L’onde longue qui a débutée à la fin de la seconde guerre mondiale a connu sa phase d’expansion jusque dans les années 1970 et depuis une phase récessive dont la crise actuelle pourrait marquer la fin. En effet, on est entré dans une période de forte instabilité systémique avec 5 crises majeures en 5 ans : la crise asiatique, la crise russe, la crise argentine, la crise internet et aujourd’hui la crise des subprime. Mais la caractéristique majeure de la crise actuelle c’est qu’elle touche le centre même du système capitaliste et non sa périphérie. La capacité de rebond du système est mise à rude épreuve, l’ouverture de nouvelles voies d’expansion, en particulier avec le développement éventuel du marché intérieur chinois, apparaît aujourd’hui comme la variable clé. La fin de la phase récessive d’une onde longue ne débouche pas mécaniquement sur la crise finale du système. Tant qu’il n’y a pas d’alternatives, le capitalisme trouvera des solutions pour se relancer.
Une seconde dimension de la situation actuelle, c’est la crise du modèle néolibéral caractérisé aux États-Unis par un endettement des ménages et un déficit commercial insoutenables. La troisième dimension c’est le changement de rapport de force à l’échelle internationale avec une perte de l’hégémonie financière étasunienne qui suggère que le centre de gravité de l’économie mondiale est en train de se déplacer. Une quatrième dimension, c’est la coincidence de cette crise avec le changement historique du mouvement ouvrier. C’est en efet la fin d’un cycle d’organisation du mouvement ouvrierqui a débuté à la fin du 19ème siècle, ce qui pose la question d’une reconstruction non seulement du mouvement ouvrier mais de l’ensemble des mouvements sociaux. Enfin, la cinquième dimension, c’est la combinaison inédite de la crise économique et de la crise écologique. La concomitance de ces cinq dimensions plaide en faveur de l’hypothèse d’un changement historique substantiel à l’échelle planétaire. On entre ainsi dans une période de forte instabilité, y compris politique, à l’échelle internationale.
Pierre Khalfa – Il y a beaucoup de points d’accord mais aussi beaucoup de points d’interrogation. Le point d’accord principal c’est l’idée qu’on assiste à une crise du modèle d’accumulation néolibéral. La racine de cette crise vient d’une déformation du partage de la richesse produite aux dépens des salariés, combinée à une déréglementation de la finance instituée par les gouvernements à partir des années 1980. La stagnation de l’investissement et l’accroissement de la consommation grâce aux mécanismes d’endettement en sont les conséquences. A partir de là plusieurs problèmes se posent. D’abord, quelles leçons les classes dominantes vont tirer de cette affaire. Il faut se souvenir qu’après 1929 plusieurs années ont été nécessaires avant que des leçons réelles ne soient tirées. La capacité des mouvements sociaux à peser sur ces débats est le second point d’interrogation. Contrairement aux années 1930 où la situation politico-sociale était explosive, pour l’instant il n’y a pas de mobilisations majeures capables de peser sur l’évolution de la situation. L’impact de la crise sur l’hégémonie étasunienne est la troisième grande inconnue. On sait que, historiquement, le capitalisme a toujours eu un centre dominant, une puissance hégémonique. La crise des années 1930 a ainsi été un moment clé dans le passage de relais entre l’hégémonie de la Grande Bretagne et celle des Etats-Unis. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si un tel déplacement de l’hégémonie va avoir lieu ou bien si les Etats-Unis vont au contraire réussir à renforcer leur hégémonie en faisant payer la crise par les autres. L’absence de puissance économique, politique et militaire suffisamment forte pour prétendre au rôle de nouveau centre plaide, pour le moment, en faveur de la seconde hypothèse. Ni l’Europe, ni la Chine ni encore moins le Brésil ou l’Inde ne sont en mesure de jouer ce rôle. D’ailleurs, le pouvoir financier acquis par la Chine a pour contrepartie une dépendance extrême vis-à-vis des Etats-Unis ; dans les mois qui viennent, plutôt que de choisir l’affrontement politique, ce pays va ainsi accepter de financer les plans de sauvetage américains en achetant des bons du trésor.
Concernant l’avenir du capitalisme le point déterminant, ce sont les luttes. Comme l’a dit François, pour que le capitalisme disparaisse, il faudra quelqu’un pour l’abattre. De plus, c’est un système extrêmement flexible, avec une capacité de transformation extraordinaire. On a ainsi pu passer du capitalisme concurrentiel au capitalisme fordiste qui sont deux formes de capitalisme radicalement différente, mais cela s’est fait aussi en partie sous la pression de mouvements politiques et sociaux et alors que le système pouvait se sentir en danger. Or, pour le moment, il n’y a aucun mouvement capable de poser des alternatives qui forcent le système à se transformer comme le communisme a été capable de le faire au 20ème siècle.
Frédéric Lordon – Au sujet de la perpétuation de l’hégémonie de la puissance américaine, je partage l’analyse de Pierre mais seulement sur le court terme. En effet, les contradictions du capitalisme à basse pression salariale qui prennent leur origine dans la déformation du partage de la valeur ajoutée frappent au premier chef l’économie américaine. Si bien que même si on parvenait au travers de la crise à en rester à une simple rerégulation cosmétique laissant inchangées les structures de la finance américaine, il resterait un problème central : la condition du prolongement de la croissance à savoir l’augmentation de l’endettement des ménages va finir par buter sur une limite absolue. Il y a de la marge, puisque le niveau d’endettement des ménages étasunien est de 120 % du PIB contre 140 % pour les ménages anglais. Mais dès lors que la limite sera atteinte la croissance va considérablement ralentir ce qui, aux Etats-Unis comme ailleurs, signifie immanquablement plus de chômage. Or la réticence de la société étasunienne au chômage est extrêmement forte ce qui va obliger les autorités étasunienne à utiliser les instruments de politique économique de manière encore plus vigoureuse que par le passé. L’ensemble des tensions vont alors se totaliser dans l’ultime degré de liberté de la politique économique, à savoir l’attractivité financière et monétaire du territoire américain. Avec un double risque, d’une part, de rendre la dette publique insoutenable et, d’autre part, de renverser la croyance dans laquelle se trouve installé le dollars et qui lui donne son statut de monnaie dominante. Si ceci arrivait la contradiction serait alors complète : croissance faible, sous-emploi et disparition des degrés de libertés de la politique économique qui permettent normalement d’accommoder ça. C’est pour cela qu’à plus long terme l’hégémonie étasunienne est sur une pente descendante irréversible. On est ainsi en attente d’un candidat de substitution, la Chine, qui n’est pas encore complètement mûr, mais qui dès qu’il le sera raflera la mise.
François Sabado – Sur ce point, le décalage qui existe entre l’affaiblissement de la domination financière des Etats-Unis et leur puissance militaire qui reste sans rival constitue un dysfonctionnement majeur. Il est à l’origine d’aventures militaires et de conflits inter-impérialistes dans la mesure où la puissance politico-militaire est perçue comme un moyen de faire payer la crise par d’autres. Or, dans le même temps, l’affaiblissement économique fragilise la puissance politico-militaire des Etats-Unis, ne serait-ce qu’en raison du coût des interventions extérieures. L’impérialisme américain va tenter de prendre des initiatives, mais pour l’instant, c’est plutôt la thèse du déclin progressif de l’impérialisme US qui semble s’affirmer : l’affaiblissement économique se surajoute à une perte de vitesse sur le plan politico-militaires que révèlent les difficultés rencontrées en Irak et en Afghanistan mais aussi le sévère revers subit cet été en Géorgie.
Michel Husson – On assiste à une débâcle idéologique du discours néolibéral qui se matérialise par la disqualification d’un certain nombre d’idée clés : la finance n’est pas le moyen optimal d’allouer les ressources, la mondialisation n’est pas un moyen de développer de manière universelle la planète, l’intervention de l’Etat n’est pas, contrairement à ce qu’affirmait Reagan, le problème. Il ne faut pas se priver d’enfoncer le clou car cela permet de marquer des points idéologiques qui auront des conséquences concrètes dans la période qui s’ouvre.
Mais dans l’immédiat, il faut insister sur le fait que si les discours évoluent, dans les actes rien n’a changé. Les plans de sauvegarde adoptée n’ont aucune contrepartie en terme de régulation qu’il s’agisse d’interdire ou d’encadrer la titrisation et les produits dérivés ou encore de proscrire les transactions avec des institutions basées dans les paradis fiscaux. Or aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe, aucune de ces contreparties n’existe si bien on assiste à la montée d’un sentiment de masse : tout pour les banques, rien pour ce qui est essentiel aux gens en particulier les salaires, l’emploi ou les budgets sociaux.
A la faveur de la crise s’opère donc une véritable mise à nue des priorités de ce système. Il s’agit même d’une véritable obscénité lorsque l’on rapporte les sommes engagées pour sauver la finance à celles qui seraient nécessaires pour atteindre les objectifs de développement du millénaire en terme d’accès à l’eau potable, à une alimentation suffisante, à la santé et à une éducation primaire : sur dix ans les sommes cumulées sont équivalentes aux lignes de crédit qui ont été ouvertes en quelques semaines aux Etats-Unis pour sauver le système financier.
La crise produit aussi une véritable déstabilisation du social-libéralisme. Les sociaux-libéraux sont finalement à la remorque des discours de la droite. De plus, ils sont – à raison – suspectés de porter une part de responsabilité dans la débâcle actuelle dès lors que les politiques menées lorsqu’ils étaient au gouvernement et leurs propositions jusqu’à une période récente ne se démarquent pas du néolibéralisme. Enfin, ils ne sont pas crédités d’une capacité à mener des politiques alternatives. Je considère ainsi qu’il n’existe pas de point d’équilibre des politiques possibles pour un programme social-démocrate : soit les politiques s’alignent sur la finance en concédant des aménagements très marginaux et de ce point de vue la droite et le PS ne se distinguent pas substantiellement ; soit, une véritable remise en cause du capitalisme financiarisé est engagée, mais alors cela implique un degré de rupture avec les règles du jeux qui est bien supérieur au niveau de confrontation que les partis sociaux-démocrates considèrent comme envisageable. Par conséquent, il existe un vaste espace pour une offre politique ajustée au niveau de rupture nécessaire.
Dans un tel contexte, deux éléments peuvent permettre de rebondir pour esquisser une alternative radicale. En premier lieu, l’idée de nationalisation est remise au centre du débat public. Évidemment, leurs nationalisations à eux ne sont que partielles, provisoires et sans contreparties : il ne s’agit que de renflouer les pertes avec de l’argent public pour mieux rendre les banques au privé lorsqu’elles seront de nouveau profitables tout en prétendant qu’au final cela sera pourrait rapporter une plus-value au contribuable. Mais, comme le montre la citation de Buiter remettant en cause l’idée même d’une propriété privée des institutions financières, cela a tout de même comme effet positif de revaloriser l’idée de nationalisation. Il convient aussi de rappeler que le seul moyen de contrôler ce qui se passe lors des opérations de sauvetage des banques, c’est une nationalisation intégrale ; en effet, si la nationalisation n’est que partielle, on crée les variables de fuite qui permettront de renvoyer sur l’argent public tous les actifs toxiques. Mais à un niveau plus fondamental, c’est l’occasion d’expliquer que dans des économies marchandes les institutions distribuant le crédit ou les assurances assument fondamentalement un service public. L’argent public injecté dans le système financier met ainsi à l’ordre du jour une reprise de contrôle par la société des priorités de son développement à travers les orientations concernant l’affectation du crédit. Il s’agit là d’une logique absolument radicale mais qui s’inscrit assez naturellement dans le paysage actuel.
L’autre idée importante concerne directement la question des profits. Il n’est pas admissible qu’en 2009 les entreprises continuent à payer des dividendes et que pour pouvoir le faire elles imposent un blocage des salaires ou des licenciements au prétexte de la crise. Il faut donc traiter le problème à la source et mettre en place des mécanismes de transferts depuis les dividendes vers les salaires et les budgets sociaux. C’est aussi un réponse plus fondamentale à la crise. En effet, si on considère que la financiarisation et l’instabilité qui en découlent ont pour origine une déformation du partage des revenus en faveur du capital, c’est bien sur cette répartition qu’il convient d’agir. Car sans reréglementation significative ni nouvelle répartition des revenus, les plans de sauvetage actuels ne font rien d’autres qu’alimenter une prochaine bulle.
Sur un autre plan, la tentation de transférer le coût de la crise sur les autres pays en développant les exportations est une réponse qui prend de plus en plus de poids. C’est en effet, la seule solution qui existe dès lors que l’on se refuse à jouer sur la demande intérieure, notamment en favorisant la hausse des salaires. On l’observe bien au niveau européen : derrière une unité de façade, c’est la règle du chacun pour soi qui l’emporte. En l’absence d’institutions en mesure d’imposer une politique commune, les gouvernements peinent à trouver un accord pour mettre en place des mesures de reréglementation et un plan de relance à la hauteur de la situation. L’Europe et ses institutions sont d’ailleurs déjà profondément ébranlées. Ainsi, c’est un collectif d’Etat et non la Commission en tant qui a été au centre de la réaction européenne. De plus, un certain nombre de dogmes ont été de fait jetés aux orties qu’il s’agisse de l’indépendance de la banque centrale, des principes de gestion du taux d’intérêt par la BCE ou encore des règles constitutives du pacte de stabilité. Enfin, les tensions qui découlent d’un fractionnement économique de l’UE entre des pays dont les problèmes sont extrêmement divers vont s’intensifier. Au final, on entre non seulement en Europe mais aussi à l’échelle internationale dans une période d’hyper-concurrence où vont prédominer ce que les économistes appellent par euphémisme des solutions non coopératives.
Pierre Khalfa – Lorsque l’on parle de délitement de l’idéologie néolibérale il convient de rappeler que, dès avant la crise, celle-ci avait du plomb dans l’aile. La décennie glorieuse du libéralisme c’est 1985-1995 avec comme moment clé la chute du mur de Berlin. Le néolibéralisme est alors à l’offensive et la concurrence et les privatisations sont perçues dans les populations comme des éléments incontournables au bonheur des sociétés. Dès le milieu des années 1990 ce climat commence à changer, ce qui se traduit notamment par l’essor du mouvement altermondialiste. Ces idées commencent à être sérieusement battues en brèche, mais il n’y a pas d’alternatives politiques ni de changements de rapports de force qui permettent d’imposer des évolutions effectives d’orientation politique. De plus, dans les classes dominantes cette idéologie perdure. Et c’est à ce niveau que la crise est en train de faire bouger les choses. Cependant, la débâcle intellectuelle néolibérale n’aura de véritables conséquences que si la crise s’approfondit ; si elle était contenue, on en resterait au « tout changer pour que rien ne change ».
Concernant les alternatives, nous en restons fondamentalement à une forme de keynesianisme radical. C’est certes nécessaire – d’autant que nos adversaires rejettent totalement cette option – mais cela pose problème. Par exemple, sur la question des nationalisations, on ne peut en rester à exiger le retour de l’Etat puisque cet Etat est celui de la classe dominante et n’incarne aucunement l’intérêt général.
Sur l’Europe, je considère contrairement à ce qu’a dit Michel que les jeux ne sont pas faits. Il existe certes des forces qui poussent à l’éclatement, et qui préexistent d’ailleurs à la crise. La mise en place de l’Euro sur des économies dont les appareils socio-productifs sont très hétérogènes est source de fortes tensions. On pense aussi à l’Allemagne qui depuis le début de cette décennie a mené une très sévère politique d’austérité salariale qui lui a permis de redynamiser ses marges exportatrices au détriment des autres économies européennes. En dépit de cela, il me semble que le précédent 1929, avec les conséquences dramatiques de la logique de l’affrontement, a fait prendre conscience aux gouvernements qu’un minimum de coopération est absolument nécessaire. Ainsi, le fait qu’un plan européen même très problématique et très limité ait émergé ou encore que la BCE ait changé son fusil d’épaule devant l’action concertée des principaux gouvernements sont des éléments qui révèlent une certaine réactivité commune face au danger immédiat.
François Sabado – Il y a une certaine confusion sur la question de l’Etat. Le retour de l’Etat évoque pour beaucoup un rapport à l’économie et à la société qui était celui de l’après seconde guerre mondiale. Or, dans la situation actuelle, il n’y a pas l’élément peur des classes dominantes face à la montée révolutionnaire qui a joué un rôle décisif dans la constitution d’un régime caractérisé par des hausses de salaires significatives, par la montée en puissance de nouveaux services publics et par la mise en place d’un puissant système de protection sociale. Les interventions des Etats auxquels ont assiste depuis le début de cette crise correspondent davantage à une tentative de perpétuer les rapports de forces entre les classes acquis par les dominants au cours de la période précédente qu’à une logique de transition vers un autre modèle – ancien ou nouveau d’ailleurs – dont les contours restent à ce jours non définis. Cette incapacité à changer de modèle invite à penser que la crise dans laquelle nous sommes va être une crise longue.
Frédéric Lordon – Concernant l’idéologie néolibérale, il y a une anthologie du retournement de veste à écrire ! C’est un scandale démocratique ahurissant, une entreprise de blanchiment intellectuel à une échelle jamais vue qui concerne aussi bien les économistes que les éditorialistes et les politique. Je pense par exemple à Ségolène Royale qui plastronnait il y a peu en affirmant que c’est grâce à la gauche que l’on n’a pas les fonds de pension. Or, c’est Jospin qui a mis en place le Fonds de Réserve des retraites et Fabius le plan d’épargne salariale qui était de l’avis général une amorce de plan 401 K[1]. Et Ségolène Royal elle-même proposait pendant la campagne présidentielle de faire monter en puissance des fonds de pension qu’elle appelait collectifs[2].
Plus fondamentalement, ce qui est mis par terre ce n’est pas seulement la capacité de la finance à exister par elle-même indépendamment du secours de l’Etat, mais c’est plus généralement sa capacité à se présenter comme lieu adéquat de règlement d’un certain nombre de problèmes économiques et sociaux. La prétention de la finance ne se limite pas à l’allocation du capital entre les entités productives mais c’est une forme institutionnelle qui ambitionne d’être la médiatrice d’un certain nombre de politiques publiques. Or, on le constate désormais aux Etats-Unis, cette fonction de la finance comme médiatrice de la vie sociale dans le domaine du logement, des pensions et de l’université est mise en échec. A l’évidence on assiste à la faillite des techniques de marché dans le domaine de logement, techniques par ailleurs hybrides puisqu’elles s’appuyaient sur des entités au statut privé mais avec garanties publiques, Fannie Mae et Freddie Mac. Parallèlement, les retraités étasuniens assistent à la vaporisation de leur épargne retraite et sont en attente d’une remontée des marchés boursiers dont il n’est pas certain qu’elle ait lieu ; on risque ainsi de voir bientôt apparaître sur les trottoirs américains les premiers vieux miséreux. Enfin, les grandes universités étasuniennes sont sur la brèche. Financées par des fondations, elles ont un capital qu’elle placent sur les marchés et dont les revenus à l’année leur permettent de financer leur fonctionnement. La concurrence pour la rentabilité financière entre ces fondations universitaires est extrêmement intense ; Harvard et Yale sont ainsi gérées avec l’agressivité de Hedge Funds et font partie des investisseurs les plus rentables de toute la sphère financière. Ces performances ne les rendent cependant pas moins vulnérables, si bien que la dégringolade des marchés va les toucher de plein fouet. Les moyens des universités vont ainsi se contracter très fortement avec comme principal mode d’accommodation la hausse de frais d’inscriptions qui sont pourtant déjà énormes. Ceci va avoir pour conséquence une aggravation des inégalités d’accès aux grandes universités au moment même où le système des prêts étudiants se contracte en raison de la montée des défaillances et de la raréfaction du crédit. Au final, ces problèmes financiers vont avoir d’importantes répercussions négatives pour le système de recherche étasunien dans son ensemble.
Je voudrais abonder dans le sens de Michel sur la question des nationalisations. Jamais, nous n’avons eu une occasion aussi forte d’affirmer le bien fondé des nationalisations. Jamais, l’époque n’a été aussi propice pour expliquer que les dépôts et les épargnes sont des biens publics vitaux pour la société qui ne doivent pas être confiés aux intérêts privés. De plus, s’il s’agit d’une structure vitale pour la société, elle ne doit pas être dimensionnée en fonction des contraintes des temps ordinaires mais au contraire en fonction des évènements extrêmes. Or, justement un événement extrême vient juste de parler : il a fallu nationaliser. La domination d’un secteur public du crédit et de la finance doit donc être retenue comme configuration permanente.
Bien entendu, comme le souligne Pierre, cela ne nous dispense pas de travailler à des propositions qui vont au-delà de la seule exigence de nationalisation : à mon sens, il s’agit de réfléchir à comment greffer des formes d’association délibératives et de contrôle citoyen. S’il est une avancée idéologique majeure que pourrait opérer une pensée progressiste à la faveur de cette crise elle se situe bien là : comment faire entrer dans les formes institutionnelles économiques les plus classiques des formes innovantes de politique authentiquement démocratique. Avant même les institutions financière, une telle avancée doit concerner l’entreprise et les formes du rapport salarial.
François Sabado – La crise actuelle pose les problèmes en terme globaux dans la mesure où le capitalisme apparaît à une échelle de masse comme accusé. Elle impose d’avoir une démarche qui combine des réponses immédiates et des réponses plus avancées de transformation radicale de la société.
Le point de départ c’est la défense de la situation matérielle de millions d’êtres humains. Cela implique des revendications sur la défense de l’emploi comme l’interdiction des licenciements et la création de véritables emplois publics plutôt que des emplois aidés ; sur la défense du niveau de vie avec des revendications d’augmentation des salaires et des minimas sociaux mais aussi d’extension de la gratuité ; enfin, lorsqu’il s’agit du logement, de l’éducation ou de la protection sociale, il faut penser les choses en terme de nouvelle répartition des richesses. Ces mesures d’urgence sociale ont une dimension transitoire lorsqu’elles touchent à la question de la propriété, par exemple lorsque l’on pose le problème de l’interdiction des licenciements dans les entreprises qui font du profit ou encore lorsque l’on entend opérer une autre répartition des richesses, ce qui impose de contenir la politique patronale.
Sur le plan financier et bancaire, il faut parvenir à la même combinaison de mesures immédiates et partielles et de mesures transitoires. Le premier bloc de proposition comprend des mesures comme l’abrogation de l’article 56 du livre III du traité de Lisbonne sur la libre circulation de capitaux, des taxes sur les dividendes, la levée du secret bancaire, couper les liens avec les paradis fiscaux. La question peut-on vivre sans bourse nous est également posé, et je considère qu’il faut d’avoir une réponse positive offensive. Au niveau international, une réunion d’économistes latino-américains qui s’est tenue à Caracas du 8 au 11 octobre a pu mettre un certain nombre de propositions sur la table[3].
Sur le plan transitoire, la question des nationalisations est centrale. Il ne s’agit bien entendu pour nous pas de nationalisations revenant à des situations comme celle du Crédit Lyonnais, mais d’une nationalisation sans indemnisation de l’intégralité du système bancaire, sous le contrôle des salariés et des usagers.
Au delà des revendications, nous avons un problème car il y a une crise de la perspective socialiste au sens global. Or, à l’évidence c’est un élément essentiel de réponse d’ensemble face à la crise. Je considère que nous devons travailler en suivant deux axes : d’une part, réfléchir aux modalités de la souveraineté politique permettant l’exercice d’une véritable démocratie ; d’autre part, imaginer une réorganisation de l’économie qui débouche sur la satisfaction des besoins sociaux tout en s’appuyant sur l’autogestion de la production par les travailleurs.
Pierre Khalfa – Il n’y a pas de désaccord sur ce qu’il faut avancer de manière immédiate et cela se décline pour moi autour des deux axes : casser la finance de marché et imposer une autre répartition des richesses. Le vrai problème c’est effectivement la crise du projet de transformation sociale, le débat portant à la fois sur le contenu du projet et sur la stratégie à mettre en oeuvre.
Michel Husson – La défense immédiate des intérêts des salariés s’articule naturellement avec la démarche transitoire. Dans le contexte actuel, les thèmes de l’interdiction des licenciements et de la réduction du temps de travail vont ainsi être particulièrement importants. La question du temps de travail avec l’idée d’échelle mobile des heures de travail était déjà présente dans Le programme de transition de Trotsky ; elle est aussi discutée par Ben Bernanke, l’actuel président de la FED, qui reproche rétrospectivement à Roosevelt d’avoir laissé les entreprises ajuster non pas sur les effectifs mais sur la durée de travail. La RTT, comme la plupart de nos revendications, n’est pas une mesure anticapitaliste par nature, mais elle le devient très vite dans le contexte actuel car elle nécessite une remise en cause des prérogatives patronales sur une variable essentielle de l’exploitation. Cela montre qu’une position keynésienne radicale est un bon point de départ car elle conduit à formuler des mesures qui très vite nécessitent une incursion dans la propriété privée. Les alternatives ne seront pas fabriquées en laboratoire, ce sont d’ailleurs des mesures que l’on connaît déjà mais qui changeront de statut dès lors que les mobilisations sociales s’en saisiront. Puisque leur mise en oeuvre implique un degré élevé d’affrontement avec le droit patronal, elles ouvrent des perspectives de dépassement du capitalisme
Frédéric Lordon – Concernant les alternatives, deux directions me semblent essentielles. Au rayon désarmement de la finance, je pense qu’il faut poser la question de la démarchéisation du système de financement de l’économie. Cela implique comme le disait François de mettre sur la table l’hypothèse d’une économie qui fonctionnerait sans bourse, c’est-à-dire sans marché d’actions. Sur un plan plus politique, il me semble qu’il faut reprendre ce que Marx avance dans la Critique du programme de Gotha : l’extension à la sphère économique d’une idée démocratique restée cantonnée à la sphère politique. Et c’est d’abord d’abord dans les entreprises, au sein des collectifs de travail, que la démocratie entendue comme autonomie des collectifs de vie c’est-à-dire comme pleine légitimité de la délibération collective des destins communs s’envisage. Nous avons certes une conjoncture quasi-philosophique extraordinairement défavorable : ce qu’on peut appeler pour faire court l’individualisme semble s’opposer à toute forme de socialisation. Cependant, dans cette conjoncture idéologico-philosophique, il y a un élément qui peut nous être extrêmement favorable, c’est justement cette idée démocratique. Une idée appliquée nulle part mais qui est en attente de déploiement et dont le prochain horizon sont les formes institutionnelles de la vie économique.
Cette discussion a été animée par Cédric Durand et Esther Jeffers et retranscrite par Cédric Durand.
Notes
[1] Nom d’un plan de retraite largement utilisé aux Etats-Unis et qui incite les salariés à placer en bourse leur épargne retraite.
[2] Entretien au Journal des Finances du 24 mars 2007, consultable en ligne : http://www.jdf.com/interview/2007/03/24/04008-20070324ARTHBD00008–je-veux-favoriser-l-actionnariat-salarie-.php
[3] Voir l’appel publié sur le site du CADTM : http://www.cadtm.org/spip.php?article3797 ; un autre document issue d’une réunion de représentants des mouvements sociaux en marge du sommet Asie-Europe peut également être mentionné : http://www.cadtm.org/spip.php?article3828




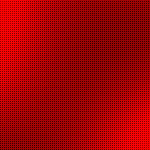

![Quelle gauche face au capitalisme ? – partie 1 [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Fi5Oe9TWIAUGetP-150x150.jpeg)

