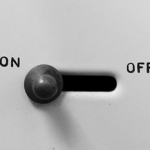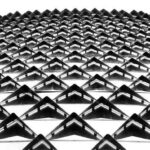Comment démocratiser l’université ?
Dans L’université qui vient. Un nouveau régime de sélection scolaire (Raisons d’agir, 2022), Cédric Hugrée et Tristan Poullaouec (avec lesquels nous nous étions entretenus en avril 2018) ne se contentent pas de dresser le bilan des contre-réformes successives qui ont mis l’université en « crise organisée ». Ils inscrivent leurs analyses dans les transformations des politiques éducatives au 20e et 21 siècles. Ils s’attachent en particulier aux trajectoires et pratiques universitaires des étudiant·es des classes populaires, qui placent désormais l’obtention de diplômes du supérieur au cœur de leurs préoccupations, mais qui subissent de plein fouet la sélection, la marchandisation et la dégradation des conditions d’étude.
Que faire ? S’il faut supprimer Parcoursup, refinancer l’université – pour inverser la baisse du budget par étudiant·e subie depuis 15 ans – et recruter du personnel (enseignant ou non), cela n’est pas suffisant pour concrétiser le « droit à la réussite à l’université de toutes et tous ». Puisque l’université ne saurait effacer les inégalités scolaires qui ont marqué les étudiant·es aux niveaux primaire et secondaire, c’est une transformation radicale de l’enseignement que les auteurs proposent dans la conclusion que nous reproduisons ici (p. 141-158). Voici donc des propositions pour un enseignement supérieur plus égalitaire, pour une université réellement ouverte à tou·tes.

Après avoir accueilli à la fin du siècle dernier les nouveaux étudiants portés par la politique scolaire visant 80 % de bacheliers dans une génération, les premiers cycles universitaires se sont adaptés tant bien que mal depuis le début des années 2000 à des bouleversements des conditions d’inscription, d’étude, de formation, d’orientation et de validation dans un contexte budgétaire très dégradé (chapitre 1). Ces transformations ont cependant dessiné un nouveau régime de sélection scolaire à l’université qui présente un double visage. D’un côté, l’accès à la licence s’est relativement banalisé, en premier lieu parmi les jeunes femmes. La poursuite d’étude après le bac révèle aussi de nouvelles lignes de clivage à l’intérieur des classes populaires (chapitre 2). De l’autre, les dispositifs adoptés pour lutter contre l’échec ont largement échoué à prévenir les « ruptures universitaires » (chapitre 3) toujours très fréquentes et très dépendantes des acquis scolaires jusqu’au bac, en particulier chez les étudiants issus de milieux populaires : parmi les bacheliers de 2014 sortis de l’enseignement supérieur, 28 % des inscrits en licence sont sans nouveau diplôme en 2020, et 9 % ont dû se contenter d’un diplôme de niveau bac + 2[1]. Comment la remédiation à l’université pourrait-elle combler en quelques semestres les écarts de connaissances entre bacheliers creusés par la « tolérance à l’ignorance[2] » qui monte dans toute l’institution scolaire ?
Dès lors, la grande disparité des manières d’atteindre la licence (chapitre 4) risque encore de s’accentuer dans l’université qui vient, prompte à multiplier les cursus et les titres conduisant à ce grade selon une logique de segmentation : licence professionnelle, doubles licences, bachelor universitaire de technologie, parcours renforcé, parcours spéciaux, licence « accès santé », cycle pluridisciplinaire d’études supérieures, parcours préparatoires au professorat des écoles, etc. Faire passer cette polarisation scolaire et territoriale entre les cursus low cost et les cursus premium pour une individualisation des parcours pourrait bien n’être qu’une rhétorique de justification de la hausse des frais de scolarité. Est-il besoin d’insister ? Lorsqu’ils poursuivent des études supérieures, la majorité des bacheliers d’origine populaire étudient à l’université. Dans leur budget, comme dans celui de leurs parents, le financement de la vie étudiante pèse déjà beaucoup : comment croire qu’ils auraient une préférence pour les cursus payants ? « Les étudiants eux-mêmes, y compris ceux issus de milieux modestes, considèrent que l’université gratuite, ce n’est pas sérieux » : voilà le préjugé libéral sans aucun fondement empirique qui anime Pierre Mathiot, auteur de la feuille de route des réformes du baccalauréat et du lycée, pour qui, bien sûr, « ce qui n’a pas de coût n’a pas de valeur[3] ».
Pour éviter la cession au marché de pans entiers de formations supérieures et pour mettre en place une politique ambitieuse pour la recherche et l’enseignement supérieur publics, le ministère dispose en fait de deux leviers financiers importants. La dépense publique par étudiant accordée à l’université doit cesser de baisser et entamer un rattrapage par le haut. Le premier levier se trouve dans la réorientation des prochains « programmes d’investissements d’avenir » (PIA). Leurs premières vagues ont permis de distribuer 7,7 milliards d’euros à des « établissements qui concentrent les populations étudiantes les mieux dotées[4] » : pourquoi ne pas distribuer les prochains crédits prioritairement aux établissements qui contribuent à l’inverse le plus à l’effort de démocratisation des études supérieures ? Le second levier réside dans la suppression de la niche fiscale du « crédit impôt recherche » (CIR) qui ne cesse de déraper depuis 2007 : le manque à gagner pour les finances publiques était de 1,8 milliard d’euros en 2007, il dépassait en 2019 les 7 milliards d’euros, et ce alors même que l’efficacité de ce système de financement de la recherche privée est critiquée de toutes parts par plusieurs syndicats de l’enseignement supérieur, mais aussi par la Cour des comptes déjà en 2013, par le conseil scientifique du CNRS en 2014 et même par une commission d’enquête du Sénat en 2015. Il est donc possible d’élever les capacités d’accueil en licence et de recruter des enseignants-chercheurs pour y encadrer les étudiants.
Toujours est-il que la licence générale est en passe de devenir le parent désargenté du premier cycle, au moment où les espoirs placés par les étudiants et leurs parents dans les études universitaires n’ont jamais été aussi importants. Pour autant, ces constats n’invitent pas à renoncer à la « démocratisation scolaire », bien au contraire, et celle-ci ne saurait se réduire à la bienveillance dans la délivrance des diplômes. Ils plaident pour se donner les moyens d’une université commune :
« l’enseignement réellement démocratique est celui qui se donne comme fin inconditionnelle de permettre au plus grand nombre […] de s’emparer […] des aptitudes qui font la culture scolaire »,
comme l’écrivaient déjà Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron en 1964[5]. Sans prétendre apporter des solutions à tous les problèmes de l’université, et en évitant tout autant de demander à l’université de trouver des solutions à toutes les contradictions de la société française, tentons de synthétiser les obstacles à cet objectif de réussite en licence pour tous. Et envisageons ce faisant les leviers possibles pour les surmonter.
Actons d’abord, et c’est une bonne nouvelle, que les difficultés et les inégalités subies par les étudiants issus des classes populaires n’ont pas vraiment entamé leur détermination à poursuivre des études supérieures. Arrivés dans l’enseignement supérieur, les bacheliers visent aujourd’hui pour la plupart un diplôme au moins égal à la licence. Ce nouvel impératif n’est pas qu’une injonction imposée par la politique éducative : comme on l’a vu, les aspirations scolaires des classes populaires sont contraintes par leurs budgets serrés et leurs conditions de logement, mais la plupart des étudiants qui en sont issus sont pourtant convaincus de la nécessité des études supérieures, par la voie du BTS ou par celle de la licence pour l’essentiel. L’enjeu des études est ici décisif. Pour échapper à la précarité et aux emplois les plus durs et les moins rémunérés, les diplômes de l’enseignement supérieur sont sans doute moins suffisants qu’il y a cinquante ans dans un contexte de chômage de masse et de concurrence avivée entre salariés. Mais ils n’en sont pas moins de plus en plus nécessaires pour exercer des métiers requérant à la fois des connaissances et une capacité générale à acquérir des capacités particulières. L’expérience historique comme la comparaison internationale invalident donc la crainte de l’inflation scolaire[6] (chapitre 5).
C’est au contraire la très forte diminution des offres d’emploi public qui fragilise les débouchés professionnels des diplômés de l’université. En s’imposant comme un nouveau critère de hiérarchisation des filières, des diplômes et des disciplines, la « professionnalisation » promeut en fait un mode managérial d’accès à l’emploi et disqualifie le mode scolaire d’accès à l’emploi, dont étaient dépendantes de nombreuses formations universitaires. L’extension de la pensée managériale aux universités ne s’est ainsi pas cantonnée aux réformes de leurs bureaucraties : elle concerne désormais toutes les formations qui doivent intégrer l’idée de marché dans leurs objectifs et dans leur contenu et voir ainsi contestée leur autonomie disciplinaire et leur histoire.
Au-delà des enjeux d’insertion professionnelle, c’est la société tout entière qui a besoin d’une jeunesse mieux instruite et plus qualifiée pour faire face aussi bien aux dérives complotistes et aux fake news qu’au danger du gouvernement des experts. Confrontés à la nécessité de la bifurcation écologique, aux crises sanitaires ou à la montée des inégalités, les savoirs élaborés et transmis à l’université sont plus que jamais d’utilité sociale.
Le droit d’apprendre, le temps d’enseigner
Aujourd’hui, 37 % des enfants d’ouvriers et 26 % des enfants d’employés sortent de l’enseignement supérieur sans nouveau diplôme et seuls un tiers des premiers et la moitié des seconds y obtiennent un diplôme supérieur ou égal à bac + 3[7]. Cet échec ne peut rester sans réponse, si l’on ne se résout pas à la généralisation de la sélection à l’entrée à l’université, par Parcoursup ou par l’augmentation des frais de scolarité. Face aux difficultés d’apprentissage rencontrées par les étudiants, les enseignants-chercheurs sont désormais sommés de réaliser des « innovations pédagogiques », appliquant le plus souvent les recettes qui ont fait la preuve de leur inefficacité, comme le fameux « distanciel » si pénible pendant les confinements de 2020 ou encore la « classe inversée », l’injonction à la « pédagogie universitaire » leur déniant généralement aussi le savoir-faire didactique sur leur propre métier. Serait-il incongru de prendre le problème à la racine ? Même si d’autres causes y sont associées, c’est avant tout le passé scolaire des étudiants qui rend compte de leurs succès ou de leurs échecs à l’université. En premier cycle universitaire, l’obtention de la licence dépend surtout de la qualité des apprentissages réalisés au lycée, au collège et à l’école.
Ce résultat majeur (exposé au chapitre 4) ne signifie pas que la réussite scolaire n’aurait rien à voir avec la transmission familiale du capital culturel, mais plutôt que les inégalités sociales d’apprentissage se jouent bien en amont de l’université. Et la transmission scolaire peut les augmenter ou les réduire : il s’agit à la fois des connaissances acquises et des techniques intellectuelles pour en acquérir de nouvelles. En première année, bien des étudiants se disent découragés et ont le sentiment de ne pas être à leur place. Les malentendus sont importants : ils se nichent dans la prise de notes, dans les lectures, dans les évaluations, etc. Comme l’a montré Valérie Montfort dès 2000, lorsque des normes de travail exigeantes ne sont pas explicitées, « les étudiants cherchent dans leur passé scolaire un modèle pour s’adapter au fonctionnement de l’université » : « là où les enseignants voient une marge d’autonomie dans le travail », beaucoup « pensent qu’on leur laisse la possibilité de réduire leurs efforts[8]. Ainsi, interrogés sur le temps consacré aux enseignements et au travail personnel, les étudiants en première année d’études supérieures se répartissent en trois pôles inégaux.
Comme on le sait, le nombre d’heures de cours est très inégal entre l’université et les CPGE. Pour un volume horaire hebdomadaire de cours comparable, les STS et les IUT demandent un travail personnel bien moins intense, notamment en raison des stages intégrés dans la scolarité. Entre ces deux pôles, et mis à part les filières de santé régies par le numerus clausus jusqu’en 2021, les filières universitaires occupent en moyenne leurs étudiants de première année avec 15 heures de cours par semaine et 10 heures de travail personnel. Peut-on augmenter la réussite en licence sans augmenter le temps passé à étudier réellement dans ces premiers cycles universitaires ? On objectera sans doute que les étudiants de licence ne peuvent pas tous étudier davantage, compte tenu de leur travail à côté.
Certes, trois sur dix en 2015 ont une activité rémunérée régulière ou ponctuelle depuis la rentrée (et parmi eux, deux sur trois y consacrent plus de quatre heures par semaine, seuil à partir duquel l’absentéisme contraint se fait ressentir dans les salles de cours). Mais dans la plupart des filières universitaires, les étudiants salariés ne consacrent pas beaucoup moins de temps à leur travail personnel que les non-salariés. En tout état de cause, la garantie entre 18 et 25 ans d’une allocation d’étude nécessaire au financement de la vie étudiante permettrait d’augmenter les volumes horaires d’enseignement et d’étude en limitant le recours « alimentaire » aux jobs étudiants.
Plus précisément, c’est la régularité et la planification du travail personnel qui sont efficaces, ainsi que l’approfondissement des cours par des lectures complémentaires et des fiches de synthèse. Ces habitudes studieuses et l’encadrement qui les encourage doivent aller de pair avec une évaluation des acquis plus intense qui ne passe pas forcément par la notation. Dès le début de la licence, les étudiants sont en droit de savoir vers où diriger leurs efforts : selon les disciplines, cela sera l’exercice de la dissertation, les équations du second degré, le commentaire de document, les étapes de la réponse immunitaire ou encore la traduction littéraire, etc. Il faudrait donc demander du temps d’enseignement supplémentaire pour les étudiants et les entraîner continûment aux techniques du travail intellectuel. Beaucoup d’enseignants s’y emploient déjà à l’université, mais sans que les moyens leur en soient toujours donnés. « Vendre la mèche » : n’est-ce pas là le principe d’une « pédagogie rationnelle » qui ne prendrait pas appui sur des savoirs implicites acquis dans la sphère familiale[9].
En vérité, ces prérequis exigés sans être enseignés devraient s’accumuler tout au long de la trajectoire scolaire. La remise à niveau n’est pas impossible à l’université mais elle a un coût, comme le montre le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) dont les programmes correspondent à ceux de la voie générale du lycée[10]. Mais comment comprendre que ces non-bacheliers obtiennent plus souvent la licence que les bacheliers professionnels et même technologiques[11] ? Cette énigme jamais posée mériterait une enquête comparative étudiant les projets d’études très mobilisés des premiers et souvent contrariés des seconds. Ne faut-il pas interroger également les contenus d’enseignement des baccalauréats de la voie professionnelle et de la voie technologique au lycée, ainsi que les raisons qui décident de l’orientation vers ces filières ? La position syndicale consistant à défendre à la fois le droit d’accès de tous les bacheliers à l’université et la contribution des trois voies d’accès au bac à la « réussite pour tous » est aujourd’hui face à ses limites. Revenons sur la genèse de ce parti pris.
Démocratiser… Mais comment ?
En mai 1977, le Syndicat national des enseignants du second degré (Snes, majoritaire) publie dans un dossier de sa revue L’Université syndicaliste un projet d’école aujourd’hui tombé dans l’oubli, mais qui est pourtant le plus ambitieux porté par une force syndicale ou politique depuis le plan Langevin-Wallon de 1947. Dès son congrès de 1972, le principal syndicat des enseignants du second degré pose comme objectif de conduire tous les élèves vers « le niveau le plus élevé dans l’acquisition des connaissances », en formant « l’intelligence et le sens critique ». En effet, il ne s’agit pas d’élargir le vivier des meilleurs, comme le visent les réformes scolaires entreprises entre 1959 et 1975, mais de développer au plus haut les possibilités de chacune et chacun à travers une scolarité obligatoire jusqu’à dix-huit ans dans un lycée progressivement unifié, ne séparant plus l’enseignement général, l’enseignement technique et l’enseignement professionnel. À l’époque, pour se faire une idée de l’ambition de ce projet, moins du quart d’une génération obtient le baccalauréat, principalement dans la voie générale, mais pour partie également dans les séries techniques créées en 1965. Les collèges d’enseignement technique sont transformés en lycées d’enseignement professionnel en 1977 : ils préparent leurs élèves au CAP et au BEP, mais la voie professionnelle ne dispose pas de baccalauréat. En 1985, la création du baccalauréat professionnel rencontre un succès rapide. La possibilité de prolonger la scolarité après le BEP est valorisée comme une seconde chance pour des élèves disqualifiés dans la voie générale. Le chômage massif qui frappe les jeunes titulaires du CAP et du BEP est pour beaucoup dans l’adhésion des parents d’élèves à ce diplôme plus ambitieux dans ses contenus comme dans ses méthodes. Au fil du temps, le projet « d’école progressive » s’estompe au Snes, au profit d’une nouvelle thèse : l’investissement éducatif est au service du développement industriel, il ne s’agit plus d’imbriquer les enseignements généraux, techniques et professionnels, mais de valoriser, à partir de 1990, « la diversification » des voies d’accès au bac comme « un formidable levier de démocratisation ». De fait, les baccalauréats technologiques et professionnels ont bien contribué à la forte progression du taux d’accès au bac. Mais cette progression est formidablement ambivalente : le constat de « démocratisation ségrégative » proposé par Pierre Merle s’impose rapidement[12]. Comme l’écrit Samuel Johsua,
« le degré de séparation scolaire entre groupes sociaux est un excellent indicateur des divisions plus larges au sein de la société[13] ».
La structuration des trois voies segmentant les scolarités lycéennes dans la France contemporaine l’illustre à l’envi : dans la voie générale, 37 % des élèves sont enfants d’ouvriers, d’employés, de chômeurs n’ayant jamais travaillé ou d’inactifs, contre 54 % dans la voie technologique et 69 % dans la voie professionnelle.
La création du bac de technicien (1965) puis celle du bac professionnel (1985) ont contribué à un élargissement sans précédent de l’accès au lycée, permettant que les deux tiers des enfants d’ouvriers et les trois quarts des enfants d’employés deviennent aujourd’hui bacheliers. Mais ces bacs préparent mal à l’université. Et pour cause ! En 1965, il s’agissait pour de Gaulle de « désencombrer » l’enseignement secondaire classique et de « s’opposer aux ambitions abusives » de « ceux qui n’ont rien à faire » à l’université[14]. En 1985, lors du premier septennat de Mitterrand, le baccalauréat professionnel représente selon le cabinet de Fabius « un moyen excellent et pas trop cher de lutte contre le chômage » par rétention au lycée. Ce nouveau diplôme a failli ne pas être un baccalauréat : il s’en est fallu de peu pour qu’il n’ouvre pas droit à la poursuite d’études. Aujourd’hui, la moitié des bacheliers professionnels poursuit des études supérieures, mais parmi eux, la moitié seulement avec succès. Pour scolariser toute une classe d’âge jusqu’à dix-huit ans, objectif largement partagé dans la gauche syndicale et politique, mais pour aussi permettre à tous les bacheliers qui le veulent de réussir des études supérieures, les structures scolaires héritées de la Ve République ne suffisent plus.
Avec d’autres, nous pensons qu’un bac unifié de « haut niveau de culture commune » pour tous, à la fois littéraire, scientifique et technologique dans un lycée unique est indispensable pour rompre avec l’école de classe à la française et pour garantir le libre choix des études supérieures. Précisons qu’il ne s’agit nullement de renoncer à un enseignement professionnel public de qualité, qui pourrait accueillir les élèves l’ayant véritablement choisi après le bac. Bien sûr, ce tronc commun n’est pas concevable sans une amélioration massive des acquis des élèves, du premier degré jusqu’au bac[15]. Ce projet n’est cependant pas incantatoire. Le Groupe de recherche sur la démocratisation scolaire en a posé les bases en 2012, en matière de contenus d’enseignement, de conduite des apprentissages et de formation des enseignants. Le bilan des politiques scolaires menées sur ces différents aspects depuis dix ans invite à relancer la réflexion à une large échelle. Limitons-nous ici à la question suivante : quelle refondation du lycée peut-on souhaiter du point de vue de la réussite des étudiants ?
La réforme de 2007 a amputé d’un an le contenu des enseignements menant au baccalauréat professionnel. Celle de 2018 a encore diminué les volumes horaires en français, en mathématiques et en langue vivante. Mais sachant que les lycées professionnels accueillent principalement des élèves en difficulté scolaire depuis l’école primaire[16], le retour au bac pro en quatre ans et le rétablissement des horaires des disciplines d’enseignement général ne suffisent pas. En effet, les bacheliers professionnels accèdent aujourd’hui plus facilement aux sections de techniciens supérieurs (STS), mais la moitié seulement y décrochent un BTS. Quant aux bacheliers technologiques, voilà dix ans que les ministères de l’Enseignement supérieur tentent sans grand succès de leur faire une meilleure place en IUT. De fait, seuls les meilleurs sont retenus, malgré des quotas pas toujours atteints. Et en dix ans, leur réussite au DUT a nettement décliné. Enfin, la voie générale a été mise à mal par les réformes Blanquer, qui ont affaibli le tronc commun et renforcé la différenciation des lycées en augmentant la part du contrôle continu au bac et en promouvant des enseignements de spécialité très inégalement répartis sur le territoire. Où est le « lycée des possibles » promis par Pierre Mathiot dans son rapport[17] remis au ministre en janvier 2018 ? Prétendant lutter contre le bachotage, la réforme l’a d’abord étendu du mois de janvier de l’année de première au mois de juin de l’année de terminale, avec les « épreuves communes de contrôle continu », avant d’en abandonner purement et simplement le principe en 2021. Quelques mois plus tard, il a fallu que trente grands patrons appellent à « sauver les maths » en lycée pour que le président candidat finisse par promettre leur retour dans le tronc commun à la rentrée 2022. Ces réformes étaient pourtant conçues comme un levier pour améliorer la réussite en premier cycle de l’enseignement supérieur. Car, entre 2007 et 2017, le taux de réussite des bacheliers généraux à la licence en trois ans est passé de 44 % à 36,5 %.
Last but not least, en chargeant les missions locales (et non les lycées !) d’assurer le respect de l’obligation de formation jusqu’à 18 ans pour les 15 % d’adolescents déscolarisés à 16 ans, la loi pour « une école de la confiance » met au défi le syndicalisme affirmant pour sa part la nécessité d’une obligation de scolarisation à 18 ans : où scolariser ces élèves en rupture scolaire, ne supportant plus une institution qui les met en échec depuis le premier degré ? Bien sûr, on peut souhaiter leur retour en formation professionnelle initiale sous statut scolaire en lycée. Mais la principale raison du décrochage reste la difficulté scolaire précoce, suivie de diverses formes de rejets de l’école, puis d’un absentéisme répété menant à la déscolarisation : il est pour le moins difficile de rendre assidus des élèves n’ayant pas choisi leur orientation sans trouver le moyen de combler leurs lacunes… ni leur garantir la réussite au diplôme.
Les partisans du maintien des trois voies d’accès au baccalauréat ont bien des arguments pertinents. Mais dans cette orientation, il faut aussi expliquer comment rendre crédible la réussite de tous les bacheliers qui font le choix de la licence. L’augmentation des taux d’encadrement est une condition probablement nécessaire, mais certainement insuffisante pour résoudre une bonne part des difficultés scolaires des étudiants quand elles remontent… loin. Pour notre part, nous ne voyons pas comment défendre durablement la liberté de choix de tous les bacheliers et résorber l’échec en licence sans aller vers un bac de culture commune préparant nettement mieux aux exigences de la poursuite d’études supérieures. Rappelons-le : avec un bac général et une mention, la plupart des étudiants obtiennent une licence, quelle que soit leur origine sociale. Et quand ils sont d’origine populaire, les bacheliers généraux aux meilleurs parcours préfèrent l’université aux classes prépa. Les formations de licence ne peuvent pas décevoir leurs attentes. Par ailleurs, il faut bien sûr envisager l’ouverture de places supplémentaires en IUT et en STS. Mais comment empêcher alors qu’elles soient attribuées de préférence aux bacheliers les mieux préparés, quand on voit la difficulté actuelle à y atteindre les quotas de bacheliers technologiques et professionnels ?
« Passe ta licence d’abord ! »
Dans le prolongement de la proposition d’une école commune, une realpolitik de gauche de l’enseignement supérieur, se donnant pour objectif de mettre en œuvre un droit à la réussite, doit d’abord répondre à trois questions : la licence, pour qui ? La licence, pour y apprendre quoi ? La licence, pour obtenir quoi ?
Nos résultats plaident tout d’abord pour replacer l’université publique au cœur de l’enseignement supérieur. Pour les jeunes d’origine populaire, l’université demeure aujourd’hui le principal moyen d’accès à la qualification et à des diplômes à valeur nationale qui leur garantissent à terme l’accès aux emplois les plus qualifiés. Il faut refuser la multiplication des formations supérieures « à péage » scolaires ou économiques et les termes du débat sur l’enseignement supérieur qu’elles imposent. Ce processus, qui résulte des choix politiques jamais démentis depuis la loi LRU, repose sur l’accroissement des inégalités scolaires entre les classes sociales et sur leurs ressources inégales pour s’orienter dans l’enseignement supérieur. Les petits succès de ces nouvelles et nombreuses formations payantes ou sélectives se fondent sur la vague promesse qu’il faudrait désormais « payer plus pour étudier mieux » et se voir ainsi garantir d’être employable. Ce faisant, ces formations renvoient la grande majorité des formations universitaires non sélectives à un supposé dilettantisme pour mieux revendiquer leur prétendu utilitarisme. Or, ce sont bien les fondements de cette vision qu’il faut également combattre : si nous plaidons à notre tour pour dépasser le dualisme de l’enseignement supérieur français, structurellement inégalitaire par son cloisonnement entre l’université et les grandes écoles, ce n’est pas pour effacer l’originalité de la transmission des savoirs académiques.
En instituant progressivement la sélectivité d’une formation comme le mètre étalon de sa qualité, Parcoursup tend tout d’abord à s’imposer comme la seule et unique balise d’orientation des bacheliers et de leurs familles. Cette tendance est d’ailleurs renforcée par la médiatisation de simili classements de formations selon leur employabilité. La légitime revendication syndicale et politique d’abolir Parcoursup passe donc en premier lieu par la réactivation d’un service public de l’orientation scolaire et universitaire capable de neutraliser ces logiques. En second lieu, supprimer Parcoursup implique de créer immédiatement des places en premier cycle et les heures d’enseignement qui vont avec afin de garantir l’accès à l’université de tous les bacheliers et les bachelières qui le souhaitent. Plus que tout, la concrétisation d’un droit à la réussite à l’université de toutes et tous passe aussi par la défense, puis par la redéfinition d’un modèle universitaire de formation intellectuelle, largement mis en cause par les réformes amorcées depuis le début des années 2000. On peut avancer l’idée qu’à l’université se jouent à la fois l’appropriation de savoirs savants et leur régulière mise à l’épreuve, dans le cadre de travaux pratiques, d’expériences et de manipulations scientifiques, de travaux dirigés, par les étudiantes et les étudiants, et ce pour toutes les disciplines. À l’université, on transmet non seulement des connaissances, fondamentales ou appliquées, comme au lycée ou dans d’autres secteurs de l’enseignement supérieur, mais on y enseigne surtout, progressivement, l’histoire de ces connaissances, les débats qui la jalonnent, les méthodes et les pratiques anciennes et nouvelles qui alimentent la connaissance rationnelle du monde.
Cette exigence est dans le droit fil du projet d’une école commune : l’université doit redonner aux formations universitaires les moyens de faire valoir l’autonomie relative de leurs savoirs par rapport aux seuls enjeux marchands. Cette autonomie relative n’a rien d’une faveur qu’il faudrait accorder aux universitaires. On sait aujourd’hui que l’université n’est pas qu’une institution allouant des individus à des places, et qu’elle est au contraire au principe même du développement culturel, technologique, écologique et social des économies avancées : en France, c’est ainsi dans les départements des facultés des sciences que s’est développée l’informatique, d’abord comme un domaine de recherche et d’enseignement puis comme lieu de formation de nouveaux spécialistes, les informaticiens, « à une époque où les écoles d’ingénieurs, en retard dans ce domaine technologique, étaient, pour beaucoup encore incapables de fournir ce type de spécialistes[18] ».
Alors que le secteur privé représente désormais un quart des inscriptions dans l’enseignement supérieur, la défense de l’université publique passe donc nécessairement par des recrutements importants d’enseignants-chercheurs, de secrétaires, de bibliothécaires, d’agents d’entretien, de techniciens, qui doivent permettre aux étudiants de bénéficier d’un « enveloppement institutionnel » identique à celui dont bénéficie la jeunesse dominante dans ses filières sélectives[19]. Elle passe enfin par la défense du monopole de la collation des grades universitaires (licence, master et doctorat) par les seules universités. En réhabilitant la distinction entre grade et diplôme, la réforme LMD a en fait élargi aux « établissements du secteur sélectif de l’enseignement supérieur, autres que les universités stricto sensu, […] le droit de délivrer des diplômes et des grades qui étaient jadis réservés à celles-ci[20] ». À l’époque, ce sont surtout les petites écoles d’ingénieur du secteur privé qui ont ainsi pu convertir leurs diplômes d’établissement en grade universitaire de master. Mais, au moment où les petites écoles privées de commerce multiplient les diplômes bachelors qu’elles font ensuite reconnaître au grade de licence, et au moment où les grandes écoles lorgnent avec insistance sur le doctorat, l’urgence est bien que l’État en finisse avec l’adjudication des grades universitaires.
C’est à ces conditions que les formations universitaires pourront faire valoir le caractère national et disciplinaire de leur diplôme et ainsi réaffirmer la nécessité d’une professionnalisation « par le haut[21] ». Celle-ci ne peut être indépendante d’une réelle politique pluriannuelle de rattrapage de l’emploi public. Mais c’est aussi dans la réhabilitation et l’adaptation du mode scolaire d’accès aux emplois à statut que se joue une partie de la légitimité des formations intellectuelles universitaires. Fondé sur des dispositions scolaires générales (argumenter sur des bases rationnelles et scientifiques, convaincre, faire preuve de réflexivité, etc.) mais aussi sur la maîtrise de techniques disciplinaires spécifiques (en droit, en informatique, en mathématiques, en lettres, etc.), le mode scolaire de recrutement semble largement en mesure de rivaliser avec le mode managérial pour permettre les reconversions professionnelles, nombreuses aujourd’hui.
Enfin, au-delà de l’accès aux emplois publics qualifiés, il faut en finir avec la professionnalisation « par le bas ». Cela passe par la fin des préparations universitaires qui destinent précocement à certains emplois et secteurs professionnels très étroits. Il convient donc d’organiser une spécialisation très progressive dans les cursus universitaires. Il faut surtout ouvrir le chantier de la reconnaissance juridique de la licence, du master et du doctorat dans les conventions collectives qui organisent largement les droits et les rémunérations dans le secteur privé. L’enjeu est de taille : il s’agit de garantir collectivement aux diplômés des universités des niveaux de rémunérations qui soient liés à leur contribution à la production de valeur dans les entreprises, en cours de formation (stage) ou une fois recruté. Les diplômes représentent encore les meilleurs indicateurs et les meilleures garanties de socialisation cognitive qui sont au cœur de la productivité : les bénéfices de la scolarisation sont en effet nombreux pour l’économie ; ils ne doivent plus rester impayés.
*
Illustration : wikimedia Commons. Manifestation contre la loi Devaquet en 1986
Notes
[1] Voir J. Klipfel, « Les bacheliers 2014 entrés dans l’enseignement supérieur : où en sont-ils à la rentrée 2020 ? », art. cit.
[2] J.-P. Terrail, « La tolérance à l’ignorance dans l’institution scolaire », www.democratisation-scolaire.fr, 23 mai 2020.
[3] Anne-Sophie Beauvais et Maïna Marjany, « Pierre Mathiot : “Avec le ministre de l’Éducation, nous considérons qu’il faut réformer le système” », www.emilemagazine.fr, 5 juillet 2018. De même, en janvier 2022, Emmanuel Macron déclare devant la conférence des présidents d’université : « On ne pourra pas rester durablement dans un système où l’enseignement supérieur n’a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants. »
[4] Romain Avouac et H. Harari-Kermadec, « L’université française, lieu de brassage ou de ségrégation sociale ? Mesure de la polarisation du système universitaire français (2007-2015) », Économie et statistique, 528-529, 2021, p. 63-84.
[5] P. Bourdieu et J.-C. Passeron, Les Héritiers…, op. cit., p. 114.
[6] Voir notamment É. Maurin, La Nouvelle Question scolaire. Les bénéfices de la démocratisation, op. cit. ; T. Poullaouec, Le Diplôme, arme des faibles. Les familles ouvrières et l’école, op. cit.
[7] L’échec et la déception concernent aussi, pour une part non négligeable, les jeunes de parents cadres ou professions intermédiaires : parmi les premiers, 14 % quittent l’enseignement supérieur sans diplôme et 10% se contentent d’un bac + 2, ces proportions atteignant respectivement 22 % et 17 % parmi les seconds. H. Papagiorgiou et J. Ponceau, « Parcours dans l’enseignement supérieur : devenir des bacheliers 2008 », art. cité.
[8] Valérie Montfort, « Normes de travail et réussite scolaire chez les étudiants en première année de sciences », Sociétés contemporaines, 40, 2000, p. 57-76.
[9] Delphine Serre, « Une réflexivité pédagogique sous contraintes. La sociologie comme ressource dans la fabrication de cours sans TD », Sociologos, 14, 2019, en ligne.
[10] Il faut avoir au moins vingt-quatre ans et avoir interrompu les études depuis au moins deux ans pour préparer à l’université ce diplôme équivalent au bac. Voir Aurélie Guibert, « Le DAEU. Étude d’un dispositif en région nantaise », mémoire de master 1 en sociologie, université de Nantes, 2011.
[11] Sans surestimer cette meilleure réussite, un non-bachelier sur trois décroche la licence en trois ou quatre ans, contre un bachelier technologique sur six et un bachelier professionnel sur vingt. Voir Isabelle Maetz, « Parcours et réussite aux diplômes universitaires : les indicateurs de la session 2015 », Note flash du SIES, 15, 2016.
[12] Pierre Merle, « Le concept de démocratisation de l’institution scolaire. Une typologie et sa mise à l’épreuve », Population, 55, 2000, p. 15-50.
[13] S. Johsua, Une autre école est possible! Manifeste pour une éducation émancipatrice, Paris, Textuel, 2003, p. 87.
[14] T. Poullaouec et J.-P. Terrail, « Les trois voies du lycée : repères socio-historiques », www.democratisation-scolaire.fr, 6 novembre 2017.
[15] Ce tronc commun s’accompagnerait d’options de spécialisation en terminale pour préparer la poursuite d’études. Ce projet est développé dans notre ouvrage collectif : Groupe de recherche sur la démocratisation scolaire, L’École commune. Propositions pour une refondation du système éducatif, Paris, La Dispute, 2012.
[16] Voir Ugo Palheta, La Domination scolaire. Sociologie de l’enseignement professionnel et de son public, Paris, PUF, 2012.
[17] Pierre Mathiot, Un nouveau baccalauréat pour construire le lycée des possibles, disponible en ligne sur www.vie-publique.fr.
[18] C. Agulhon, B. Convert, F. Gugenheim, S. Jakubowski, La Professionnalisation. Pour une université « utile » ?, op. cit. Les pages précédant cette citation présentent une synthèse fort utile de la critique de la théorie fonctionnaliste de l’université formalisée par John Meyer.
[19] Muriel Darmon, Classes préparatoires. La fabrique d’une jeunesse dominante, Paris, La Découverte, 2013.
[20] Voir notamment les pages 54-63 de l’ouvrage d’O. Beaud, A. Caillé, P. Encrenaz, M. Gauchet, F. Vatin, Refonder l’université. Pourquoi l’enseignement supérieur reste à reconstruire, op. cit.
[21] V. Pinto, « “Démocratisation” et “professionnalisation” de l’enseignement supérieur », Mouvements, 55-56, 2008, p. 12-23.