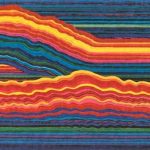Violences masculines : pourquoi l’ordonnance de protection protège si peu les femmes ?
L’ordonnance de protection, créée en 2010, visait à mieux protéger les femmes, en autorisant la justice à intervenir en urgence dans des situations de violence au sein des couples. Pourtant, cet outil juridique demeure étonnement peu employé. Dans son ouvrage Les femmes et les enfants d’abord ? Enquête sur l’ordonnance de protection (CNRS Éditions, 2024), Solenne Jouanneau revient sur la genèse de ce dispositif et sur son application, pour montrer qu’il demeure inscrit dans un cadre familialiste où un certain degré de violence masculine demeure toujours acceptable. Contretemps vous propose de lire un extrait de la conclusion de l’ouvrage.

L’idée qu’il serait de la responsabilité de l’État de protéger les femmes victimes de la violence de leur (ex)partenaire a initialement été portée par les associations féministes. Dans les années 1970-1980, celles-ci ont réclamé et obtenu des financements publics pour créer des structures d’accueil et d’hébergement, mais aussi pour recruter et former des travailleuses sociales féministes chargées de les animer. Celles que l’on appelle les fémocrates, parce qu’elles œuvrent au sein de l’État, ont ensuite défendu la nécessité d’inscrire ce devoir de protection dans la loi. Dans les années 1980-1990, elles sont parvenues à améliorer leur protection sociale, avant de réclamer au cours des décennies une amélioration de leur traitement judiciaire.
Ce mouvement a débuté par la reconnaissance du caractère aggravé des violences commises sur conjoint ou concubin par la réforme du Code pénal de 1992. Il s’est poursuivi avec l’élargissement de la circonstance aggravante aux « ex » partenaires, ainsi qu’à de nouvelles infractions au milieu des années 2000. Dans les politiques pénales arrimées à ce premier mouvement de judiciarisation, la protection des femmes victimes n’était cependant jamais pensée indépendamment des opérations de condamnation et de réhabilitation des hommes qui les maltraitent. Conditionnée au déclenchement d’enquêtes et/ou de poursuites pénales, cette protection n’est alors pas envisagée comme un droit à part entière : elle apparaît plutôt comme une possible dimension de la lutte contre la récidive.
À compter des années 2000, s’amorce ensuite un processus de production du droit visant moins la répression des violences commises que l’organisation et la sécurisation des séparations conjugales et/ou familiales marquées par un contexte de violence. La procédure de référé-violence mise en place lors de la réforme de 2004 en est une première étape, limitée aux femmes mariées. Les injonctions faites aux magistrat·es du parquet en vue de favoriser l’éloignement du conjoint ou concubin violent à toutes les phases de la procédure pénale à compter de la même année en est une deuxième. Les lois de 2005 et 2006 invitant les juges correctionnels à ordonner des mesures permettant de mieux tenir compte de l’intérêt de la victime (mesures d’éloignement et d’information notamment) en constituent une troisième.
L’ordonnance de protection s’inscrit dans le prolongement de ces législations. Son adoption témoigne cependant d’un changement de palier dans la mesure où, dans cette procédure, la protection est censée pouvoir se déployer indépendamment de la logique de répression qui préside à l’exercice de la justice pénale. En effet, si le droit à être protégé découle de la reconnaissance par le Code pénal du caractère condamnable des violences subies, dans ce cadre procédural, le droit à la protection est un droit autonome. La délivrance d’une ordonnance de protection n’entraîne ni condamnation du défendeur, ni déclenchement automatique d’une enquête ou de poursuites au pénal. Elle donne uniquement la possibilité de bénéficier de mesures permettant de sécuriser l’organisation de la séparation et la mise en œuvre effective de la séparation.
L’invention de ce droit à la protection contraint les magistrat·es du parquet et du siège à expertiser les situations de violences au sein du couple. Cette position d’expert·es ne consiste pas uniquement à qualifier et à caractériser juridiquement les faits allégués par les victimes ou rapportés par les officiers de police judiciaire. Elle consiste aussi à statuer sur leur signification sociale, que ce soit pour les personnes qui les subissent ou pour celles qui les exercent : l’opération d’évaluation des risques de récidive (au pénal) ou de danger (au civil) revient bien souvent pour les magistrat·es à devoir apprécier ce qui génère et motive ces violences ainsi que leur impact sur les femmes et les enfants qui y font face.
Une mesure d’inspiration féministe insérée dans un édifice judiciaire familialiste
L’objet de mon travail sur l’ordonnance de protection consiste à se demande ce que devient une procédure d’inspiration féministe entre les mains d’une justice familialiste largement aveugles aux inégalités de genre, de race et de classe. Pour ce faire je me suis intéressée à sa mise en œuvre dans les chambres de la famille en me concentrant sur trois éléments majeurs au cours de mon enquête : la manière dont les magistrat·es se sont approprié·es les exigences d’accessibilité et de célérité au fondement de la procédure ; leurs manières de diriger les audiences ; les opérations cognitives à l’origine de leurs décisions judiciaires. Ces différents aspects, chacun à leur manière, sont venus révéler à quel point un dispositif comme l’ordonnance de protection perturbe les routines et l’ethos professionnel des JAF.
Certaines de ces perturbations sont liées à des phénomènes transversaux, notamment l’imposition des référents gestionnaires qui affectent désormais les instances judiciaires. La justice familiale n’échappe pas aux logiques d’accélération du temps judiciaire. Habituellement, néanmoins cette accélération concerne les procédures les plus simples et sa mise en œuvre procédurale reste principalement à la charge des justiciables et de leurs avocat·es. À l’inverse, entre 2010 et 2019, audiencer des ordonnances de protection à moyens constants a obligé les chef·fes de service des juridictions familiales à s’interroger. Leur responsabilité se limite-t-elle à créer des parcours procéduraux permettant de passer rapidement devant le/la juge pour peu que l’on maîtrise les arcanes de la Justice et qu’on puisse s’adjoindre les services d’auxiliaires de justice compétents ? Ou l’urgence et la gravité des situations potentiellement traitées dans cette procédure invitent-elles à mettre en place des parcours qui anticipent les difficultés pratiques des procédures accélérées (technicité accrue, nécessité de recourir à des auxiliaires de justice, etc.) ? Jusqu’à la loi du 28 décembre 2019 fixant à 6 jours le délai légal de traitement de ces demandes de protection, les réponses apportées sur le terrain ont dépendu d’un ensemble de facteurs (positionnement des juges du service vis-à-vis du dispositif, volume des stocks et des flux, délais d’audiencement des procédures classiques de séparation, nombre annuel de demandes d’OP, etc.). Elles ont donc fortement variées d’une juridiction à l’autre.
Mais l’ordonnance de protection a aussi contraint les juges à réviser leur manière de présider les audiences. Dans les audiences classiques de séparation, les JAF différencient peu les notions d’impartialité et de conciliation. L’interdiction de prendre parti pour l’un ou l’autre des justiciables se manifeste par l’égale injonction qui leur est faite de trouver un terrain d’entente afin que la décision rendue soit moins celle d’un·e juge extérieur·e que la leur. Dans les audiences de protection, une telle position est intenable. La procédure réclame d’opérer une distinction entre violence conjugale et conflit conjugal entre égaux afin de décider si l’organisation de la séparation conjugale et/ou familiale doit ou non s’inscrire dans un registre de protection. L’impossibilité d’évacuer les allégations de violence limite drastiquement la possibilité pour les juges d’adopter leur posture habituelle de conciliation. Cela les oblige à repenser les modalités d’exercice de leur devoir d’impartialité, tout en les forçant à se demander où commence et où finit la mission de protection que la procédure leur assigne. Celle-ci débute-t-elle dès l’audience, via l’adoption d’une posture d’investigation active lors des échanges avec les justiciables ? Ou ne doit-elle s’exercer qu’à partir du moment où la décision est prise, au cours du délibéré, de délivrer une ordonnance de protection ?
Les mesures ordonnées à l’occasion des OP témoignent quant à elles des réticences des juges aux affaires familiales à prendre des décisions trop ouvertement défavorables aux défendeurs reconnus comme vraisemblablement violents et dangereux. L’interdiction d’entrer en contact avec les requérantes, le droit à dissimuler sa nouvelle adresse ou l’attribution du domicile du couple sont certes presque systématiquement accordées à celles qui les demandent. Mais les juges apparaissent plus réticent·es à déterminer en urgence (et parfois en l’absence du défenseur) le montant des sommes que le mari ou le père devra leur verser au nom des charges du mariage ou de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (CEEE). Les JAF sont aussi plus réticent·es à réduire drastiquement les droits parentaux. En effet, si les décisions relatives aux droits de visite et d’hébergement que ces JAF prennent dans le cadre de l’ordonnance de protection sont nettement plus restrictives que celles ordonnées dans les procédures plus classiques de séparation, la majorité reste très attachée au principe de coparentalité et persuadée qu’un conjoint violent n’est pas nécessairement un « mauvais père » dès lors que les violences ne sont pas expressément commises en présence des enfants. Les demandes de réserve de droits de visite formulées par les mères sont donc souvent transformées en droits de visite médiatisée, tandis que les demandes d’exercice exclusif de l’autorité parentale sont très rarement accordées.
Pour justifier leurs décisions, les juges usent d’une rhétorique qui leur permet de renvoyer dos à dos le droit des mères à être protégée d’un (ex-)partenaire violent et celui des pères à conserver une autorité sur leurs enfants. D’un côté, les JAF refusent de penser les convergences susceptibles d’exister entre « l’intérêt de l’enfant » et celui des mères violentées ; de l’autre, ils et elles confondent l’intérêt de l’enfant avec celui des pères violents en faisant comme si les enfants avaient moins besoin de sécurité que de continuer à voir leurs deux parents.
Au terme de cette enquête, l’analyse des opérations de catégorisation qui conduisent les JAF à accéder aux demandes de protection, ou à les rejeter, conduit à un constat sans appel : si l’ordonnance de protection est bien l’expression d’un droit des femmes victimes à être protégées de la violence d’un (ex-)partenaire, cette protection s’exerce sous condition. Cette réalité s’objective dans l’important pourcentage de demandes de protection déboutées chaque année (40 % en 2016, 33 % en 2020), alors même que le volume de requêtes demeure relativement faible au vu de ce qui se pratique dans les autres pays européens et nord-américains.
Protéger au-delà d’un seuil de violence juridiquement et donc socialement acceptables
L’inscription de l’ordonnance de protection dans le droit civil devait permettre de protéger sans punir et, ce faisant, de faciliter la prise de décision des juges. Elle devait aussi permettre aux femmes d’être protégées sans avoir à produire des preuves équivalentes à celles qui sont nécessaires au pénal pour déclencher des poursuites (et, dans ce cadre, bénéficier de mesures de protection). En définitive, pourtant, le basculement du dispositif dans la justice civile semble avoir eu un effet inverse à celui escompté.
Alors que l’ordonnance de protection repose a priori sur une volonté d’autonomisation du droit de protection, de manière que celui-ci puisse d’exercer en dehors (ou plutôt préalablement) à toute démarche pénale, la majorité des juges aux affaires familiales de notre enquête considère le dépôt de plainte comme un élément non seulement nécessaire, mais également non suffisant, à l’établissement de la vraisemblance des violences. Ces JAF réclament aussi la production de certificats médicaux et, si possible, ceux qu’émettent les unités médico-judiciaires dans le cadre des enquêtes de type pénal ; et accordent qui plus est une crédibilité réduite aux attestations produites par des proches (sujet partiaux) ainsi qu’aux attestations fournies par les travailleuses sociales féministes (y compris lorsque celles-ci étaient pourtant en mesure d’attester un suivi sur la durée des situations de violence dénoncées).
La vraisemblance des violences n’est en outre pas la seule condition à remplir pour obtenir le droit d’être protégée. Les critères d’attribution de l’ordonnance de protection instaurent aussi une distinction entre les notions de « violences » et de « danger » qui, jusqu’ici, n’existait pas dans le référentiel de la lutte contre les violences faites aux femmes. Or cette distinction, qui consiste à dire que l’on peut être (ou avoir été) victime de violences sans nécessairement être en danger, favorise l’adoption de raisonnements consistant à minimiser l’impact ou la gravité de certaines formes de violences. Dossier après dossier se construit ainsi une jurisprudence qui ne dit pas son nom, celle d’un seuil de violences juridiquement et donc aussi socialement tolérables dans le couple. Or l’existence de ce seuil de violence alimente en premier lieu les pratiques masculines d’extorsion du consentement des femmes quant aux conditions d’organisation de la séparation.
La différenciation de la « vraisemblance des violences » et du « danger » a un autre effet. Elle encourage l’évaluation des demandes de protection à l’aune de ce que les juges perçoivent de la probité supposée des requérantes et de leur demande. En différenciant en affirmant que toutes les victimes ne méritent pas d’être protéger ce dispositif alimente la suspicion des juges quant aux raisons qui poussent certaines femmes à requérir la protection de la Justice et entretient leur peur de l’instrumentalisation. Cette méfiance favorise l’évaluation des situations de violence dénoncées à l’aune de critères infrajuridiques qui laissent la part belle aux préjugés de genre, de classe et de race, ce qui conduit les juges, toutes choses égales par ailleurs, à délivrer moins d’ordonnances de protection aux femmes immigrées (qui souvent sont aussi des femmes racisées) qu’aux femmes françaises et nées en France (qui sont aussi souvent des femmes blanches).
Pour une sociologie politique du droit qui n’abandonne pas les acquis de la sociologie du genre (et les victimes à leur sort)
La théorie féministe francophone s’est toujours montrée suspicieuse vis-à-vis du droit et de la justice. Le premier est accusé d’être, au pire ouvertement sexiste, au mieux faussement neutre, tandis qu’il est reproché aux juges de rendre des décisions défavorables aux femmes et de participer à la légitimation et à la reproduction de l’ordre patriarcal. Chez certaines féministes, la dénonciation du sexisme juridique s’accompagne d’une contestation radicale des cadres de la pénalité et de la dénonciation d’une justice de classe et de race.
L’enquête que j’ai réalisé démontre que cela est encore vrai aujourd’hui. L’ordonnance de protection telle qu’elle a été inscrite dans le droit et mise en œuvre par les juges aux affaires familiales peine à protéger les femmes, en particulier les plus fragiles : pauvres, racisées et stigmatisées, leur probité est encore plus contestée que celle des autres femmes. Non seulement l’ordonnance de protection n’a pas contraint les juges aux affaires familiales à repenser en profondeur leur positionnement vis-à-vis des violences masculines dans le couple, mais elle a aussi contribué à légitimer répétons-le l’existence d’un seuil de violences tolérables au sein du couple.
Pourtant, d’un point de vue féministe, il y avait des raisons de se réjouir de la création d’un restraining order ou d’un orden de protección « à la française ». L’importation dans notre système juridique et judiciaire de cet outil, forgé dans le sillage des droits états-unien et espagnol, venait y entériner la reconnaissance du droit des femmes à la sécurité dans la sphère privée. Elle laissait aussi entrevoir la possibilité que ce droit puisse s’exercer sans nécessairement alimenter le processus d’incarcération sans précédent qui affecte la société française depuis quelques années.
Face à ce constat en demi-teinte, la question déjà maintes fois posée se repose une nouvelle fois : les arènes juridique et judiciaire peuvent-elles faire progresser la cause des femmes ? Si, d’un point de vue purement théorique, on peut être tenté de répondre « non », du point de vue de l’action, cependant, il convient de ne pas laisser sans recours les femmes qui se retrouvent aux prises avec cette violence au quotidien. À n’en pas douter, la judiciarisation de la violence masculine dans le couple ne permettra ni de mettre fin aux inégalités structurelles entre les femmes et les hommes, ni véritablement de lutter contre les mécanismes qui permettent, génération après génération, que des hommes se sentent autorisés à recourir à la violence sur leur (ex-)compagne pour leur extorquer ce qu’elles refusent de leur donner.
Mais quand la violence est déjà là, quand elle menace des vies, obliger l’État à protéger les femmes qui subissent ces violences n’est certainement pas inutile, et il importe de continuer à réfléchir aux meilleurs moyens d’y parvenir. C’est peut-être là l’un des chantiers les plus stimulants qui s’offrent à la sociologie du droit et du genre dans les années à venir : imaginer un positionnement scientifiquement stimulant et politiquement responsable, pratiquer une sociologie d’autant plus à même d’informer l’activisme judiciaire qu’elle est empiriquement fondée.
*
Illustration : Photothèque rouge / Martin Noda / Hans Lucas France, Paris, 8 mars 2022.