
À lire : un extrait de « Le travail et l’émancipation », de K. Marx
Karl Marx, Le Travail et l’émancipation, textes choisis, présentés et commentés par Antoine Artous, Paris, Éditions sociales, 2016.
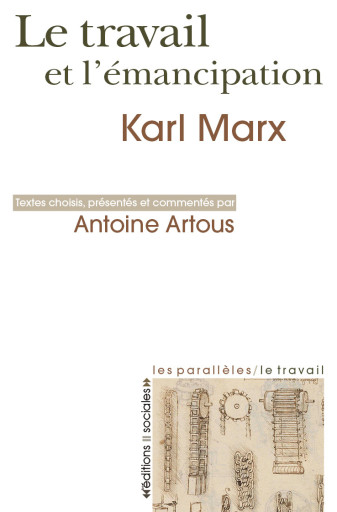
Introduction générale
En 1875 se tient en Allemagne, à Gotha, un congrès d’unification de deux organisations ouvrières afin de créer le SAPD (Sozialistische Arbeitparti Deuschland), point de départ de la social-démocratie allemande qui, on le sait, va jouer un rôle central dans le mouvement ouvrier européen et structurer une orthodoxie marxiste que l’on retrouvera, sous certains aspects, dans l’Internationale communiste.
À Londres, Marx, pourtant très engagé dans un travail international d’édition du livre I du Capital, estime nécessaire d’écrire des notes qui étrillent le projet de programme et apparaissent comme un testament politique.
« Le travail est source de toute richesse » énonce le projet dans sa première phrase. Une formule qui peut sembler banale tant elle exprime, non pas seulement la classique fierté du « travail bien fait » de l’ouvrier, mais la valorisation politico-programatique du travail qui marque le mouvement ouvrier de l’époque et va continuer de le marquer au siècle suivant.
« Le travail n’est pas la source de toute richesse »
Les premiers mots de Marx sont pour récuser l’affirmation :
« Le travail n’est pas la source de toute richesse. La nature est tout autant source des valeurs d’usage (et ce sont bien elle qui constituent de fait la richesse ? ( …) Cette phrase relève du b.a.ba et elle n’est exacte que dans la mesure où l’on sous-entend que le travail s’effectue avec des objets et les moyens appropriés. Mais un programme socialiste ne doit pas permettre à ce type de rhétorique bourgeoise de passer sous silence les conditions qui, seules, lui donne sens ».
Et il enfonce le clou :
« Les bourgeois ont d’excellentes raisons d’attribuer au travail une puissance de création surnaturelle »[1].
Au-delà de l’enjeu immédiat, résonne comme un écho de « la méthode de l’économie politique » traitée par Marx dans son « Introduction » (dite de « 1857 ») aux Grundrisse. Elle concerne les conditions d’émergence historique et théorique des catégories générales d’analyse et de leur fonctionnement, en prenant justement l’exemple la catégorie de travail. En tant que telle, comme « travail général » cette dernière prend forme avec le développement historique de la production capitaliste, donc avec le rapport salarial de la société bourgeoise moderne.
Non seulement Marx refuse de naturaliser les rapports capitalistes, mais il ne traite pas les catégories issues de cette société comme des catégories transhistoriques. La catégorie de « travail en général » n’est pas un outil d’analyse transhistorique des sociétés. Ce serait oublier un point, décisif pour Marx, mais trop souvent ignoré du marxisme : les formes d’objectivité du social de la société bourgeoise moderne sont en rupture complète avec celle des formes précapitalistes de production. Il n’existe pas un ordre des concepts (des problèmes d’analyse) qui pourrait s’articuler hors histoire, il est nécessaire de spécifier historiquement ces catégories dès leur énoncé.
Le travail n’existe pas « en soi », il est la forme prise dans le capitalisme par les activités de production de biens et de services qui existent certes dans toutes les sociétés mais qui peuvent prendre des formes sociales différentes. Dans de très nombreuses sociétés précapitalistes, il n’existe pas de mot équivalent à la catégorie moderne de travail. C’est très précisément pour rendre compte de la spécificité du rapport capital/travail salarié que Marx met en chantier sa « critique de l’économie politique ».
Cela a bien sûr des effets programmatiques. Ainsi – Marx n’en dit rien dans sa note – le programme de Gotha parle de « l’émancipation du travail » (et non pas des travailleurs), formule elle aussi classique à l’époque. Reste qu’on ne la trouve pas dans les textes programmatiques de Marx. Le Manifeste du Parti Communiste parle d’abolition du travail salarié et de l’avènement d’une « association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous ». Et dans la Critique de Gotha, Marx parle « d’une société de forme coopérative fondée sur la possession commune des moyens de production »[2]. On voit bien les différences.
Cela dit, on retrouve dans ce même texte, une équivoque qui réapparaît sans cesse dans l’œuvre de Marx. Il y distingue deux phases dans la société communiste à venir : la première, encore marquée par l’héritage de la société capitaliste, la seconde dite « supérieure ». La distinction a donné lieu à de nombreux débats dont il n’est pas le lieu de traiter ici. Je cite simplement ce que Marx dit alors du devenir du travail :
« Dans une phase supérieure de la société communiste, quand aura disparu l’asservissante subordination des individus à la division du travail (…) ; quand le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais sera devenu le premier besoin vital, quand le développement des individus à tous égards, leurs forces productives seront également accrues et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance… »[3].
Si l’on y prend garde, Marx ne dit pas seulement que le travail, comme moyen de production de biens et de services ne sera plus dominé par le capital mais géré par les producteurs associés. De fait, il disparaîtra comme forme spécifique d’activité sociale pour devenir l’expression du « premier besoin vital », l’archétype d’une activité libre. Dans la période du Capital (de la « critique de l’économie politique »), cette thématique reste marginale, au sens où elle ne structure pas une problématique d’analyse centrée, non pas sur le « travail en général », mais sur « les conditions « qui, seules, lui donnent sens » ; en l’occurrence le rapport capital/travail salarié conçu comme un rapport de production spécifique.
Par contre, elle est présente dans des textes de jeunesse, très marqués par la référence à « l’homme générique » ; c’est-à-dire l’essence de l’homme, une question « constitutive de l’anthropologie (qui) est aussi vieille que la philosophie »[4]. Ainsi dans les Manuscrits de 1844, très logiquement d’ailleurs. Le travail est l’essence de l’homme qui s’exprime de façon aliénée dans le travail salarié, en lien avec le développement de la propriété privée. Supprimer cette dernière c’est, en quelque sorte, restituer à l’homme son essence, faire du travail le premier besoin vital » : le travail non aliéné sera « une manifestation libre de la vie, une jouissance »[5].
C’est pourquoi à cette époque Marx parle souvent d’abolition du travail. Ainsi dans un texte de 1845 sur Friedrich List, un économiste allemand :
« La propriété privée n’est rien d’autre que le travail matérialisé. Si l’on veut lui porter un coup fatal, il faut attaquer la propriété privée, non seulement comme état objectif, mais comme activité, comme travail ».
D’où la perspective explicitement énoncée d’abolition du travail. Cette argumentation comme la formule d’abolition se retrouvent à plusieurs reprises dans L’idéologie allemande, présentée souvent comme un texte fondateur du « matérialisme historique »[6].
Libérer le travail et se libérer du travail
Dans un passage du livre III du Capital, Marx esquisse une problématique des rapports entre travail et émancipation qui me semble bien plus pertinente. Et toujours d’actualité.
« En fait, le royaume de la liberté commence seulement là où l’on cesse de travailler par nécessité et opportunité imposée de l’extérieur ; il se situe donc par nature, au-delà de la sphère de reproduction matérielle proprement dite. De même que l’homme primitif doit lutter contre la nature pour pourvoir à ses besoins, se maintenir en vie et se reproduire, l’homme civilisé est forcé, lui aussi, de le faire et de le faire quels que soient la structure de la société et le mode de production. Avec son développement, s’étend également le domaine de la nécessité naturelle, parce que les besoins augmentent ; mais en même temps l’élargissement pour les satisfaire. En ce domaine, la seule liberté possible est que l’homme social, les producteurs associés, règlent rationnellement leurs échanges avec la nature, qu’ils la contrôlent ensemble au lieu d’être dominés par sa puissance aveugle et qu’ils accomplissent ces échanges en dépensant le minimum de force et dans les conditions les plus dignes, les plus conformes à la nature humaine. Mais cette activité constituera toujours le royaume de la nécessité. C’est au-delà que commence le développement des forces humaines comme fin en soi, le véritable royaume de la liberté qui ne peut s’épanouir qu’en se fondant sur l’autre royaume, sur l’autre base, celle de la nécessité. La condition essentielle de cet épanouissement est la réduction de la journée de travail »[7].
Et il est intéressant de noter que dans le livre I du Capital, Marx avait déjà fait référence à la réduction du temps de travail, non pas seulement dans l’énoncé d’une problématique générale d’émancipation, mais comme une possibilité actuelle, permettant à la fois de lutter contre le chômage, tout en améliorant les conditions de travail.
Il traite du développement d’une « armée industrielle de réserve », comme d’une donnée structurelle de l’accumulation capitaliste :
« La condamnation d’une partie de la classe ouvrière à une oisiveté forcée par le surcroît de travail de l’autre et l’enrichissement du capitaliste individuel ».
Et, parlant de l’Angleterre, il ajoute :
« Cependant, si demain le travail était partout limité à des propositions rationnelles et distribué dans les différentes couches de la classe ouvrière, selon l’âge et le sexe, la population ouvrière actuelle serait absolument insuffisante pour la continuation de la production nationale à son échelle présente. La grande majorité des travailleurs actuellement ‘improductifs’ devrait être transformée en travailleurs ‘productifs’ »[8].
Cette mise au centre du développement du temps libre est fortement présente dans les Grundrisse. Marx va même jusqu’à écrire que la véritable richesse sociale ne se mesure pas en temps, mais en temps libre !
Il insiste alors sur trois questions essentielles. Tout d’abord le capital, en réduisant sans cesse le temps de travail nécessaire, permet de créer du temps de social disponible au service de tous et pour l’épanouissement de chacun. Ensuite, il ne pourra pas toujours, comme dans la société bourgeoise, opposer de façon abstraite temps de travail et temps libre, qui est tout à la fois loisir et activité supérieure. Enfin, ce temps libre permettra de transformer les individus qui entreront alors transformés dans le procès immédiat de production.
L’émancipation est donc ici pensée comme une dialectique du temps de travail et du temps libre. Et l’on remarquera les formules très modérées dans la façon de parler de la gestion de la production et de la confrontation à la nature par les producteurs associés. On est loin du productivisme échevelé dont on accuse parfois Marx. Il s’agit de régler « rationnellement » les échanges avec la nature.
Il faut donc libérer le travail et se libérer du travail[9]. Et, ce faisant, marquer une rupture avec une lecture de Marx, forte dans la tradition marxiste, qui ontologise la production en quelque sorte : l’émancipation du travail permettrait de réconcilier la société avec elle-même, en mettant la production, enfin émancipée, au centre de la vie et des relations sociales. Ici, la situation est inversée, c’est au-delà de la production que l’individu peut développer des activités vraiment libres. D’autant que ce passage du livre III du Capital explicite plus clairement que les Grundrisse la conséquence de cette approche : la sphère du travail ne peut pas disparaître[10]. On est loin des formules de L’idéologie allemande invoquant une « transformation du travail en activité libre »[11].
Cette problématique d’émancipation à travers une dialectique du temps de travail et du temps libre débouche sur toute une série de problèmes concernant l’organisation d’une société « socialiste ». Ainsi le passage du livre III du Capital en parle comme d’une société des « producteurs associés ». On peut reprendre cette formule à condition, non seulement, d’entendre par producteur, l’ensemble des travailleurs, qu’ils produisent des biens matériels ou des services, mais encore de s’interroger sur la nature du « pouvoir public », pour reprendre la formule du Manifeste communiste, qui s’articule avec (au moins) deux sphères des pratiques sociales : le temps de travail et le temps libre. Ce pouvoir ne s’encastre donc pas dans la production, même émancipée de la domination du capital, mais continue à exister comme sphère politique séparée. Or les tentations récurrentes ont été l’inverse ; depuis « le gouvernement sera l’atelier » des syndicalistes révolutionnaires à la démocratie des conseils ouvriers des années 1920[12].
Au demeurant, il serait vain de chercher à restituer la « vérité » marxienne sur ces questions ou de faire apparaître deux problématiques ouvertement contradictoires. Il y a là des tensions traversant l’ensemble de l’héritage légué par Marx et Engels. Ainsi dans l’Anti-Dühring, relu par Marx et qui a eu une influence considérable sur la tradition marxiste, Engels expose une problématique entière centrée sur l’émancipation à travers la production, permettant alors l’avènement du règne de la liberté.
« Le premier acte par lequel l’État apparaît réellement comme représentant de toute la société – la prise de possession des moyens de production au nom de la société – est en même temps son dernier acte en tant qu’État. (…) Le gouvernement des personnes fait place à l’administration des choses et à la direction des opérations de production. (…) Avec la prise de possession des moyens de production par la société, la production marchande, et, par suite, la domination du produit sur le producteur. L’anarchie à l’intérieur de la production sociale est remplacée par l’organisation planifiée consciente. (…) La vie en société propre aux hommes, qui jusqu’ici se dressait devant eux comme octroyée par la nature et l’histoire, devient maintenant un acte libre. (…) C’est le bond de l’humanité du règne de la nécessité dans le règne de la liberté »[13].
Si l’État peut ainsi disparaître, au moment même où il s’empare des moyens de production, c’est que, explique Engels dans les pages précédentes, le développement des forces productives générées par le capitalisme pousse « à l’affranchissement de leurs qualités de capitalistes, à la reconnaissance effective de leur caractère de forces productives sociales »[14].
Cette contradiction entre production sociale et propriété privée s’exprime sous la forme de l’antagonisme entre bourgeoisie et prolétariat, ce dernier étant en fait porteur d’une dynamique de socialisation immanente des individus et de la production. Mutatis mutandis, le prolétariat occupe le même lieu que l’homme générique dans les Manuscrits de 1844.
Notes
[1] Karl Marx, Critique du programme de Gotha, Editions sociales GEME, 2008, p. 49-50.
[2] Ibidem, p 57.
[3] Ibidem, p 60.
[4] Etienne Balibar, La philosophie de Marx, La Découverte, 1993, p. 28. L’auteur montre bien comment, à partir des Thèses sur Feuerbach, Marx change de terrain pour s’orienter vers une approche relationnelle des individus, récusant à la fois l’individualisme ( qui part de l’individu isolé )et la holisme (primat du tout) pour « penser l’humanité comme une réalité transindividuelle » (p. 21).
[5] Karl Marx, Manuscrits de 1844, Editions Sociales, 1962, p. 88.
[6] Karl Marx, A propos du système national de l’économie politique de Friedrich List, Œuvres III, La Pléiade, Gallimard, 1982, p. 1433. Pour L’idéologie allemande Maximien Rubel signale au moins cinq passages sur ce thème.
[7] Karl Marx, Le Capital, III.3, Editions sociales, 1960, p. 198
[8] Karl Marx, Le Capital livre I (4° édition allemande), Editions sociales, 1983, p. 713-714.
[9] Antoine Artous, Travail et émancipation. Marx et le travail, Syllepse, 2003.
[10] André Tosel, « Centralité et non-centralité du travail, ou la passion de l’homme superflu », in Jacques Bidet et Jacques Texier (dir), La crise du travail, PUF, 1995.
[11] Karl Marx, Friedrich Engels, L’idéologie allemande, Editions sociales, 1965, p. 82.
[12] Antoine Artous, Marx, l’Etat et la politique, Syllepse, 1999.
[13] Friedrich Engels, Anti-Dühring, Editions sociales, 1969 p. 322.
[14] Ibidem, p.316.





![Marx, critique de l’économie politique [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/industrialization-factories-150x150.jpg)



