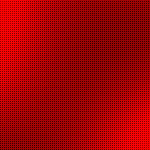Les dettes illégitimes. L’introduction du livre de François Chesnais
« Tout problème humain demande à être considéré à partir du temps. L’idéal étant que toujours le présent serve à construire l’avenir. Et cet avenir n’est pas celui du cosmos, mais bien celui de mon siècle, de mon pays, de mon existence. […] J’appartiens irréductiblement à mon époque. Et c’est pour elle que je dois vivre. L’avenir doit être une construction soutenue de l’homme existant » (FRANTZ FANON, Peau noire, masques blancs).
INTRODUCTION
Le 22 mars 2011, les salariés grecs ont fait grève et manifesté une nouvelle fois à Athènes contre la politique du gouvernement Papandréou. À la veille du sommet européen qui devait avaliser le « pacte de compétitivité et de convergence », dit « pacte pour l’euro », le gouvernement venait d’annoncer un nouveau train de mesures d’austérité et de libéralisation. Depuis le début de 2010, c’était la dixième fois environ que les travailleurs grecs manifestaient, mais la première fois qu’une des principales banderoles exigeait l’« annulation de la dette ». Interrogé par le correspondant du Monde, un manifestant a répondu : « Nous ne sommes pas responsables de ce qu’ont fait les précédents gouvernements. » Cela ne vaut pas seulement pour la Grèce, mais pour tous les peuples sommés d’assumer la charge de dettes publiques contractées dans des conditions échappant à leur contrôle, voire à leur connaissance. La dénonciation de la dette est une question politique majeure qui se pose pour beaucoup de pays, y compris la France. Elle intéresse celles et ceux qui combattent contre la régression sociale et l’injustice, pour une démocratie qui ne soit pas un simple paravent masquant la domination de l’oligarchie financière.
Beaucoup a été écrit depuis les années 1980 sur la dette des pays du tiers-monde, désignés aujourd’hui sous l’appellation de « pays du Sud ». Dans le cas des pays d’Amérique latine, de nombreux travaux ont expliqué la genèse de leur dette et ont analysé les conséquences économiques et sociales régressives de celle-ci. Aujourd’hui les dettes publiques européennes commencent à faire l’objet de telles études, auxquelles le présent livre souhaite apporter sa contribution. Comme d’autres publications, il se concentre surtout sur les dettes des pays membres de la zone euro, qui partagent une monnaie unique et sont soumis à des instances de décision communes : la Commission européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et l’Eurogroup où se concertent les gouvernements de la zone euro. Les dettes latino-américaines résultaient de prêts bancaires classiques et comportaient un face-à-face entre des gouvernements et des consortiums de banques. Dans le cas des dettes publiques actuelles, il y a eu émission et adjudication sur des marchés spécialisés, dits « marchés obligataires », de bons du Trésor et autres titres de dette. Ces titres ont été achetés par deux groupes d’institutions financières, les banques et les fonds de placement spéculatifs, désignés aujourd’hui du nom de Hedge Funds. Les dettes latino-américaines et européennes ont été contractées à des étapes différentes de la libéralisation et de la mondialisation de la finance, mais elles ont des points en commun, dont celui de servir d’instrument destiné à accélérer la libéralisation et la déréglementation. Un document du FMI de novembre 2010 explique clairement que l’endettement des gouvernements peut les aider à imposer les « réformes » propres au capitalisme libéralisé, financiarisé et mondialisé : « Les pressions des marchés pourraient réussir là où les autres approches ont échoué. Lorsqu’ils font face à des conditions insoutenables, les autorités nationales saisissent souvent l’occasion pour mettre en oeuvre des réformes considérées comme difficiles, comme le montrent les exemples de la Grèce et de l’Espagne. » Il faut prendre cet avertissement au sérieux. Depuis un an, les peuples grecs et portugais ont déjà vécu une régression sociale considérable. Ceux d’Espagne et d’Irlande sont appelés à s’appauvrir pour payer les créanciers des banques. Et c’est pour que la France conserve la note AAA donnée par les agences de notation que le calendrier de la réforme des retraites a été changé et que celle-ci a été menée sans ménagement.
Subir la crise sous la forme d’une « double peine » ?
Ce livre présente l’Europe non comme une forteresse à défendre ou à partir de laquelle lancer des « croisades », mais comme le berceau d’idées et de mouvements politiques tournés vers l’émancipation, individuelle et collective. Aujourd’hui, les économies européennes sont confrontées à la perspective d’une longue récession, accompagnée d’un chômage de masse structurel, qui frappe déjà et qui frapperait toujours plus fortement les salariés de plus de cinquante ans et surtout les jeunes. Depuis l’automne 2008, dans la très grande majorité des pays européens comme dans beaucoup de parties du monde, les salariés et les jeunes ont subi les effets de la crise sous la forme du chômage dont le BIT a rappelé récemment l’ampleur4, ainsi que sous celles d’une précarité et d’une déqualification accrues de l’emploi. Depuis 2009, les groupes industriels européens ont réalisé l’essentiel de leurs nouveaux investissements en Asie ou dans les plus grands pays d’Amérique latine. C’est le cas de groupes français importants. Dans de nombreuses régions industrielles d’Europe, les salariés sont frappés par le chômage de masse, à un niveau jamais atteint depuis les années 1930. Ils y sont confrontés dans les conditions inédites d’une internationalisation très poussée de la production industrielle. Partout en Europe, au tournant des années 2010, chez Fiat à Mirafiori, les entreprises exigent des baisses de salaires, une intensité du travail accrue et l’abandon des libertés syndicales. Quelques semaines après avoir arraché aux salariés un vote de consentement, elles annoncent que le transfert de la production aura lieu quand même. Les ouvriers de Continental en ont fait les frais, pour ne citer qu’eux.
Cette situation a deux causes. La première est évidemment la crise économique et financière mondiale. Aux États-Unis et en Europe, il s’agit d’une crise de surinvestissement et de surproduction qui a une acuité particulière dans des industries déterminées, notamment le bâtiment et l’automobile. Dans ces deux parties du système capitaliste mondial, la crise marque les limites d’un « modèle » ou d’un « mode de croissance » dans lequel la production et la vente de biens et de services ont été entretenues par un endettement élevé des entreprises et surtout des ménages, moyen conçu par la finance pour contrecarrer la faiblesse de la demande due à la baisse de la part des salaires dans le revenu national – à laquelle elle a du reste fortement contribué. L’effondrement de ce modèle, dont le détonateur a été la crise de montages financiers insoutenables autour du crédit immobilier, a laissé derrière lui d’importantes capacités de production excédentaires, de biens immobiliers inoccupés et un montant très élevé de dettes privées à épurer.
L’autre cause est à chercher dans les politiques de rigueur budgétaire et de réduction salariale suivies dans la zone euro, comme dans la très grande majorité des pays de l’Union européenne6. En 2008, beaucoup de pays danubiens et baltiques intégrés depuis peu dans l’UE se sont vu imposer une potion assez similaire à celle administrée au groupe de pays auquel les traders ont donné l’acronyme de PIGS (en anglais Portugal, Ireland, Greece, Spain, la lettre I pouvant aussi désigner l’Italie). Ces politiques sont menées au nom de la réduction des dépenses publiques posée comme un préalable nécessaire à celle de l’endettement. Elles ont un caractère dit « procyclique » dans le langage économique. Là où elles n’enfoncent pas les pays dans la récession, elles leur imposent un taux de croissance très faible, synonyme de stagnation. Parce qu’ils ont fortement réduit l’imposition des revenus du capital et des profits et qu’ils ont autorisé de facto l’évasion fiscale vers les paradis fiscaux, beaucoup de pays se sont en effet lourdement endettés. Dans certains cas (Grèce, mais aussi France et Italie), l’endettement avait commencé à croître bien avant la crise. Celle-ci l’a considérablement aggravé. Dans d’autres pays, notamment l’Espagne et l’Irlande, la dette est née de l’effondrement de la bulle immobilière et du fort endettement consécutif des banques et des promoteurs immobiliers, que les gouvernements ont décidé de porter à la charge de l’État. Les grandes banques européennes, qui détiennent une partie importante des titres publics des États les plus exposés, ont reçu une aide considérable à l’automne 2008 au moment où la faillite de la banque Lehman Brothers à New York conduisait la crise financière à son paroxysme. Les banques européennes n’ont pas épuré tous les actifs toxiques de leurs comptes et continué à faire des placements à haut risque. Au printemps 2010, elles ont convaincu certains gouvernements, ceux de l’Allemagne et de la France en premier, ainsi que l’Union européenne et la BCE, que le risque de défaut de paiement de la Grèce mettait leur bilan en danger. Elles ont exigé d’être mises à l’abri des conséquences de leur gestion.
En mai 2010, au terme de négociations longues et tendues, un accord a été conclu à Bruxelles sur un « plan de lutte contre les risques de contagion des dettes souveraines » à hauteur de 750 milliards d’euros, soit à peu près le montant du plan de secours états-unien monté en catastrophe en septembre 2008 lors de la faillite de la banque Lehman Brothers. En mars 2011, cet accord a été prolongé et assorti de dispositions draconiennes (cf. infra chapitre 3). Un banquier britannique a noté au sujet des mesures de 2010 qu’il était « plus facile de vendre un tel plan en disant qu’il doit servir à sauver la Grèce, l’Espagne et le Portugal, que d’avouer qu’il doit d’abord sauver et aider les banques ». Appréciation peu discutée en France, mais partagée par le Financial Times : « fondamentalement on n’a pas affaire à une crise de la dette des États, mais à une crise bancaire doublée d’une crise de coordination des politiques [au sein de l’UE] ». On s’accorde à dire que la crise bancaire a ses racines dans une expansion débridée de certaines formes de crédit, notamment immobilier, dans certains pays, ainsi que dans les placements à très forts risques des grandes banques françaises et allemandes. Le manque de coordination est vrai pour la politique monétaire. Il ne date pas de 2010, car il résulte de la nature même de la zone euro et de la grande hétérogénéité des pays qui en font partie. En revanche, dans le cas des politiques budgétaires et salariales, on a affaire à des politiques similaires. Elles prennent la forme de fortes baisses des dépenses sociales, de diminution de traitements des fonctionnaires et de réduction de leur nombre, ainsi que de nouvelles atteintes aux systèmes des retraites, que ceux-ci soient par capitalisation ou par répartition. Les premiers pays, tels la Grèce et le Portugal, à les avoir appliquées ont été pris dans une spirale infernale dont les couches populaires et les jeunes sont les victimes immédiates. La chute de la production et la montée du chômage résultant des coupes budgétaires et d’une rigueur salariale accrue y ont provoqué une baisse de rentrées fiscales. Le ratio de la dette publique au produit intérieur brut (le PIB), qui est l’un des indicateurs scrutés par les agences de notation, loin de diminuer, s’est aggravé. Le niveau des taux d’intérêt demandés par les banques et les Hedge Funds s’est donc élevé lors de chaque nouvelle émission de bons du Trésor. Les pays les plus endettés sont pris dans une spirale infernale. Chaque deux ou trois mois, les agences de notation et les investisseurs, mais aussi les institutions européennes demandent un tour de vis supplémentaire, budgétaire et salarial, aux gouvernements ; le chômage monte ; la TVA, qui est dans beaucoup de pays l’une des plus importantes sources de recettes fiscales, baisse, creusant le déficit budgétaire malgré la réduction des dépenses. L’émission suivante de titres est encore plus onéreuse que la précédente et donc le service des intérêts encore plus lourd. Les Hedge Funds ont profité de la faiblesse des pays les plus vulnérables et fait grimper les taux d’intérêt.
En France, la soudaine nécessité de « réformer » le système des retraites de l’été 2010
Nicolas Sarkozy s’était fait élire en 2007 sur un programme qui comportait l’engagement de ne pas toucher aux retraites au cours de son mandat. Trois ans plus tard, la réforme des retraites est devenue impérative, qualifiée par lui de « mère de toutes les réformes ». Une dépêche de l’agence de presse Reuters du 16 juin 2010 explique fort bien pourquoi (les références allant dans ce sens abondent) : « Le paquet de mesures dévoilé mercredi par le ministre du Travail Éric Woerth vise à rééquilibrer dès 2018 le système de retraites, qui autrement aurait présenté à cette date un déficit estimé à plus de 40 milliards d’euros […]. Avec son calendrier accéléré, la réforme des retraites en France devrait satisfaire les agences de notation, veut croire le gouvernement. Les sources de Bercy insistent sur le calendrier accéléré de la réforme, alors que la date de 2020 était jusqu’ici la plus souvent évoquée pour l’élimination du déficit des retraites. Le président de la République a vivement souhaité que le problème soit rapidement réglé tout en restant socialement supportable et équitable pour l’ensemble de la population. Pour sa part, le ministère des Finances espère voir confortée la note AAA dont bénéficie la dette souveraine de la France sur les marchés financiers. »
Objectif confirmé par François Fillon dans une intervention du 25 juin : « Ce qui est en jeu, c’est la crédibilité financière de la France, c’est la qualité de notre signature, donc le niveau auquel nous empruntons, et c’est ultimement, au fond, une part de notre souveraineté. » Phrase qui mérite d’être analysée, en raison de la définition tout à fait nouvelle que le Premier ministre donne de la souveraineté. Il fait dépendre celle-ci des desiderata des banques et des fonds de placement, français et étrangers (ceux-ci détenant une part pouvant varier, selon les émissions, d’environ deux tiers des bons du Trésor et titres de la dette publique). Frédéric Lordon est l’un de ceux qui ont énoncé en premier la portée de la « configuration inédite de la politique moderne dans laquelle nous a fait entrer la libéralisation financière internationale. Car on croyait le peuple souverain la seule communauté de référence de l’État, son ayant droit exclusif, l’unique objet de ses devoirs, et l’on aperçoit comme jamais à l’occasion de la réforme des retraites que, contrairement à de stupides idées reçues, le pouvoir politique ne gouverne pas pour ceux dont il a reçu la “légitimité” – mais pour d’autres. Il y a donc un tiers intrus au contrat social et l’on découvre que, littéralement parlant, c’est lui qui fait la loi ».
En France, jusqu’en 1982-1983, la dette publique était négligeable. Comme on le verra (cf. infra, p. 109) elle est née du cadeau fait au capital financier lors des nationalisations du gouvernement d’Union de la gauche. Sa croissance a épousé le mouvement de la libéralisation financière, dont la première phase des années 1980 a été marquée par des taux d’intérêt réels très élevés. L’endettement de l’État a sa source dans la faiblesse de la fiscalité directe (impôt sur le revenu et impôt sur les entreprises) et dans l’évasion fiscale. Depuis cette époque, plutôt que d’affronter les groupes sociaux qui en bénéficient et qui y ont recours, les gouvernements du Parti socialiste comme ceux du RPR-UMP ont « contourné » le problème de la façon la plus favorable au capital et à la fortune. Ils ont emprunté à ceux qu’ils renonçaient à taxer. L’imposition du capital et des hauts revenus a été diminuée d’abord prudemment, puis sous les gouvernements Jospin, Raffarin et Villepin de façon plus forte avec la multiplication des niches fiscales, avant que Sarkozy ne mette en place en 2007, avec le bouclier fiscal, des mécanismes restituant aux plus riches une partie de l’impôt. L’analyse des origines de la dette de la France aidera à cerner la notion de « dette illégitime » et donc à poser la question de son annulation, non seulement d’un point de vue économique, mais comme question politique à fondement éthique.
En 2007, avant le début de la crise mondiale, la dette représentait déjà 64 % du PIB français. À partir de 2008, la baisse des rentrées fiscales, conjointement au sauvetage des banques et des grandes entreprises de l’automobile, l’a portée à près de 83 %. De quoi permettre aux investisseurs de poser la question de la solvabilité de la France, de pousser leurs porte-parole à inciter le gouvernement à accélérer la privatisation du secteur public et de s’attaquer au statut des fonctionnaires. Depuis le milieu des années 1990, le paiement des intérêts des emprunts a été le deuxième poste budgétaire en France, derrière l’Éducation nationale, et devant la Défense. De 44 milliards d’euros en 2010, il s’élèvera à 57 milliards en 2013. Mais si on prend le total des engagements financiers, c’est-à-dire le paiement des intérêts et le remboursement de la dette, ils sont déjà le premier poste de dépenses, devant l’enseignement, les pensions du secteur public et les dépenses militaires. Le poids de l’impôt, dont la TVA est la colonne vertébrale dans le système français, pèse principalement sur les salariés. Moyennant le service de la dette, ce sont eux qui assurent un transfert très élevé de richesse aux banques et aux fonds de placement financiers. Même si une partie des salariés ont des économies dans un compte d’épargne que leur banque place en bons du Trésor, le transfert net opéré aux dépens des salaires est gigantesque. Aucun changement significatif de la répartition en faveur du travail ne peut se faire sans toucher au service de la dette, donc à la dette elle-même. La taxation des profits et des hauts revenus, mesure centrale de toute reconfiguration de la fiscalité, ne se fera pas tant que cette composante importante du pouvoir du capital n’aura pas été anéantie.
A-t-on besoin des banques sous leur forme actuelle ?
Le rôle des banques est de fournir du crédit commercial à très court terme (l’escompte des effets commerciaux) et des prêts à plus long terme aux entreprises pour leurs investissements. Ce rôle est indispensable au fonctionnement du capitalisme. Il le serait aussi pour toute forme d’organisation économique fondée sur des modalités décentralisées de propriété sociale des moyens de production supposant le recours à l’échange. Le financement de l’économie au moyen de ces deux formes de crédit comporte la création de moyens de paiement, c’est-à-dire de monnaie. C’est même la forme dominante de création monétaire, bien plus importante que la mise en circulation de billets. Ces fonctions indispensables ont été dévoyées. Depuis les années 1980, par étape, les grandes banques se sont transformées en groupes financiers diversifiés, qui cumulent des activités de banque de dépôt et de banque de placement financier. Les opérations de placement effectuées par les traders dans les salles de marché ont plus d’importance que les activités menées auprès de la clientèle dans les agences de quartier. Les groupes bancaires ont soutenu à partir de 2002-2003 la transformation de l’immobilier – logements, résidences secondaires, bureaux – en actif financier, souvent à caractère spéculatif, sans que cela résolve la crise massive du logement. Ils ne l’ont pas fait seulement aux États-Unis, mais aussi en Irlande et en Espagne, premiers pays de la zone euro à être frappés par la crise. Ils ont alimenté, ce faisant, le boom de la construction au moyen d’instruments financiers qui en permettaient le financement de façon très risquée, sinon factice, de sorte que la crise a d’abord pris la forme d’une crise de l’immobilier et des modes de financement fondés sur la titrisation, dont les « actifs toxiques » dits subprime sont les plus connus. À partir de fin 2007 et de la faillite de la banque britannique Northern Rock, les gouvernements ont consacré des sommes élevées au sauvetage des banques. Ils en ont transféré la charge sur les citoyens, soit immédiatement comme en Irlande (les premières coupes budgétaires datent de février 2008), soit un peu plus tard ailleurs. Puis a eu lieu le grand sauvetage de l’automne 2008. Dans le cas de l’Europe, l’exigence d’aider les banques n’a apparemment pas de fin.
Les études et rapports officiels sur la situation des banques aboutissent à des conclusions contradictoires. Les uns jugent leurs bilans fragiles, les autres solides. L’un des points majeurs sur lesquels leur attention se focalise est l’« effet de levier », qui désigne des prêts accordés par les banques excédant très fortement leurs capitaux propres. Il suscite des interrogations quant à la nature des prêts et à la place qu’ils occupent dans l’endettement des États. Est-ce une épargne représentant une substance économique véritable qui a été prêtée, ou a-t-on simplement affaire à des montants fictifs résultant de l’« innovation financière » ? La réponse qu’on donne a évidemment une incidence sur l’appréciation de la légitimité des dettes publiques. La question justifie la nécessité de les examiner de très près.
Le bilan de trois décennies de libéralisation financière et de quatre années de crise pose, en tout état de cause, la question de l’utilité économique et sociale des banques dans leur forme actuelle. Devenues des conglomérats financiers, les banques ont-elles droit au soutien des gouvernements et des contribuables chaque fois que leurs bilans sont menacés du fait de leurs propres décisions de gestion ? Beaucoup de gens commencent à en douter et l’expriment parfois, comme l’a fait Éric Cantona, dans des formes que les médias ne peuvent pas ignorer.
Nicolas Sarkozy a été obligé d’inviter, très poliment, les dirigeants des grandes banques bénéficiaires du sauvetage financier d’octobre 2008 à venir lui expliquer pourquoi elles consentaient si peu de crédits aux petites et moyennes entreprises, d’autant plus que la BCE leur prêtait alors des liquidités au taux très bas de 1 %. Il s’agissait d’une simple mise en scène destinée à essayer de calmer l’opinion.
Déjà en 2006, donc hors de tout contexte de crise, le rapport sur les banques françaises commandé par le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (à l’époque Thierry Breton) soulignait que les PME « rencontraient des difficultés pour accéder aux crédits bancaires ». Plus graves et plus symptomatiques encore sont les « actifs toxiques » que les municipalités, les régions et même certains hôpitaux ont été poussés à acheter par les banques. Sensés faciliter par leur rendement élevé le financement de projets d’investissement lourds dans un contexte de transfert de dépenses par l’État, ces achats de titres ont aggravé qualitativement la situation financière des entités publiques. Les élus viennent de se constituer en association pour mener des actions judiciaires collectives contre les banques. L’achat de titres financiers opaques, de contrats de swap notamment, illustre bien entendu le fait que le fétichisme de l’argent n’est pas le propre des seuls traders, puisqu’il emporte le jugement des élus et des administrateurs locaux. Mais les banques savaient parfaitement les risques qu’elles leur faisaient prendre, le jeu de casino dans lequel elles les faisaient entrer. Le supplément d’endettement contracté par les municipalités relève des « dettes odieuses », dont on parlera plus longuement par la suite (cf. infra, p. 105), « celles qui ont été contractées contre les intérêts des populations d’un État (ici une municipalité), sans leur consentement et en toute connaissance de cause du côté des créanciers ».
Ainsi, les banques se sont détournées de leur fonction indispensable de crédit aux particuliers et aux entreprises pour s’engager dans des activités de spéculation financières nocives et dépourvues d’utilité sociale. Il est temps non pas de détruire les banques, mais de les saisir afin qu’elles puissent remplir les fonctions essentielles qui sont en principe les leurs.
Quelles solutions opposer à l’endettement public et aux politiques menées en son nom ?
Les effets économiques procycliques des politiques suivies en Europe vont y aggraver la situation sociale, dans les pays obligés de solliciter l’aide de l’UE comme dans toute l’Europe. La contagion touchera les pays voisins du continent. Les problèmes sociaux y seront d’autant plus sérieux que les conséquences de la hausse des prix alimentaires, provoquée au moins en partie par la spéculation financière, viendront s’ajouter aux effets dépressifs propagés depuis l’UE. Certains lieux de réflexion stratégique de la finance jugent qu’il faut gérer les dettes publiques autrement que ne le font l’UE et la BCE. L’idée qui gagne du terrain est de procéder à la « restructuration » des dettes souveraines, notamment celles de la Grèce, du Portugal et de l’Irlande. Elle a été défendue en janvier par l’hebdomadaire The Economist, l’un des principaux porte-parole de la City de Londres. Le terme désigne l’échelonnement dans le temps – un temps dont la durée est décidée par les créanciers – du remboursement du principal des prêts, ainsi que l’aménagement du service des intérêts à la capacité de paiement du pays – dans des conditions également décidées par eux. La notion peut être étendue pour inclure l’annulation de la dette due à certaines catégories de créanciers. C’est ce que Martin Wolf, éditorialiste du Financial Times et chroniqueur du Monde de l’économie, défend pour l’Irlande.
La restructuration des dettes est rejetée pour le moment par la majeure partie des investisseurs financiers qui redoutent des réactions incontrôlables de panique sur les marchés financiers. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, le Premier ministre grec, Georges Papandréou, s’en est fait l’écho : « Une restructuration se ferait au détriment de la crédibilité de notre pays et de la santé du système bancaire national et européen. Elle pourrait provoquer l’effondrement des banques grecques et produirait une avalanche d’attaques spéculatives contre un grand nombre d’autres pays européens. » Mais l’idée fait son chemin, d’autant que les termes des restructurations seraient décidés par les représentants des créanciers, en l’occurrence la BCE et le FMI avec, en arrière-plan, le gouvernement allemand.
Le terme « restructuration » est également utilisé par des économistes qui combattent le néolibéralisme ainsi que les institutions européennes dans leurs formes actuelles. Ils donnent au mot le contenu d’une annulation d’une partie importante des dettes. Ne serait-il pas préférable d’utiliser ce terme plus clair et plus mobilisateur qui n’est pas entaché d’une expérience historique douloureuse, celle des pays d’Amérique latine, notamment le Mexique, dans les années 1980, lors de la restructuration organisée par le « plan Brady » (œuvre du secrétaire d’État des finances des États-Unis de l’époque) ? Les termes en avaient été dictés par les banques créancières et leurs gouvernements, réunis au sein d’une institution portant le joli nom de « club de Paris » (qui possède toujours des bureaux à Bercy puisque certaines dettes n’ont toujours pas été annulées). Ils avaient inclus la cession d’actifs industriels et énergétiques et avaient opéré au bénéfice des créanciers une longue et douloureuse ponction de la richesse produite dans les pays objets de cette potion amère. Les années 1980 ont été pour ces pays ce que les Latino-Américains ont nommé une « décennie perdue ».
Dans les années 2010, il serait encore plus dangereux qu’un continent entier accepte de vivre une « décennie perdue » pour satisfaire les actionnaires et les dirigeants des banques (car l’Allemagne finirait par se faire happer par la récession prolongée). La consolidation de la domination des banques et des investisseurs financiers aurait un impact bien au-delà de l’Europe – pas seulement dans le domaine économique, social et culturel, mais aussi sur le terrain des luttes autour du changement climatique et contre le pillage des ressources naturelles. On comprend l’importance d’un large débat dans la gauche et l’anticapitalisme pour s’entendre sur ce que la restructuration pourrait signifier exactement.
Prendre position sur les banques et le crédit a pour corollaire la remise en question de l’euro. Aujourd’hui, la monnaie commune pilotée par la BCE est l’instrument au plan monétaire des politiques de mise en concurrence entre salariés et de démantèlement des acquis sociaux auxquelles les traités de Maastricht et de Lisbonne servent de cadre institutionnel et juridique. À mesure que la crise mondiale se développait, l’euro s’est révélé être un système marqué par des contradictions et une instabilité majeures, que l’Allemagne et ses alliés dans la zone euro cherchent à contenir. Soutenus par le gouvernement Sarkozy, ces pays viennent d’obtenir la création de nouvelles procédures européennes de surveillance mutuelle des budgets et des politiques économiques et sociales, ainsi une « stratégie de croissance », dite de « compétitivité », fondée sur la « modération salariale ». Ces dispositions, baptisées « pacte de compétitivité par la convergence » ou « pacte pour l’euro », feront l’objet d’un ajout à l’article 136 du traité de Lisbonne. Le texte, déjà rédigé, sera présenté dès que la situation politique interne des pays de l’UE le permettra. Selon les Économistes atterrés, on a affaire à des mesures destinées à « pérenniser la tutelle des intérêts financiers sur les politiques économiques des États européens ». Elles accentueraient encore les traits fortement antidémocratiques de l’UE et créeraient dans la zone euro une espèce de Directoire des dirigeants des pays les plus puissants. Le combat contre le pacte pour l’euro s’impose. Il n’en va pas de même pour la sortie de l’euro défendue par certains économistes.
L’éclatement de la zone euro sous l’effet des conditions insupportables imposées aux pays les plus endettés ne peut pas être exclu. En France, certains économistes et politistes sont prêts à devancer cette éventualité. Ils défendent la sortie de l’euro. Ils préconisent le retour au franc ainsi que sa dévaluation,dont on a pourtant vu les effets sociaux néfastes dans les années 1980. La sortie de l’euro est également défendue par des économistes grecs. Ce n’est pas la position défendue dans ce livre. L’enjeu est d’aider à la convergence des luttes sociales et politiques des peuples soumis aujourd’hui à une Europe néolibérale vers un objectif de contrôle social démocratique commun de leurs moyens de production et d’échange, donc aussi de l’euro. L’avenir de ceux qui ne bénéficient pas de rentes financières, donc de l’écrasante majorité des citoyens des pays d’Europe, va dépendre de leur capacité à créer ensemble ce qui n’existe pas actuellement, à savoir une véritable union. Dans différents pays européens, la réflexion politique autour de la crise, de la dette publique et de l’euro a débuté dans des formes propres à chaque pays. Dans la perspective de la construction d’une « autre Europe », ne pourrait-on définir des objectifs communs tels que ne pas payer les dettes, saisir les banques, y compris la BCE, et les socialiser pour les contrôler efficacement ?
François Chesnais, Les dettes illégitimes – Quand les banques font main basse sur les politiques publiques, Raisons d’agir, 2011.