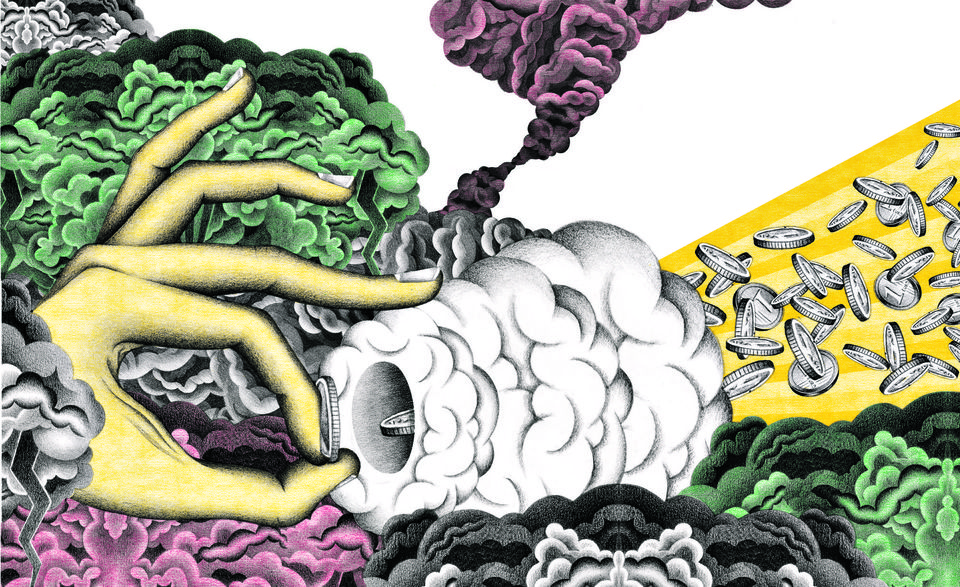
Capitalisme et changement climatique: notions théoriques et trajectoire historique initiale (I)
Le changement climatique et ses conséquences sont la question la plus redoutable que la société humaine contemporaine ait à affronter. Héritière de la trajectoire multimillénaire des civilisations qui se sont succédé depuis l’Age de pierre, elle est aujourd’hui prise au piège dans des processus économiques et des comportements individuels et sociaux autodestructeurs propres au capitalisme. La notion de «devenir-capital du monde» proposée par Alain Bihr, c’est-à-dire «la production d’une société capitaliste appropriée à l’économie capitaliste»[1], peut être étendue à ses rapports à la nature. C’est de ceux-ci que viennent les transformations de la biosphère et de nombreux écosystèmes existant sur la planète qui sont à l’origine du changement climatique. L’expansion planétaire de l’économie capitaliste, sa prise de possession du monde, sont allées de pair avec la constitution d’un ensemble de relations du capital avec son milieu naturel, pris au sens le plus large du terme, qui lui ont été «appropriées».
Il est trompeur de parler de «global warming», de réchauffement global. Aussi bien les causes du changement climatique que leurs effets sont répartis très inégalement. Les rapports de production et de propriété entre les classes et les rapports entre certains Etats et les autres qui caractérisent le capitalisme font qu’il ne saurait en être autrement. Les émissions de CO2 varient très fortement selon les pays. En 2012, les émissions moyennes par habitant (qui ne reflètent donc pas les différences au sein d’un même pays) en Amérique du Nord sont plus de huit fois plus élevées qu’en Inde. Les moyennes ne reflètent pas les disparités qu’il peut y avoir dans une zone géographique. Par exemple, au Moyen Orient, les émissions par tête sont de plus de 50 t CO2 équivalent/habitant au Qatar et de moins de 2 t CO2éq./habitant au Yémen[2]. Le changement climatique affecte tous les écosystèmes de la planète, mais de façon nécessairement différente[3]. Les conséquences dramatiques du changement climatique dans des parties spécifiques du monde engendreront les formes majeures de la barbarie au XXIe siècle. On commence déjà à le comprendre avec sur la « question » des migrant·e·s et les alignements sociaux et politiques à laquelle elle conduit.
S’orienter politiquement sur la question du changement climatique comme sur celle, complémentaire, de l’épuisement ou de la dégradation profonde des ressources naturelles, comporte une double exigence: d’abord en comprendre la relation avec les ressorts essentiels du processus d’accumulation du capital; ensuite chercher à saisir la manière dont les rapports de classe internes à chaque pays et ceux de domination et de dépendance entre pays sont de nature à faire tomber les effets des dérèglements d’abord sur les secteurs des travailleurs et les communautés les plus exploités, marginalisés et vulnérables, à créer un facteur supplémentaire de migrations et à engendrer de nouvelles formes de guerre. C’est alors que peut s’engager la discussion sur les caractéristiques et les buts du combat politique sur une question qui surdétermine désormais toutes les autres[4]. Un mot pour éviter tout faux procès. Conduit par la structuration politique propre à la bureaucratie stalinienne, le « socialisme réellement existant » – selon la formule développée en RDA – a provoqué des désastres écologiques incommensurables dans l’immense espace de l’ancienne URSS à cheval sur l’Europe et sur l’Asie. Ils ne sont cependant pas l’objet de cet article ni du suivant, pas plus que ne le sont ceux provoqués par les choix de « développement » du Parti communiste chinois.
Anthropocène et capitalocène
Si la notion de «devenir-capital du monde» s’applique parfaitement aux transformations que la biosphère et de nombreux écosystèmes ont subies au long de l’expansion des rapports de production capitalistes, nous sommes obligés de partir des termes utilisés dans le débat actuel.
Le premier est l’anthropocène. Ce terme a été proposé (avec un point d’interrogation) dans un article publié en 2007 par le chimiste de l’atmosphère Paul Crutzen et deux de ses collègues[5] pour désigner une nouvelle époque géologique où l’homme est devenu une force géophysique dont les activités transforment la biosphère. Le taux de CO2 dans l’atmosphère sert d’indicateur. L’anthropocène ne désigne pas un être ontologique transhistorique, mais une époque géologique[6], qui aurait succédé à l’époque de l’holocène dont la durée s’est étendue sur 10 millénaires. Dans la théorisation de Crutzen, le début de la transition de l’holocène à l’anthropocène remontrerait aux années 1830-1850, en Grande Bretagne, avec l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère provoquée par la révolution industrielle. Le changement climatique provoqué par ces émissions est la dimension de l’anthropocène sur laquelle le plus d’attention a été portée. Toutefois, l’anthropocène comporte également des processus tout aussi graves dont certains ont un impact direct sur le changement climatique et tous sur l’état de la planète et la reproduction sociale de certaines communautés: la déforestation, l’artificialisation et l’appauvrissement progressif des sols sous l’effet de l’usage massif d’engrais et de pesticides, l’exploitation minière sous ses différentes formes, les forages, la pollution extrême des océans et la destruction de la vie marine débouchant sur le processus d’extinction de masse d’espèces terrestres et marines.
La notion d’anthropocène ne fait pas l’unanimité chez les scientifiques. Une commission internationale a été créée en 2008 et n’est pas encore parvenue à un accord. Néanmoins l’usage du mot s’est généralisé. Entrant dans le langage commun il a suscité en réaction chez des chercheurs en sciences sociales des recherches visant à montrer que ce n’est pas à l’action de « l’homme en général » qu’on a à faire, mais aux conséquences de la production capitaliste. Le premier à opposer en 2014 le terme « capitalocène » à celui d’anthropocène a été l’anthropologue américain Jason W. Moore dont on parlera plus loin[7]. Il a été suivi en 2016 par l’historien économique suédois Andreas Malm dont les recherches ont porté sur les choix énergétiques des industriels du capitalisme anglais et le rôle de l’énergie fossile dans la consolidation de l’impérialisme britannique[8]. Enfin le philosophe brésilien Daniel Cunha a inscrit une recherche critique sur la notion d’anthropocène dans le cadre mis en place par J. W. Moore et A.Malm. On doit à un historien de la question écologique Armel Campagne une présentation très claire des points d’accord et des points de divergence entre les trois auteurs. J’y renvoie les lecteurs[9].
Avant de suivre certaines des pistes que ces auteurs ont ouvertes, il faut exposer les éléments conceptuels qui permettent d’établir la notion sur les bases théoriques établies par Marx. Elles montrent les hommes et les femmes pris sous le capitalisme dans l’étau de formes de produire et de consommer propres à un système caractérisé par la recherche du profit sans fin et sans limites.
Création de survaleur et naissance du rapport à la nature comme étant « pure affaire d’utilité »
L’enjeu n’est pas de démontrer, comme a voulu le faire notamment John Bellamy Foster, que Marx était un écologiste avant l’heure[10] (Marx n’a pas prévu, ne pouvait pas prévoir le réchauffement climatique), mais de comprendre les processus qui font du travail abstrait, de la valeur d’échange et de la création de plus-value les déterminants clefs du rapport du capital à ses conditions extérieures.
L’observation méthodologique générale la plus ramassée de Marx sur les rapports des hommes à la nature se trouve dans un texte écrit de 1847. Il est peu lu aujourd’hui mais m’a beaucoup aidé :
« Pour produire, les hommes entrent en relations et en rapports déterminés les uns avec les autres, et ce n’est que dans les limites de ces rapports sociaux que s’établit leur action sur la nature. »
Ces rapports sociaux sont structurés, écrit-il, par la valeur d’échange de marchandises, leur échange et leur transformation en capital[11]. Dans un texte important de 1992[12], Daniel Bensaïd cite de longs passages des Manuscrits de 1857-58 où Marx situe le rapport du capital à la nature par rapport à la recherche de la survaleur (plus-value) et le lie à la «tendance à créer le marché mondial donnée dans son concept même», (la célèbre phrase citée à peu près sans exception, y compris par moi, sans la suite et donc privée d’une large partie de sa portée).
« La création de survaleur absolue par le capital – c’est-à-dire plus de travail objectivé – implique que le cercle de la circulation s’élargisse, et qu’il s’élargisse constamment. La survaleur créée en un point exige la création en un autre point d’une survaleur contre laquelle elle puisse s’échanger […]. La production basée sur le capital implique donc, entre autres, la production d’un cercle sans cesse élargi de la circulation, soit que ce cercle soit agrandi directement, soit qu’on transforme un plus grand nombre de ses points en points de production […].
La tendance à créer le marché mondial est immédiatement donnée dans le concept de capital. Chaque limite y apparaît comme un obstacle à surmonter. Le capital a donc d’abord tendance à soumettre chaque moment de la production elle-même à l’échange et à abolir la production de valeurs d’usage immédiates n’entrant pas dans l’échange, c’est-à-dire à substituer la production basée sur le capital à d’autres modes de production antérieurs qu’il juge trop enracinés dans la nature.
De la même façon, donc, que la production fondée sur le capital crée l’industrie universelle – c’est-à-dire du surtravail, du travail créateur de valeur – elle crée d’autre part un système d’exploitation universelle des propriétés naturelles et humaines, un système qui repose sur l’utilité et qui semble s’appuyer aussi bien sur la science que sur toutes les qualités physiques et intellectuelles, tandis que rien n’apparaît comme ayant une valeur supérieure en soi, comme étant justifié pour soi en dehors de ce cercle de la production et des échanges sociaux. Si bien que c’est seulement le capital qui crée la société civile bourgeoise et développe l’appropriation universelle de la nature et de la connexion sociale elle-même par les membres de la société.
C’est seulement avec lui que la nature devient un pur objet pour l’homme, une pure affaire d’utilité ; qu’elle cesse d’être reconnue comme une puissance pour soi; et même la connaissance théorique de ses lois autonomes n’apparaît elle-même que comme une ruse visant à la soumettre aux besoins humains, soit comme objet de consommation, soit comme moyen de production. Le capital, selon cette tendance, entraîne aussi bien au-delà des barrières et des préjugés nationaux que de la divinisation de la nature et de la satisfaction traditionnelle des besoins, modestement circonscrite à l’intérieur de limites déterminées et de la reproduction de l’ancien mode de vie. Il détruit et révolutionne constamment tout cela, renversant tous les obstacles qui freinent le développement des forces productives, l’extension des besoins, la diversité de la production et l’exploitation et l’échange des forces naturelles et intellectuelles. »[13]
C’est dans les Manuscrits de 1857-58 également que Marx écrit que
« le capital en tant qu’il représente la forme universelle de la richesse – l’argent – est la tendance sans borne et sans mesure de dépasser sa propre limite. Sinon il cesserait d’être capital, l’argent en tant qu’il se produit lui-même »[14],
formule qu’il reprend dans le chapitre 4 du livre premier du Capital[15].
Le rapport à la nature du capital et le développement de la science et la technologie, qui lui est consubstantiel, sont donc commandés par la valorisation sans fin de l’argent devenu capital, dans un mouvement marqué par la réduction du travail concret au travail abstrait, de production et vente de marchandises et donc de demande de matières premières, nécessairement toutes sans fin. Descartes théorise, parallèlement à Sir Francis Bacon en Angleterre, la place des connaissances scientifiques dans le rapport du capitalisme à la nature. La thèse des « hommes maîtres et possesseurs de la nature» du Discours de la Méthode[16] est celle d’une nature présentée par Descartes comme ayant été encore créée par Dieu (qui est très prudent à l’égard de l’Inquisition même après son départ pour Amsterdam)[17], mais dont les propriétés utiles exigent d’été exploitées grâce au développement des connaissances scientifiques et des inventions technologiques. La théorisation de Descartes est alors celle d’une bourgeoisie en guerre contre l’obscurantisme. Aujourd’hui, elle est celle d’une bourgeoisie placée face à une question de vie ou de mort, dont une partie des scientifiques défendent le recours aux différentes formes de géo-ingénierie (par exemple de gigantesques miroirs dans l’espace pour dévier les rayons solaires)[18]. Les positions écologiques de Marx dont nous parlerons dans le second article sont très loin du « maîtres et possesseurs de la nature ».
Exploiter au maximum la force de travail et puiser sans fin dans les ressources naturelles
L’attribut du capital de « valeur en procès » tournée perpétuellement vers son autoreproduction tel un « automate » repose sur deux piliers. Le premier est l’alchimie très particulière qui naît de la rencontre de l’argent devenu capital avec le travail vivant. Le cadre contemporain du capital mondialisé est celui de la mise en concurrence directe des travailleurs de pays à pays et de continent à continent et la constitution grâce à la liberté d’établissement des firmes, aux délocalisations et à la libéralisation des échanges, d’une armée industrielle de réserve mondialisée. Elle permet au capital de s’approprier les qualités d’intelligence et d’énergie à l’échelle planétaire et au meilleur coût.
Le second est celui, constant, à puiser sans limites dans les réserves de matières premières, de ressources du sol et du sous-sol, puis à partir d’un moment donné à continuer à émettre du gaz à effet de serre en dépit des atteintes toujours plus graves des émissions à la biosphère et à des écosystèmes vulnérables au réchauffement climatique. La primauté de la valeur d’échange sur la valeur d’usage fait que pour le capital, il est absolument indifférent que les marchandises produites soient réellement des « choses utiles » ou qu’elles en aient simplement l’apparence. Pour le capital, leur seule « utilité » est de permettre la poursuite du processus de valorisation sans fin. Les dépenses de publicité sont là pour persuader ceux qui ont du pouvoir d’achat réel (ou fictif: le petit crédit à la consommation comme « réponse » à la compression des salaires) que les marchandises qu’elles leur proposent sont « utiles ».
C’est ce second plier qui a été, et qui reste, peu étudié par les marxistes à l’exception des spécialistes théoriciens de l’éco-socialisme. Pourtant le chapitre premier du livre I du Capital contient l’observation comme quoi,
« l’homme ne peut pas procéder autrement que la nature elle-même, c’est-à-dire il ne fait que changer la forme des matières. Bien plus, dans cette œuvre de simple transformation, il est encore constamment soutenu par des forces naturelles. Le travail n’est donc pas l’unique source des valeurs d’usage qu’il produit, de la richesse matérielle. Il en est le père, et la terre, la mère, comme dit William Petty.»
L’affirmation de l’importance d’une prise en compte du rôle clef de «la nature » n’est pas simplement théorique. C’est par ce point que Marx commence sa critique du premier programme du Parti social-démocrate allemand, celui dit de Gotha:
« Le travail n’est pas la source de toute richesse. La nature est tout autant la source des valeurs d’usage (qui sont bien, tout de même, la richesse réelle!) que le travail, qui n’est lui-même que l’expression d’une force naturelle, la force de travail de l’homme.[19]»
Le caractère du capital de « valeur en procès » tournée vers une autoreproduction sans fin ainsi que la concurrence – entre oligopoles et entre Etats – au travers desquels celle-ci se manifeste, sont tels qu’aucune preuve scientifique du dérèglement climatique et de ses causes ne peut arrêter le mouvement décrit plus haut. Il se poursuit en toute connaissance de cause.
« L’auto-expansion contrainte de chaque entreprise si elle veut rester en course (….) crée un ‘système boule de neige industriel’ relativement incontrôlé où chaque investissement industriel résulte d’une contrainte générale de valorisation, l’ensemble constituant une ‘force géologique aveugle’ ».
Pour autant « une histoire du Capitalocène avec le ‘Capital’ comme sujet-automate doit être rejetée[20]. Les groupes financiers et les États continuent à recourir en toute connaissance de cause à des modes de production et de consommation dont les conséquences écologiques sont connues. La « waste economy » (système économique reposant sur le gaspillage) résulte de l’extraordinaire pression exercée sur les consommateurs par la publicité et l’incitation à s’endetter (avec la multiplication du type d’officines de crédit à la consommation qui font écho aussi à des besoins socialement nécessaires qui ne peuvent se concrétiser étant donné la contraction des revenus).
Dater le capitalocène du début de l’époque du capital marchand: traite d’esclaves et économie de plantation
Nous pouvons en venir maintenant à l’emploi du terme capitalocène fait par Jason W. Moore, celui de Malm exigeant un travail distinct, objet possible d’un article ultérieur.
La position dominante chez ceux qui défendent l’idée d’un tournant qualitatif dans les relations de l’homme à la nature porteur d’une nouvelle ère géologique, est de le dater des années 1830-1850 au moment du plein essor et du début d’internationalisation de la révolution industrielle. Moore soutient que le tournant est bien antérieur. Il le fait remonter à l’économie de plantations et à un rapport d’exploitation des ressources naturelles qui va de pair avec le recours massif à la main-d’œuvre esclave. L’anthropocène qui doit être nommé capitalocène peut
« être daté symboliquement de 1492. Les émissions de CO2 se sont intensifiées à partir du XIXe siècle, mais la manière capitaliste de traiter la nature date de bien avant.[21]»
Pour Moore le capitalocène est
« une manière d’organiser la nature, à la fois en faisant de la nature quelque chose d’externe à l’homme, et en faisant de la nature quelque chose de «cheap», dans le double sens que peut avoir ce terme en anglais: ce qui est bon marché, mais aussi le verbe «cheapen» qui signifie rabaisser, déprécier, dégrader.[22]»
Elle est le complément nécessaire du travail bon marché et souvent rabaissé et déprécié de ceux, hommes et femmes, qui vendent leur force de travail. La rupture du métabolisme entre l’homme et la nature à laquelle Marx a donné une grande importance, qui a été étudiée par John Bellamy Foster et dont nous parlerons dans le second article, ne date pas du 19°siècle, mais du moment où naît l’économie de plantation.
La référence de Moore à la conquête du Mexique et ce qu’il dit du lien entre la façon de traiter la nature dans le cadre de l’économie de plantation et la main-d’œuvre esclave[23] fait de lui l’un du petit nombre d’auteurs se situant dans la tradition marxiste à s’intéresser
« aux rapports que l’Europe occidentale a pu nouer avec d’autres continents, peuples et civilisations à la faveur de son expansion commerciale et coloniale au cours des temps modernes»[24].
Ces auteurs, dit Bihr, incluent « Marx lui-même, dans une certaine mesure (…) la question de la genèse du capitalisme (des rapports capitalistes de production) ne l’ayant que peu préoccupé. » Voyons cependant, dans cette question qu’il aurait un peu laissé de côté, ce que Marx dit de l’esclavage. Il y a d’abord dans sa polémique contre Proudhon, donc dès 1847, ceci :
« L’esclavage direct est le pivot de l’industrie bourgeoise aussi bien que les machines, le crédit, etc. Sans esclavage, vous n’avez pas de coton; sans le coton, vous n’avez pas d’industrie moderne. C’est l’esclavage qui a donné leur valeur aux colonies, ce sont les colonies qui ont créé le commerce de l’univers, c’est le commerce de l’univers qui est la condition de la grande industrie. Ainsi l’esclavage est une catégorie économique de la plus haute importance. Sans l’esclavage, l’Amérique du Nord, le pays le plus progressif, se transformerait en pays patriarcal. Effacez l’Amérique du Nord de la carte du monde, et vous aurez l’anarchie, la décadence complète du commerce et de la civilisation modernes. Faites disparaître l’esclavage, et vous aurez effacé l’Amérique de la carte des peuples.[25]»
Dans ce texte, il n’est pas fait mention de la traite, du commerce des esclaves comme tel. Il en est question très brièvement dans le passage souvent cité du livre premier du Capital sur l’accumulation primitive :
« La découverte des contrées aurifères et argentifères de l’Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquête et de pillage aux Indes orientales, la transformation de l’Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les procédés idylliques d’accumulation primitive qui signalent l’ère capitaliste à son aurore.[26]»
Mais il y a aussi un autre chapitre du Capital où il est question de l’esclavage, notamment un passage portant sur les situations où les capitalistes n’ont pas à se préoccuper de la reproduction de la force de travail que Marx rapproche de celle de l’esclavage. Il cite longuement sa principale source, The Slave Power de John Elliot Cairnes :
« si fatale et si destructive que soit l’influence des champs de riz de la Géorgie et des marais du Mississippi sur la constitution de l’homme, la destruction qui s’y fait de la vie humaine n’y est jamais assez grande pour qu’elle ne puisse être réparée par le trop-plein des réservoirs de la Virginie et du Kentucky. Les considérations économiques qui pourraient jusqu’à un certain point garantir à l’esclave un traitement humain, si sa conservation et l’intérêt de son maître étaient identiques, se changent en autant de raisons de ruine absolue pour lui quand le commerce d’esclaves est permis. Dès lors, en effet, qu’il peut être remplacé facilement par des nègres étrangers, la durée de sa vie devient moins importante que sa productivité. Aussi est-ce une maxime dans les pays esclavagistes que l’économie la plus efficace consiste à pressurer le bétail humain (human chaule), de telle sorte qu’il fournisse le plus grand rendement possible dans le temps le plus court.[27] »
« C’est sous les tropiques, là même où les profits annuels de la culture égalent souvent le capital entier des plantations, que la vie des nègres est sacrifiée sans le moindre scrupule. C’est l’agriculture de l’Inde occidentale (les Caraïbes F.C.), berceau séculaire de richesses fabuleuses, qui a englouti des millions d’hommes de race africaine. C’est aujourd’hui à Cuba, dont les revenus se comptent par millions, et dont les planteurs sont des nababs, que nous voyons la classe des esclaves non seulement nourrie de la façon la plus grossière et en butte aux vexations les plus acharnées, mais encore détruite directement en grande partie par la longue torture d’un travail excessif et le manque de sommeil et de repos ».
Et Marx d’enchaîner :
« Mutato nomine de te fabula narratur ! Au lieu de commerce d’esclaves lisez marché du travail, au lieu de Virginie et Kentucky, lisez Irlande et les districts agricoles d’Angleterre, d’Ecosse et du pays de Galles; au lieu d’Afrique, lisez Allemagne. Il est notoire que l’excès de travail moissonne les raffineurs de Londres, et néanmoins le marché du travail à Londres regorge constamment de candidats pour la raffinerie, allemands la plupart, voués à une mort prématurée.[28]»
Elliot Cairns a des réflexions intéressantes sur les avantages et les inconvénients de l’économie de plantations et du travail esclave. Le seul avantage est, pour autant que le prix d’achat des esclaves soit bas et les coûts de surveillance du travail faibles, de permettre la production en monoculture à grande échelle avec appropriation de l’ensemble de la récolte. Les inconvénients sont qu’il s’agit d’un travail fourni de très mauvais gré qui exige donc une surveillance étroite, absolument non-qualifié et donc absolument non-flexible. Un esclave qui a travaillé dans les champs de tabac ne peut pas être transféré sans coût vers des champs de coton. L’économie de plantation exige des domaines très grands, une concentration de la propriété du sol qui reste à ce jour une plaie sociale et écologique dans toutes les Amériques.
Le rodage de l’économie esclavagiste et du commerce triangulaire antérieur à 1482
En attendant de lire le nouveau livre d’Alain Bihr – Le premier âge du capitalisme 1415-1763. Tome 1: L’expansion européenne – dont la table des matières du tome 1 annonce qu’il la traitera, je présente mes propres connaissances sur le commerce triangulaire de la première période du capital marchand. Grâce aux recherches des dernières années on sait mieux, maintenant, que le système de production et d’échange de produits de base et de valorisation d’un capital fondé sur le travail esclave, a commencé par être africain avant de devenir atlantique[29]. Ce sont des marchands arabes qui ont montré aux portugais et espagnols le parti qu’ils pouvaient tirer du travail esclave. Ceux-ci ont commencé dans la première moitié du XVe siècle à se fournir en esclaves blancs venant du Caucase sur les marchés nord-africains, notamment Le Caire, pour les faire travailler sur les plantations de canne à sucre de Madère et des Canaries. La chute de Constantinople en 1453 met fin à l’approvisionnement d’origine slave. Emmenés par le prince Henri Le Navigateur les marins portugais y ont pallié. Ils ont razzié et vendu des esclaves à mesure de leur progression le long des côtes africaines. Cap Vert en a été la première plaque tournante. Le travail esclave s’est généralisé pendant un temps au Portugal même. Les principaux marchés se trouvaient à Lagos et à Lisbonne. Les historiens estiment que 150 000 Africains sont arrivés par le port de Lisbonne dans le demi-siècle qui précéda le premier voyage de Colomb. Les Noirs en vinrent à représenter plus du dixième de la population de Lisbonne.
Dans le golfe de Guinée, à partir de 1471, les Portugais établirent sur la petite île tropicale de Sao Tomé une seconde colonie à vocation sucrière, avec des esclaves achetés sur le continent au royaume du Kongo. Sao Tomé a aussi été un marché d’esclaves. C’est de là que des esclaves capturés au Kongo ont été vendus à d’autres chefs africains sur la côte de l’Or (actuel Ghana) pour exploiter les mines d’or d’El Mina. Puis vient la conquête du Mexique, puis des contrées andines. Dès que les Espagnols ont pris la mesure de l’immensité des richesses des civilisations qu’ils soumettaient à leur domination, ils ont commencé à s’approvisionner en esclaves auprès des Portugais pour les faire travailler dans les plantations de café, cacao et de tabac. Les esclaves africains commencent à être débarqués au Mexique depuis Luanda dès 1502, soit dix ans à peine après l’arrivée de Christophe Colomb. Les Espagnols se lancèrent aussi dans l’exploitation des mines d’argent et d’or du Mexique et du Pérou notamment à Potosi. Ils firent d’abord appel au travail forcé des Indiens des hauts plateaux et ensuite à l’esclavage[30]. De leur côté les Portugais, dès 1516, soit une quinzaine d’années après l’expédition de Pedro Cabral au Brésil ont commencé d’y importer le système de plantations sucrières développé avec succès à Madère puis à Sao Tomé[31].
Dès la fin du XVIe siècle, 300’000 esclaves africains ont été transportés en Amérique pour alimenter les plantations sucrières en main-d’œuvre, dont la moitié au Brésil. Mais les Hollandais, les Anglais et les Français n’ont pas laissé longtemps aux Espagnols et aux Portugais le monopole du fructueux commerce triangulaire. Les trois pays chassent les Espagnols des îles des Antilles (à l’exception de Cuba et Porto Rico) et y fondent leurs propres colonies sucrières.
Dans tous les ports importants de l’Atlantique, des armateurs lancent des expéditions vers le golfe de Guinée pour y acheter les esclaves nécessaires aux nouvelles plantations. Les gouvernements ont apporté leur concours à ce trafic en accordant des privilèges fiscaux aux compagnies et en construisant des forts le long du golfe de Guinée, au total une quarantaine entre le Sénégal et le Niger. Les navires font escale sur les côtes guinéennes à l’abri de ces forts, et attendent que des trafiquants africains leur amènent des captifs en nombre suffisant. L’achat du « bois d’ébène», euphémisme donné au commerce d’esclaves, a tous les aspects d’un commerce ordinaire: les chefs et trafiquants africains fournissant les Européens en échange d’armes, d’alcool et produits manufacturés divers.
Avec l’invention en Angleterre et en Ecosse des machines à filer et à tisser et la construction de manufactures cotonnières qu’il fallait approvisionner à une échelle industrielle, le coton est devenu la matière première produite par l’économie de traite et de plantation, passant devant la canne à sucre. On n’a plus eu affaire à une denrée alimentaire, fût-elle d’une importante croissante, mais à la matière première, à l’intrant nécessaire à l’une des industries motrices de la première phase du capitalisme industriel.
La culture du coton a d’abord été introduite à Saint-Domingue en 1740, où les conditions pédologiques étaient plus propices que celle de la canne. Pendant un demi-siècle, jusqu’aux soulèvements des esclaves qui débutent en 1790, dont Toussaint Louverture prit la tête, Saint-Domingue a dominé la production de coton au point d’en avoir le quasi-monopole et d’obliger les Anglais à continuer de s’y approvisionner même lorsqu’elle était en guerre avec la France. Avec la fuite des planteurs devant le soulèvement vers la Louisiane et le Mississippi, puis l’extension de la culture du coton en Géorgie et en Caroline du Sud, les États-Unis sont devenus de loin le principal pays producteur de coton au monde et par là même le principal pays esclavagiste.
La suite de cet article portera en grande partie sur le système de production en monoculture organisé dans de très grandes exploitations, souvent avec une exploitation des travailleurs particulièrement brutale. Dans le cas des pays de la Caraïbe et du continent Sud-Américain, il est le legs de cette histoire.
Publié initialement par Alencontre.org
Notes
[1] https://alencontre.org/marxisme/marx-et-la-premiere-mondialisation-i.html
[2] http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2016/chiffres-cles-du-climat-edition2017-2016-12-05-fr.pdf
[3] On peut renvoyer à la définition de l’Agence française de normalisation : un écosystème est constitué « des êtres humains et de leur environnement physique, des plantes et des animaux » et que cet écosystème est dit durable si « ses composantes et leurs fonctions sont préservées pour les générations présentes et futures». À l’échelle planétaire, il est possible de caractériser différents types de milieux et d’établir une typologie, même incomplète et surtout indicative, des zones de vie ou écorégions. L’ONG étatsunienne WWF en recense quatorze. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
[4] Celles et ceux qui voudraient aborder la question Que faire ? peuvent se reporter sur une intervention de 2015 Daniel Tanuro. Il y ouvre de bonnes pistes qui s’éloignent un peu de l’écosocialisme. http://www.inprecor.fr/article-CLIMAT-Face%20%C3%A0%20l’urgence%20%C3%A9cologique?id=1795
[5] Will Steffen, Paul J. Crutzen and John R. McNeill, The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature? Ambio, Vol. 36, No. 8, December 2007.
[6] Même si c’est du climat dont il est question, on parle de période géologique parce que c’est dans la lithosphère, c’est-à-dire la croûte de la surface de la Terre, dont la roche, que se trouvent les traces qui permettent de lire les changements climatiques. La première datation des ères géologiques a été proposée en 1913 par un géologue anglais, Arthur Holmes. Les techniques de datation se régulièrement enrichies, les échelles devant être périodiquement mises à jour, les âges devenant plus précis. https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_des_temps_g%C3%A9ologiques
[7] Voir “The Capitalocene, Part I: On the Nature & Origins of Our Ecological Crisis” 2014 http://www.jasonwmoore.com/Essays.html. “The Capitalocene, Part II: Abstract Social Nature and the Limits to Capital’, http://www.jasonwmoore.com/uploads/The_Capitalocene___Part_II__June_2014.pdf. Jason Moore a commencé par écrire sur les causes environnementales de la grande crise économique et sociale de 14°-15° siècle.
[8] Voir en français Andreas Malm, L’anthropocène contre l’histoire. Le réchauffement climatique à l’ère du capital, La Fabrique, Paris, 2017, et sa recension publiée par Contretemps : https://www.contretemps.eu/anthropocene-capital-malm/
[9] Armel Campagne, La Capitalocène. Aux racines historiques du dérèglement climatique, Editions Divergences, Paris, 2017.
[10] Dans son numéro de juin 2018, Le Monde Diplomatique vient de recycler un extrait de son livre Marx écologiste, paru en français aux Editions d’Amsterdam en 2011, mais publié aux Etats-Unis en 2000. On peut se rapporter à l’ouvrage abordant certaines critiques qui lui ont été faites John Bellamy Foster et Paul Burkett, Marx and the Earth. An Anti-Critique, Haymarket (Historical Materialism), 2017.
[11] Marx, Travail salarié et capital, 1847, Editions sociales, Paris, 1952, page 31. https://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/12/km18471230-3.htm, section 3. Je m’en suis servi dans mon chapitre, « Ecologie, lutte sociale et construction d’un projet révolutionnaire dans les conditions du XXI° siècle » dans le livre coordonné par Vincent Gay, Pistes pour un anticapitalisme vert, Syllepse 2010.
[12] Daniel Bensaïd, Le tourment de la matière : Marx, productivisme et écologie, cours de formation à l’université d’été de la LCR, repris par l’Institut international de recherche et de formation d’Amsterdam pour une conférence internationale sur l’écologie tenue en octobre 1993. Disponible à http://danielbensaid.org/Marx-productivisme-et-ecologie
[13] Marx, Manuscrits de 1857-58, Editions Sociales, Paris, 1980, volume I, p. 347-349. Dans un article pour le site alencontre.org Michel Husson attribue à Marx trois positions, « prométhéenne », « productiviste » et « métabolique » , il place ce texte dans la seconde catégorie. Michel Husson, Marx a-t-il inventé l’écosocialisme, https://alencontre.org/ecologie/marx-a-t-il-invente-lecosocialisme.html
[14] Marx, Manuscrits de 1857-58, Editions Sociales, Paris, 1980, volume I, p. 273.
[15] Marx, Le Capital, Editions Sociales, Paris, 1950, volume I, p. 156.
[16] « Au lieu de cette philosophie spéculative, qu’on enseigne dans les écoles, on peut en trouver une pratique, par laquelle connaissant la force et les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n’est pas seulement à désirer pour l’invention d’une infinité d’artifices, qui feraient qu’on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. » Discours de la Méthode, sixième partie.
[17] Descartes ne veut rien enseigner, écrit-il à son ami, le Père Mersenne, qui soit contraire à la foi de l’Église, et au surplus, sa devise est : heureux qui vit caché, bene vixit qui bene latuit. https://www.superprof.fr/ressources/philosophie/supports-philosophie-comp/ /philo-cartesianisme-bio.html Il est intéressant de remarquer que tout à l’inverse Sir Francis Bacon a occupé le poste de Lord Chancellor, l’un des plus élevé de la monarchie anglaise au 17°siècle.
[18] Voir par exemple https://news.vice.com/fr/article/trois-projets-de-geo-ingenierie-sont-en-cours-pour-sauver-la-planete
[19] Marx, Critique du Programme de Gotha.
[20] Campagne, op. cit. pages 42 et 72.
[21] Moore a tiré des ses publications universitaires consultables sur Internet un important livre Capitalism in the Web of Life, Verso, 2015. En français on peut lire ce qu’il dit dans deux entretiens. Jason W. Moore, «Nous vivons l’effondrement du capitalisme», entretien avec Joseph Confavreux et Jade Lindgaard, Médiapart, 13 octobre 2015 https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/131015/jason-w-moore-nous-vivons-l-effondrement-du-capitalisme?onglet=full et avec Kamil Ahsan à http://revueperiode.net/la-nature-du-capital-un-entretien-avec-jason-w-moore/
[22] Entretien Médiapart
[23] Beaucoup des développements théoriques de Moore le desservent. C’est le cas de sa critique du dualisme homme-nature qui est tout bonnement la marque de fabrique des rapports capitalistes. Je me concentre sur la piste qu’il ouvre autour de la date 1482.
[24] Alain Bihr, Le premier âge du capitalisme (1415-1763), Introduction générale, Editions Page2/Syllepse, à paraître à l’automne 2018.
[25] Marx, Misère de la philosophie, La méthode, quatrième observation. https://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/06/km18470615g.htm
[26] Marx, Le Capital, livre 1, Editions Sociales, vol.3, p.193.
[27] John Elliot Cairnes, The Slave Power, 1862. Cairnes était professeur à Dublin et son livre est dédié à John Stuart Mill.
[28] Marx, Le Capital, livre 1, Editions Sociales, vol.1, p. 261.
[29] Ces recherches ont été présentées sous forme filmique dans le documentaire en quatre parties de Daniel Cattier, Juan Gélas et Fanny Glissant, Les routes de l’esclavage, diffusé par Arte en mai 2018, notamment dans la seconde partie.
[30] https://www.mondialisation.ca/pillage-des-ressources-et-neocolonialisme-de-largent-desclaves-a-lor/5621386
[31] Les plantations de l’île africaine ont été vite victimes de la concurrence de celle du Nouveau Monde, des révoltes d’esclaves. En 1595, un grand soulèvement conduit par le « roi » Amador donna le coup de grâce à l’économie sucrière de Sao Tomé. http://www.une-autre-histoire.org/les-angolares-de-sao-tome/








