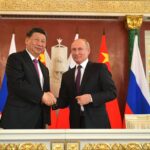À lire un extrait de Révolution et contre-révolution en Chine maoïste, d’Elliott Liu
Elliott Liu, Révolution et contre-révolution en Chine maoïste, Paris, Syllepse, 2018.
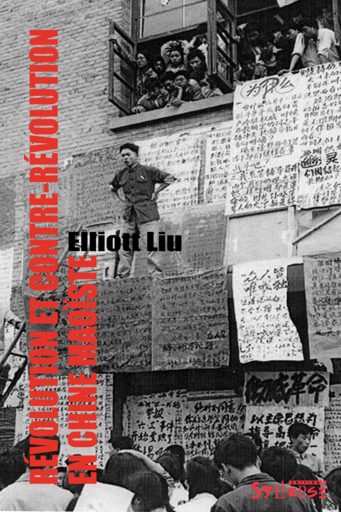
5. Tibet : union volontaire ou assimilation forcée ? [Extraits]
Après les émeutes de Lhassa en 2008[1], le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Qin Gang, a accusé le dalaï-lama d’être « le chef suprême d’un régime théocratique reposant sur le servage ». L’accusation était à moitié juste. Quin oublie ainsi que même s’il le voulait, le dalaï-lama ne pourrait être « chef suprême du servage », parce que le parti de Qin a aboli le servage il y a plus de cinquante ans. Les anciens serfs sont devenus depuis longtemps des fermiers et des gardiens de troupeaux. Mais peut-être le dalaï-lama cherche-t-il à restaurer le servage bien que son rétablissement soit improbable ? Pour être juste, ni la charte du gouvernement en exil du dalaï-lama ni ses propres déclarations ne permettent de penser que cette perspective soit pour lui à l’ordre du jour. Le dalaï-lama a en effet fait un bond en avant historique, même si celui-ci a été imposé à la classe dirigeante tibétaine par le PCC. Personne ne sait cela mieux que le PCC, qui continue pourtant à ressasser les mêmes vieilles accusations qui relèvent plus de la calomnie que de la vérité.
S’il est vrai que le dalaï-lama est « le chef suprême d’un régime théocratique », il faut cependant ajouter que c’est un régime en exil. L’article 19 de la charte du gouvernement tibétain en exil stipule effectivement que le pouvoir suprême du gouvernement repose sur le dalaï-lama, qu’aucune loi ne peut être adoptée sans son consentement et qu’il peut dissoudre le Parlement à tout moment. Le dalaï-lama n’est donc pas un simple chef religieux, il est également le chef d’un gouvernement théocratique en exil dont la mission, selon la clause 3 de la même charte, est la construction d’un État « démocratique » qui soit également un État tibétain bouddhiste (littéralement un État qui fusionne religion et politique)[2]. Par conséquent, parler du dalaï-lama comme s’il n’était qu’un chef religieux est erroné. Enfin, il est très douteux qu’une théocratie soit dans l’intérêt des Tibétains, même si je respecte les choix démocratiques du peuple tibétain.
Cependant, tout en ayant cette capacité à le faire oublier par les médias occidentaux, le fait est que le dalaï-lama reste partisan d’un État théocratique et qu’il est moins progressiste qu’il ne le paraît. Conscient de cette difficulté, il répète sans cesse que s’il retourne au Tibet il n’en sera que le chef religieux et qu’il laissera à d’autres le rôle de dirigeant politique. Et s’il croit réellement dans la démocratie, il peut le prouver immédiatement en abrogeant la clause théocratique de la charte.
Il est ironique qu’en 1995, le PCC, qui est un parti athée ne croyant pas en la doctrine bouddhiste de la réincarnation, non seulement emprisonne les Panchen-Lama, Gedhun Choekyi Nyima réincarnés qui ont été choisis par le dalaï-lama, mais qu’il désigne Gyaincain Norbu comme le Panchen Lama « réincarné[3] ». Cette décision est à la fois une violation brutale de la liberté religieuse et des principes d’un État séculier. Le gouvernement chinois n’a pas à intervenir dans le choix des chefs religieux, même s’ils sont également des dirigeants politiques. Ce qui appartient à César revient à César, ce qui appartient à Bouddha revient à Bouddha.
Si le gouvernement chinois ne respecte pas le principe séculier, s’il fait également preuve d’intolérance religieuse, c’est parce qu’il présente lui aussi, dans une certaine mesure, les traits d’un État théocratique : il considère son propre pouvoir comme un mandat reçu du ciel et sa conception du « socialisme » est celle d’une religion d’État avec laquelle, sous son règne, nul sujet ne peut être en désaccord. C’est pourquoi le PCC est hostile à toute religion dont les chefs n’acceptent pas son idéologie.
Le gouvernement chinois a accusé le dalaï-lama de vouloir séparer le Tibet de la Chine, ce que celui-ci persiste à nier tout en soulignant qu’il avait changé depuis longtemps pour adopter une « politique de voie moyenne ». Son objectif actuel est d’aboutir à « un pays, deux systèmes », proposition que le gouvernement chinois refuse de discuter avec lui. Avant d’explorer cette idée, je devrais peut-être répondre à la question suivante : « Le gouvernement chinois pratique-t-il la répression des aspirations nationales des Tibétains ? ». Il est évident que cette opinion est largement partagée en Occident. Mais ce qui est significatif, c’est qu’aujourd’hui en Chine non seulement le PCC nie cette affirmation, mais que de nombreux démocrates et de gens de gauche pensent de même. Une discussion sur ce sujet devrait contribuer à clarifier les idées sur ce qui se passe réellement au Tibet et révélerait également comment les Chinois Han pensent et traitent la question ethnique, qui a une forte influence à l’intérieur et à l’extérieur de la Chine.
Une fausse autonomie
Le PCC considère que les mouvements séparatistes tibétains trahissent la République populaire de Chine. On doit se souvenir que, malgré une adhésion à la pensée de Lénine lors de sa fondation il y a quatre-vingts ans, c’est le PCC qui a trahi les positions de Lénine sur le droit à l’autodétermination des minorités.
À la fin de 1931, le soviet des travailleurs et des paysans chinois a tenu son congrès national populaire qui a adopté les grandes lignes de la Constitution soviétique. Le texte réaffirmait le droit à l’autodétermination des minorités ainsi que leur droit à la sécession. Cette position s’est progressivement émoussée après que le parti soit devenu une redoutable force après la guerre de résistance à l’impérialisme japonais. Elle a été remplacée par une position défendant l’autonomie régionale des ethnies en même temps que la formule d’un État fédéral pour la future Chine était abandonnée au profit d’un État unitaire. À partir de là, quiconque évoquait l’autodétermination et le fédéralisme était condamné comme traître.
L’hostilité au droit à l’autodétermination des minorités ethniques est partagée par différents courants, parfois opposés, existant parmi les Chinois Han. Xu Mingxu, un opposant libéral à Pékin, explique dans son livre pourquoi il est opposé à l’autodétermination : « Il y a dans le monde trois mille ethnicités, mais il n’y a que cent soixante-dix pays. Si chacune d’entre elles cherchait l’autodétermination et construisait un pays indépendant, cela conduirait la plupart de ces pays à sombrer dans des guerres interethniques[4]. »
Il n’est pas nécessaire d’entrer dans les détails pour réfuter ces arguments. Il suffit de rappeler comment Lénine réfutait ce même vieil argument en soulignant qu’instituer le droit au divorce ne voulait pas dire l’encourager. Le problème est que même l’autonomie promise par le gouvernement chinois est une imposture. Le gouvernement chinois répond à ceux qui le critiquent en soulignant que l’autonomie tibétaine permet aux Tibétains de gérer leurs propres affaires et en en donnant pour preuve que la majorité du parti et des cadres du gouvernement sont désormais tibétains. Cet argument ne supporte pas un examen sérieux. Il s’agit seulement de mesures de décentralisation de services de l’État, du même ordre que celles dont avait bénéficié le gouvernement colonial de Hongkong dans la dernière partie de la période de transition. Le secrétaire du parti au Tibet et tous les postes disposant d’un pouvoir véritable sont aux mains de Chinois Han et la langue officielle prédominante est le chinois. Et si ce sont des policiers tibétains qui tirent sur les manifestants tibétains, ils sont considérés comme des instruments de la répression aux mains du gouvernement chinois Han.
Après son arrivée au pouvoir, la politique d’autonomie du PCC mise en œuvre par le PCC a été claire : il ne s’agissait que d’une autonomie administrative et pas du tout d’une autonomie politique. Même après la Révolution culturelle – période pendant laquelle l’ultra-gauchisme de sa politique ethnique (reconnu par le PCC lui-même) a causé des dommages sérieux aux minorités –, la loi de 1984 sur l’autonomie régionale nationale n’accorde aucune autonomie substantielle aux minorités. Alors que l’article 4 de cette loi prohibe le séparatisme ethnique, les clauses sur l’autonomie restreignent les droits des minorités à l’usage de leur langue et de leurs traditions. Le troisième chapitre définit l’autonomie d’une telle façon qu’il n’y a pas d’autonomie réelle. Et si l’article 19 stipule que le Congrès populaire des régions ethniques autonomes a le droit de légiférer en fonction des besoins spécifiques, il est immédiatement suivi d’une clause indiquant que la loi doit recevoir l’approbation du comité permanent du Congrès national du peuple avant de pouvoir être promulguée et appliquée, ce qui en pratique annule toute autonomie des régions. L’article 20 est fondamentalement identique : « Si les résolutions, les décisions, les décrets et les directives émanant d’une institution supérieure de l’État ne conviennent pas à la situation particulière d’une région autonome, les institutions de la région autonome peuvent [les] appliquer avec certains aménagements ou encore s’y opposer, sous réserve de l’accord des organes supérieurs de l’État. » Si chaque décision doit recevoir l’approbation de Pékin, il n’y a à l’évidence aucune autonomie. Par conséquent, il n’est pas exagéré de dire que la région autonome du Tibet n’est qu’une marionnette entre les mains de Pékin.
Dans leur livre, Report on Chinese National Problems, deux universitaires du continent, Xu Xiaoping et Jinxin, reconnaissent que la loi de 1984 sur l’autonomie régionale ne concerne que les seules questions suivantes, « le mariage, les successions, les élections, le planning familial, l’éducation obligatoire » et qu’elle est « totalement silencieuse sur le droit des régions à contrôler leurs finances, leur fiscalité, leur commerce extérieur ou l’utilisation de leurs ressources naturelles ». Les deux auteurs reconnaissent que les droits à l’autonomie des régions mentionnées dans la loi sont incontestablement les mêmes que ceux dont jouissent d’autres régions autonomes non-ethniques. Dans les régions côtières, l’autonomie économique est ainsi plus importante que celle dont jouissent les régions autonomes, particulièrement en ce qui concerne d’exploitation des ressources. À l’inverse, les régions ethniques autonomes ont peu de pouvoir de contrôle sur leurs propres ressources[5].
Et en ce qui concerne la langue, les élèves tibétains ne peuvent employer leur langue maternelle comme langue d’enseignement qu’au cours de leur scolarité primaire. À partir du secondaire, le chinois est utilisé beaucoup plus régulièrement, même si les étudiants ont de meilleurs résultats en employant leur langue maternelle[6]. Tout en admettant qu’il ne parle pas tibétain, Xu Mingxu explique que la langue tibétaine ne permet pas d’exprimer les concepts scientifiques modernes et soutient la politique gouvernementale en matière linguistique[7].
Le gouvernement chinois a aboli toute liberté religieuse au Tibet durant la Révolution culturelle et presque tous les monastères ont été saccagés. Une liberté religieuse limitée a été restaurée dans les années 1980, le gouvernement essayant de trouver une ligne de conciliation avec le dalaï-lama. Après la visite du frère du dalaï-lama au Tibet en 1980, la ligne dure a de nouveau été appliquée. Le gouvernement a été dépité par l’accueil fervent réservé aux émissaires du dalaï-lama, alors qu’il escomptait que les Tibétains, reconnaissants au PCC de les avoir libérés du servage et de la théocratie, allaient accueillir la délégation avec hostilité[8]. L’émeute de 1987 a conduit le gouvernement à restreindre encore plus la liberté religieuse pour aboutir, en 1996, à l’interdiction complète du culte du dalaï-lama.
Certains intellectuels chinois Han, qu’ils soient partisans du régime ou non, expliquent aussi que les Tibétains sont privilégiés par la politique économique, culturelle, éducative et familiale du gouvernement, prenant pour exemple que la politique d’« un enfant par famille » ne s’appliquait pas aux minorités[9]. Cet argument n’est pas convaincant parce que tous ces « privilèges » ne peuvent en aucun cas constituer des substituts aux droits politiques qui sont déniés en permanence aux Tibétains. Tant que les minorités ne jouiront pas du pouvoir politique pour décider de leur propre destin, elles seront dans la peur constante d’être brimées.
Suprême ironie, les résidents de Hongkong, qui ne sont pas ethniquement différents des Chinois Han, jouissent d’une autonomie relativement plus importante que les minorités non chinoises. Hongkong bénéficie d’une autonomie politique : nous établissons nos propres lois sans attendre le consentement du gouvernement central et nous avons même notre propre monnaie. Même si l’autonomie de Hongkong s’érode, elle est encore largement intacte. C’est aussi cette situation qui a conduit le dalaï-lama à abandonner ses positions antérieures en faveur de l’indépendance pour proposer un pays avec deux systèmes comme solution à la question tibétaine. Cette proposition, modérée et cohérente, a été rejetée catégoriquement par le gouvernement qui refuse toute négociation sur cette proposition et qui enferme ainsi les Tibétains dans une impasse.
Zheng Yongnian, le directeur de l’East Asian Institut de l’université nationale de Singapore, explique que l’autodétermination n’est pas une bonne option car cela revient au même que la recherche de l’indépendance. Les Tibétains et les Ouïghours[10] devraient donc se contenter de moins que d’une véritable autonomie ? Pour Zheng, l’autonomie complète « n’est guère différente de l’autodétermination ». Selon lui, écrit-il encore, « l’autonomie ethnique est trop idéaliste » et une « politique des minorités trop idéaliste est non seulement nuisible à l’intégration nationale et ethnique, mais elle pave également la voie au séparatisme[11] ». Bien que ce qu’il entende par « complète autonomie » ne soit pas clair, ce qu’il dit n’est pas ambigu : il ne s’agit de rien d’autre que d’une défense de la très incomplète politique d’autonomie du gouvernement chinois.
Certains démocrates, tout en manifestant de la sympathie pour les Tibétains, n’admettent pas que la politique tibétaine du gouvernement chinois soit une forme d’oppression nationale. Ils considèrent qu’il ne s’agit de rien d’autre que d’une manifestation du despotisme du PCC qui opprime de la même façon tous les citoyens, qu’ils soient Tibétains ou Chinois Han. De ce fait, ils ne proposent donc ni autodétermination ni autonomie, mais la démocratie stricto sensu. Wang Lixiong, écrivain très connu dont l’ouvrage Sky Burial exprime une sympathie ouverte pour les Tibétains, écrit ainsi : « L’oppression du PCC frappe le peuple et non les nationalités. […] L’oppression à laquelle les minorités font face ne doit pas être définie comme une oppression nationale, mais appréhendée plutôt comme une oppression subie par tout le peuple et menée par un régime despotique[12]. »
La réponse tibétaine à ce discours est la suivante : ce que subissent les Chinois Han n’a rien à voir avec ce que subissent les Tibétains, mais ce que subissent les Tibétains est lié à ce que subissent les Chinois Han. Quand le gouvernement chinois refuse aux Tibétains leur liberté linguistique et religieuse, qu’il trahit sa promesse d’autonomie pour les minorités nationales, il est évident qu’il s’agit d’une oppression nationale dont les Chinois Han ne font pas l’expérience. Et aucune démocratie représentative ne peut réparer les injustices d’un peuple qui ne compte pas plus de six millions d’individus[13].
Nationalisme tibétain : l’ancien et le nouveau
L’actuel mouvement tibétain pour l’indépendance est très différent de celui d’il y a soixante ans. Même si c’est toujours le dalaï-lama qui en assure la direction directe ou spirituelle, l’ancien mouvement indépendantiste avait une base sociale beaucoup plus étroite, composée principalement de nobles et de moines. Et les serfs qui suivaient leurs maîtres agissaient plus selon une allégeance féodale que d’une conscience nationaliste. L’autre élément qui doit être pris en compte est le prétendu pouvoir que le dalaï-lama et ses moines auraient eu sur les « vies ultérieures » de leurs sujets. À l’inverse, le nationalisme tibétain d’aujourd’hui est à la fois une réponse interclassiste à plus de soixante années d’oppression nationale par le PCC et un projet de mise en route d’un projet de modernisation.
Ce qui est notable dans la politique tibétaine du PCC, c’est qu’il saute d’un extrême à l’autre, ce qu’il fait d’ailleurs aussi pour le reste de la Chine. Quand l’accord en dix-sept points a été signé en 1951 par le gouvernement chinois et les représentants du dalaï-lama, les autorités chinoises avaient accepté de ne pas imposer de réforme politique et agraire au Tibet, même si l’accord enjoignait au dalaï-lama de promouvoir lui-même une telle réforme. Voulant s’attacher de cette manière la classe dirigeante tibétaine, le PCC est allée jusqu’à exclure les membres du parti qui parlaient de révolution démocratique, d’athéisme et, bien entendu, de socialisme. Un maoïste, Yanfeng, écrit ainsi dans une brochure datée de 2010 que : « Selon les instructions données par le comité central du parti et du président Mao, non seulement, selon l’accord [de 1951], il n’y aurait pas de réforme du système social tibétain, mais l’armée et les cadres qui pénétreront au Tibet devront s’abstenir de mener toute éducation de classe, au point que des films comme White Haired Lady ont été interdits au Tibet[14]. »
Quand il soutient le servage en disant qu’à cette époque le peuple tibétain était heureux et que la société était harmonieuse, le dalaï-lama n’est pas convaincant[15]. En effet, être libéré de l’exploitation en général et des servitudes féodales en particulier est plutôt toujours une bonne chose. Le problème avec la « réforme démocratique » mise en œuvre par le PCC après la répression de la rébellion de 1959, n’est pas qu’elle a renversé le servage en tant que tel, mais la façon dont elle l’a fait. Elle a été imposée en l’imposant de l’extérieur et par le haut, alors même que le parti flirtait encore peu de temps auparavant avec les classes supérieures tibétaines et que son tournant brutal est apparu peu convaincant et malhonnête aux yeux de nombreux serfs. Et si les serfs ont bénéficié d’une distribution de terres et de l’abolition des servitudes féodales, il leur était difficile de se ranger avec enthousiasme du côté des cadres du parti pour dénoncer et attaquer leurs anciens seigneurs. Selon Tom Grunfeld, le peuple tibétain, qui n’avait jamais fait l’expérience ni ne connaissait d’autre mode de vie que le sien, craignait les Chinois Han et restait perplexe sur ces « libérateurs » qui avaient, peu de temps auparavant, conclu une alliance avec leurs maîtres[16]. La « réforme démocratique » aurait été mieux accueillie si elle n’avait pas été lancée par des forces extérieures, mais mise en œuvre par le peuple tibétain lui-même.
En 1939, Phuntso Wangye avait fondé le Groupe communiste tibétain qui a rejoint le PCC dix ans plus tard. Pendant les négociations avec le dalaï-lama, il avait tenté de servir de médiateur entre les deux parties. Critique vis-à-vis du secrétaire général du parti au Tibet, Fan Ming, pour son manque de respect à l’égard des Tibétains, Phuntso Wangye a été « purgé » en 1957 et emprisonné pendant dix-huit ans en compagnie de nombre de ses camarades tibétains[17]. Cette tragédie est le produit du chauvinisme grand Han du PCC dont les dirigeants n’ont jamais fait confiance aux communistes tibétains et n’ont jamais pris en compte l’option de soutenir les communistes tibétains pour qu’ils s’enracinent progressivement dans la société tibétaine afin de mener à bien la « révolution démocratique » de l’intérieur du pays. Le PCC a simplement décidé d’exporter la révolution au Tibet, sans considération aucune pour les droits nationaux et religieux des Tibétains.
L’erreur du PCC provient, en partie, de sa théorie erronée sur la question nationale de l’époque. On peut ainsi lire dans un document interne du comité central datant de 1958 l’explication suivante : « Dans une société de classe, la question nationale est par essence une question de classe, et on ne peut donc pas solutionner complètement la question nationale sans affronter d’abord la nature de classe[18]. » Si on suit ce raisonnement, l’identité nationale (de même que la religion) n’est rien d’autre qu’un instrument de la classe exploiteuse pour tromper le peuple, donc si on détruit cette classe en réalisant le communisme, alors la question nationale sera automatiquement résolue. Ou bien, dans une version légèrement différente, le parti expliquera que l’identité nationale tibétaine et ses liens à la religion ne sont que le reflet du faible niveau de développement économique du Tibet et que la modernisation va les guérir de ces maladies liées à l’arriération. Les deux versions sont complémentaires car le parti considère que le projet communiste et la modernisation sont pratiquement une même chose et que les deux objectifs seront atteints sous la direction du parti. Ceci a conduit l’État-parti à imposer la lutte de classe au Tibet pendant la « réforme démocratique » de 1960. Quand Mao Zedong prononce son fameux discours rappelant à ses camarades qu’il ne faut pas oublier les « luttes de classes », il donne un élan supplémentaire aux cadres du parti au Tibet pour poursuivre une politique plus ultragauche et plus répressive. Quant aux serfs, même s’ils ont bénéficié de la réforme agraire, ils assistent avec consternation et amertume à l’expropriation des monastères dont dépend leur culture tout entière.
Panchen Lama a loyalement soutenu la politique du PCC au Tibet, y compris après la rébellion de 1959. À son retour au Tibet, il découvre qu’en son absence, la moitié des moines de son propre monastère ont été chassés et que les prêtres innocents sont brutalement réprimés : il décide alors de rédiger un rapport interne à la direction du parti[19]. Après que le PCC ait lancé en 1962 une violente attaque publique contre son « rapport de 70 000 caractères », il est condamné en 1964 – il était déjà en résidence surveillée – à douze ans de prison.
Lorsqu’il est devenu en 1965 le premier président de la toute nouvelle région autonome du Tibet, Ngapoi Ngawang Jigme lui-même n’a jamais eu de réels pouvoirs. Il avait pourtant été le commandant en chef des forces armées du Tibet à Chamdo en 1950, signataire à ce titre de l’accord en dix-sept points et l’une des figures les plus prestigieuses de l’élite tibétaine qui coopérait avec le PCC. Cette époque est également celle de la purge des cadres dirigeants du parti ayant défendu une politique plus modérée au Tibet. Li Weihan, qui avait la responsabilité du secteur du « front uni » et de la question des minorités au PCC, avait averti à plusieurs reprises que « quelle que soit l’importance de l’aide que les Chinois Han peuvent apporter aux Tibétains, elle ne peut leur être imposée[20]. » Cette prise de position conduit à son élimination en 1964 pour avoir commis la grave erreur de ne se soucier que des droits nationaux en négligeant la question de classe.
Les anciens serfs comprirent aussi qu’ils avaient été trompés lorsqu’en 1964 le gouvernement collectivisa leurs terres en communes, ce qui provoqua rapidement une chute de la production de céréales. Beaucoup d’autres excès brutaux se sont produits pendant la Révolution culturelle lorsque les gyenlok (gardes rouges tibétains), encouragés par le groupe de la Révolution culturelle à Pékin, commencèrent à mettre en œuvre leur programme d’éradication totale de la religion et de la culture de toutes les classes exploiteuses. Il est quelque peu ironique d’observer que le culte du Président Mao que les gyenlok tentaient d’imposer avait beaucoup en commun avec celui de Bouddha et du dalaï-lama que la révolution culturelle maoïste voulait éradiquer. Yan Feng, dont nous avons parlé précédemment, assure encore aujourd’hui que dans les années 1960, les serfs étaient heureux et qu’ils auraient chanté : « Le soleil du dalaï ne brille que sur les nobles, tandis que le soleil du Président Mao brille sur nous. Voilà le temps venu pour le soleil des nobles de passer de l’autre côté de la colline et pour notre soleil de se lever[21]. »
La collectivisation des terres et le saccage des monastères conduisirent finalement les Tibétains ordinaires à entrer en rébellion en 1969. Après que l’ordre a été rétabli par l’armée, la collectivisation forcée fut encore plus rapide.
En dix ans, les zigzags du PCC lui valurent l’hostilité de toutes les classes et couches sociales du Tibet. Ceux des Tibétains qui se rebellèrent les premiers contre le gouvernement chinois, comme le dalaï-lama, ceux qui avaient soutenu pleinement le PCC, du Panchen Lama au communiste Phuntso Wangye, sans oublier les paysans et les bergers, tous sans exception ont été expropriés et persécutés. L’expérience commune de la persécution par le gouvernement chinois Han les a tous rassemblés sous le drapeau du nationalisme tibétain moderne. Et si avec l’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping en 1979, le parti a commencé à reconnaître ses erreurs ultragauches en général et au Tibet en particulier, si une résolution sur l’histoire du parti qui critiquait Mao a été adoptée, cela n’a cependant pas suffi pour regagner le cœur des Tibétains.
Si Mao était responsable des erreurs de la Révolution culturelle, n’était-ce pas la preuve qu’il n’était pas infaillible ? Et s’il était un faux dieu, n’était-il pas logique pour les Tibétains d’en tirer la conclusion qu’ils devaient revenir à leur propre religion et au culte de Bouddha, leur vrai dieu, et à celui de l’incarnation d’Avalokite Varan, le dalaï-lama ? Au moins ces dieux n’avaient-ils pas infligé tant de blessures à leur vie spirituelle et séculière en si peu de temps, ainsi que l’avait fait le PCC. Il faut néanmoins noter que tous les Tibétains ne partagent pas la même expérience ni exactement les mêmes intérêts. Les nations ne sont pas des entités homogènes et, après tout, il y avait des classes au Tibet avant que le PCC ne prenne le pouvoir.
Si les serfs avaient de sérieux griefs contre leurs maîtres, les relations sociales entre eux étaient vieilles de milliers d’années. Elles s’étaient ainsi maintenues jusqu’à l’arrivée du PCC dans un équilibre relatif contre lequel les serfs n’avaient pas encore eu l’idée de se rebeller ; et il n’y a aucune indication qui laisse penser qu’une révolution couvait au Tibet dans les années 1950. La vieille société féodale s’est écroulée quand le PCC, venu de l’extérieur, lui a brisé les reins pour reconstruire une structure sociale sans aucun égard pour les classes inférieures du Tibet qu’il prétendait représenter. L’expérience commune de la répression par les Chinois Han a beaucoup plus pesé que les antagonismes de classes parmi les Tibétains, ce qui les a conduits à une conclusion commune : « Dehors les envahisseurs chinois Han ! Vive le Tibet indépendant ! »
Dans les années 1980, la politique du PCC au Tibet a consisté à faire marche arrière pour revenir à son point de départ, alors même que le contexte et la composition de classe du pays avaient totalement changé. Il a mis à nouveau à contribution la vieille aristocratie et les moines sans leur donner, évidemment, le moindre pouvoir. Si dans le meilleur des cas cela pouvait les empêcher de se rebeller, le PCC ne pouvait pas espérer gagner leur soutien et encore moins les convaincre de ne pas adorer le dalaï-lama en privé. D’un autre côté, bien que la pauvreté des masses laborieuses tibétaines ait décliné, le fossé entre les pauvres et les riches s’élargissait rapidement. En outre, à Lhassa, le ressentiment des Tibétains se nourrissait des bénéfices tirés par les Chinois Han et les Hui de la « réforme » et de l’« ouverture ». Quant aux vieux cadres tibétains de base qui avaient été les soutiens actifs du PCC, leur départ en retraite était synonyme de paupérisation : « Les gens disent que le PCC a changé. Dans les années 1950, il nous a choisis. Dans les années 1980, il a choisi à nouveau l’aristocratie. On dit, parmi le peuple, que toutes les politiques qui sont (favorables) à la classe supérieure, y compris celles de leurs pierres et de leurs chiens, ont été complètement réalisées. Mais qu’en est-il des gens ordinaires ? Et des retraités et des cadres ? Ils n’ont ni argent, ni maison pour vivre[22]. »
Il est difficile de se faire une idée précise de l’enracinement du nationalisme tibétain dans les différentes classes et de ses liens avec le bouddhisme et le dalaï-lama. Il y a toutefois suffisamment d’éléments pour comprendre que le PCC a perdu toute base sociale au Tibet et qu’il n’y a plus que la bureaucratie autochtone pour soutenir son pouvoir. Cette bureaucratie a été formée pendant la période où le PCC « exportait la révolution » au Tibet. Dans les années 1960, parmi ceux des Tibétains qui ont soutenu la réforme agraire, s’il y avait quelques gangsters, il y avait également ceux qui voulaient la libération des serfs. Encore qu’avec les purges successives qu’a connues le régime, c’est probablement cette catégorie de cadres qui a disparu au bénéfice des « béni-oui-oui ». Ce sont désormais ces derniers qui forment la colonne vertébrale d’une nouvelle bureaucratie autochtone qui, bien qu’elle n’ait pas de pouvoir réel, en exerce cependant une forme marginale sur ses marges. Consciente de son rôle particulier dans l’assimilation forcée du Tibet par le régime de Pékin, elle l’utilise comme levier pour défendre ses propres intérêts, notamment en faisant du chantage sur le gouvernement central pour obtenir plus de subventions. Phuntso Wangye a remarqué que la bureaucratie autochtone « se nourrissait de l’antiséparatisme, défendait sa position sociale grâce à l’antiséparatisme et s’enrichissait par l’antiséparatisme ». Elle n’est pas loin de penser qu’il n’est pas dans son intérêt d’éliminer totalement le séparatisme tibétain car si l’éradication du séparatisme devait arriver, l’équilibre entre les deux parties serait rompu. Il est ainsi couramment admis que cette bureaucratie autochtone encourage les petits incidents pour apporter la preuve au gouvernement central de son utilité dans leur répression[23].
Étant donné son statut de bureaucratie de seconde classe, il n’est pas difficile d’imaginer que certaines fractions de la bureaucratie tibétaine autochtone aient également quelques griefs à l’égard de leurs maîtres chinois Han. Ceux-ci doivent accepter le fait que de nombreux cadres tibétains vivent une double vie : ils attaquent le dalaï-lama quand ils sont en fonction, le vénèrent secrètement en privé et envoient leurs enfants ou leurs familles en Inde pour lui rendre hommage. Très populaire parmi les cadres tibétains, la plaisanterie placée en exergue de cet article reflète leur rancœur.
Notes
[1] . NdT : Le 10 mars 2008, des émeutes éclatent à Lhassa, la capitale de la région autonome du Tibet, à la suite de la répression de manifestations pacifiques de moines bouddhistes qui commémoraient l’anniversaire d’un soulèvement contre la tutelle de Pékin de mars 1959. Elles se soldent par la mort d’au moins quatre-vingts personnes.
[2] . Su Jiahong, Liuwangzhong de minzhu – Yindu liuwang zangren de zhengzhi yu shehui, 1959-2004 (La démocratie en exil : la politique et la société des Tibétains exilés en Inde), Taipei, Buffalo Book, 2005, appendice 3.
[3] . NdT: Panchen-Lama: deuxième plus haut chef spirituel après le dalaï-lama. Gedhun Choekyi Nyima: onzième Panchel-Lama depuis sa sélection par le dalaï-lama en 1995. Il est détenu par les autorités chinoises.
[4] . Xu Mingxu, Yinmou yu qiancheng – Xizang saoluan de laolongqumai (Intrigues et dévotion – l’origine et le développement des émeutes tibétaines), Hongkong, Mirror Books, 1999, p. 373.
[5] . Xu Xiaoping and Jin Xin, Zhongguo minzu wenti baogao (Rapport surs les questions nationales chinoises), Beijing, China Social Science Press, 2008, p. 99.
[6] . Melvyn C. Goldstein, op. cit., p. 162.
[7] . Xu Mingxu, ibid.
[8] . Goldstein, op. cit., p. 104-106.
[9] . NdT: Depuis 1979, une loi imposait aux couples de n’avoir qu’un seul enfant. Depuis 2002, le dispositif a été assoupli et les couples versant une somme d’au moins 5000 yuans (le salaire moyen urbain est de 1200 yuans) peuvent avoir légalement un deuxième enfant. Pour les familles tibétaines le plafond est fixé à trois enfants.
[10] . NdT : Les Ouïghours sont un peuple turcophone et musulman sunnite de la région autonome ouïghoure du Xinjiang (ancien Turkestan-Oriental) en Chine et en Asie centrale.
[11] . Zheng Yongnian, « Zhongguo shaoshu minzu zhengce de wenti daodi zai nail ? » (Quel est le problème de la politique chinoise pour ses minorités ethniques ?), Zao Bao Daily, 21 juillet 2009. www.zaobao.com/special/forum/pages7/forum_zp090721.shtml
[12] . Wang Lixiong, Tianzang – Xizang de mingyun (L’enterrement du ciel : le destin du Tibet), Hongkong, Mirror Books, 6e éd., 2006, p. 241-242. Je ne suis pas certain que son opinion ait changé depuis qu’il a écrit ce livre.
[13] . Dans la seule région autonome du Tibet, la population tibétaine se monte à environ 3 millions.
[14] . Yan Feng, Gaige kaifang niandai de ziben yundong (Le mouvement du capital à l’âge de la réforme et de l’ouverture), Hongkong, China Cultural Communication Press, p. 69. The White Haired Lady (La dame aux cheveux blancs) est un opéra dont la première représentation a eu lieu en 1945. Décrivant la misère dont souffraient les paysans, il a été pendant très longtemps – avec le ballet et le film qui en ont été tirés – l’instrument favori du parti pour promouvoir l’éducation de classe.
[15] . Pierre-Antoine Donnet, Tibet mort ou vif, éd. chinoise, Taipei, Reading Times, 1994, p. 85. En français, Paris, Folio, 1993.
[16] . Tom Grunfeld, The Making of Modern Tibet, New York, East Gate Books, 1996, cité dans Wang Lixiong, op. cit., p. 170.
[17] . Melvyn C. Goldstein, Dawey Sherap and William R. Siebenschuh, A Tibetan Revolutionary – The Political Life and Times of Bapa Phuntso Wangye, Berkeley, University of California Press, 2004.
17 Xu Xiaoping and Jin Xin, op. cit., p. 76.
[18] . Ibid.
[19] . Warren W. Smith, Jr., Tibetan Nation – A History of Tibetan Nationalism and Sino-Tibetan Relations, Boulder, Westview Press, 1996, p. 521-525.
[20] . Wang Lixiong, op. cit., p. 169.
[21] . Yan Feng, op. cit., p. 73.
[22] . Wang Lixiong, op. cit., p. 503.
[23] . June Teufel Dreyer, « Economic Development in Tibet Under the People’s Republic of China » in Barry Sautman and June Teufel Dreyer (ed.), Contemporary Tibet – Politics, Development and Society in a Disputed Region, New York, M.E. Sharpe, 2006.