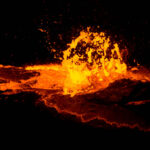Le conflit égalitaire : un impensé de la science politique en Amérique Latine
De nombreux auteurs et perspectives théoriques se sont penchés sur la relation entre le savoir et le pouvoir[2]. Cet article prétend aborder cette problématique à propos de la science politique latino-américaine. De ce point de vue, s’il existe une littérature récente et encore sommaire sur son développement et son histoire, la réflexion épistémologique sur la relation complexe que la science politique entretient avec les objets qu’elle cherche à comprendre est beaucoup plus rare. La manière dont elle conçoit et étudie le politique détermine pourtant une hiérarchisation "épistémologique" spécifique entre ses objets d’étude.
Nous voudrions ici faire part de cette "inquiétude épistémologique" concernant le conflit égalitaire et la place qui lui est assignée dans la science politique dominante en Amérique Latine. Par conflit égalitaire, on entendra l’ensemble des luttes contre la domination d’une identité, d’un secteur ou d’une catégorie sur une autre (que ce soit de classe, de genre, sexuel ou ethnique). L’Amérique latine est un continent riche en mouvements sociaux et acteurs politiques qui réclament l’accès à une citoyenneté pleine et entière et par là même pointent du doigt les inégalités criantes qui traversent historiquement leur société. Or, comme le résume bien Cours-Salies : "le sens des luttes fait partie de leurs enjeux, y compris dans l’arène du travail scientifique" (2003 : 7). Notre hypothèse est que l’ "état conceptuel" de la science politique latino-américaine dominante rend difficile l’analyse des transformations sociales et politiques que l’on observe dans plusieurs pays du continent – et dont le conflit est un élément essentiel. Ceci renverrait au fait que le champ de cette discipline est marqué par le néopositivisme anglo-saxon, dont les stratégies d’analyse conduisent à privilégier les dimensions institutionnelles et le jeu politique polyarchique excluant ainsi certains phénomènes et acteurs qui nous semblent pourtant incontournables pour comprendre l’actualité latino-américaine.
Depuis les années 1950, la constitution de la science politique comme discipline en Amérique latine et l’institutionnalisation de son champ d’étude l’a conduite à se différencier de la sociologie politique. Ce processus a eu autant de bénéfices que de coûts. Les bénéfices consistent en la possibilité de penser avec une intensité spécifique la question de la démocratie électorale et l’importance des phénomènes et acteurs situés sur le terrain désigné comme relevant du "système politique" : on se réfère principalement aux partis politiques et à l’institutionnalisation de la démocratie. Pour autant, le préjudice consiste symétriquement à s’interdire de prendre en compte d’autres phénomènes / acteurs dans l’appréhension de la réalité politique et/ou à les réduire à des facteurs de désordre.
Suite à la sortie des régimes autoritaires, la valorisation par la science politique des institutions peut être perçue comme une "avancée" face à des approches qui leur attribuaient une moindre importance. Pour le dire différemment, si le marxisme a pu au moment de sa splendeur donner par certains aspects une vision biaisée de la réalité politique, le manque d’attention pour ce qui ne se situe pas dans l’espace de la politique conventionnelle engage, à notre sens, la science politique dans une nouvelle ornière. Ces dernières années, les conflits égalitaires ont certes gagné en visibilité dans l’opinion publique en général. Notre réflexion vise cependant à montrer que les caractéristiques idéologiques de la science politique conventionnelle conditionnent la manière avec laquelle elle aborde ces objets. La réserve de la plupart des politologues de la région à leur endroit explique la lacune dont nous voudrions rendre compte.
I. La science politique latino-américaine : jeunesse et "dépendance"
Pour commencer, quelques données historiques élémentaires permettront d’aborder la trajectoire régionale de la discipline. Pour cela, nous nous baserons en particulier sur un numéro paru en 2005 de la Revista de Ciencia Politica chilienne consacré à l’état de la science politique en Amérique latine et coordonné par David Altman. Suite de monographies nationales, ce numéro de revue donne un bon aperçu des processus d’institutionnalisation de la discipline au niveau régional.
Les premiers cours et écoles de science politique apparaissent dans la deuxième moitié des années 1960. Au Mexique, la UNAM crée une école d’études politiques et sociales en 1955. Dans l’article « Ciencia Política en América Latina » de son dictionnaire, Dieter Nohlen (2006) cite les cas de la Colombie (1965), de l’Uruguay (1966), du Costa Rica (1968), du Chili (1969) et du Guatemala (1969). En Amérique latine comme ailleurs, l’institutionnalisation des disciplines académiques est conditionnée par le contexte historique. Comme le signale Altman (2005: 4) : « les débuts de la science politique ont été stoppés net par les gouvernements autoritaires et c’est seulement dans l’effervescence de la redémocratisation que la discipline acquiert un nouvel élan[3] ». Il faut ainsi attendre les années 80 pour que l’institutionnalisation de la discipline reprenne et se complète. A titre d’illustration, la création du cursus de science politique de la UBA (Universidad de Buenos Aires, Argentine) date de 1985. En 1988, l’Institut de science politique est créé au sein de la Université de la République (Uruguay), en Équateur, au même moment, la discipline est encore en cours d’institutionnalisation.
Les trajectoires historiques nationales ont logiquement marqué l’évolution de ce champ de connaissance et son degré de développement. L’Amérique latine sur ce point comme sur d’autres présente une forte hétérogénéité. Selon David Altman, il faut distinguer trois grands groupes de pays en fonction du degré d’institutionnalisation de la discipline : un premier réunissant les "trois grands" (Argentine, Brésil, et Mexique), un intermédiaire (Chili, Colombie, Costa Rica, Uruguay et Venezuela), et enfin le moins institutionnalisé (Équateur, Bolivie, Pérou, Guatemala, Cuba, Honduras, et Panama).
Les années 1960 ont été marquées par l’hégémonie marxiste que d’aucuns identifient à une radicalisation des "études politiques". Selon Dieter Nohlen (2007, 21), « prévalaient [alors] des courants d’analyse sociologistes et structuralistes, le marxisme et le néo-marxisme prédominant chez les intellectuels d’Amérique latine, d’un coté, et le "cepalisme" prédominant chez les économistes de la région, de l’autre. » Avec la transition à la démocratie s’ouvre une nouvelle ère pour la science politique latino-américaine : le marxisme perd du terrain et la discipline s’attache à l’étude de l’ingénierie démocratique. Les politologues sont souvent appelés à participer à sa mise en place concrète (Guilhot, 1995). Dans l’article consacré à la science politique bolivienne, Marcelo Varnoux (2005: 93-94) affirme : « de nombreux éléments des théories démocratiques développées par Robert Dahl, Giovanni Sartori, Dieter Nohlen y Arendt Lipjhart ont été appliqués pour organiser le système politique de partis, sur la base d’une ingénierie constitutionnelle dont le centre est le pouvoir législatif. »
Si la vague de régimes autoritaires a supposé un arrêt dans le développement disciplinaire, les politologues accordent désormais une valeur incommensurable à l’État de droit, aux droits garantis par le libéralisme et à la "démocratie formelle", qu’il s’agit de préserver par-dessus tout. Parallèlement, une interprétation courante des régimes militaires en fait le résultat de la polarisation et du conflit socio-politique – c’est ce qu’on appelle en Uruguay la théorie des deux démons. La sacralisation du consensus semble ainsi être la trace laissée par l’expérience autoritaire. La critique de la gauche radicalisée des années 1960 devient une forme d’autocritique de l’académie sur elle-même. La reconstruction dominante de l’histoire de la discipline suppose en effet que la production scientifique des intellectuels latino-américains a porté préjudice à l’ "objectivité scientifique". Concernant l’Équateur, Mejía Acosta, Freidenberg et Pachano (2005 : 151) estiment que la "réflexion sur la démocratie" des années 1990 souffrait encore du "travers idéologique d’une bonne partie des universitaires". Il s’agit selon eux d’ "un obstacle (…) dans la mesure où il a conduit au rejet de perspectives amplement acceptées dans la science politique contemporaine et qui se fondent sur des processus soutenus de construction conceptuelle et théorique".
La conception "transitologique" du passage de l’autoritarisme à la démocratie ainsi que du fonctionnement de cette dernière rend également compte de cette perspective normalisante qui privilégie la stabilité et marginalise le conflit. Ainsi, pour Przeworski, la persistance des mouvements sociaux après la phase de libéralisation risque de déstabiliser les élites civiles et militaires (Przeworski, 1991). Dans le même esprit, O’Donnell et Schmitter considèrent que « si la mobilisation des opposants au régime paraît aller « trop loin », le régime autoritaire peut de nouveau se sentir indispensable » (1986 : 49). Si la politique institutionnelle doit conduire à la pacification de la société, assurer la stabilité du régime démocratique implique dès lors de limiter le rôle des mouvements sociaux. Dans le cône sud, cela renvoie au retour à la démocratie ; dans la région andine et en Amérique centrale, le problème est de construire un État de droit. Dans les deux cas, le conflit et la polarisation sociale sont à éviter.
Le numéro de la revue coordonné par Altman rend compte de ce « culte » de la stabilité politique. Certaines contributions célèbrent l’hégémonie épistémologique nord-américaine sur la science politique régionale. Dans certains cas, le néopositivisme semble fonctionner comme modèle de scientificité indiscutable. Ainsi, pour Ana María Bejarano y María Emma Wills (2005: 112-113) "la science politique (colombienne), ces dernières décennies, est passée d’une défense de causes politiques et de paradigmes idéologiques, à comprendre et expliquer des processus, afin, à partir de cette connaissance historique, de suggérer des critères et des stratégies pour l’action politique". Ce passage à la neutralité signifie un changement de cap radical du point de vue de l’auteur. Pour elle,
"Ce n’est pas une coïncidence si le premier département de science politique est apparu à l’université des Andes, une université jeune, privée, séculière, avec une orientation clairement "modernisatrice" (…). La nature privée de l’université a permis au département naissant de se distancier du militantisme radical jusqu’alors si répandu sur les campus universitaires, spécialement dans les facultés de sociologie où on pratiquait "la sociologie engagée" (…). Dans la recherche comme dans l’enseignement, le département de los Andes a incliné depuis le début vers le modèle nord-américain : beaucoup de ses professeurs venaient à l’origine de diverses institutions nord-américaines ; certains des professeurs colombiens avaient suivi leur formation aux États-Unis." [c’est nous qui soulignons)
On voit bien comment cette narration omet le lien entre la "dépendance épistémologique" – reconnue par l’auteur – et l’hégémonie politique du voisin du nord sur l’Amérique latine, et, plus spécifiquement sur la Colombie. Cette évolution n’est pas seulement le fait de la science politique colombienne. Dieter Nohlen (2007, 24) n’hésite pas non plus à revendiquer cette dépendance : "En général, l’utilisation de théories et de techniques d’investigation plus modernes dans les pays latino-américains dépend beaucoup du contact que leur instituts respectifs et chercheurs ont eu avec les centres de recherches aux États-Unis et en Europe." Comme le signale l’article sur l’Argentine de la revue chilienne, « cette influence se manifeste par la croissante diffusion du néo-institutionnalisme d’inspiration rationaliste, des analyses basées sur les théories du public choice, des jeux, et des techniques statistiques. Dans bien des cas, les études qui utilisent ces instruments sont réalisées par des économistes ou des politologues qui collaborent avec des économistes. » (Leiras, Abal Medina (h.) et D’Alessandro, 2005: 81).
Cette dépendance vis-à-vis des « agences étatiques et académiques internationales » a empêché comme le signalent les mêmes auteurs de prêter attention aux « graves problèmes nationaux comme l’inégalité, le chômage, la pauvreté et l’insécurité » (Leiras, Abal Medina (h.) et D’Alessandro, 2005: 82).
II. L’impensé (et impensable) virage à gauche de l’Amérique latine et les limites idéologiques de la science politique conventionnelle
"Ni dictatures, ni utopies sociales". Cette double négation extraite du roman Sobre héroes y tumbas d’Ernesto Sabato vient conclure de façon lapidaire la harangue d’un patron à un ouvrier affamé venu lui demander du travail. Si le récit se situe à un autre moment historique, on retrouve dans les années 1990 cette même équivalence entre utopies égalitaires et régimes autoritaires et cet appel à les rejeter également.
Cependant, l’hégémonie néolibérale des années 90 contraste avec le paysage des années 2000 qui se révèle inattendu (et peut-être inexplicable) pour des perspectives informées par un dogme, aujourd’hui questionné. Vingt ans après les transitions, la situation sociale latino-américaine déçoit les espérances placées dans la démocratie. La montée en puissance des mouvements sociaux et l’arrivée au pouvoir de gouvernements de gauche peuvent être interprétés comme relevant de conflits égalitaires, si l’on entend par là la lutte contre la domination d’une identité, d’un secteur ou d’une catégorie sur une autre (que ce soit de classe, de genre, sexuel ou ethnique). Cette tension a aussi lieu dans le champ académique.
Notre acception du conflit égalitaire est suffisamment large pour contenir différentes causes et contextes de lutte. Du Venezuela, à l’Uruguay, en passant par l’Équateur, la gauche accèdent au pouvoir tandis que les mouvements sociaux (mouvements indigènes, mouvement des sans-terre etc) contestant la mondialisation néolibérale trouvent un terreau fertile en Amérique latine. Dans certains cas, les mouvements sociaux ont joué un rôle crucial tant dans la contestation des gouvernements antérieurs que dans la conduite actuelle du pays – de ce point de vue, le cas bolivien est paradigmatique. Le caractère hétérogène de ces processus est indiscutable. Pourtant leur unité consiste peut-être dans cette exigence démocratique et égalitaire.
Le lieu occupé par les mouvements sociaux se révèle incommode. Le marxisme-léninisme qui privilégiait le parti de masse les délégitimait déjà. Même si c’est pour d’autres raisons, la perspective libérale dominante aujourd’hui a le même effet. Analytiquement, le libéralisme en mettant l’accent sur la stabilité institutionnelle et le respect des "règles du jeu" disqualifie a priori les mouvements sociaux et empêche de les comprendre en tant que protagonistes fondamentaux de la politique contemporaine. Cela affecte ainsi l’analyse des dynamiques régionales. Conceptuellement, leur assimilation au désordre suppose une conception traditionnelle de la politique qui ne considère comme acteurs pertinents que les partis politiques et renvoie de plus, à une conception élitiste qui ne reconnaît aux gens du commun ni la capacité de participer ni celle de transformer leur réalité. Dans cette perspective, comme le signale Erik Neveu (2002, 3) : "une assimilation implicite du modèle démocratique à la seule procédure électorale fait traiter les mouvements sociaux comme un objet suspect."
Le retour de la gauche en tant que sujet ayant la prétention de changer la réalité inégalitaire est nécessairement conflictuel. La clameur égalitaire déborde les pâles partitions démocratiques propres au projet néolibéral ; il s’agit de la démocratie au sens aristotélicien, c’est-à-dire, le gouvernement des plus nombreux (qui sont toujours les plus pauvres) en faveur du plus grand nombre. Ces projets politiques prétendent contribuer à la construction d’une autre démocratie. En réalité, la conception libérale et pluraliste de la démocratie adoptée par une bonne partie des politologues latino-américains, dans laquelle la propriété privée s’érige comme un droit fondamental et "universel", explique qu’ils perçoivent ces processus comme "autoritaires". Le mexicain Roger Bartra s’inquiète ainsi : "Est-il possible que les processus bolivien, équatorien et vénézuélien soient sur la voie d’une condition autoritaire, similaire à celle de Fujimori, mais avec une marque gauchisante ? Si la culture politique populiste s’est profondément enracinée, la réponse pourrait être affirmative et nous devrions nous attendre à l’entrée de ces pays dans un cycle d’autoritarisme croissant[4]."
Le débat se noue finalement autour des sens possibles de la démocratie. En suivant Rancière (2006), « La démocratie n’est ni la forme du gouvernement représentatif ni le type de société fondé sur le libre marché capitaliste. » Pour le philosophe français, « il faut rendre à ce mot sa puissance de scandale. Il a d’abord été une insulte : la démocratie, pour ceux qui ne la supportent pas, est le gouvernement de la canaille, de la multitude, de ceux qui n’ont pas de titres à gouverner. » Les conflits égalitaires posent un défi à la démocratie, car ils exigent quelque chose de plus que ce qu’elle offre aujourd’hui. S’ils peuvent conduire à une remise en question de sa stabilité institutionnelle, il nous semble réducteur de les assimiler à un danger. On peut tout aussi bien considérer que leur expression est une condition de la démocratie. Olivier Fillieule fait le même constat, en le supposant cependant daté : « c’est encore au nom de présupposés idéologiques, en faveur des théories pluralistes (…), et du respect des règles institutionnelles que les mouvements sociaux continueront jusqu’au milieu des années 60 à s’analyser en termes de phénomènes irrationnels suscités par la frustration » (1997, 28). De ce point de vue, l’establishment des sciences politiques qui, consciemment ou inconsciemment, suit les critères normatifs importés de la science politique conventionnelle étasunienne, est fonctionnel à la résistance au virage à gauche.
On peut donc retourner l’argument de l’idéologisation et de la neutralité axiologique. Si le Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) est un lieu où s’exprime la pensée critique latino-américaine, ses projets sont souvent qualifiés de pamphlétaires ou d’idéologiques par ces mêmes politologues. Symétriquement, lorsque O’Donnell et Schmitter se réfèrent à des « couches explosives de la société », d’ « indocile secteur populaire », d’ « acteur ambigu », ou encore de « théâtre de rue »[5], il apparaît que de telles qualifications ne sont pas exemptes de présupposés idéologiques. De même, lorsque Marcelo Varnoux Garay décrit la science politique bolivienne en déclarant que le courant de pensée bourdieusien dans ce pays n’a pas permis « d’expliquer les comportements erratiques et apparemment irrationnel des dénommés « mouvements » sociaux qui ont réussi à arrêter les politiques libérales », peut-il vraiment prétendre à la neutralité ?
L’opposition maintes fois formulée entre deux gauches latino-américaines : l’une « raisonnable » car modérée et respectant la partition social-démocrate, l’autre radicale et populiste, va dans le même sens. Le « populisme » est un bon exemple de catégorie normative qui juge ce qu’elle nomme. Lors du premier Congrès de Science politique d’Uruguay d’octobre 2006, une des tables-rondes portait le titre suivant : "Gouvernements de gauche en Amérique latine : populisme vs social démocratie". L’absence d’un point d’interrogation venant ponctuer cette alternative signifie bien l’absence de questionnement critique. Dans ce cas, une analyse prend parti pour certains projets au mépris d’autres, et légitime cette position depuis un point de vue "scientifique".
Finalement, en quoi la revendication de l’ajustement structurel dans les années 90 serait moins idéologique que « la lutte des classes » des années 60 ? Pourquoi réaliser un projet pour CLACSO serait plus idéologique que pour la Banque Mondiale ? En termes foucaldiens, la victoire de la perspective dominante consiste dans la production d’un ordre du discours où certaines perspectives acquièrent le statut de neutralité, tandis que d’autres sont dévalorisées au nom de cette supposée neutralité.
La science politique latino-américaine conventionnelle présente donc des lacunes. Ces dernières impliquent l’absence d’outil pour penser le virage à gauche ; elles deviennent d’autant plus visibles que les conflits égalitaires s’imposent sur l’agenda politique de la région. Leur montée en puissance défie en quelques sorte la discipline à leur faire une place. De son coté, Sartori s’est fait l’écho d’un certain mal-être qui éclaire les impasses d’une approche strictement positiviste.
III. La science politique : un champ de bataille ?
a. Giovanni Sartori "contre" la science politique : un certain mal-être
En Octobre 2004, Giovanni Sartori publie un article titré «Where is Political Science Going ? » où il questionne radicalement la discipline qu’il a, selon ses propres mots, contribué à créer. La critique qu’il adresse à la communauté des politologues nord-américains sonne comme une sanction. Si Sartori signale qu’il a toujours résisté à l’influence de la science politique nord-américaine, il déclare qu’il n’avait pas prévu à quel point “la notion de science allait devenir étroite aux États-Unis” (2004, 785). Loin de la perspective wéberienne et des accumulations épistémologiques contemporaines, la science politique “dominante” (le terme est utilisé par l’auteur) "a adopté un modèle inapproprié de science (extrait des sciences dures)" (785), en d’autres termes, un modèle néopositiviste. Dans ce contexte, la méthode est assimilée à la technique. Loin de cultiver une méthodologie de “comment penser”, ce dont il s’agit c’est simplement de s’entraîner aux “techniques d’investigation et traitement statistique” (785). Il critique également le quantitativisme extrême et extrémiste qui « de fait, nous a entraîné sur un sentier de fausse précision ou d’inutilité précise ». Pour lui, « l’alternative ou du moins celle pour laquelle [il] plaide, consiste à résister à la quantification de la discipline (…), à penser avant de compter » (786).
Il est surprenant de constater que cette mise en garde venant d’une des références incontournables de la science politique n’ait eu que peu de répercussions en Amérique latine. Le politologue mexicain César Cansino en tire la conclusion suivante :
« Les politologues défenseurs des méthodes quantitatives, des modèles et schémas supposément plus scientifiques de la discipline, qui dénigrent tout ce qui ne peut pas tenir l’épreuve de la réalité empirique, qui ne peut pas être formalisé ou mathématisé, préfèrent suivre et alimenter une illusion sur les mérites de la science politique avant que d’initier une réflexion sérieuse et autocritique d’elle-même, ils préfèrent maintenir leur statut dans le monde académique avant de reconnaître les faiblesses des savoirs produits selon ces critères, ils préfèrent disqualifier viscéralement Sartori plutôt que de se confronter à un débat de fond. Le fait est que, malgré ce que les scientifiques purs voudraient, la science politique actuelle est effectivement en crise. » (2006)
En ce sens, la critique de Sartori peut être radicalisée et enrichie. Comme le disait Bourdieu, l’épistémologie est à la science ce que la psychanalyse est au sujet. Le primitivisme épistémologique de la science politique "dominante" empêche de mener une réflexion exigeante sur les effets politiques du discours politologique. La sociologie a une tradition plus longue d’auto-réflexion. La double herméneutique de Giddens est un exemple récent d’une telle perspective. La sociologie se propose d’étudier "la société". Le champ intellectuel et plus particulièrement les sciences sociales appartiennent donc logiquement à son champ d’investigation, ce qui entraîne une réflexion sur les enjeux épistémologiques de sa production. La science politique d’inspiration anglo-saxonne, dans sa revendication disciplinaire d’une spécificité de l’objet politique, tend au contraire à exclure la sociologie de l’étude du politique. Elle concentre dès lors ses efforts analytiques sur ce champ, et réfléchit moins sur elle-même et sa relation avec son environnement[6]. Pourtant, comme le signale le politologue chilien Juan Carlos Gómez Leyton « la science politique ne peut maintenir ainsi sa disposition positiviste ni sa prétendue neutralité ». Comme l’avait déjà pensé Hannah Arendt, le scientisme et ses dogmes peuvent dériver en obscurantismes aussi dangereux que leurs prédécesseurs. En ce sens, il apparaît nécessaire de tirer le pluralisme sur le terrain épistémologique et méthodologique.
Le paradoxe de la critique sartorienne de la science politique actuelle est que le "vieux sage" ne parvient pas à sortir de la "prison discursive" qu’il a contribué à créer. Il ne problématise pas une question cruciale : celle de la relation entre la discipline et son objet d’étude spécialement en ce qui concerne les relations de pouvoir et le conflit. Tout champ d’investigation scientifique et peut-être plus encore l’analyse du conflit égalitaire est traversé par les enjeux sociaux. Neveu constate à propos de la sociologie des mouvements sociaux : "l’analyse fonctionne tantôt – lorsqu’elle est favorable – comme écho du discours des groupes mobilisés, tantôt – lorsqu’elle condamne – comme redoublement d’un travail de maintien de l’ordre." (2002, 4). De ce point de vue, il s’agirait de distinguer le "savoir scientifique" du "discours militant" tout en étant conscient de leurs problématiques relations. L’auteur pose la question : "comment faire pour ne pas être prisonnier des enjeux directement politiques ?" (2002, 35).
b. Pensée critique latino-américaine et prise en compte du conflit
Comme nous l’avons signalé à plusieurs reprises, la science politique latino-américaine est loin d’être homogène. La Revue de Science Politique Chilienne[7] elle même n’est pas univoque. Nous voudrions mentionner rapidement l’existence d’autres perspectives et espaces au sein de la discipline qui s’attachent en Amérique latine à interroger le conflit égalitaire.
A sa façon, CLACSO représente une telle approche. Réseau d’institutions actives dans le champ des "sciences sociales" parmi lesquelles la science politique, CLACSO assume une perspective critique selon l’acception qu’Horkheimer donne à ce terme. Il poursuit un objectif spécifique à savoir de “libérer les êtres humains des circonstances qui les asservissent" (Horkheimer, 1978 : 244). Il suffit de lire leurs programmes de recherche pour observer d’une part, une réflexion permanente sur la discipline et sur le lieu politique des sciences sociales, et d’autre part, une attention particulière accordée aux conflits pour l’émancipation et l’égalité en Amérique latine. Leurs interrogations portent ainsi sur "la capacité actuelle des sciences sociales latino-américaines à penser la singularité historique de la région".
Cependant, ici comme pour le paradigme néopositiviste, la relation à l’objet se révèle fort problématique. Le rapport d’enchantement et de désenchantement, conséquence de la proximité/sympathie du chercheur pour la cause égalitaire peut, à son tour, porter préjudice à l’analyse. Si, pour les raisons que nous avons exposées plus haut, nous ne faisons pas nôtre la disqualification des recherches entreprises dans ce cadre, nous ne nions pas non plus les dangers analytiques à superposer analyses et discours politiques-critiques.
Conclusion
Comme l’a signalé Sartori, aux États-Unis, il existe une "science politique dominante". En Amérique latine, beaucoup d’institutions et de chercheurs en science politique voient dans le positivisme nord-américain "la manière" de la faire progresser et de professionnaliser le champ. Pourtant, l’adoption de ce canon n’est pas le simple reflet d’un « développement académique » mais bien plutôt de l’influence de cette école de pensée dans la région. L’éloge constant du système universitaire nord-américain et la valorisation d’une standardisation analytique observable dans de nombreuses universités latino-américaines l’illustrent bien. Devant le paradoxe de la coexistence dans un même raisonnement de l’affirmation que la science politique "est démocratique" et qu’à son heure elle s’est défaite de toute idéologie, nous avons insister sur la nécessité d’une réflexion de la science politique sur elle-même. Seule l’illusion néopositiviste peut expliquer que les politologues libéraux croient à la neutralité de leurs discours. Il y a donc un lien entre l’absence de débat épistémologique et l’hégémonie que nous observons.
Pourtant, comme nous l’avons vu, la science politique en Amérique latine demeure diverse et plurielle. Elle constitue de fait un champ hétérogène où cohabitent des postures très différentes. Le numéro coordonné par Altman et auquel nous nous sommes référé est l’expression de l’hégémonie que nous avons relevée mais aussi des résistances à cette dernière. On y trouve par exemple des articles comme celui de Fernández Ramil consacré au Chili ou celui sur l’Argentine qui présentent des points de vue beaucoup plus critiques.
Nous avons signalé que le renouveau des conflits égalitaires est concomitant d’une remise en cause du néolibéralisme et dans certains cas du modèle même de la démocratie libérale tel qu’il a été appliqué dans la région depuis les transitions. Le néolibéralisme est perçu comme la cause de la paupérisation d’une bonne partie des latino-américains, et la démocratie libérale, comme excessivement restrictive en terme d’exercice de la citoyenneté. Les biais idéologiques dont nous avons cherché à rendre compte invalident la compréhension des conflits égalitaires qui marquent l’actualité latino-américaine. De ce fait et comme cette contribution a voulu le montrer, ce débat est d’une importance manifeste aujourd’hui pour la science politique régionale. La relation complexe entre les faits sociaux et les théories qui en rendent compte explique notre attention pour la mobilisation de catégories venant délégitimer le virage à gauche en Amérique latine.
Enfin, nous pensons que la discipline sera en mesure de répondre à cette problématique dans la mesure où elle acceptera de s’ouvrir aux apports de l’anthropologie historique, de la sociologie et des sciences sociales et humaines en général. Si l’on admet que la démocratie ne peut être réduite à un « savoir technique ayant pour objet la constitution et la préservation des institutions démocratiques[8] », il faudrait tenir compte du diagnostic que Nicolas Guilhot fait pour l’Europe de l’est : "Le libéralisme aussi sait être stalinien à ses heures."
Paulo Ravecca & Cécile Casen[1]
Bibliographie
David Altman, “La institucionalización de la ciencia política en Chile y América Latina: una mirada desde el sur”, Revista de Ciencia Política, vol. 25, nº1, 2005, Universidad Católica, Santiago, Chili, pp. 3-15.
Roger Bartra, “Populismo y democracia en América Latina”, publié sur le site http://www.aportescriticos.com.ar
Ana María Bejarano, María Emma Wills, “La ciencia política en Colombia: de vocación a disciplina”, Revista de Ciencia Política, vol. 25, nº1, 2005, Universidad Católica, Santiago, Chili. pp. 111-123.
Atilio Borón, “Aristóteles en Macondo: Notas sobre el fetichismo democrático en América Latina”, in Hoyos Vásquez, Guillermo, Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía. CLACSO libros, Buenos Aires, 2007.
César Cansino, "Adiós a la ciencia política – Crónica de una muerte anunciada", Espacios Políticos, nº3, Rosario, Argentina, 2006.
CLACSO, appel paru en 2007 pour des bourses sur "l’actualité de la pensée critique en Amérique latine", disponible sur http://www.clacso.org.ar
Hélène Combes, Doctorat en science politique, « De la politique contestataire à la fabrique partisane. Le cas du Parti de la révolution démocratique au Mexique. 1989-2000 », Institut des hautes études de l’Amérique latine (IHEAL), université La Sorbonne Nouvelle-Paris III.
Pierre Cours-Salies et Michel Vakaloulis (dir.), « Les mobilisations collectives, une controverse sociologique », Actuel Marx, PUF, Paris, 2003.
Olivier Fillieule, Stratégies de la rue, les manifestations en France, Presses de science po, Paris, 1997.
Anthony Giddens, La constitution de la société, PUF, Paris, 1987.
Juan Carlos Gómez Leyton, « El RIP de la ciencia política norteamericana », publié sur le site www.espaciospoliticos.com.ar, 2007.
Nicolas Guilhot « la science politique et la transition démocratique à l’est », Futur Antérieur, n°27, L’Harmattan, 1995, pp.139-152.
Nicolas Guilhot, "Les professionnels de la démocratie. Logiques militantes et logiques savantes dans le nouvel internationalisme américain", Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 2001/3, n° 139, pp. 53 et 65.
Max Horkheimer, Théorie critique, Payot, Paris, 1978.
David Laitin, "¿Adónde va la ciencia política?, Reflexiones sobre la afirmación del profesor Sartori de que "la ciencia política estadounidense no va a ningún lado", Política y gobierno, vol. XI, n°2, 2e semestre 2004, pp. 361-367. 36
Marcelo Leiras, Juan Abal Medina, Martín D’Alessandro, "La ciencia política en Argentina: el camino de la institucionalización dentro y fuera de las aulas universitarias", Revista de Ciencia Política, vol. 25, nº1, 2005, Universidad Católica, Santiago, Chili. pp. 76-91.
Carlos Huneeus, "El lento y tardío desarrollo de la ciencia política en América Latina, 1966-2006 (Ciencia política y derecho internacional)", Estudios Internacionales, octobre 2006.
Andrés Mejia Acosta, Flavia Freidenberg, Simón Pachano, “La ciencia política en Ecuador: un reflejo de su fragilidad democrática (1978-2005)”, Revista de Ciencia Política, vol. 25, nº1, 2005, Universidad Católica, Santiago, Chili, pp. 147-161.
Amparo Menéndez-Carrión, Repensar la polis. Del clientelismo al espacio público. Compilación y Estudio Introductorio: Paulo Ravecca, CLAEH, Montevideo, 2007.
Erik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, La découverte, Paris, 2002.
Dieter Nohlen, Ciencia política: teoría institucional y relevancia del contexto, Universidad del Rosario, 2007.
Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, Ediciones Paidós, Barcelona-Buenos Aires-México, 1986.
Adam Przeworski, Democracy and market, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.
Jacques Rancière, « La haine de la démocratie – Chroniques des temps consensuels II», publié sur le site http://multitudes.samizdat.net/
Giovanni Sartori, “Where is Political Science going ?”, Political Science and Politics, vol. 37, n° 4, octobre 2004, Washington, pp. 785-789.
Philippe Schmitter, “The Consolidation of Democracy and Representation of Social Groups”, American Behavior Scientist, vol. 35, n°4/5, 1992.
Marcelo Varnoux Garay, “La ciencia política en Bolivia: entre la reforma política y la crisis de la democracia", Revista de Ciencia Política, vol. 25, nº1, 2005, Universidad Católica, Santiago, Chili, pp.92-100.
[1] Paulo Ravecca est doctorant en science politique à l’Université de York (Toronto, Canada). paulorav@yorku.ca
Cécile Casen est doctorante en science politique à l’Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine (Paris III). cecilecasen@gmail.com
[2] Une version préliminaire de cet article a été présentée lors du 4e Congrès de l’Association Belge de Science Politique – Communauté française (ABSP-CF), Louvain-la-Neuve (UCL), 24-25 avril 2008. L’atelier portait sur les « Conflits redistributifs et égalitaires : des objets invisibles pour l’actualité ? »
[3] Toutes les citations ont été traduites par les auteur-e-s.
[4] Roger Bartra, “Populismo y democracia en América Latina”, publié sur le site http://www.aportescriticos.com.ar
[5] Formules mises en exergue par Hélène Combes (2004). L’auteur se réfère à un ouvrage de O’Donnell et Schmitter (1986 : 90-91).
[6] Il faut remarquer ici que la frontière entre sociologie et science politique est relativement marquée en Amérique latine, ce qui n’est pas le cas en France par exemple.
[7] Revista Chilena de Ciencia Política XXV/1, Universidad Católica, Santiago de Chile, 2005.
[8] cité par Guilhot. ce serait l’objectif poursuivi par un ouvrage comme celui de Goldman, Promoting Democracy : Opportunities and Issue,1988.