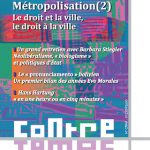Contre la gentrification, reprendre la main sur la production de l’espace
En 1964, la sociologue marxiste Ruth Glass forgeait le terme « gentrification » afin de qualifier, à partir des rapports de classe, les transformations de plusieurs quartiers populaires du centre de Londres qui étaient alors marqués par une forte élévation des prix des logements et par l’installation de catégories sociales plus favorisées, entraînant l’éviction graduelle des habitant·es en place. Depuis, le processus s’est répété dans un nombre toujours croissant d’espaces populaires et ses modalités se sont considérablement diversifiées.
Si la géographie critique analyse depuis longtemps la gentrification comme une forme de production de l’espace intimement liée aux transformations du capitalisme et des rapports sociaux, le terme circule dorénavant aussi sous des formes aseptisées, tantôt comme simple descripteur d’une transformation urbaine d’apparence inéluctable, tantôt pour applaudir une évolution censée favoriser le « renouveau urbain » ou la « renaissance des quartiers ». Les rapports de domination dans lesquels la gentrification s’imbrique disparaissent alors du champ de vision, de même que les violences que le processus engendre.
Dans son livre Contre la gentrification, Convoitises et résistances dans les quartiers populaires (La Dispute, 2021), Mathieu Van Criekingen (géographe, enseignant-chercheur à l’Université libre de Bruxelles) redonne toute sa puissance critique et politique au concept, rappelant qu’il exprime avant tout le pouvoir de classes dominantes (en termes économiques ou culturels) de réaménager des espaces populaires à leur image et à leur avantage, au prix de multiples formes de dépossessions de groupes dominés. Mais il souligne également, qu’aussi puissant soit-il, ce « rouage spatial de la domination sociale » fait face à diverses formes de résistance à l’échelle locale. En situation concrète la gentrification est évitable, car elle participe chaque fois d’une lutte située entre différents modes d’appropriation de l’espace dont l’issue n’est pas écrite d’avance.

Gilles Martinet – Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, pourriez-vous expliquer pourquoi vous considérez que certains usages du mot « gentrification » en dévoient le sens critique d’origine ou l’aseptisent ? C’est, je pense, une belle porte d’entrée vers l’analyse que vous faites de la transformation des discours sur l’urbain et de la valorisation, avec force slogans, de la « ville entrepreneuriale » – que vous comprenez comme une norme commandant de penser les politiques urbaines d’abord et avant tout en termes de concurrence et d’attractivité du territoire ?
Mathieu Van Criekingen – Quand j’ai commencé à travailler sur la gentrification, à Bruxelles à la fin des années 1990, j’entendais souvent dire que ce phénomène n’existait pas ici, que c’était quelque chose pour New York, Londres ou Paris, mais pas pour une ville comme Bruxelles. Aujourd’hui, ce discours-là a disparu, le phénomène est devenu bien trop visible.
Ce que j’entends dire, aujourd’hui, notamment du côté d’aménageurs publics, c’est que, oui, la gentrification existe aussi à Bruxelles, mais que le phénomène a aussi des « bons côtés », qu’il n’est pas uniquement négatif, qu’il faut l’encadrer pour en limiter les « excès » ou les « effets pervers ». Or, ce changement de discours sur la gentrification est concomitant d’un changement de discours sur les quartiers populaires qui, à Bruxelles, sont situés dans la partie centrale de l’agglomération. Ces quartiers ne sont plus seulement dépeints par les aménageurs comme des espaces « défavorisés », marqués par une série de carences (emplois, revenus, équipements, etc.), mais de plus en plus comme des espaces « d’opportunités », comme des quartiers pleins de « potentiels » à mobiliser pour faire du « développement métropolitain ». L’approche politique change : il s’agit non plus tant de répondre à des besoins, de soigner l’existant, que d’utiliser ces espaces comme leviers pour l’attractivité de la ville, pour son rayonnement, tout ça au nom de la concurrence entre les villes ou entre la ville centrale et les communes périurbaines qui l’entourent. Dans cette logique, les quartiers populaires doivent être transformés pour aider à « mettre Bruxelles sur la carte » des villes – au choix – « durables », « créatives », « innovantes », « smart », etc. C’est, il me semble, une manifestation de cette vision entrepreneuriale de la ville, qui conduit à penser l’espace urbain comme un stock d’opportunités à saisir et à valoriser, par le biais de toute une série de projets.
À Bruxelles, compte tenu de l’histoire de la ville et de la localisation centrale des quartiers populaires, leurs potentiels fonciers sont particulièrement convoités. Ça veut dire que beaucoup y voient des opportunités de transformer les usages du sol existants en usages plus rentables ou plus distinctifs. La gentrification, dans ce cadre, n’est plus un problème, elle devient un processus à encourager, mais tout en l’habillant de costumes sémantiques consensuels : « requalification urbaine » ou « revitalisation des quartiers », par exemple. Mais, sur le fond, bien sûr, la gentrification reste un rapport de dépossession, qui appelle à mettre les espaces populaires au service d’un projet sur la ville qui marginalise leurs habitant·es ordinaires, déjà là.
Je trouve assez renversant qu’on puisse en arriver à parler des effets bénéfiques de la gentrification, ou même à utiliser le mot pour simplement décrire une série de transformations urbaines parmi d’autres. À mes yeux, l’intérêt du concept est d’aider à penser la capacité de classes dominantes – économiquement ou culturellement – à s’approprier des quartiers populaires. Si la gentrification a un bénéfice, il est donc conceptuel : utiliser ce prisme-là, dans son sens critique d’origine, oblige à se poser toute une série de questions sur les rapports de pouvoir et la conflictualité sociale en jeu dans les transformations de l’espace – qui gagne et qui pâtit ?, rénover pour qui et contre qui ?, qui décide ? etc.
Gilles Martinet – De plus, pour affirmer que certaines transformations sont « positives », il faut avoir préalablement imposé certaines représentations de l’espace urbain désirable – qui sont aussi des représentations d’un ordre social désirable – dans lequel certain·es habitant·es n’ont pas leur place. Vous citez les propos d’élus locaux, qui considèrent qu’il y a de « vrai·es habitant·es », qui sont celles et ceux qui paient des impôts, qui appartiennent aux classes moyennes et supérieures, et d’autres, qu’on ne nomme même pas.
Mathieu Van Criekingen – La promotion de facto de la gentrification s’accompagne de discours sur les personnes ou les activités légitimes à occuper les espaces de centre-ville, et sur celles qui ne le seraient pas. J’ai été notamment frappé, à Bruxelles, par les propos d’un architecte-urbaniste chargé par le Gouvernement régional de repenser l’aménagement des quartiers historiquement industriels et populaires de la ville et qui parlait du manque de « dignité » de certains usages de cet espace. Dans le même genre, je reprends aussi dans le livre le propos d’un élu – qui est aujourd’hui ministre régional de l’urbanisme – qui déclarait il y a quelques années qu’il faut ramener les classes moyennes à Bruxelles pour éviter que la ville ne soit « la poubelle de la Belgique ». Si on se rappelle qu’une poubelle sert à évacuer les déchets, ça fait froid dans le dos…
Alors, bien sûr, les propos de ce genre restent rares. Ce qui est beaucoup plus courant, par contre, ce sont les discours qui construisent la figure de l’urbain désirable autour de la catégorie des « classes moyennes ». En un mot, leur présence apporterait à la ville ou au quartier tout à la fois élan économique, dynamisme culturel et sauvegarde du patrimoine, tandis que leur absence condamnerait au déclin, au délabrement… Ces classes moyennes sont ainsi posées comme le seul agent légitime du développement urbain, comme le seul vecteur de réussite ou de progrès urbain, supposément bénéfique in fine « pour la ville », c’est-à-dire, pour tout le monde, y compris pour les classes populaires.
À ce propos, il est frappant de constater le décalage entre la représentation des classes moyennes mobilisée dans les discours des aménageurs – des familles propriétaires de leur logement, avec des emplois et des revenus stables, qui déménagent peu, etc. – et les réalités socio-démographiques d’une ville comme Bruxelles. De fait, les ménages « moyens » en termes de revenus sont beaucoup plus souvent locataires que propriétaires, vivent plus souvent seul·es qu’en famille, ont souvent des emplois instables et, pour beaucoup, habiter dans un quartier central ou péricentral de la ville est une étape dans leur parcours résidentiel.
Gilles Martinet – Maintenant, nous pouvons nous pencher un peu plus en détail sur les acteurs de la gentrification et sur leurs intérêts. On comprend bien que pour les promoteurs, les investisseurs, il y a une recherche de la valorisation foncière et immobilière, mais qu’en est-il pour les pouvoirs publics ? Et comment s’articulent les relations entre acteurs de la promotion immobilière et pouvoirs publics ?
Mathieu Van Criekingen – Si je pars à nouveau du cas de Bruxelles, le constat est que les relations entre ces acteurs ne sont pas nouvelles, mais elles ont changé de nature au cours des dernières décennies. Dans les années 1950 et 1960, l’État belge voulait faire de sa capitale une ville de rang international, spécialisée sur les activités tertiaires, en assumant une désindustrialisation très rapide de la ville. Ainsi, pendant ces années, la ville a été en quelques sortes livrées aux promoteurs immobiliers, à charge pour ceux-ci de produire de grandes quantités de bureaux, notamment pour accueillir les institutions européennes et toutes sortes d’entreprises ou d’organisations qui gravitent autour d’elles. Résultat : les quartiers centraux se sont dépeuplés, beaucoup d’entreprises ont fermé leurs portes et des immeubles de bureaux ont été construits un peu partout dans la ville, et en trop grands volumes par rapport à la demande réelle.
Aujourd’hui, par contre, la situation a changé. D’un côté, on a une masse énorme de capitaux financiers qui cherchent des débouchés profitables sur les marchés immobiliers urbains, pas seulement dans le secteur du bureau – et Bruxelles n’est qu’une cible relativement secondaire pour ces investisseurs, par rapport à Londres ou Paris par exemple. De l’autre, on a un Gouvernement régional – mis en place seulement en 1989, à la suite de la transformation de la Belgique en État fédéral – qui mise sur l’attraction des classes moyennes comme levier de son développement territorial, l’idée étant que fixer ces populations solvables est le meilleur gage de stabilisation de la ville, notamment au plan fiscal. On voit ainsi se nouer une alliance objective autour de la production de produits immobiliers de gamme supérieure, des logements mais aussi des commerces ou des centres de loisirs, en particulier dans des espaces qui ne sont pas spontanément attractifs pour ces populations. Comme les financiers n’aiment pas le risque, l’appui des pouvoirs publics leur est crucial. On peut ainsi lire toute une série de politiques dites de « revitalisation » des quartiers populaires comme des programmes qui, de fait, permettent de diminuer les risques pour les investisseurs, de lever une série de barrières à l’investissement, d’ordre réglementaire, matériel ou symbolique.
Cette stratégie implique des coûts sociaux structurels, qui ne sont en rien des « effets pervers » qu’on n’aurait pas pu voir venir, puisque, pour réussir, les prix du sol et du logement doivent augmenter – les investisseurs ne viennent pas en masse là où les prix baissent… Mais on peut aussi questionner l’efficacité de cette stratégie dans ses propres termes. En effet, on voit que bon nombre des logements produits par des promoteurs ne sont pas achetés par des personnes ayant l’intention de s’y installer durablement, mais par des investisseurs qui y placent leur argent, ou les mettent en location sur des plateformes comme Airbnb. L’objectif de fixation des classes moyennes idéalisées par les politiques publiques n’est alors pas atteint, malgré toute l’énergie et tous les financements consacrés à ces politiques dites de « revitalisation urbaine ». Autrement dit, les politiques d’attraction de classes moyennes coûtent cher, et il n’est pas du tout garanti que l’équation soit au final positive pour les budgets publics.
Gilles Martinet – Pour mieux comprendre et incarner ces relations entre les différents acteurs publics et privés qui propulsent la gentrification, il serait intéressant de dire un mot sur les espaces dans lesquels se forgent ces imaginaires de la ville désirable et les politiques censées permettre leur réalisation. Loin des espaces de délibération institués, des acteurs privés apportent leurs « solutions » – vous soulignez combien la ville entrepreneuriale se pense sous le prisme des « solutions » apportées à des « défis urbains ». Vous citez par exemple le Plan de développement international de Bruxelles, élaboré par un cabinet de conseil, PricewaterhouseCoopers, et qui a été présenté au Marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM), à Cannes, sans jamais avoir été présenté publiquement aux Bruxellois·es, alors même qu’il a eu des effets directs sur les politiques publiques mises en œuvre.
Mathieu Van Criekingen – Tout à fait, et d’autres plans ont été présentés dans des forums immobiliers avant d’être présentés publiquement, quand ils l’ont été. J’ai eu l’occasion une fois de me rendre, avec un collègue, à un équivalent bruxellois du MIPIM. On y trouvait le stand de la Région bruxelloise au beau milieu de toute une série de stands de promoteurs et d’autres acteurs de l’immobilier. C’était comme si chacun faisait la cour à l’autre. D’ailleurs, quelques personnes présentes sur le stand de la Région bruxelloise, et qui me connaissaient, étaient assez gênées que je les retrouve là, eux-mêmes qui me disaient que la gentrification, « ce n’est pas si terrible que çà… ». Ces relations entre pouvoirs publics et intérêts immobiliers sont aussi fortes que discrètes, et ces « marchés internationaux », auxquels l’accès du public est très restreint, sont un des espaces où elles se nouent. Ce qui ne veut pas dire qu’aménageurs publics et promoteurs privés sont toujours sur la même longueur d’onde – il y a souvent des tensions entre eux.
Gilles Martinet – Autour de cet imaginaire entrepreneurial, on retrouve donc différentes catégories d’acteurs en position dominante dans la production de l’espace urbain, des acteurs immobiliers et des institutions publiques en particulier. Mais ne faut-il pas aussi tenir compte de certaines catégories d’habitant·es ?
Mathieu Van Criekingen – Oui, tout à fait. Je pense que les logiques de gentrification sont portées non seulement par les appétits spéculatifs d’acteurs immobiliers et par des politiques focalisées sur des critères d’attractivité urbaine, mais aussi par un désir de centralité urbaine de populations bien dotées en capitaux économiques ou culturels. Et ce désir est socialement construit et lié à des situations matérielles.

Gilles Martinet – Arrêtons-nous donc un instant sur ces habitant·es qui accompagnent la gentrification, qui y participent, qui sont parfois appelé·es « gentrifieurs », par les chercheur·ses comme par les collectifs en lutte contre la gentrification. Vous montrez qu’iels participent réellement à la gentrification, mais qu’iels n’en sont souvent pas les acteur·ices volontaires, que leurs trajectoires résidentielles sont elles-mêmes contraintes. Vous écrivez qu’il s’agit de « groupes souvent peu conscients de leur pouvoir de marquage de l’espace et des privilèges sociaux sur lesquels ce pouvoir est construit » mais qu’ils n’en sont pas moins « des acteurs locaux de la gentrification ». Pourriez-vous revenir sur ce point ? Il me semble d’autant plus important qu’une des manières de dépolitiser la gentrification, ou d’autres questions urbaines, c’est de masquer les responsabilités des promoteurs et des pouvoirs publics derrière une supposée responsabilité dispersée, diffuse. Ici, celle des membres des classes intermédiaires qui s’installent dans ces quartiers populaires.
Mathieu Van Criekingen – C’est précisément une des raisons pour lesquelles je parle d’acteurs locaux de la gentrification, plutôt que de « gentrifieurs », afin de souligner que les agents les plus structurels de la gentrification sont les institutions, privées ou publiques, qui amènent des capitaux dans ces espaces populaires dans le but de les transformer. Les « gentrifieurs », ce sont donc, à mes yeux, les investisseurs, les promoteurs ou les entrepreneurs qui misent sur une revalorisation marchande des espaces populaires, et les divers acteurs publics qui rendent possible ces opérations, les accompagnent, les encouragent voire les suscitent, par différents leviers réglementaires, symboliques, d’équipement etc. C’est bien à ce niveau-là que les responsabilités majeures se trouvent : les propriétaires de capitaux et l’État entrepreneurial.
Pour autant, il ne faut pas sous-estimer le rôle des habitant·es appartenant aux classes intermédiaires qui s’installent dans ces quartiers populaires réinvestis. Ces populations sont à la fois dominées et dominantes : dominées sur le plan économique, mais dominantes sur le plan culturel. Ce qui fait que, d’une part, leurs choix résidentiels sont contraints – iels n’ont souvent pas les moyens de s’installer dans les quartiers bourgeois – mais que, d’autre part, leurs capitaux culturels leur permettent de faire entendre leurs voix dans le débat urbain, de faire primer leurs aspirations sur d’autres. Par exemple, les dispositifs dits de « participation », qui accompagnent la plupart des programmes de rénovation urbaine, font souvent office de chambres d’écho d’aspirations – socialement situées – pour des espaces publics « apaisés », c’est-à-dire sans trop d’activités économiques ou commerciales populaires, ou pour des quartiers sans trop de logements sociaux – afin de ne pas peser à la baisse sur les valeurs immobilières.
Souvent, ces populations ne se posent pas trop de questions, par exemple sur ce que l’ouverture de commerces qui correspondent à leurs modes de consommation peut signifier en termes de dépossession pour d’autres catégories d’habitant·es. La conscience de ses propres privilèges sociaux ne vient pas naturellement à l’esprit, d’autant moins quand les acteurs dominants de la transformation de ces espaces mettent tout en œuvre pour que ces classes intermédiaires se sentent pleinement légitimes à s’approprier les quartiers populaires, notamment en accédant à leurs demandes concernant la régulation des pratiques des espaces publics.
Comme Neil Smith, je pense qu’on ne conteste pas efficacement la gentrification simplement en critiquant ou en moquant les modes de vie des hipsters. Il me semble beaucoup plus utile et pertinent de s’attacher à comprendre les conditions qui permettent à ces modes de vie de « prendre place », de se déployer dans des parties de la ville où les classes intermédiaires ne sont pas la majorité de la population.
Gilles Martinet – Jusqu’à présent, nous nous sommes surtout intéressés à celles et ceux qui favorisent, qui produisent la gentrification et qui en bénéficient. Abordons maintenant les multiples formes de dépossessions que la gentrification engendre, et présentons les habitant·es qui sont frappé·es par ces dépossessions.
Mathieu Van Criekingen – En effet, les dépossessions engendrées par la gentrification prennent des formes multiples. Il n’y a pas uniquement les schémas d’éviction directe de locataires, entraînée par les hausses de loyers. On a aussi des effets de blocage à l’entrée : quand un quartier historiquement populaire devient inaccessible parce qu’il a été transformé en espace plus bourgeois, la dépossession a lieu en amont. C’est comme si une porte d’entrée dans la ville se fermait, au détriment de toutes les catégories de personnes qui en faisaient usage jusque là – immigré·es, artistes, étudiant·es…
Et puis, il ne faut pas négliger les dépossessions d’ordre symbolique ou communautaire. Par exemple, il est violent de se voir dépossédé d’un espace familier, dans lequel on a noué des relations sociales, parce que, par exemple, les voisin·es ont dû partir, les commerces ont changé, les espaces publics ne permettent plus certains usages, etc. Ceci est d’autant plus lourd de conséquences dans les quartiers populaires, où l’espace local est un lieu de production et de distribution d’une série de ressources essentielles pour pouvoir vivre en situation de domination, ou pour se ménager des capacités d’action. C’est une dimension que les travaux du collectif Rosa Bonheur[1] ont particulièrement bien mise en évidence dans le cas de Roubaix, mais qui fait sens pour beaucoup d’autres villes. Pour les habitant·es de ces quartiers frappés de plein fouet par la désindustrialisation, l’espace local fait ressource de diverses manières, pour les courses, l’accès à des emplois ou à des soutiens associatifs, etc. Se voir privé de l’accès à ces ressources localisées, parce qu’on doit quitter le quartier ou parce que des projets de gentrification viennent les affaiblir ou les supprimer au prétexte de leurs « nuisances », c’est aussi une forme de dépossession lourde de conséquences.
Gilles Martinet – La gentrification résulte donc d’un ensemble d’actions qui ne peuvent se comprendre sans considérer la configuration des rapports de pouvoirs dans la production des espaces urbains. Maintenant, pouvons-nous analyser non pas seulement les effets de la gentrification sur la transformation des villes, mais aussi sur les rapports de pouvoir qui font ces espaces et, finalement, sur l’ordre social articulé à cet ordre urbain ? Pour le dire autrement, il s’agirait de penser l’espace comme structure structurée et structure structurante, à la fois cristallisation des rapports de pouvoir et matérialité qui permet la perpétuation de ces rapports de pouvoir. Quels sont donc les effets de la gentrification sur ces relations dialectiques, et que fait-elle aux rapports sociaux de domination ?
Mathieu Van Criekingen – Je pense qu’on peut répondre ici à deux niveaux. En premier lieu, je voudrais souligner que les logiques de gentrification ne sont plus à la marge dans le tableau général de la production de l’espace dans les sociétés capitalistes du début du XXIème siècle. Si, il y a quelques décennies, on pouvait encore dire qu’elles en étaient des composantes assez marginales, qui passaient surtout par des initiatives plutôt locales et plutôt individuelles, aujourd’hui les logiques de gentrification sont propulsées depuis le cœur de l’économie politique de la production urbaine. Elles sont devenues à la fois une rationalité de premier plan des politiques urbaines et un débouché important pour une série d’acteurs capitalistes liés à la finance. Par exemple, à Bruxelles, une vaste zone auparavant dédiée à des activités ferroviaires et d’entreposage de marchandises, qui jouxte des quartiers populaires denses et souvent stigmatisés, est en train de devenir un espace résidentiel et commercial haut de gamme. À la manœuvre de cette opération de gentrification de gros calibre, on trouve la société Ackermans & van Haaren, l’une des plus grandes holdings financières belges, qui fait partie du BEL 20 – l’équivalent belge du CAC 40. Cela montre comment, par la gentrification, la finance transforme la matérialité de la ville, mais, aussi, comment elle acquiert ou renforce une influence sur les choix politiques en matière d’aménagement urbain. Dans cet exemple, il est en effet frappant de voir le nombre de projets publics greffés autour de cette opération immobilière privée, qui lui donnent encore plus de portée et d’aura.
Deuxièmement, la gentrification signifie aussi que les classes populaires ont de moins en moins d’espace pour faire entendre leurs voix dans le débat urbain. Moins d’espace au sens matériel, et ça nous ramène à la question des dépossessions, mais aussi moins d’espace au sens politique, c’est-à-dire, moins de capacité de peser sur les orientations des politiques urbaines. Il est révélateur à cet égard, je pense, de voir à quel point les ressources, matérielles ou symboliques, que les espaces populaires procurent à leurs habitant·es ordinaires sont ignorées dans les diagnostics sur lesquels se fondent les politiques qui prétendent « revitaliser » ces quartiers. Ceux-ci parlent en revanche beaucoup de retrouver une « qualité urbaine », mais dans un sens très situé socialement – les logements sociaux ne sont pas souvent considérés comme de la « qualité urbaine », par exemple. Si ces politiques étaient conçues à partir des conditions matérielles d’existence des classes populaires et de leurs aspirations, on n’aurait pas des programmes de rénovation urbaine autant focalisés sur des normes d’attractivité, puisque ces habitant·es sont déjà là…
Gilles Martinet – On l’a compris, le concept de gentrification permet de remettre les rapports de classe au cœur de l’analyse de la production contemporaine des espaces urbains. Est-ce que la gentrification s’appuie aussi sur d’autres dominations, notamment autour des rapports sociaux de race et de sexe ?
Mathieu Van Criekingen – C’est une excellente question, mais dont je ne parle pas dans l’ouvrage, parce je ne m’en sentais pas tout à fait capable. Ce sont par ailleurs des questions qui sont de plus en plus présentes dans les recherches qui sont conduites sur la gentrification, alors que jusqu’ici l’analyse se concentrait sur les classes sociales. Néanmoins, tout en restant prudent, je dirais que le rapport de domination saisi par le concept de gentrification – la domination sur le devenir social des espaces populaires – peut coïncider avec d’autres rapports de domination, mais sans pour autant que ceux-ci soient indispensables à la mise en place du processus. Je veux dire qu’il arrive que des projets de gentrification s’appuient sur des dominations racistes, par exemple pour « justifier » que certaines populations racisées ne seraient pas légitimes à occuper des espaces de centre-ville présentés comme « stratégiques » pour le développement métropolitain, mais ce n’est pas pour autant une condition structurellement nécessaire. C’est pour cela aussi que je ne suis pas enclin à parler de gentrification comme d’un colonialisme urbain.
Gilles Martinet – Ce qu’on observe en France dans des quartiers en cours de gentrification, c’est une intensification du contrôle des corps dans l’espace public, et en particulier du contrôle policier de ces corps. Or, dans un contexte dans lequel les pratiques policières sont marquées par les rapports sociaux de race et dans des quartiers populaires dont une large portion des habitant·es sont racisé·es, il semble bien que la gentrification s’appuie également sur des rapports sociaux de race. Est-ce que ce renforcement, en contexte de gentrification, du contrôle policier des personnes racisées dans l’espace public s’observe aussi à Bruxelles ?
Mathieu Van Criekingen – À nouveau, je n’ai pas directement travaillé sur cette articulation-là. Mais je vois néanmoins que, à Bruxelles aussi, les contrôles au faciès et d’autres formes de violences policières sont bien présentes. Pendant le confinement, des associations disaient « on ne peut pas laisser la police toute seule dehors avec les jeunes ». Et il y a même eu un jeune de 19 ans tué pendant un contrôle policier en avril 2020. Même si la plupart des quartiers populaires bruxellois n’ont pas la morphologie des grands ensembles français, les violences policières à l’encontre des classes populaires racisées, surtout les jeunes hommes, sont bien semblables.
Ces violences policières existent indépendamment des logiques de gentrification, mais elles peuvent se surimposer à elles dans certains quartiers, et contribuer ainsi à compliquer encore plus la vie de leurs habitant·es. Certains travaux ont d’ailleurs montré que la gentrification peut venir renforcer des politiques de contrôle ou de normalisation des pratiques prenant place dans l’espace public, à la demande de nouveaux habitant·es ou d’investisseurs par exemple. Cela passe alors par les activités policières, mais aussi par des réaménagements physiques, qui vont enlever des bancs publics par exemple, ou par des interdictions de certains usages.
Gilles Martinet – Est-il possible de faire une analyse de la gentrification à travers le prisme de la justice environnementale ? Il apparaît souvent que l’amélioration de l’environnement des quartiers populaires – à travers la végétalisation, la lutte contre les pollutions, la rénovation et l’isolation des logements – se fait souvent dans le cadre de la gentrification, et d’abord pour rendre ces espaces désirables aux yeux de membres des classes sociales supérieures.
Mathieu Van Criekingen – Il y a aujourd’hui de plus en plus d’études qui parlent d’éco-gentrification. Elles soulignent le rôle que jouent des politiques traitant de l’environnement comme d’un ensemble d’aménités à mettre en valeur, dans le but d’attirer des investisseurs ou des habitant·es. À Bruxelles, ces dernières années, l’agence publique chargée de produire du logement à destination des classes moyennes a développé, en partenariat avec des promoteurs immobiliers, un grand projet d’écoquartier tout neuf, Tivoli GreenCity, qu’elle présente comme « le quartier le plus durable en Europe ». Ce projet répond à toute une série de critères de performance énergétique et d’exemplarité environnementale, mais il est situé en bordure d’un quartier populaire ancien, dont beaucoup de logements sont en mauvais état, mal isolés ou suroccupés. Le nouvel écoquartier tranche vraiment avec son environnement, et on peut se demander ce qu’il améliore pour les habitant·es déjà là. Il me semble que ce genre de projets participe aussi de l’imaginaire de la ville entrepreneuriale, qui conduit des acteurs publics à valoriser une action très visible, en partenariat avec des acteurs privés, sur laquelle ils vont pouvoir communiquer abondamment et faire du marketing territorial – « on met Bruxelles sur la carte des écoquartiers » –, mais sur des sites particuliers plutôt qu’à l’échelle de la ville toute entière, sans ambition d’amélioration de la situation de la majorité des habitant·es, comme le voudrait, il me semble, un souci de justice sociale et environnementale.
Gilles Martinet – Avant d’en venir aux luttes portées par des habitant·es et aux politiques anti-gentrification, il serait peut-être utile de redire, en deux mots, pourquoi il est important de s’opposer à la gentrification. En effet, beaucoup de discours en circulation au sein de la gauche font des luttes contre la gentrification des combats accessoires. Vous citez dans le livre cette phrase d’Henri Lefebvre qui écrit, dans La production de l’espace, « « Changer la vie », « changer la société », cela ne veut rien dire s’il n’y a pas production d’un espace approprié ». Pourriez-vous développer cette idée ?
Mathieu Van Criekingen – S’opposer à la gentrification, à mon sens, c’est s’opposer à un mode particulier de production de l’espace. C’est une logique de réaménagement des espaces populaires, pas seulement en ville, qui peut prendre des formes très variées, mais qui trouve son unité dans son point de mire, sa perspective structurelle : il s’agit de transformer ces espaces populaires à l’avantage de groupes socialement favorisés, de les adapter à des usages plus rentables ou plus distingués, sans mettre en place aucune option de rechange pour les habitant·es ordinaires de ces espaces, donc en leur enlevant une série de ressources liées à l’existence de ces espaces. Henri Lefebvre n’a jamais parlé ou écrit sur la gentrification, mais sa conception de la production de l’espace est à mes yeux essentielle pour comprendre à quoi on a vraiment affaire avec la gentrification. Et cette phrase sur « Changer la vie » exprime bien ce qu’il désigne par production de l’espace : on ne peut pas concevoir une société qui ne soit pas régie par les impératifs capitalistes sans concevoir aussi, en théorie comme en pratique, une autre façon d’aménager l’espace, de l’organiser collectivement.
Gilles Martinet – Vous expliquez que la gentrification est, pour une part, le résultat d’une situation dans laquelle les collectivités territoriales se retrouvent affaiblies et isolées face aux acteurs dominants de la production de l’espace, du fait notamment des dérégulations. Alors, que peuvent-elles faire ?
Mathieu Van Criekingen – Je dirais d’abord qu’elles peuvent arrêter de l’encourager. Mais c’est vrai que le cadre mis en place par plusieurs décennies de réformes néolibérales est hostile à des politiques urbaines franchement anti-gentrification. Ces réformes ont sensiblement accru la force de frappe de ceux qu’on appelle les « investisseurs », mais qu’il faudrait plutôt les nommer « capitalistes de la rente », parce que leurs stratégies de profit reposent sur la captation de rentes foncières ou immobilières sans cesse croissantes. Ce sont eux que courtisent les politiques urbaines entrepreneuriales, en imaginant que l’attraction de ces propriétaires de capitaux produira in fine du développement, des emplois, des rentrées fiscales, une belle image de la ville, etc. Mais il reste encore, au sein des pouvoirs publics, des morceaux plus sociaux-démocrates, qui peuvent soutenir localement des initiatives différentes, comme des Community land trusts par exemple. Cela peut donner des tableaux d’ensemble bigarrés, où coexistent des politiques qui encouragent objectivement la gentrification et des politiques qui cherchent à limiter les marges d’action des forces du marché. Mais la tendance dominante est bien celle de l’État entrepreneurial.
C’est ce qui m’amène à penser que, pour que des collectivités territoriales s’opposent réellement à la gentrification, il faut d’abord qu’elles se soient émancipées de l’imaginaire entrepreneurial, qu’elles cessent de penser dans le cadre de modèles aujourd’hui omniprésents dans les débats urbains comme la « ville durable », la « ville intelligente », la « ville créative », etc. L’alternative, à mon sens, c’est de partir de l’existant, des conditions matérielles d’existence des habitant·es au sens large, et puis de se demander comment des politiques urbaines – en matière de logement, de transport, d’environnement, d’activité économique, etc. – peuvent faire obstacle aux rouages spatiaux de la domination sociale. Comment contrecarrer les rapports de domination à travers des interventions sur l’espace, les conditions d’habitat et de vie en ville ? Un levier essentiel, à ce propos, c’est de s’attaquer aux mécanismes de la rente foncière, c’est-à-dire, au pouvoir des propriétaires du sol d’exiger les prix qu’ils veulent pour faire usage de leur terrain ou de leur immeuble. C’est essentiel notamment en matière de logement – on voit à quel point se loger en ville devient hors de prix pour la majorité des habitant·es. Dans l’imaginaire entrepreneurial, le logement socialisé – les logements dont les loyers sont fixés à partir des capacités financières de leurs occupant·es, pas par des critères de marché – est totalement déconsidéré. Il n’est présenté que comme un coût pour la collectivité, alors qu’il a des avantages évidents en termes collectifs : ce que les ménages ne paient plus en loyer, ils pourront le consommer dans l’économie locale, dans l’alimentation, la santé, les loisirs… Ce serait bien plus utile collectivement que d’entretenir des rentier·es.
Gilles Martinet – Revenons à cette initiative que vous présentez, portée à la fois par des habitant·es et les pouvoirs publics locaux, qui semble à première vue permettre de battre en brèche l’imaginaire entrepreneurial et la propriété privée lucrative : le Community Land Trust (CLT), ou organisme foncier solidaire.
Mathieu Van Criekingen – Le CLT attire aujourd’hui l’attention, notamment à Bruxelles. Au départ, ce sont quelques associations actives dans l’aide au logement qui ont trouvé cette idée aux États-Unis et qui ont voulu l’importer à Bruxelles en réponse au manque de logements abordables. Assez rapidement, iels ont convaincu les autorités régionales de les soutenir et de les financer. L’idée du CLT, c’est de séparer la propriété du sol de la propriété des immeubles construits dessus et de retirer le foncier du marché, pour empêcher toute forme de spéculation foncière. On peut, je pense, à la fois trouver l’expérience intéressante, parce qu’elle s’attaque à la rente foncière, et s’interroger : le logement social classique ne fait-il au fond pas mieux, puisque là le sol et le bâti sont mis hors marché ? De plus, cette initiative, à Bruxelles du moins, n’échappe pas à des logiques d’affichage ou de marketing politique. Le Gouvernement régional a en effet beau jeu d’afficher qu’il innove en matière de droit au logement en soutenant le CLT, ou même qu’il « met Bruxelles sur la carte des CLT », alors qu’à peine un peu plus d’une centaine de logements CLT existent aujourd’hui et que l’ambition est d’arriver à 1.000 personnes logées en CLT d’ici 2030, alors qu’il y a aujourd’hui plus de 130.000 personnes en liste d’attente à Bruxelles pour un logement social ! Le contraste entre le volume de discours et le volume de logements produits est saisissant, d’autant plus que, dans le même temps, la production de logements sociaux reste à des niveaux historiquement bas.
Gilles Martinet – Qu’en est-il de la résistance que les habitant·es opposent à la gentrification ?
Mathieu Van Criekingen – Dans le livre, je ne développe pas beaucoup l’analyse des luttes urbaines organisées. J’ai préféré insister sur les manières dont on peut « résister en habitant », formule que j’emprunte notamment à Matthieu Giroud[2]. Je trouve un peu étroite la représentation d’une opposition entre deux camps, les pro-gentrification d’un côté et les collectifs militants de l’autre. Il y a aussi les habitant·es ordinaires des quartiers populaires, tous ceux et celles qui habitent ces espaces, y travaillent, y font leurs courses, y retrouvent leurs familles et leurs ami·es, etc. Dès lors que toutes ces pratiques banales de l’espace viennent freiner ou faire obstacle à des projets de gentrification, il y a aussi résistance, même si ce n’est pas une résistance consciente d’elle-même. C’est l’espace habité qui résiste, parce qu’il ne se laisse pas facilement approprier par des investisseurs ou des aménageurs. C’est l’autre sens du « contre » qui est dans le titre du livre : qu’est-ce qui va à l’encontre des logiques de gentrification, à contre-courant ? C’est une façon de remettre une dialectique et de se dégager d’un certain fatalisme : oui, la gentrification peut être dépeinte comme une vague puissante de transformation de l’espace, propulsée depuis le cœur de l’économie politique de la production urbaine à l’ère néolibérale, mais cette vague ne déferle pas sur des plages de sable fin totalement lisses, sans rien pour lui faire obstacle, la contrecarrer ou la freiner. Il y a bien sûr les résistances conscientes d’elles-mêmes, mais aussi des résistances « en soi » plutôt que « pour soi ».
Gilles Martinet – Ainsi, en habitant on produit des espaces urbains, et on défend par l’action son droit à la ville, si on entend le droit à la ville comme la capacité effective de chacun·e à participer à la production collective de l’espace.
Mathieu Van Criekingen – Tout à fait, si on reprend la définition lefebvrienne du droit à la ville, et pas sa version dégradée ou affadie qui en fait un droit à disposer de services urbains. Dans son principal plan stratégique de développement urbain, le Gouvernement bruxellois présente même le droit à la ville comme une condition de l’attractivité de la ville…
À nouveau, je pense que le droit à la ville ne se revendique pas qu’à travers des luttes urbaines, même si ces luttes sont bien sûr essentielles. Résister à la gentrification, c’est défendre un droit à la ville populaire, et ça passe aussi par la défense de tout un ensemble de ressources matérielles, sociales ou symboliques produites collectivement dans et à partir des quartiers populaires. On peut prendre l’exemple des marchés populaires. À Bruxelles, un grand marché se tient chaque week-end dans le quartier de Cureghem. Plein de gens le fréquentent, parfois en venant de très loin, parce qu’iels y trouvent toute une série de produits bon marché ou qui correspondent à des habitudes culturelles, mais aussi parce que c’est un lieu de rencontre, de socialisation, de respiration. C’est un espace à la fois utilisé et produit collectivement par celles et ceux qui le fréquentent, un lieu qui participe à l’appropriation du quartier par ses habitant·es.
Or, depuis quelques années, une série d’initiatives publiques ou privées essaient de changer ce lieu, de transformer son image populaire pour en faire un endroit plus cool, plus innovant – cela va de projets d’agriculture urbaine à l’organisation d’afterwork parties et bientôt, peut-être, à l’aménagement d’une piscine avec un bar au-dessus d’un nouveau parking. Cet imaginaire-là ignore complètement la dimension de ressource de ce lieu tel qu’il fonctionne aujourd’hui, où même le dénigre. La lutte contre la gentrification est donc une bataille qui porte aussi sur les imaginaires de la ville, contre les stigmatisations des espaces populaires.
Gilles Martinet – Votre livre a donc notamment comme objectif de participer à la transformation des regards portés sur ces espaces populaires. Est-ce que vous pourriez développer davantage les motivations qui sous-tendent la rédaction de cet ouvrage – ouvrage qui, dans sa forme comme dans son contenu politique, s’adresse aussi à un public hors de l’université et du monde académique ?
Mathieu Van Criekingen – Ce livre est notamment né d’un désir de réaffirmer la substance proprement politique du concept de gentrification, et d’ainsi essayer de contribuer à repolitiser une série de débats urbains. En un mot, la gentrification est une violence sociale et symbolique qui passe par un réaménagement de classe de l’espace. Il n’a rien à voir avec de faux concepts très présents dans les discussions comme la « boboïsation » ou le « retour de la mixité sociale dans les quartiers ». Mais je me suis aussi lancé dans l’écriture de ce livre – mon premier, je n’en ai pas écrit d’autres – pour participer à un débat au-delà du champ académique. Je suis en quelque sorte la trajectoire du concept lui-même : à l’origine, la gentrification est un mot de chercheur·ses, puis ce mot a débordé hors du champ académique, comme une rivière sortie de son lit. Mon objectif n’était pas de faire un état des savoirs sur la gentrification à destination d’autres chercheur·ses, mais de m’appuyer sur toute une série de travaux académiques, les miens ou d’autres, pour m’adresser à ceux et celles qui, d’une manière ou d’une autre, sont concerné·es par cette question, dans divers milieux associatifs, militants ou professionnels. Et je dois dire que ce qui m’a pris le plus de temps – j’ai mis 6 ans à écrire ce livre – c’est de parvenir à me dégager d’un certain formalisme académique, d’un certain jargon. Parler des « recompositions territoriales à l’heure de la mondialisation », ça passe inaperçu dans un texte académique, mais au fond ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne permet pas d’engager vraiment une discussion. Dans le livre, je parle plutôt de convoitises sur des espaces et de résistances à ces convoitises, ce qui permet, me semble-t-il d’entrer dans le vif du sujet : qui convoite les quartiers populaires, pourquoi et de quelle manière ? Qui ou qu’est-ce qui leur résiste, et comment ? etc.
Enfin, j’ai aussi voulu écrire ce livre à partir de quelque part, Bruxelles en l’occurrence, la ville où j’habite et où je travaille, le seul espace à partir duquel je me sens autorisé à parler. Je voulais ancrer les idées et les concepts dans des réalités urbaines situées, et donc nécessairement singulières, plutôt que de m’en tenir à des discussions hors-sol. Mon espoir est que ce propos à la fois situé et générique puisse donner à penser à des lecteur·ices qui vivent dans d’autres espaces.
Gilles Martinet – Puisque nous parlons du travail de chercheur·ses, nous pouvons peut-être conclure avec l’épilogue du livre. Qu’est-ce que cela signifie, aujourd’hui, de publier un livre qui affiche ses objectifs politiques et se nourrit de travaux de recherche ? Si les débats urbains sont autant « dépolitisés », comme vous le disiez, est-ce aussi en partie parce que des prises de position comme celle-ci, à partir des travaux de recherche, sont rares ?
Mathieu Van Criekingen – À mes yeux, l’analyse critique n’a pas beaucoup de sens si elle ne vise pas aider à construire un positionnement par rapport aux questions traitées, et ça commence par la construction de son propre positionnement. Ensuite, c’est la moindre des choses, il me semble, que de dire à quel positionnement je suis moi-même arrivé à partir de l’analyse menée. Sur ce plan, je trouve que beaucoup d’universitaires se gardent trop facilement de prendre position. Je sais bien que le contexte français est très pesant en ce moment, c’est un peu différent en Belgique – personne ne traque les « islamo-gauchistes » dans mon université, que je sache… – et les choses sont donc sans doute un peu plus simples pour moi…
Néanmoins, en Belgique comme en France, et dans beaucoup d’autres pays encore, nous sommes depuis plusieurs années dans un moment où l’institution universitaire se transforme en institution de marché, au prétexte de la quête de « l’excellence ». Dans ce cadre, c’est l’accompagnement savant de projets portés par des institutions de pouvoir qui est la posture la plus « porteuse » en termes de reconnaissance institutionnelle. Si on ajoute à cela la précarisation croissante de très nombreux chercheur·ses, on comprend pourquoi se développe cette tendance à ne pas prendre position, ou à bien séparer travail académique et prise de position. Mais je pense qu’on y perd beaucoup. Imagine-t-on, par exemple, que les chercheur·ses du GIEC puissent faire autre chose que de mettre leur science au service de la lutte contre le changement climatique ? Nous aussi, dans le champ des études urbaines, on devrait davantage prendre position, sur la base de ce que nous apprennent nos recherches. En somme, j’ai voulu à la fois écrire contre « l’excellence urbaine » et contre « l’excellence académique ».
*
Photo d’illustration : Mathieu Van Criekingen.
Notes
[1] Collectif Rosa Bonheur, La ville vue d’en bas. Travail et production de l’espace populaire. Paris, éd. Amsterdam, 2019. Voir ici même l’entretien en compagnie d’Antonio Delfini.
[2] Matthieu Giroud, « « Résister en habitant » : les luttes dans des quartiers populaires à l’épreuve du renouvellement urbain », Contretemps, 2005, n° 13.