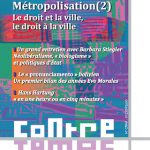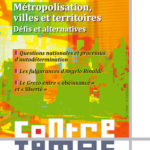Combattre le capitalisme urbain
Logement, écologie, organisation du pouvoir, justice sociale, mobilité : les combats autour des enjeux urbains connaissent aujourd’hui une nouvelle vigueur. Ils ont en commun d’émaner de mobilisations qui mettent l’espace au cœur de la lutte pour l’émancipation, l’autonomie et les conditions de vie. Ce point commun ne doit cependant pas masquer le fait que la question spatiale, et en particulier la question urbaine, manque aujourd’hui d’une perspective politique radicale.
En réunissant vingt-quatre contributions1, Tenir la ville tente de défricher un chemin, de tracer une feuille de route, que les rencontres autour du livre prolongeront.
Cet article est un condensé remanié de la conclusion du livre Tenir la ville. Luttes et résistances contre le capitalisme urbain, du Collectif Asphalte, qui vient de paraître aux Éditions les Étaques.

« Il fait froid dans nos HLM, mais nous on est chauds » / « Non aux expulsions » / « S’ils expulsent les potagers, on labourera le bitume » / « On ne veut pas être concertés, on veut décider » / « Non aux Zones à forte Exclusion »…
La conflictualité est permanente dans les espaces urbains : entre locataires et propriétaires, entre population et pouvoirs publics ou intérêts privés, entre acteurs de l’urbanisme eux-mêmes. Qu’elle emprunte les chemins de l’illégalité ou ceux de la négociation, elle engendre une multitude de résistances quotidiennes, individuelles ou collectives. Mais les luttes – moments où cette conflictualité surgit et conduit à un affrontement, quels qu’en soient le terrain et les modalités – sont assez rares. Et si, comme l’illustrent ces slogans, ces luttes existent, elles n’atteignent que rarement le seuil critique à même de faire de l’espace un enjeu et un clivage central des luttes politiques.
La ville, comme forme historique, peut sembler irrémédiablement abîmée tant dans sa forme physique – nappes pavillonnaires, quartiers fermés, muséification des centres anciens, zones logistiques ou commerciales à perte de vue – que dans les possibilités d’y habiter dans de bonnes conditions pour le plus grand nombre – du fait de la spéculation, de la « montée en gamme » des logements et des commerces, de la touristification, de l’inadaptation des logements au dérèglement climatique, du prix des loyers, de la surveillance et du contrôle policier. Dans ce contexte, partir à la « campagne » apparaît comme une solution désirable pour une large fraction de la population, mais cette alternative ne constitue une possibilité réelle que pour une petite minorité2.
À contre-pied de ces deux tendances, nous prenons le parti de l’urbain. Ce n’est pas une option de la « Ville » contre la « Campagne », mais un choix pour s’inscrire dans une réalité historique qui nous semble incontournable. Les pensées antiurbaines en vogue, des fantasmes d’exode urbain au survivalisme, outre leur essentialisme qui flirte avec le mythe du bon sauvage, sont réactionnaires au sens où elles reproduisent ce paradigme individualiste de la concurrence de toutes contre tous pour les ressources, que celles-ci soient foncières, nourricières ou simplement de bien-être. Elles tendent aussi parfois à délaisser la question sociale et la question politique au profit d’un illusoire « en dehors ». Ce faisant, elles promettent un avenir aussi inégalitaire que la société actuelle, dont les plus fragiles sont exclus et où seuls les plus forts – économiquement comme physiquement – peuvent s’épanouir. Défendre la société urbaine – comme communauté coopérante pour permettre la satisfaction des besoins – c’est considérer au contraire que l’autonomie est le geste réalisé en commun, que le pouvoir se conquiert par l’interdépendance. L’interdépendance, qui est précisément la prise en compte conjointe des besoins et des envies de l’individu et de la communauté, sans faire fi des contradictions du social.
Il n’est pas question de défendre la forme actuelle de la ville, configurée et organisée par la dynamique du système de production capitaliste. Celui-ci – plus encore dans sa forme néolibérale – nous assigne au statut d’individus supposément autonomes en concurrence permanente avec les autres, dans toutes les sphères de nos existences. Le défaire passe par le geste consistant à refuser radicalement cette définition individualiste de l’autonomie. Certains voudraient nous convaincre de voir dans le « pouvoir des villes », et en particulier des métropoles, la perspective d’un monde meilleur3. Pour cela, toute une mythologie de la cité et du citoyen, de la participation et des communs est mobilisée à l’intérieur d’une critique tronquée. On retrouve ici le ciment d’une certaine idéologie de la participation, de la co-construction des projets, de la « transition ». Cette idéologie est à la racine d’une alliance entre bourgeoisie et classe d’encadrement, qui ont tendance à vouloir résoudre les inégalités par le dialogue et l’éducation. Pour que des alliances porteuses de transformations soient possibles autour de la question urbaine, il est nécessaire de casser le bloc idéologique qui assure la perpétuation apaisée de la production capitaliste de l’espace. En d’autres termes, il revient aux membres de la classe d’encadrement4 – en particulier aux architectes, urbanistes ou fonctionnaires territoriaux, mais aussi aux professionnels du travail social, de la création, de la recherche urbaine – de casser leur alliance avec l’État et le Capital. Mais c’est surtout l’auto-organisation à la base et dans une visée de transformation radicale qui peut fissurer ce bloc.
La mixité sociale comme solution pour réduire les inégalités urbaines, le développement durable comme contribution à la résolution de la crise écologique, la construction massive d’immeubles locatifs comme réponse à la crise du logement, entre autres exemples, sont des inepties relayées par les professionnels de la ville, mais elles relèvent trop souvent encore de croyances partagées. La critique de l’urbanisme n’est donc pas seulement un travail de déconstruction qui vise à donner des clés de compréhension de son fonctionnement et des outils pour s’y opposer : elle est aussi une entreprise de fragilisation de son socle idéologique dans le but de produire une reconfiguration des alliances de classes. Le pouvoir d’organiser la vie quotidienne passe par le fait de produire un espace dans lequel elle puisse être différente. Prendre le pouvoir sur la production de l’espace est donc à la fois une nécessité vitale et une possibilité de changer le monde.
S’organiser dans la durée
Les luttes pour l’espace durent longtemps et doivent faire avec l’héritage historique, tant physique qu’institutionnel. L’espace est le résultat d’aménagements passés, fruit de confrontations et de rapports de force : un vaste terrain laissé en friche par le départ de l’industrie, une zone d’aménagement différé gelée par les luttes passées, des immeubles menaçants de tomber en ruines, des grands ensembles dénigrés, des infrastructures routières. Ce sont aussi des institutions — État central, communautés urbaines, municipalités, mais aussi aménageurs, urbanistes, promoteurs — qui donnent les ordres, prennent les décisions, fixent les orientations et les mettent en œuvre. Toutes les luttes rassemblées dans Tenir la ville font face, plus ou moins longtemps et fortement, aux institutions. Mais elles le font de différentes manières – entre les associations qui acceptent de jouer le jeu de la participation institutionnelle et les collectifs plus ou moins formels qui envisagent leurs modes d’action et leur agenda dans une extériorité complète à l’institution. La thématique de l’institution est, en ce sens, inextricablement liée à celle des objectifs assignés aux luttes et notamment du rapport au pouvoir.
La question de l’organisation est patente dans l’ensemble de l’ouvrage. Elle fait face à une difficulté majeure : celle de tenir dans la durée tout en échappant à des formes stérilisantes d’institutionnalisation. C’est explicite quand le municipalisme cède la place au citoyennisme ou, à l’inverse, se rêve en communalisme, quand une association glisse de la contestation à l’accompagnement des politiques publiques. Cela se voit aussi quand les institutions évoluent au contact des luttes et digèrent en partie leurs revendications pour mieux les neutraliser. Là où les comités d’habitants et d’habitantes et les associations de défense du cadre de vie se sont progressivement institutionnalisés, là où les résistances ont en partie intégré des objectifs gestionnaires, les luttes urbaines contemporaines doivent souvent recréer de la conflictualité pour réarmer de nouveaux mouvements.
S’agit-il de transformer des mouvements en luttes dans la production de l’espace en structures formelles pérennes ? C’est ce que voudrait un syndicalisme radical des quartiers populaires ou ce qui peut naître du renouveau des associations de locataires. S’agit-il au contraire d’en faire des formulations momentanées, souples et orientées vers des objectifs définis, après lesquels il s’agit de se dissoudre pour réapparaître sous d’autres formes et dans d’autres espaces ? C’est ce qu’incarnent certains squats – notamment pour faire face à la répression –, les mouvements spontanés qui surgissent quand des immeubles s’écroulent et qu’il faut réagir dans l’urgence, ou les destructions d’engins de chantier pour stopper net des travaux. Ces deux tendances peuvent coexister, de façon conflictuelle ou complémentaire, par exemple lorsque occupations et batailles juridiques soutiennent le même combat.
Enfin, les rapports sociaux traversent les habitantes et habitants : il n’y a pas d’unité préexistante, bien au contraire. Il y a tout à gagner à prendre la mesure de ces rapports et à comprendre les intérêts divergents, les réalités différentes, les rapports de force internes, pour n’oublier personne et pour gagner en puissance.
L’espace des rapports sociaux de domination
L’interdiction de certains espaces ou l’assignation à d’autres sont centrales dans la mécanique d’exclusion au cœur des rapports de domination. Les voyageuses et voyageurs sont cantonnés à des espaces isolés et pollués, ce qui génère des effets directs sur leur santé et leurs conditions de vie. Les femmes et les minorités de genre subissent harcèlement et violence dans l’espace public. Les classes populaires issues de l’immigration postcoloniale se trouvent assignées à résidence et sont la cible depuis plus de trente ans d’une entreprise de déplacement et de destructions de leurs logements dans une relative indifférence du reste de la société. L’aménagement réalisé à l’aune des corps valides et de leurs capacités exclut une part immense de la population. L’accessibilité est une question de justice sociale, à savoir la capacité collective à penser les nécessités des personnes sur le plan physique et mental.
Ces questions sont aujourd’hui liées à un aménagement de l’espace conditionné par la logique marchande : il faut produire rapide, fluide, efficace, lucratif. Mais elles sont aussi prégnantes dans les efforts déployés pour construire des luttes et pour faire vivre des résistances. Les habitants et les habitantes sont très largement mobilisées au fil des pages de Tenir la ville comme la figure de celles et ceux qui pourraient prendre le pouvoir des lieux dont elles et ils ont l’usage. Cette figure donne l’illusion d’une homogénéité et masque l’incontournable question des rapports sociaux. Dans un quartier, a fortioridans une ville, il n’y a pas une unité latente, déjà-là, à réaliser, qui serait à la convergence d’intérêts naturels des personnes qui habitent là. Il y a au contraire des rapports de force, des méfiances, des antagonismes. Partir des espaces concrets, c’est d’abord partir de ces fractures pour tenter de construire des convergences. Et celles-ci sont nombreuses. Classes populaires et classes moyennes précarisées sont confrontées à des difficultés de logement relativement similaires : se battre pour une ville financièrement accessible, où le choix du quartier relève davantage du désir que de la solvabilité, c’est lutter pour le plus grand nombre. S’engager pour des espaces urbains accueillants pour les personnes handicapées, c’est batailler aussi pour qu’ils le soient pour les enfants, les personnes ponctuellement invalides ou les personnes âgées.
Refuser de voir ces rapports sociaux inégalitaires fait prendre le risque de reproduire des rapports de pouvoir identiques à ceux que l’on prétend combattre. Accepter le validisme parce qu’il n’est jamais urgent de rénover le local et qu’il est contraignant d’appliquer des principes d’autodéfense sanitaire en réunion, laisser faire des comportements sexistes ou racistes parce qu’on est pris dans l’effervescence d’une occupation ou d’un mouvement social, c’est se priver de forces vives pour penser et agir. Cela pose la question de l’espace dans lequel nous voulons vivre. D’une part, penser l’abolition de rapports sociaux inégalitaires influence la définition des réalisations matérielles désirables, afin qu’elles répondent aux besoins de toutes et tous. D’autre part, cela pèse sur la détermination des modes d’organisation, et notamment sur la question de savoir qui milite au nom de qui – comme c’est trop souvent le cas lorsque des militants et militantes de la classe d’encadrement parlent ou négocient au nom des personnes exilées ou des habitants et habitantes davantage convoquées qu’incarnées.
La propriété foncière ou l’éléphant au centre de la pièce
Il est notable que, dans l’extensive littérature sur la ville, la question de la propriété foncière soit si peu abordée. Cycliquement, la promesse d’une « France de propriétaires » vient fleurir les discours politiques. De fait, la propriété de son chez-soi possède une puissante force d’attraction dans toutes les couches de la société. Si pour certains « la propriété c’est le vol », elle sécurise nombre de nos contemporains et contemporaines, en tentant de garantir la sécurité d’un toit pour les vieux jours ou d’assurer la reproduction du patrimoine familial5.
La constitution d’un marché du logement de masse a été une entreprise longue, à la fois par le développement d’une filière de la construction et par l’incitation à la création d’une capacité d’achat financée par la dette. Cette stratégie, constante depuis les années 1970, de privilégier la solution individuelle dans l’accès à la propriété a profondément marqué la société et le paysage. En France, depuis les années 20006, le prix à l’achat des logements a été en moyenne multiplié par deux. Cette moyenne masque de profondes différences territoriales, les prix allant du simple au triple. En 2021, 58 % des ménages sont propriétaires de leur logement7 et 20 % sont encore « accédants » (ils remboursent encore leur crédit), mais 3,5 % des ménages détiennent 50 % des logements privés à la location8.
La différence se fait entre ceux et celles qui peuvent constituer un patrimoine et les autres. Les inégalités de patrimoine ont une influence décisive, au moins aussi importante que celle des revenus, sur l’accès au logement, sur le choix du lieu de résidence et par conséquent sur la qualité de vie. Les inégalités d’accès au logement sont alors tout à la fois économiques, générationnelles et territoriales. Elles sont influencées par les rapports sociaux de domination, par les revenus et par les habitudes de consommation. L’acquisition d’un bien immobilier est le lieu de stratégies complexes individuelles et familiales. C’est aussi un terrain d’intervention des politiques de crédit, de la construction et de la redistribution (via l’impôt, les crédits d’impôt, les prêts à taux zéro et les prêts patronaux). C’est donc une thématique profondément politique et pourtant bien peu investie politiquement, et encore moins collectivement.
La propriété n’est pas non plus le socle solide que se figure un imaginaire collectif aujourd’hui répandu. Pour beaucoup, accéder à la propriété, c’est avant tout accéder à des dettes et à une pression qui vaut bien celle d’un loyer. Contraignant fortement les possibilités d’achat, les prix du foncier entraînent souvent un éloignement des lieux de travail et de sociabilité, et mécaniquement des coûts de déplacement supplémentaires, sans compter les frais d’entretien qui peuvent parfois s’avérer très élevés. Le mouvement des Gilets jaunes a en partie été composé de ces personnes qui ont cherché à améliorer leur situation en s’achetant une maison là où c’était possible, et qui se trouvent mises sous pression par la hausse des coûts de transport9.
Nous avons peu d’outils pour penser notre positionnement de classe au regard du temps long du patrimoine, ce qui complexifie l’immédiateté d’une analyse en termes de revenu. Par exemple, la communisation du patrimoine est rarement prônée, malgré son potentiel de subversion de l’ordre capitaliste, mais aussi de l’ordre patriarcal et familial bourgeois10. Produire un habitat social en favorisant la propriété collective, c’est l’option prise en Uruguay par les coopératives de logement par aide mutuelle. En plus de favoriser un accès à un logement de qualité pour les classes populaires, elle participe de la constitution d’une force collective inscrite dans la lutte des classes. Le rapport à la propriété induit une forme d’organisation sociale : la propriété individuelle favorise l’atomisation, la propriété collective l’agir en commun11. En attendant de se donner les moyens de son abolition, il est sans doute nécessaire de construire des formes juridiques qui permettent de passer outre la propriété privée inaliénable et de privilégier une propriété d’usage.
Prendre le pouvoir sur la production de l’espace
Les différentes expériences relatées dans le livre et les questions qu’elles soulèvent confortent l’hypothèse que dans l’urbain se joue une bataille importante pour l’autonomie et l’émancipation. La forme des villes, le logement, l’aménagement des périphéries, le déploiement des infrastructures, les déplacements, les manières dont nous pouvons nous réunir et nous rencontrer là où nous vivons : toutes ces choses que nous désignons comme « l’urbain », tout à la fois matérialités et relations sociales, doivent être pensées politiquement. D’une part, car s’attaquer à l’urbain, c’est s’attaquer conjointement, et inextricablement, à la fois à l’État et au Capital – dont l’action commune est particulièrement visible en contexte néolibéral. D’autre part, parce que l’urbain est un champ de luttes où pourraient se nouer des alliances en dehors de la fragmentation du monde du travail : le logement, le transport, l’accès à l’espace public ou à la nature sont des problématiques où les intérêts des classes populaires et d’une partie de la classe moyenne peuvent se rejoindre, car elles sont faites de galères en partie communes. Dans la pratique, c’est très rarement le cas, car le plus souvent les classes moyennes s’enrôlent au service de la bourgeoisie pour reproduire l’ordre social capitaliste. C’est la malédiction et l’opportunité des luttes urbaines : opportunité de prendre appui sur la vie quotidienne et par là d’échapper un tant soit peu aux strictes nécessités de l’économie et à la logique des intérêts ; malédiction de se retrouver trop souvent sous l’hégémonie des plus aisés.
Dans le camp du pouvoir comme dans celui des luttes, l’urbain est trop souvent « naturalisé », pensé comme une conséquence d’autres réalités plus importantes : la politique et le travail. En agissant sur le terrain de l’espace, il ne s’agit pas d’épouser le spatialisme du pouvoir qui prétend agir sur l’espace pour transformer les rapports sociaux (construire des logements, raser des barres ou des tours, aménager des espaces publics et des infrastructures de transport). Il s’agit à l’inverse de partir des pratiques et d’attaquer le discours dominant, en considérant l’espace comme une réalisation concrète des pratiques sociales — de penser à partir de nos vies quotidiennes, de leur banalité, de ce que nous sommes là où nous sommes. Outre sa dimension transversale à tous les aspects de l’existence, l’espace a un autre intérêt politique : il représente à la fois l’objet de nos détestations – en tant qu’incarnation matérielle du capitalisme – et celui de nos désirs – en tant que support de projections d’un monde sans exploitation ni domination.
Vers une écologie de classe
Ville durable, écoquartier, déplacement doux : le bréviaire des professionnels de l’urbain est rempli de références à l’urbanité verte. L’écologie se trouve enrôlée dans les stratégies de reproduction capitalistes comme une nouvelle ressource. Au nom du développement durable ou de la transition, le respect de l’environnement est un prétexte pour détruire et pour construire encore plus12. Les compensations et les impacts limités se font passer pour des efforts de préservation.
La marche forcée vers le transport tout électrique repose sur un extractivisme écocide et aggrave les inégalités. Sans transformation de la relation aux déplacements contraints, en particulier ceux liés au travail, l’injonction à « rouler propre » est hors de portée pour une large fraction de la population. Les zones à faibles émissions en sont le symbole. La nécessaire isolation des logements, qui aurait pu fonder un vaste plan d’amélioration de l’habitat pour les classes populaires, a bien souvent été conduite de façon autoritaire en motivant des opérations de démolition-reconstruction ou des rénovations justifiant des augmentations de loyer. Et les politiques environnementales en ce sens bénéficient d’abord aux propriétaires, via des dispositifs de subventions et d’exonérations fiscales de la rénovation ou par l’augmentation de la valeur des biens.
Mais le capitalisme vert n’est pas la seule écologie possible. La destruction systématique des terres, des cours d’eau et de l’atmosphère vient renforcer la pertinence à investir la question spatiale. Les luttes de défense des jardins populaires et celles des voyageurs et voyageuses contre le racisme environnemental montrent comment l’écologie est elle-même un espace de conflit, opposant une écologie capitaliste à une écologie populaire, inscrite dans la lutte des classes, antiproductiviste et mise en œuvre par les personnes concernées.
Les combats contre les grands projets inutiles et imposés et les luttes écologistes urbaines et périurbaines ont en commun de placer la question de l’aménagement du territoire et de nos manières d’habiter et de circuler sur le devant de la scène politique. Elles sont le terrain d’alliances nouvelles qui soulignent l’importance du territoire dans la possibilité même des luttes. C’est la proximité géographique qui fait émerger ici une lutte commune aux écologistes et aux ouvriers et syndicalistes de la logistique contre la construction d’un nouvel entrepôt, là entre écologistes et communauté voyageuse contre les nuisances auxquelles est exposée une aire d’accueil.
Au sein des combats écologistes urbains, les positions sociales et les cultures politiques différentes mettent en prise des formes de luttes parfois difficiles à combiner : manifestations légales et actions illégales, occupations et batailles juridiques. Au-delà, ou en deçà, de ce qui peut être qualifié de lutte, existent d’innombrables résistances quotidiennes, souvent discrètes, pour le fait de pouvoir faire du vélo dans de bonnes conditions ou de mieux se nourrir. Quels que soient leur objet et leur territoire, résistances et luttes écologistes soulignent enfin l’inextricabilité des enjeux sociaux et environnementaux, qu’elles associent sans les séparer en interrogeant la manière dont il est possible d’habiter et de produire sans saccager nos lieux de vie et sans exclure personne.
Tenir la ville, embrasser l’urbain
Tenir la ville traite de dynamiques générales en s’appuyant essentiellement sur des expériences françaises. C’est aussi à partir de cet espace social, intellectuel, politique et linguistique que nous théorisons, ce qui implique que nos réflexions se nourrissent avant tout de cet espace, où nous vivons et luttons, sans prétention généralisatrice excessive.
Du squat au municipalisme, des luttes féministes dans l’espace à la propriété d’usage, de la sauvegarde de jardins populaires au syndicalisme de quartier, la question qui traverse les combats réunis dans cet ouvrage est celle de la part et de la place des personnes dans la production de l’espace, c’est-à-dire celle du pouvoir qu’elles ont sur leurs conditions d’existence et sur l’organisation de leur vie quotidienne. Les questions sous-jacentes portent sur quoi et comment produire et sur comment maîtriser une répartition juste du pouvoir et des actions. L’enjeu est finalement toujours d’aboutir à une société qui s’organise « de chacun et chacune selon ses facultés, à chacune et chacun selon ses besoins13. »
C’est par les luttes collectives que, parfois, la tendance peut s’inverser. Même si elles sont prises dans des rapports de pouvoir, par nature dissymétriques, les populations peuvent s’autonomiser sur des pans entiers de leur rapport à l’espace. Le pouvoir qui nous intéresse est alors celui, même partiel, même timide, que les habitantes et les habitants reprennent au Capital, à l’État et aux classes dirigeantes et celui qu’elles et ils se donnent pour décider de façon autonome de la manière dont l’espace doit être produit. Comme le montrent les chapitres de cet ouvrage, ce pouvoir est fragile, mais il existe.
La dégradation des conditions d’habitabilité de la planète, l’explosion des inégalités sociales et territoriales, l’émiettement des faux-semblants démocratiques et la perpétuation des mécanismes ségrégatifs les plus variés actualisent la question urbaine et appellent à l’investir à nouveaux frais. La prendre à bras-le-corps implique conjointement de penser l’ensemble des processus qui engendrent et organisent les espaces urbanisés, de prendre à cœur l’enjeu de la production de l’espace, de s’engager pour y gagner du pouvoir, enfin de saisir sans les laisser s’échapper les opportunités qui permettent de gagner en autonomie. Cette ambition tient en une formule : embrasser l’urbain.
Matthieu Adam, Antonio Delfini, Ariela Epstein, Américo Mariani, du Collectif Asphalte*.
*Asphalte parce qu’on colle à la rue et qu’on ne veut pas laisser la place. Parce qu’il nous fallait trouver un nom qui exprime notre attachement pour la ville et le caractère profondément collectif du projet. Parce que ça sonnait bien, ni tout à fait politiquement correct, ni tout à fait amour béat. Parce que nous pensons qu’il faut s’amalgamer pour faire pièce à l’aménagement capitaliste de nos vies et aux différents rapports de domination qui structurent nos espaces. Parce que nous pensons qu’écrire un livre c’est participer à défricher un chemin, à tracer une feuille de route.
à voir aussi
références
| ⇧1 | Les vingt-quatre chapitres racontent autant d’expériences de combats contre le capitalisme urbain. Leurs formes varient. Certains chapitres sont des récits de luttes et de résistances particulières. D’autres présentent des réflexions sur des thématiques particulières en s’appuyant sur des exemples de conflits variés. D’autres encore sont des entretiens avec les protagonistes de certains combats. Le livre comprend aussi des cahiers thématiques qui décrivent des facettes centrales du processus capitaliste de production de l’espace urbain. Ils sont accompagnés par un poster et par un bréviaire du vocabulaire des professionnels de l’urbain. |
|---|---|
| ⇧2 | Delage Aurélie et Rousseau Max, « L’“exode urbain”, extension du domaine de la rente », Métropolitiques, juillet 2022. |
| ⇧3 | Barbier Clément, « Le mythe de la métropole attractive », Métropolitiques, mars 2023 |
| ⇧4 | Alain Bihr propose là une alternative aux notions floues de « classe moyenne » ou de « petite bourgeoise. » La classe d’encadrement est définie par sa fonction dans la division sociale du travail. Elle regroupe celles et ceux qui assurent « les tâches d’encadrement (d’organisation, de conception, de légitimation, de contrôle) des groupes sociaux, des pratiques sociales, des rapports sociaux, dont la fonction générale est d’assurer la reproduction globale du capital, c’est-à-dire sa domination non pas sur le seul acte social de travail […], mais plus largement sur la société dans son ensemble et à tous ses niveaux (économique, social et politique). » (Bihr Alain, Entre bourgeoisie et prolétariat. L’encadrement capitaliste, Paris, L’Harmattan, 1989, p. 1-2). |
| ⇧5 | Ce qui passe par l’achat d’une résidence principale, mais aussi, bien souvent, par celui d’une résidence secondaire (10 % du parc de logements France métropolitaine) ou d’un bien destiné à la location (ce qu’on nomme la propriété lucrative). Ces deux marchés structurent aussi la distribution du foncier et l’accès au logement. |
| ⇧6 | Voir les travaux de Jacques Friggit, en ligne ici. |
| ⇧7 | Insee, « 37,2 millions de logements en France au 1er janvier 2021 », Insee Focus, n° 254, 2021. |
| ⇧8 | Insee, « 24 % des ménages détiennent 68 % des logements possédés par des particuliers », Portrait social. Édition 2021, 25 novembre 2021. |
| ⇧9 | Blavier Pierre, Gilets jaunes, la révolte des budgets contraints, Paris, PUF, 2021. |
| ⇧10 | Gollac Sibylle et Bessière Céline, Le Genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités, Paris, La Découverte, 2020. Extrait ici. Entretien là. |
| ⇧11 | La propriété individuelle ne conduit cependant pas plus mécaniquement à l’individualisme que la propriété d’usage ne conduit à lui échapper définitivement. |
| ⇧12 | Valegeas François, « Ville durable », in Adam Matthieu et Comby Émeline (dir.), Le Capital dans la cité, op. cit., p. 377-391. |
| ⇧13 | Selon le vieil adage qui, de Louis Blanc à Kropotkine en passant par Marx, définit l’horizon d’une société affranchie du mode de production capitaliste. |