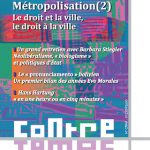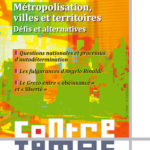Pour les luttes urbaines. Les enseignements du mouvement de l’Alma-Gare
À travers une lecture du livre de Paula Cossart et Julien Talpin Lutte urbaine. Participation et démocratie d’interpellation à l’Alma-Gare, Antonio Delfini revient sur la question des luttes urbaines à la lumière de la dite « démocratie participative ».
La thématique des luttes urbaines a connu une fortune contrastée depuis son apparition à la fin des années 1960. Largement investie par la sociologie urbaine marxiste dans les années 1970, elle est peu à peu tombée dans l’oubli, passée de mode. Reprise ensuite par les sociologues des mouvements sociaux notamment au Québec et en Amérique du Sud, elle connaît aujourd’hui un – relatif – renouveau en France à la faveur d’une recrudescence des approches critiques de l’urbanisation capitaliste.
L’ouvrage chroniqué ici se propose d’aborder l’objet des « luttes urbaines » à partir d’un autre angle : la littérature consacrée à la « démocratie participative ». En se concentrant sur l’une des luttes les plus symboliques de cette vague de mobilisations née dans l’après-68, il s’agit en effet pour ses auteurs de montrer en quoi l’expérience de l’Alma-Gare peut être source d’enseignement pour les politiques de démocratie participative. Or, si cette approche aboutit à des réflexions stimulantes pour ce champ de recherche, il est également possible de faire une autre lecture de cet ouvrage. Une lecture qui viserait moins à outiller l’offre de participation via des politiques publiques – par le haut – qu’à favoriser l’émergence de formes de politisation et mobilisation autonomes dans les quartiers populaires – par le bas. En ce sens, si ce livre est présenté comme un outil pour la mise en place de politiques de participation, il peut également être lu comme un petit manuel de la lutte urbaine, décrivant par le menu les différentes phases par lesquelles est passée cette lutte au long cours, en ne manquant pas de souligner ses forces mais aussi ses écueils. C’est à partir de cette seconde position que nous rendrons compte ici de cet ouvrage en suivant une histoire, pas toujours heureuse, qui va de la victoire d’une lutte urbaine à l’échec d’un changement global de société. Enfin, nous reviendrons dans un troisième temps sur un des ressorts important des mouvements de lutte contre la rénovation urbaine.
La victoire d’une lutte urbaine
La naissance de la mobilisation du quartier de l’Alma-Gare à Roubaix ressemble à un air connu. Un quartier ouvrier voué à la destruction par des politiques urbaines qui cherchent à reconvertir dans le secteur tertiaire une métropole touchée de plein fouet par la désindustrialisation. Des habitants concernés par les expulsions et expropriations qui s’organisent aux côtés de militants politiques plus aguerris issus des mouvements catholiques ouvriers et de l’extrême gauche. Création des Ateliers populaires d’urbanisme et des régies de quartier, infléchissement des politiques de rénovation urbaine, participation des habitants… Depuis plus de quarante ans, la mobilisation des habitants du quartier de l’Alma-Gare à Roubaix dans les années 1970 a fait l’objet de nombreux écrits et discours qui ont participé à en faire un mythe. C’est ce mythe qui est déconstruit ici en analysant, suivant un plan chrono-thématique, les différentes étapes de la lutte.
Mobiliser le quartier. « À problème individuel, réponse collective ». Tel pourrait être le credo des militants de l’Alma-Gare dans le travail de mobilisation des habitants du quartier. En effet, si « la résolution directe des problèmes liés à la vie quotidienne est au cœur de la mobilisation » les réponses qui leur sont apportés doivent avant tout éviter l’individualisation. Dans cette perspective, le mouvement est rapidement confronté aux pratiques des travailleurs sociaux, facteurs de dépolitisation des enjeux de la rénovation, de démobilisation des familles et en fin de compte de départ du quartier. Il s’agira donc pour l’Association populaire des familles, sur lequel nous reviendrons plus loin, de reconstruire du collectif sur la base des problèmes individuels : les expulsions ou les expropriations. Un des enseignements de cette lutte, c’est que « la mobilisation de l’Alma est concrète (s’attaquer à la question du logement) et permet de résoudre rapidement certains problèmes, convainquant les habitants que la lutte paie. » Pour le dire autrement, gagner des petites victoires à court terme, améliorer sa situation individuelle : voilà qui permet de se donner de la force pour continuer d’avancer collectivement.
La démocratie dans le mouvement. Quand l’usine n’est plus l’espace et l’enjeu de la lutte, comment reconstituer un espace commun pour l’organisation ? Le pari de la lutte de l’Alma sera de s’appuyer sur la figure de « l’ouvrier-habitant », inséré à la fois dans les rapports de production et dans une communauté de quartier. À partir de 1974, le mouvement de l’Alma-Gare va créer l’Atelier populaire d’urbanisme (APU), pendant du syndicat dans le quartier. Empruntant pour partie son nom à l’Association populaire des familles (APF), structure d’obédience catholique dont plusieurs membres sont des éléments militants cruciaux pour l’avenir de la lutte, il rassemble également des militants gauchistes (principalement maoïstes) et les habitants du quartier. La structure se dote rapidement d’un local qui accueillera pendant dix ans une réunion hebdomadaire, « la réunion du mercredi ». Elle est un lieu de débat, de recherche d’information, de régulation de la vie sociale et d’élaboration d’une démocratie de quartier. Si certaines formes de domination se rejouent dans les discussions entre militants et habitants, ces derniers sont incités à prendre la parole notamment par la valorisation de leurs témoignages individuels. Cette inégalité dans la prise de parole est pourtant contrebalancée par ce que les auteurs nomment la « démocratie dans la relation ». Dans ce cadre, les porte-parole tiennent leur légitimité de leur insertion dans la vie quotidienne du quartier, le réseau de connaissance et d’interrelation noué au fil du travail militant de mobilisation.
Équiper et financer la lutte. Comment imposer un rapport de force avec les décideurs ? Comment se faire reconnaître comme interlocuteur légitime et réussir à peser dans les décisions fondamentales d’un projet urbain ? Voilà quelques-unes des questions qui traversent et ont traversé l’ensemble des mouvements sociaux urbains. L’expérience de l’Alma nous donne ici un début de réponse par la mise en place d’une « aide technique » à la mobilisation via l’intervention de trois architectes et d’un sociologue regroupés dans un collectif, l’ABAC La création d’outils, comme les « fiches santé » pour chaque maison ou la « carte affiche » comme alternative au projet municipal de rénovation, participent à l’élaboration d’une compétence technique au sein du mouvement et à la concrétisation d’un contre-projet. Derrière cette expérience, centrale dans l’histoire de la lutte de l’Alma, plusieurs questions apparaissent. Tout d’abord celle de la place des chercheurs dans les luttes. Plusieurs entretiens avec des universitaires ayant travaillé sur l’Alma à l’époque font apparaître leur volonté de contribuer au changement social. Ils se décrivent alors comme « spectateurs engagés » ou « sociologues praticiens ». Le second questionnement est relatif aux conditions de financement des luttes. Le financement de l’équipe d’architectes est attribué par le ministère de l’équipement en 1975. Il permet alors une autonomie financière vis-à-vis des pouvoirs publics locaux et l’entrée dans un rapport de force libéré de la tutelle financière qui pèse souvent sur les collectifs associatifs ou militants dans les quartiers populaires.
Conflits et négociations. Une fois le mouvement constitué, les modalités de décision en interne élaborées, la légitimité auprès des pouvoirs publics conquise… tout reste à faire : s’imposer dans la négociation. Là encore, l’expérience de l’Alma est riche d’enseignements à travers ce que les auteurs ont appelé une « concertation conflictuelle ». Les exemples sont nombreux de mobilisations qui, une fois intégrées au processus décisionnel, sont d’une certaine manière plus contrôlables et contrôlées par les décideurs. Pour se prémunir contre ce genre de récupération, la lutte de l’Alma s’est attachée à ne jamais quitter l’espace du quartier pour celui des salles de réunions : les actions directes et symboliques (le relogement de la grand’ mère, la manif des seaux d’eau, etc.) rythment les différentes étapes du rapport mouvement/pouvoir publics. En juin 1977, face à des tentatives de blocage et de passage en force de la municipalité sur la question du taux d’insalubrité du quartier, l’APU décrète « la grève de la concertation » et réussit à faire plier la mairie. Les réunions se tiennent ensuite dans le quartier et ce sont les interventions de l’APU qui structurent ces temps de négociation. Par ailleurs, l’APU saura aussi s’appuyer sur un certain nombre d’acteurs « facilitateurs » occupant des positions intermédiaires dans la structure hiérarchique, comme celle des techniciens. On voit ici l’importance de l’utilisation d’un répertoire d’actions diversifié, modulable en fonction de la fluctuation du rapport de force. On voit aussi l’importance de bien connaître son adversaire, ses clivages internes, et de pouvoir jouer stratégiquement sur les différents corps de métiers qui composent les pouvoirs publics.
L’ensemble de ces éléments va entraîner une victoire de la lutte urbaine qui réussit à imposer son projet de rénovation du quartier, à faire entendre la parole des habitants et leurs revendications sur la question du relogement.
L’échec d’un changement de société
Pourtant, la lutte de l’Alma-Gare ne s’est pas arrêtée après la victoire de la mobilisation concernant le choix du projet urbain pour le quartier. Confronté à une hausse massive du chômage dans le quartier, le mouvement de l’Alma tente de poursuivre la mobilisation dans d’autres domaines. La création de coopératives de quartier (SCOP dans les secteurs de l’imprimerie, du bâtiment, de la menuiserie, etc.) permet l’embauche d’habitants dans ce qui préfigure l’économie sociale et solidaire. Les idéaux autogestionnaires de l’époque incitent les militants à cogérer le quartier dans le domaine de l’éducation, avec la création de l’école ouverte Elsa Triolet, dans l’animation et la gestion des espaces publics, avec la première régie de quartier, et enfin dans celui des politiques de peuplement, par la mise en place d’ateliers relogement. Les auteurs constatent pourtant l’échec de ce second temps de la mobilisation qui porte il est vrai une ambition beaucoup plus large : au-delà de la seule question du logement, il s’agit de transformer plus largement toutes les sphères de la vie (éducation, emploi, sécurité, etc.).
Cet échec peut s’expliquer par deux séries de raisons : externes tout d’abord, qui résultent des évolutions économiques et politiques de la ville de Roubaix ; internes ensuite, concernant les décisions ou absence de décision au sein du mouvement. Une fois encore, ces échecs sont riches d’enseignement. À partir des années 1970, la ville de Roubaix est frappée par une désindustrialisation particulièrement massive et rapide. Le climat du quartier va alors rapidement se dégrader. « Incivilités », bagarres, cambriolages, prostitution : malgré les nombreuses interventions, notamment des membres de la régie de quartier, le phénomène s’inscrit dans la durée. En 1983, les thématiques de l’immigration et de la sécurité vont se retrouver au cœur de la campagne municipale roubaisienne remportée par la droite. La montée du racisme est alors particulièrement pesante, donnant même naissance à des milices de quartier1 C’est alors une sorte de revanche qui est prise par la nouvelle municipalité sur le mouvement de l’Alma et qui se traduit rapidement par un tarissement du soutien financier.
Dans le même temps, dans le courant des années 1980, plusieurs orientations internes du mouvement participent à son déclin. Tout d’abord les difficultés de gestion des coopératives de quartier créées à la suite de la lutte urbaine, qui ferment une à une dans les années 1980. Baisse des commandes, difficultés de paiement pour une population pauvre et culture militante qui freine les décisions de licenciement ou les refus d’augmentation de salaire sont parmi les principales raisons. Viennent ensuite les biais bien connus de nombreuses associations qui œuvrent dans différents champs : routinisation du travail militant, difficultés de renouvellement, institutionnalisation. Ces différentes dynamiques ont participé à couper le mouvement du quartier. Le symbole le plus fort est la disparition de la réunion du mercredi à partir de 1983. Les auteurs soulignent également un autre aspect important : le manque de volonté de prendre en compte les discriminations raciales qui structurent de manière importante la vision du monde des populations d’origine maghrébines à Roubaix. D’une certaine manière, l’augmentation du racisme à Roubaix n’a pas trouvé de réponse au sein du mouvement de l’Alma, lequel a voulu effacer ces différences derrière la figure de « l’ouvrier-habitant ».
Classe et communauté : les ressorts des mobilisations
La lutte de l’Alma-Gare n’en reste pas moins, dans sa première phase, un exemple de mouvement social urbain victorieux. Il convient donc dans cette optique de s’interroger sur ce qui a permis l’émergence de cette mobilisation. Quelles conditions ont été réunies pour permettre la victoire de l’APU ? Si les auteurs insistent à juste titre sur le travail militant déployé durant toutes ces années, il semble important d’insister sur un autre aspect propre aux politiques urbaines de rénovation et aux mouvements de contestation qu’elles engendrent.
Le plan de rénovation qui touche le quartier de l’Alma-Gare et de nombreux autres à cette époque s’inscrit dans une histoire plus large de la rénovation urbaine en France. Trois grandes vagues de rénovation ont touchées les villes industrielles du XIXe siècle : l’haussmannisation, la rénovation urbaine des années 1960-1970 et la politique de renouvellement urbain menée depuis le milieu des années 20002. Ces trois vagues de rénovation urbaine ont en commun d’intervenir sur les quartiers pauvres des principales agglomérations en transformant le bâti et la composition sociale de ces espaces. Elles sont, en ce sens, des politiques de classe, qui redessinent la ville pour les nouveaux besoins de l’accumulation du capital et pour modifier les usages et pratiques de certains espaces jugés mal employés3. Très concrètement, la rénovation urbaine attaque les classes populaires sur leur lieu de vie afin de « reconquérir » ces espaces par des politiques de démolition-reconstruction du cadre bâti.
Ces trois vagues de rénovation ont entraîné des formes de résistance dans les quartiers concernés. L’historiographie marxiste a insisté sur les caractères proprement urbains d’un mouvement comme celui de la Commune de Paris. Mais si le caractère classiste de ces mobilisations est indéniable, elles ne peuvent pourtant être analysées uniquement à travers ce prisme. À l’image d’autres quartiers ouvriers, l’Alma rassemble des familles pauvres, aux conditions matérielles d’existence semblables, aux forts liens de sociabilité et de solidarité, ainsi qu’à des pratiques et usages intenses de l’espace public dans le quartier. Ces différents arrangements spatiaux participent à la création d’un sentiment d’appartenance communautaire qui, s’il n’est évidemment pas complètement extérieur à l’appartenance de classe, ne peut s’y résumer. Dans son enquête sur la rénovation d’un îlot du 13e arrondissement parisien, Henri Coing4 écrivait :
« L’existence d’une telle « communauté » n’est rendue possible que par certaines conditions d’habitat (surpeuplement, insalubrité), par la pauvreté de ses membres, leur stabilité, par la polyvalence des fonctions (commerces, loisirs, relations…) et surtout par l’appartenance ouvrière de la population, qui identifiait statut social et mode de vie collectif. […] Toute modification du cadre de vie et de la composition de la population, telle que la réalisera la rénovation, signifie à coup sûr la mort du quartier. »
C’est contre la mort de leur quartier et la sauvegarde d’un mode de vie collectif que se sont mobilisés les habitants de l’Alma-Gare. L’insistance de l’APU sur la figure de l’ouvrier-habitant traduit bien ce fait : l’appartenance de classe ne se manifeste pas uniquement sur le lieu de travail et au sein d’un unique conflit résultant du rapport capital/main d’œuvre. Elle trouve place dans une « culture ouvrière » qui se manifeste également dans les différentes sphères de la vie quotidienne (consommation, loisirs, etc.) rattachés au lieu de vie. David Harvey, dans son analyse de Paris sous le Second Empire5, ne dit pas autre chose quand il constate les formes d’organisation urbaine du prolétariat parisien dans le mutualisme local, les cantines coopératives, les cabarets : « les identifications de classe se forgent autant dans la communauté que sur le lieu de travail », écrit-il. Cette alliance d’une double défense de classe et communautaire nous semble un des aspects les plus récurrents des luttes urbaines contre la rénovation urbaine. Aujourd’hui, les transformations du monde ouvrier, la dispersion des classes populaires et l’augmentation massive du chômage renforcent peut-être d’autant plus cette nécessaire prise en compte de l’appartenance à une communauté de quartier dans les ferments des mobilisations des classes populaires. C’est en tout cas à cette question qu’il convient de réfléchir pour construire les luttes urbaines de demain.
Le 6 janvier dernier, un article du Monde relatait la mobilisation d’habitants roubaisiens dans le quartier du Pile – voisin de l’Alma – concerné par un important projet de rénovation dans le cadre du « Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés » (PNRQAD). Rassemblés au sein d’une « table de quartier », ils contestent « le bien-fondé des démolitions »6 et font face à une répression « à bas bruit » de la part de la municipalité.7 Rénovation et luttes urbaines : un éternel recommencement.
Nos contenus sont placés sous la licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 FR). Toute parution peut être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.
Image en bandeau : Donne di Casalbruciato in manifestazione Roma, 1974.
à voir aussi
références
| ⇧1 | Voir cette vidéo intitulée « Les chevaliers de Roubaix ». |
|---|---|
| ⇧2 | Renaud EPSTEIN, « (De)politisation d’une politique de peuplement : la rénovation urbaine du XIXe au XXIe siècle », in Fabien Desage, Christelle Morel-Journel, Valerie Sala Pala (dir.), Le peuplement comme politiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014. |
| ⇧3 | Un phénomène décrit par Friedrich Engels, dès 1872 dans La question du logement : « L’extension des grandes villes modernes confère au terrain, dans certains quartiers, surtout dans ceux situés au centre, une valeur artificielle, croissant parfois dans d’énormes proportions ; les constructions qui y sont édifiées, au lieu de rehausser cette valeur, l’abaissent plutôt, parce qu’elles ne répondent plus aux conditions nouvelles ; on les démolit donc et on les remplace par d’autres. Ceci a lieu surtout pour les logements ouvriers qui sont situés au centre et dont le loyer, même dans les maisons surpeuplées, ne peut jamais ou du moins qu’avec une extrême lenteur, dépasser un certain maximum. On les démolit et à leur place on construit des boutiques, de grands magasins, des bâtiments publics. » |
| ⇧4 | Henri COING, Rénovation urbaine et changement social, Paris, Les Éditions ouvrières, 1966. |
| ⇧5 | David HARVEY, Paris, capitale de la modernité, Paris, Les prairies ordinaires, 2012. |
| ⇧6 | Sylvia ZAPPI, « A Roubaix, la rénovation du Pile passe mal », Le Monde, 6 janvier 2016. |
| ⇧7 | Julien TALPIN, « Une répression à bas bruit. Comment les élus étouffent les mobilisations dans les quartiers populaires », Métropolitiques, 22 février 2016. |