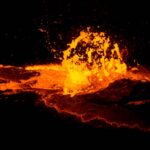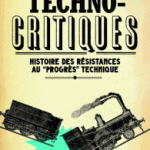Extraire des métaux pour sauver la planète ? Entretien avec Celia Izoard
Journaliste et traductrice (notamment du Mille neuf cent quatre-vingt-quatre de George Orwell) formée à la philosophie, Celia Izoard a notamment fait profiter de sa plume la Revue Z et Reporterre. Après Merci de changer de métier, série de « lettres aux humains qui robotisent le monde » en 2020, elle vient de publier La Ruée minière au XXIe siècle, dans lequel elle démonte pièce par pièce un paradoxe pseudo-écologique : « extraire des métaux pour sauver la planète ».

Contretemps (CT) : Ton nom est avant tout attaché à la critique de la technologie et notamment de la domination numérique, y compris dans des cadres collectifs comme celui du groupe Marcuse ou au sein des éditions L’Échappée. D’où te vient cette sensibilité politique ? Quand et comment s’est-elle formée ?
Celia Izoard (CI) : Pendant mon adolescence, je lisais des romans sur la Résistance, j’avais hérité d’une histoire familiale violemment liée à l’Occupation et à la persécution des Juifs, puis joyeusement ancrée dans les aventures de Mai 68 – et je ne comprenais pas où était passée l’Histoire. À la fin des années 1990, au début des années 2000, j’avais l’impression que la politique avait été remplacée par la simple succession des technologies : l’époque du baladeur et du Macintosh, l’époque du Tatoo et du CD, l’époque du portable et du mp3 et demain celle des voitures volantes…
C’est en lisant Hannah Arendt puis plus tard Guy Debord que j’ai réussi à mettre des mots sur cette impression : la technique avait englouti le politique. Nous étions devenus de simples figurants dans l’histoire de la production industrielle, des utilisateurs de machines, nostalgiques de celles de notre enfance, enthousiasmés d’avance par celles de l’avenir. En ce sens Francis Fukuyama avait raison : c’était bel et bien la « fin de l’Histoire », non pas parce que le capitalisme mondialisé avait définitivement mis tout le monde d’accord comme il le prétendait, mais parce que nous avions été séquestrés par la marchandise, nous étions prisonniers d’un spectacle dans lequel les progrès de la technologie s’étaient en quelque sorte substitués à l’histoire. Si nous n’avions pas été prisonniers de ce spectacle, nous aurions pu voir que pendant ce temps, la majeure partie du globe, le Tiers Monde d’alors connaissait d’immenses bouleversements, des putschs néocoloniaux, des faillites orchestrées par le FMI et la Banque mondiale, des famines, des révoltes contre la violence du néolibéralisme.
L’autre sentiment qui m’a obligée à m’intéresser à la technologie, c’est la stupéfaction que j’ai ressentie, que nous avons ressentie avec mes ami.es et camarades, en voyant l’espace public se recouvrir de nouveaux objets tout droit sortis d’un film de science-fiction : les caméras de surveillance, les écrans publicitaires géants, les téléphones dans toutes les mains. Je me disais : on est en train de construire le cauchemar d’Orwell, la dystopie de la société de surveillance déshumanisée, on y va tout droit. Ce qui est incompréhensible, c’est que personne ne désire cette société et que pourtant personne ne fait rien. Pour des raisons mystérieuses, il est interdit de porter un jugement sur ces machines.
Avec d’autres (le groupe Marcuse, l’Échappée, la Lenteur…), nous avons voulu éclaircir ce mystère : d’où viennent ces tabous autour de la technologie ? Quelle est leur histoire ? Par exemple l’extrême violence de la répression des mouvements luddites marque le moment où les objets technologiques de l’industrie sont devenus intouchables, en même temps que la propriété bourgeoise est consacrée et sacralisée. Autre exemple : le stigmate infamant qu’on renvoie à celui qui contesterait une technologie date de l’instauration de la religion du Progrès au XIXe siècle, mais c’est aussi, dans les milieux de gauche, un héritage du stalinisme qui a terrorisé toute personne critique de la grande industrie en la suspectant d’être réactionnaire.
CT : Dans ce livre, tu « descends » pour ainsi dire au niveau de l’infrastructure physique qui soutient la numérisation généralisée, prétendument « immatérielle ». Comment as-tu entrepris non seulement de t’intéresser davantage à ces « bas-fonds », mais d’enquêter sur le sujet ? La conscience de ce « soubassement » rendu plus ou moins invisible par le discours dominant est-elle intervenue tôt dans ta réflexion, ou bien peut-on dire que celle-ci s’est peu à peu déplacée des effets jusqu’aux causes ?
CI : J’ai toujours été fascinée par le fait que notre rapport mystique à la technologie implique de faire disparaître des données matérielles de base dont l’enjeu est déterminant, qui devraient nous obliger à tout arrêter. Avant que je m’intéresse à l’informatisation, comprendre le fonctionnement de l’industrie nucléaire a été un choc pour moi. Vous voulez dire qu’en cas d’accident une seule de ces centrales peut rendre une région inhabitable pour des siècles, et qu’en plus, ça s’est déjà produit, et qu’on a quand même décidé de continuer à les utiliser ? Et que face à la pollution radioactive on n’a pas d’autre solution que d’enterrer la terre, enterrer les arbres, enterrer les maisons, comme à Tchernobyl ? C’est dément. En lisant par exemple La Supplication, de Svetlana Alexievitch, j’ai compris que la fascination de la société industrielle pour sa propre puissance impliquait un déni de son impuissance. Cette société, sous couvert de créer des instruments de puissance, ne cesse de créer des phénomènes face auxquels nous sommes radicalement impuissants : le réchauffement climatique, la pénurie d’eau potable…
Depuis, c’est resté mon principal sujet d’étude : tout ce que recouvre ce déni. Je l’étudie pour donner une légitimité au sentiment d’incrédulité que je ressens. Et bien sûr ce déni s’exerce le plus fortement là où la vénération pour la technologie est la plus forte : donc, aujourd’hui, dans le domaine du numérique, le monde des écrans et de l’intelligence artificielle (IA), les fétiches des fétiches. Dans ce domaine, ce n’est pas seulement que la technocratie a gommé une série de problèmes techniques insolubles, comme dans le nucléaire, c’est qu’elle a carrément réussi à créer une hallucination collective, à faire disparaître pendant des décennies les objets en tant qu’objets, en tant qu’ils existent matériellement, en tant qu’ils ont été produits et qu’ils seront jetés. L’électronique, terme qui renvoie à des machines et des composants, a été refoulé au profit de l’informatique puis du numérique, les termes qui renvoient à l’existence mathématique, abstraite de ces technologies. Alors que, bien sûr, le numérique s’incarne dans des objets électroniques.
C’est pour faire face à ce déni que j’ai édité en 2015 La Machine est ton seigneur et ton maître, où des ouvrières et ouvriers chinois des usines d’électronique Foxconn racontent leur quotidien, leur exploitation. C’est une exploration des bas fonds du capitalisme numérique, que j’ai conclue par un texte intitulé « Les ombres chinoises de la Silicon Valley ». Ce qui m’a le plus frappée est que le géant Foxconn a produit l’essentiel de tout ce que recouvre le terme de numérique depuis 40 ans, des premières consoles Atari aux iphones, qu’il est le premier employeur en Chine, et qu’il a néanmoins fallu attendre 2010, une épidémie de suicides d’ouvriers dans une des usines, pour que le nom de cette entreprise apparaisse dans les médias occidentaux. En trois décennies, le public n’a jamais été amené à associer le numérique à la moindre usine. Le paradoxe est que c’est le secteur de l’économie qui en nécessite le plus. Un smartphone est un concentré d’industries : minière, pétrolière, chimique, auxquelles s’ajoute l’industrie du data mining, de l’extraction de données. Comme je l’indique dans mon livre, selon les données de Fairphone, il faut des composants issus de plus de mille usines différentes pour permettre produire un seul « smartphone ».
CT : Tu parlais de paradoxe : ton livre en soulève un autre, temporel ou chronologique : l’extraction minière passe volontiers pour un phénomène du passé et dépassé, une sorte de vestige historique qui serait en tous points opposé aux « innovations techniques » d’aujourd’hui, alors qu’en réalité celles-ci reposent sur une exploitation intensive des sous-sols. Comment expliquer la persistance de ce décalage ?
CI : J’analyse dans La Ruée minière comment la mine a disparu de l’imaginaire dominant dans les pays riches alors que leurs industries, notre mode de vie, n’ont jamais cessé de consommer plus de métaux, d’être plus dépendants du secteur minier. La mystique du Progrès suppose qu’il y ait un dépassement de l’ancien, en particulier de l’ancien qui pose problème, et à partir des années 1980 ce dépassement a été consacré par le mythe de la société post-industrielle, la société de la communication, une société dite tertiaire qui s’est affranchie de ses secteurs primaires et secondaires et qui ne produisait plus que l’information, des idées ou des services.
Mais au fond, ce décalage entre l’absence de la mine et son omniprésence réelle est le résultat de l’histoire flatteuse que l’Occident se raconte depuis des siècles, une civilisation sortie de la caverne pour se projeter dans le ciel des idées.
C’est aussi l’effet d’une reprise en mains idéologique et politique des élites après la décennie 1968. En réponse aux mouvements de contestation qui dénonçaient l’aliénation technique dans les usines et la destruction des milieux causés par la production industrielle, les élites ont déménagé et invisibilisé la production minière, métallurgique (entre autres), elles l’ont à la fois sortie du pays et sortie du récit. En fait, le néo-libéralisme a toujours été follement extractiviste : il a obligé par des putschs ou par la dette des dizaines de pays à livrer leurs sous-sols, il a balayé au profit des multinationales les acquis de la décolonisation des pays miniers du Sud, qui avaient socialisé les richesses issues de l’extraction. C’est l’impérialisme, l’amplification d’un mode de vie impérial que l’on a appelé à cette période la mondialisation, qui a permis de mettre en scène la fiction des sociétés « tertiarisées ».
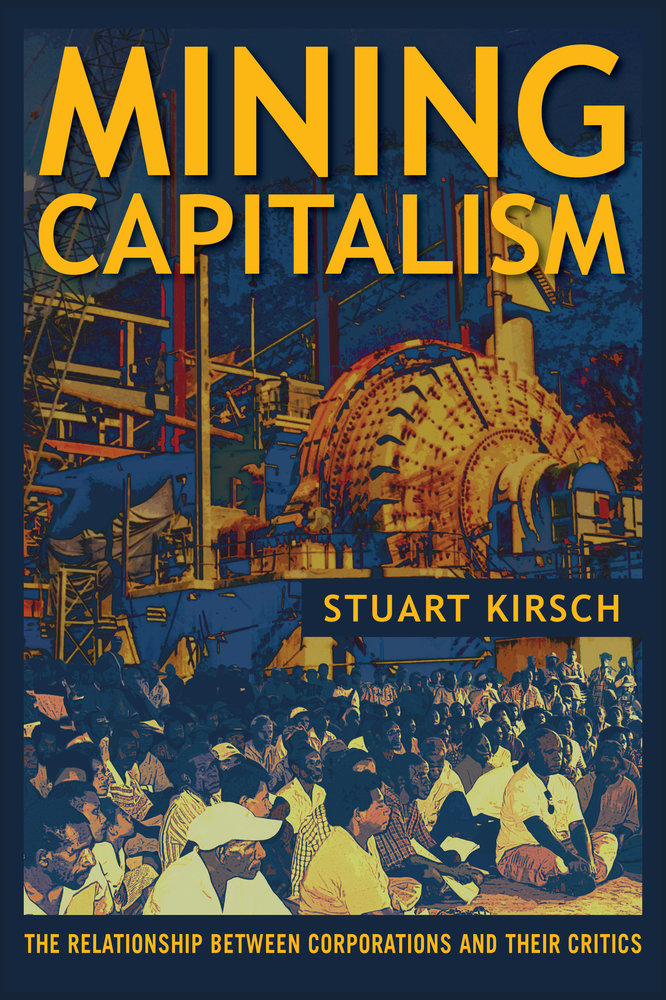
Tant que le flot de minéraux importés arrivait paisiblement dans les pays occidentaux ou dans leurs usines outremer, on a pu continuer à ignorer la nature fondamentalement extractiviste du capital, allant jusqu’à ignorer des conflits de grande ampleur des populations indigènes contre des multinationales de la mine, dans tout l’Est de l’Inde, contre Rio Tinto à Bougainville ou BHP en Papouasie, etc. (Elles sont racontées par Stuart Kirsch dans Mining Capitalism pour les années 1990, notamment en Papouasie.) Ce n’est qu’au début des années 2000, à partir du moment où l’arrivage de minéraux s’est enrayé, du fait de la concurrence de la Chine, que la mine a réapparu dans l’espace public, parce que les dirigeants ont été sommés par les grands groupes industriels d’inventer à la fois des politiques pour assurer leur approvisionnement et des discours publics pour les justifier.
CT : Autre paradoxe, et même « l’un des grands paradoxes de notre temps », comme tu l’écris : « Pour sauver la planète, un coup d’accélérateur historique a été donné à l’une des industries les plus énergivores et toxiques que l’on connaisse ». Peux-tu revenir sur cet extractivisme paradoxal, d’autant plus redoutable qu’il se prétend mû par des intentions écologiques ?
CI : Le pari des élites capitalistes consiste à décarboner les économies sans renoncer à la croissance, sans renoncer, donc, à l’urbanisation, à la vitesse, au béton, aux avions, à la conquête spatiale, au numérique, etc. En gros, il s’agit de continuer à alimenter la mégamachine tout en s’engageant à baisser les émissions de CO2. Ce pari repose presque entièrement sur la production minière et métallurgique qui est censée permettre cette électrification : batteries des voitures électriques, électrolyseurs pour la production d’hydrogène vert, uranium pour le nucléaire, giga-projets éoliens et photovoltaïques. Le paradoxe incroyable, donc, c’est de favoriser l’industrie la plus destructrice en prétendant ainsi sauver la planète. L’extraction minière est l’un des principaux agents du réchauffement climatique (8 % des émissions) et de la déforestation. C’est la première productrice de déchets au monde. Elle est à l’origine d’une contamination des milieux qui menace la santé de 23 millions de personnes dans le monde. On ne peut pas extraire entre cinq et dix fois plus de minéraux qu’aujourd’hui, comme il est prévu de le faire, sans exercer une violence inouïe contre les peuples.
Ce projet est d’autant plus absurde que les quantités de métaux nécessaires, ne serait-ce qu’aux batteries des véhicules électriques, sont colossales et rendent le projet irréaliste. Par exemple, pour disposer de 39 millions de voitures électriques en France, soit le parc actuel, il faudrait plus d’un an de production mondiale de cobalt, et près de deux ans de production mondiale de lithium. On voit bien que la France ne pourrait donc décarboner ses transports qu’au détriment d’un autre pays : du point de vue de la lutte contre le réchauffement, c’est un non-sens, puisque l’atmosphère se fiche de la nationalité des émissions carbone, l’important est qu’elles baissent partout.
CT : Se concentrer sur la question des métaux, est-ce une manière de rouvrir une perspective excessivement focalisée sur l’« empreinte écologique » et plus encore sur l’« empreinte carbone » au détriment d’autres concepts ou indicateurs ?
CI : Bien sûr : la question des métaux permet de réintroduire la violence sociale et coloniale dans la pensée écologiste, car la mine est indissociable de la conquête. Comme le dit un vieux proverbe impérialiste, « le commerce suit le drapeau, mais le drapeau suit le pic du mineur ». C’est toujours vrai. De la Centrafrique aux forêts indiennes, des Andes aux steppes d’Asie centrale, les fronts pionniers du capitalisme aujourd’hui, ce sont principalement les mines.
Dès lors qu’on s’intéresse aux mines et à la chaîne d’approvisionnement métallique de nos objets, on voit réapparaître les peuples, leurs mondes, l’accaparement des ressources, tout ce que les outils de quantification des émissions et de l’énergie font disparaître. Si ces indicateurs ont servi à mettre en évidence la voracité de la production dans un langage compréhensible par les bureaucraties, ces outils ont une affinité structurelle avec le capitalisme dans la mesure où ils introduisent de la commensurabilité. C’est ainsi qu’on arrive à la conclusion, par exemple, que détruire telle forêt pour installer des panneaux photovoltaïques est légitime puisque cela permettrait d’éviter tant d’émissions carbone par ailleurs. Dans la vraie vie, la forêt en question est aimée et habitée, elle donne de l’ombre et de l’humidité, elle abrite des usages collectifs parfois ancestraux : en réalité, rien, absolument rien ne saurait justifier ni compenser sa destruction. C’est exactement ce qui se passe à Prospérité, en Guyane, où les Kali’na se battent contre la destruction de la forêt tropicale de leur village pour installer une centrale photovoltaïque.
Ce sont ces indicateurs qui ont produit l’aberration qu’est la voiture électrique telle qu’elle est promue : l’idée qu’il serait légitime de détruire tels et tels endroits du monde en toute connaissance de cause dans le but de faire baisser les émissions carbone. On le voit, le principal problème de ces indicateurs est qu’ils font d’une question politique une question purement technique : ils évacuent la justice sociale, la domination coloniale, néo-coloniale. Le fait qu’on va créer des mines de lithium sur les terres collectives des peuples autochtones d’Argentine ou de Bolivie, le fait qu’on va construire des usines de batteries chez les pauvres du Nord de la France…
D’autre part ces indicateurs devraient servir à objectiver des coûts environnementaux et des pollutions ; mais ils ne font que refléter des rapports de force. Je constate que les analyses de cycle de vie ne prennent que très peu en compte les pénuries et les pollutions de l’eau créées par les mines : c’est lié à la capacité des populations qui les subissent de les dénoncer. À l’exception de celles qui sont soutenues par des ONG internationales, la majorité vit des drames qui n’arrivent jamais jusqu’aux bureaux d’études européens. C’est le cas par exemple au Maroc où j’ai enquêté sur l’extraction de cobalt destiné principalement aux batteries des véhicules électriques. La catastrophe qui se déroule autour de cette mine n’a jamais été intégrée au moindre indicateur.
CT : Le livre de Guillaume Pitron La guerre des métaux rares a bénéficié d’une couverture médiatique aussi large que positive, y compris dans le secteur indépendant ou alternatif du champ médiatique. Rares sont les voix qui, comme Ysé dans un article pour le site du collectif d’enquêtes militantes Strike, ont souligné les ambiguïtés politiques du livre et critiqué la perspective de l’auteur, en particulier du point de vue de la critique du capitalisme et du colonialisme. Quelle est ta position à cet égard ?
CI : Guillaume Pitron a fourni un argumentaire précieux aux dirigeants et aux industriels pour imposer de nouveaux projets miniers et métallurgiques en Europe. Il semble considérer qu’il y aurait d’une part des métaux sales, produits par la Chine ou par des pays pauvres, mais qu’ailleurs, comme en France, de meilleures normes environnementales permettraient d’obtenir des métaux propres. J’ai montré, au contraire, les impacts de la mine industrielle en tant que système et l’incompatibilité de ce système avec la préservation du vivant et de l’eau, a fortiori quand la sécheresse et la pénurie d’eau potable se généralisent.
Il a donc promu la mine responsable, mais il a aussi contribué à façonner une seconde créature mythique : la mine relocalisée, l’idée selon laquelle la relance minière européenne permettrait de rapatrier les mines et d’alléger notre dette écologique. En réalité, pour que l’Europe puisse fournir ne serait-ce qu’un tantième des métaux de l’industrie européenne, il faudrait diviser la production industrielle par dix, revoir notre mode de vie drastiquement à la baisse. Exit Airbus, Thalès, Stellantis et Volkswagen…. Tant qu’on ne met pas en avant la nécessité impérieuse d’un sevrage minéral, d’une décroissance de la consommation des métaux, les mines ouvertes sur le vieux continent s’additionneront aux mines qui existent ailleurs. Mais parler de relocaliser les mines est surtout un argument massue pour imposer un projet face à une contestation locale : la culpabilisation (des victimes) est devenu un mode de gouvernement.
Je m’étonne depuis la parution de ce livre du succès qu’il a connu dans les milieux pourtant conscients des enjeux écologiques et antiracistes, alors qu’il défend surtout les intérêts de la grande industrie européenne et s’ingénie à résoudre ses problèmes d’approvisionnement en métaux critiques. Je montre essentiellement l’inverse : la priorité est de contester les besoins de ces entreprises et de libérer la technique de son emprise minière, sans quoi la démesure extractiviste ne pourra que progresser.

CT : Comme l’indique son sous-titre, le livre est une réflexion sur la « transition », en théorie et en pratique. Coïncidence : il sort en même temps que celui de Jean-Baptiste Fressoz, justement intitulé Sans transition. Pourrais-tu revenir sur cet aspect et notamment sur ta caractérisation de ladite transition comme « état d’exception » ?
CI : L’impératif de produire des métaux pour la transition sert de prétexte à l’ensemble des politiques visant à sécuriser l’approvisionnement en matières premières pour les entreprises occidentales, face aux monopoles chinois et russes. Réaliser la transition devient la justification des nouvelles frontières extractives qui s’ouvrent un peu partout, c’est un motif d’intérêt supérieur qui permet de faire tomber les barrières réglementaires et politiques auxquelles faisaient face les entreprises minières. En ce sens, la transition crée les conditions d’un état d’exception, que reflète la nouvelle loi européenne sur les matières premières : il faut se donner les moyens d’ouvrir des mines le plus vite possible même dans des zones protégées.
Plus largement, je montre dans ce livre que la transition est devenu le mot d’ordre qui permet de justifier la poursuite du développement industriel et de l’accumulation, alors même que le désastre actuel devrait l’interdire. Finalement, si le réchauffement climatique est un obstacle à la poursuite de la croissance, la « transition » permet de contourner cet obstacle en justifiant l’ouverture de nouveaux marchés, la production de nouvelles marchandises et de nouvelles infrastructures.
La Transition est l’idéologie qui accompagne la poursuite de l’extractivisme de la même manière qu’il avait été légitimé il y a quelques décennies en Occident par l’impératif du Développement, il y a deux siècles par celui du Progrès, et il y a cinq siècles par l’avancée de la Civilisation. C’est encore une mission salvatrice qui justifie l’accaparement de ressources.
CT : Les phénomènes que tu analyses se déploient à une échelle de temps considérable, jusqu’à entraîner parfois des effets quasi irréversibles. « L’après-mine se prolonge indéfiniment dans le futur », écris-tu, avant d’évoquer une gestion « au pire désespérante, au mieux acrobatique », que le « chaos climatique » pourrait rapidement rendre « totalement inopérante »… Dans ces conditions, comment ne pas désespérer ? Quelles voies de sortie restent envisageables ?
CI : Des voies de sortie, des gens en inventent en permanence, des coopératives de maraîchage, des collectifs de charpentières, des ateliers textiles de laine locale, des mairies en autogestion, des salles de quartier pour s’entraider, des recycleries, des brasseries… Je pense qu’il faut à la fois cultiver ces initiatives autogérées et les relier pour former une sorte de filet de sécurité coopératif, solidaire, qui puisse enrayer un minimum l’exploitation économique ; tout en réinvestissant d’urgence la démocratie représentative, aussi impuissante et épuisante soit-elle. Il faut essayer de faire les deux à la fois pour faire face au chaos qui s’annonce : une tempête climatique et probablement fasciste.
À mes yeux, la désertion par les mouvements anticapitalistes et la jeunesse de la démocratie représentative se paie très cher. L’ensemble du paysage politique s’est déplacé vers l’extrême droite. Les partis en sont devenus incultes, totalement en décalage par rapport aux forces les plus clairvoyantes et les plus à même de créer de réelles alternatives, comme les mouvements antiracistes des quartiers populaires et les Soulèvements de la terre (à l’exception des mouvements féministes qui ont plutôt mieux réussi à faire passer leurs revendications vers la politique mainstream). Les industriels ont toujours des solutions et des projets de société clés en main à glisser aux élus. Les mouvements sociaux doivent eux aussi mettre en avant leurs imaginaires et leurs programmes, ne serait-ce que pour exiger autre chose que cette transition extractiviste. Nous avons besoin de constituer des assemblées territoriales pour planifier la décroissance et l’usage des ressources, notamment minérales – nous pourrions nous appuyer sur des partis pour le faire si la situation était différente.
Quant au désespoir, se battre pour faire de belles choses et des choses qui ont du sens sera longtemps possible. Certes la pollution est généralisée, mais prendre soin des mondes qui nous entourent, même abîmés, appauvris, ça n’a rien de déprimant. Tisser des liens communautaires et améliorer ensemble nos conditions de vie, c’est joyeux. Faire preuve de solidarité envers ceux et celles qui souffrent, c’est réparateur. Ce n’est pas parce que la mégamachine semble inarrêtable que nous devrions cesser de prendre plaisir aux cycles de la vie, de jouir d’être ces animaux terrestres, au contraire ; profitons de tout ce qui nous lie à un monde qui existait bien avant les multinationales de la mine. Quand le printemps arrive, je repense à cette formule de George Orwell : « Les bombes atomiques s’accumulent dans les usines, la police rôde dans les villes, les mensonges sont déversés par les haut-parleurs, mais la terre continue de tourner autour du soleil, et ni les bureaucrates ni les dictateurs ne peuvent rien contre cela. »
*
Celia Izoard, La Ruée minière au XXIe siècle. Enquête sur la transition à l’ère de la transition, Paris, Seuil, 2024, 352 p., 23 €. « Bonnes feuilles » disponibles sur le site de Terrestres.
Signalons aussi la parution de L’Or et l’Arsenic, de Nicolas Rouillé, sous-titré Histoire orale d’une vallée minière, aux (excellentes) éditions Anacharsis.
Crédit image : "Metal Mining Taught By Mail (1896)" par Butte-Silver Bow Public Library est sous licence CC BY-NC-ND 2.0.