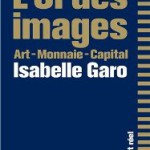Comment l’ « Europe sociale » est devenue un alibi pour la construction de l’Europe néolibérale
Alors que les élections européennes approchent et que le Parti socialiste – avec sa liste menée par Raphaël Glucksmann – nous fait une fois encore, la main sur le coeur, la promesse de l’ « Europe sociale », toujours à venir, il vaut la peine de revenir sur les rapports qui se noués historiquement entre la gauche et la « construction européenne ». C’est ce que permet le livre de l’historienne Aurélie Dianara Andry, Social Europe, the Road Not Taken (« L’Europe sociale, la voie qui n’a pas été empruntée »), paru récemment aux éditions Oxford University Press.
Elle y montre notamment qu’au cours des années 1970, les partis de gauche européens ont répondu à la crise de la social-démocratie en proposant des réformes plus radicales à mener au niveau transnational. Mais l’appel formulé alors à construire une « Europe sociale » a fini par servir de vernis et de contrepartie fictive à la construction – bien réelle – d’une Europe néolibérale.
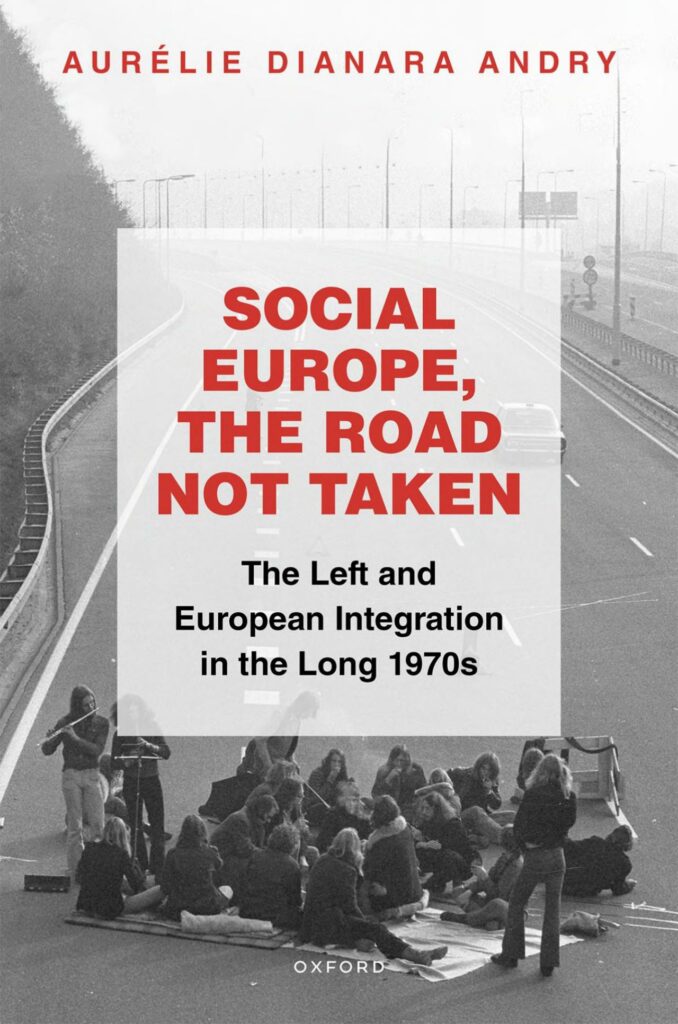
Les travaux sur la montée du néolibéralisme mettent généralement l’accent sur l’épuisement du libéralisme intégré d’après-guerre au cours des crises économiques des années 1970 et sur l’internationalisation parallèle de l’activité économique. En Europe, ce dernier processus est surtout, et de manière controversée, associé au processus d’intégration européenne.
L’ouvrage d’Aurélie Dianara Andry, Social Europe, the Road Not Taken (« L’Europe sociale, la voie qui n’a pas été empruntée ») passe au crible les récits qui sous-tendent ces deux processus. L’ouvrage retrace les débats autour d’un projet politique de gauche à l’échelle européenne tout au long des « longues années 1970 ». Cette désignation rend compte de la remarquable période d’incertitude et de contestation qui a débuté avec les mouvements de protestation de la fin des années 1960 et s’est achevée avec le triomphe effectif d’une nouvelle politique conservatrice et néolibérale au début des années 1980.
Andry soutient que ces politiques de gauche constituaient une alternative cohérente à la version néolibérale de l’intégration européenne qui a finalement triomphé, mais que les dirigeant.es de la gauche ouest-européenne ont manqué une « fenêtre d’opportunité » cruciale pour les mettre en œuvre. L’accent mis sur la Communauté Européenne (CE), le prédécesseur de l’Union européenne (UE), singularise son analyse de celles qui se focalisent au niveau national ou bien mondial.
Bien qu’elle soit en pratique d’accord avec les critiques selon lesquelles l’idée d’une « Europe sociale » a fini par servir d’alibi pour le rôle plus fondamental de l’UE dans la promotion et la consolidation du néolibéralisme, elle soutient que les programmes antérieurs proposés sous cette appellation constituaient un défi véritablement radical au pouvoir capitaliste et, parfois, cherchaient même vaincre et dépasser le capitalisme.
Sortir de la crise
La crise des années 1970 est traditionnellement décrite comme un conflit entre les nouvelles idées associées au néolibéralisme et les systèmes d’après-guerre en difficulté, fondés sur le keynésianisme ou le libéralisme intégré. Ces dernières années ont été marquées par une volonté de remettre en question ce récit, un certain nombre d’ouvrages mettant en avant des alternatives socialistes, fruits de larges débats, à ces deux paradigmes.
Le mouvement en faveur des politiques néolibérales, qui visent à faciliter la rentabilité du capital aux dépens d’autres parties de la société, a été stimulé par la crise de la rentabilité et l’accroissement de la mobilité internationale du capital. Ces problèmes ont été exacerbés par l’effondrement du système de taux de change fixes de Bretton Woods après 1971 et par la flambée des prix du pétrole après 1973.
Cependant, pour de nombreux partis de gauche et syndicats européens confrontés à une vague de protestations et de militantisme ouvrier dans les années 1960, la première réaction a été de s’orienter davantage vers une orientation socialiste. Avec une croissance économique chancelante et une inflation croissante, la compatibilité des politiques de redistribution en faveur des travailleurs.ses avec un modèle économique fondé sur la rentabilité du capital privé était de plus en plus remise en question.
Pour de nombreux partis socialistes, cela signifie que le pouvoir du capital, protégé dans le modèle d’après-guerre, doit être remis en question. Une citation fournie par Andry, tirée d’un rapport de 1978 d’un groupe de travail sur la politique de l’emploi de la Confédération des partis socialistes de la Communauté Européenne, résume ce calcul :
Les socialistes sont donc confrontés à un choix. D’une part, ils peuvent s’appuyer sur la motivation du profit, qui ne peut fonctionner efficacement qu’en abandonnant les objectifs sociaux-démocrates traditionnels … ou ils peuvent supplanter l’accumulation privée du capital par un contrôle de l’État (et des travailleurs.ses) bien plus important … que ce qu’ils ont envisagé jusqu’à présent.
L’exemple du Plan Meidner en Suède, qui proposait que la propriété des entreprises suédoises soit progressivement transférée à des fonds de salarié.es contrôlés par les syndicats, a particulièrement bénéficié d’un regain d’intérêt de la part de chercheurs et chercheuses. D’autres réponses à l’inflation d’après-guerre, notamment le contrôle des prix et des investissements publics ciblés, ont également été brillamment étudiées. Un autre axe de travail, tout à fait différent, s’est concentré sur le niveau international, en particulier sur le plan pour un Nouvel Ordre Économique International, un ensemble de propositions pour un ordre mondial plus égalitaire approuvé par les pays du Sud dans les années 1970.
Le livre d’Andry met l’accent sur l’Europe occidentale, qui se situe à mi-chemin entre ces priorités nationales et mondiales. Les partis de gauche et les syndicats de la région ont été de plus en plus influencés par l’idée que le pouvoir des entreprises multinationales devait être remis en question au niveau international, et en premier lieu au niveau de l’Europe (occidentale).
De ce point de vue, l’objectif économique de l’intégration européenne, en particulier depuis la création de la Communauté Économique Européenne en 1957, devait être contrebalancé par un objectif « d’harmonisation sociale vers le haut ». Mais au-delà de cela, la puissance économique combinée du marché commun de l’Europe occidentale lui donnait la capacité d’imposer des conditions aux multinationales et de réglementer l’activité économique d’une manière qui dépassait les capacités des pays individuels.
Entre Kautsky et Lénine
L’intégration européenne a été, comme le note Andry, « l’une des questions les plus controversées pour la gauche européenne au cours du vingtième siècle ». Deux citations de Karl Kautsky (1854-1938) et de Vladimir Lénine (1870-1924) résument la profondeur historique de ce clivage et les différences idéologiques plus fondamentales qu’il recouvre souvent.
En 1911, Kautsky affirmait que le seul moyen de « bannir le spectre de la guerre » en Europe était de créer « une confédération dotée d’une politique commerciale universelle, d’un parlement fédéral, d’un gouvernement fédéral et d’une armée fédérale : la création des États-Unis d’Europe ». En revanche, en 1915, Lénine affirmait que « sous un régime capitaliste », les États-Unis d’Europe ne pouvaient être qu’une « entente de capitalistes européens » visant à « étouffer en commun le socialisme en Europe et à protéger en commun les colonies capturées contre le Japon et l’Amérique. ».
Les débats d’aujourd’hui font écho à ces positions, s’alignant sur les ailes les plus radicales et les plus modérées de la gauche, auxquelles Lénine et Kautsky sont respectivement, bien que souvent de manière anachronique et trompeuse, associés. D’un côté, il y a l’idée que l’intégration européenne promeut la paix en Europe et offre la perspective de surmonter les limites imposées aux États-nations par le capital mondial.
L’intégration européenne a été, comme le note Andry, « l’une des questions les plus controversées pour la gauche européenne au cours du vingtième siècle ». Certains ont affirmé qu’il y a eu un processus constant de construction de l' »Europe sociale » depuis la Commission 1985-1995 dirigée par Jacques Delors, qui a également vu la transformation de la CE en UE, l’établissement d’un marché unique européen et le début de l’Union économique et monétaire (UEM). Un point de vue opposé souligne que l’intégration européenne est un projet inéluctablement capitaliste et même impérial, et qu’elle a joué un rôle-clé dans l’affaiblissement des protections sociales et de l’autonomie nationale.
Andry suggère qu’aucun des deux points de vue n’est tout à fait exact, en partie parce que le terme « Europe sociale » a eu des significations multiples. L' »Europe sociale » proclamée depuis la Commission Delors était en effet un alibi pour la construction du marché unique et de l’UEM, qui a vu les gouvernements renoncer à des éléments clés de leur autonomie économique et mettre en place ce qu’elle appelle « une combinaison d’ordo-libéralisme et de monétarisme » en tant que cadre de la monnaie unique.
Toutefois, Andry affirme également que cela n’a pas toujours été le cas. Les projets d’une Europe sociale défiant le capital ont été stimulés par l’estompement des divisions traditionnelles entre la gauche et la droite au sein du socialisme. Alors que les partis sociaux-démocrates adoptaient des positions politiques plus radicales et critiquaient ouvertement le capitalisme, l’adoption de l’eurocommunisme par leurs rivaux communistes s’est accompagnée d’une attitude plus favorable à l’intégration européenne dans des pays tels que l’Italie.
De Marcuse à Maastricht
Certaines des figures de proue de ce récit, comme le chancelier allemand Willy Brandt (1913-1992), sont familières des histoires de la social-démocratie de cette période. Mais Andry attire également notre attention sur des personnalités plus négligées. La plus remarquable de ces figures est peut-être Sicco Mansholt (1908-1995), qui a été président de la Commission Européenne de 1972 à 1973 tout en plaidant ouvertement pour une rupture avec le capitalisme.
Membre du parti travailliste néerlandais et premier commissaire européen à l’agriculture pendant de longues années – il joua un rôle majeur dans la création de la politique agricole commune -, Mansholt a été de plus en plus influencé par des idées de gauche plus radicales à partir de 1968. Il aimait citer Herbert Marcuse (1898 – 1979) et affirmait qu’il fallait un « second Marx » et une forme « nouvelle » et « moderne » de socialisme qui ne se limite pas à corriger les maux du capitalisme.
Mansholt a également été influencé par les avertissements du Club de Rome concernant les conséquences potentiellement dévastatrices d’une croissance économique continue et a plaidé en faveur de ce que nous pourrions appeler aujourd’hui une forme de décroissance. Il a appelé à une action coordonnée pour gérer la rareté des ressources, contester le pouvoir des multinationales et s’attaquer à la pollution de l’environnement, à une transition des politiques économiques basées sur l’expansion du produit national brut dans les pays riches et à une redistribution des ressources en faveur des pays du Sud. Il considérait que le renforcement des compétences de la Communauté Européenne jouait un rôle central dans ce processus, suggérant même la nécessité de procéder à des « nationalisations » au niveau de la CE.
Les propositions politiques paneuropéennes les plus courantes n’allaient généralement pas aussi loin, bien qu’elles soient devenues plus concrètes et plus ambitieuses au fil des années 1970. Elles comprenaient la coordination et la planification de la politique macroéconomique et des investissements publics, « l’harmonisation vers le haut » des normes sociales et de travail, et l’expansion des fonds communautaires. Des appels furent également lancés en faveur de la protection des lieux de travail et de la représentation des travailleurs.ses dans les conseils d’administration des entreprises de la CE, d’une plus grande participation des partenaires sociaux au processus décisionnel de la CE et de la négociation collective au niveau transnational.
Parmi les autres propositions figuraient des réglementations environnementales paneuropéennes, des réductions du temps de travail et des interventions visant à contrôler les prix, ainsi qu’une politique énergétique commune de la Communauté Européenne et de nouvelles restrictions sur les flux de capitaux. L’élaboration de ce programme politique s’est faite parallèlement à des efforts visant à améliorer la coopération organisationnelle et la coordination politique des partis de gauche et des syndicats au niveau communautaire.
Dans un contexte de détente de la guerre froide, où la critique des États-Unis s’étendait aux éléments les plus courants de la social-démocratie, l’idée que l’Europe pourrait soutenir une « troisième force » alternative aux États-Unis et à l’Union soviétique, éventuellement en alliance avec le mouvement des non-alignés du Sud global, est également devenue plus populaire. Le livre d’Andry n’indique pas clairement comment ces idées étaient censées fonctionner dans la pratique, ni comment elles auraient pu s’accommoder de la position dominante et souvent néocoloniale de l’Europe occidentale au sein de la hiérarchie économique internationale.
Toutefois, étant donné la frustration commune des Européens et des partisans du Nouvel Ordre Économique International face au pouvoir et à l’unilatéralisme de la politique économique et des multinationales étatsuniennes, il existait un alignement partiel des intérêts qui rendait un tel programme au moins théoriquement réalisable. Une citation de Samir Amin ((1931-2018), par laquelle commence le livre d’Andry, montre les ramifications potentiellement mondiales avec lesquelles une telle action au niveau européen a été conçu.
Pour trouver une solution à cette crise structurelle du capitalisme, il faudrait une recomposition de nouvelles forces socialistes en Occident, opérant à l’échelle continentale en Europe, remplaçant l’État national défaillant par un État supranational capable de gérer à cette échelle le nouveau compromis social …. . . Mais tous les espoirs que l’on pouvait nourrir à l’époque sont simplement partis en fumée, la gauche occidentale ayant manqué l’occasion de se renouveler.
Bien que peu de gens soient allés aussi loin que l’idée de Samir Amin (1931-2018) d’un État supranational, Andry souligne qu’à une époque où les partis socialistes étaient au gouvernement dans la plupart des États membres de la CE, leurs idées n’étaient pas simplement une liste de souhaits abstraits. Il s’agit néanmoins d’une chance qu’ils n’ont pas su saisir. Alors qu’une série de politiques moins radicales mais substantielles ont réussi à obtenir le soutien de la Commission Européenne, elles se sont heurtées à des obstacles ultérieurs, en particulier lorsqu’il s’est agi d’obtenir le soutien des gouvernements des États membres du Conseil européen.
Occasions manquées
Selon Andry, cet échec peut s’expliquer par les divisions de la gauche – nationales, idéologiques et autres – et son manque de coordination, ses insuffisances stratégiques et son incapacité à mobiliser le soutien de la base en faveur de ces politiques. À ces facteurs s’ajoutent le calendrier et les personnalités, ainsi que la sincérité douteuse du virage à gauche des dirigeants socialistes dans la première moitié des années 1970.
Bien que les partis socialistes aient pu se mettre d’accord sur des principes généraux et sur certaines politiques du plus petit dénominateur commun, ils n’ont jamais réussi à se mettre d’accord sur la signification plus spécifique des propositions centrales. En outre, il restait le problème des divisions sur la question même de savoir si l’intégration européenne pouvait être poursuivie d’une manière compatible avec les objectifs socialistes. En 1980, le président du groupe socialiste au Parlement européen observait que « le problème le plus fondamental, et où le groupe est profondément divisé, est celui de la construction de l’Europe elle-même ».
En même temps, un élément clé de l’argumentation d’Andry est que « ces divergences n’ont pas empêché l’émergence d’un vaste projet d' »Europe sociale » ». Tout projet efficace aurait nécessité une action à la fois intergouvernementale et supranationale. Certains signes montrent que les tensions entre les partisans de l’intégration les plus modérés et les eurosceptiques les plus radicaux pouvaient parfois s’avérer très productives.
L’entrée du Trades Union Congress (TUC) britannique, plus eurosceptique, ainsi que d’autres organisations telles que la Confédération danoise des syndicats (LO) et la Confédération générale italienne du travail (CGIL), dans une nouvelle Confédération Européenne des Syndicats (CES) en 1973, a créé une nouvelle dynamique. La CES, bien que toujours favorable à l’intégration européenne et dominée par des courants plus modérés tels que la Confédération allemande des syndicats (DGB), adopte ce qu’Andry appelle une « position plus combative à l’égard des institutions européennes » et met « beaucoup plus l’accent sur le contrôle des multinationales, les questions environnementales, le tiers-monde, la paix et le désarmement ».
Si les partis socialistes pouvaient se mettre d’accord sur des principes généraux, ils ne parvenaient pas toujours à s’entendre sur le sens plus précis des propositions centrales.
Cependant, ces organisations n’ont jamais accordé suffisamment d’attention ou de coordination au niveau européen, en particulier dans un contexte où le capital européen était beaucoup plus organisé et coordonné. Le calendrier et les personnalités ont également joué un rôle dans cet échec.
Par exemple, Andry souligne les conséquences néfastes de la démission de Brandt en tant que chancelier de l’Allemagne de l’Ouest en 1974. Brandt, l’un des principaux promoteurs des initiatives de l’Europe sociale et, plus tard, l’un des principaux défenseurs du Nouvel Ordre Économique International, a cédé la place à Helmut Schmidt (1918-2015), plus à droite, qui prônait des politiques déflationnistes et s’opposait aux idées de planification économique et au Nouvel Ordre Économique International.
Le coup de grâce
Lorsque la gauche arrive au pouvoir en France en 1981, les socialistes ont déjà perdu leur majorité au Conseil Européen et les idées néolibérales commencent déjà à s’imposer. L’échec des appels du gouvernement français en faveur d’une coordination au niveau de la CE pour soutenir un programme de relance a été, selon Andry, un « coup de grâce » pour ces projets d’une Europe sociale alternative.
Selon Andry, ces projets de gauche ont surtout échoué parce qu’ils n’ont pas montré d’intérêt à s’engager ou à se mobiliser à un niveau plus large à la base. Les discussions sur la politique européenne sont restées confinées à un petit cercle d’élites. Andry suggère que la « vieille gauche », qui contrôlait la plupart des directions des partis, considérait son projet d’Europe sociale comme un moyen « paternaliste » de réaffirmer son autorité sur ses électeurs et électrices, « sans jamais essayer de susciter un soutien populaire largement mobilisé en faveur de son projet européen ».
En 1983, affirme-t-elle, ils avaient laissé passer leur chance. La droite dominait désormais la scène politique et les nouvelles tensions de la guerre froide avaient sapé les possibilités ouvertes par la détente. L’affaiblissement moral et économique du bloc communiste a sapé la force d’une alternative mondiale au capitalisme, tandis que le Sud était de plus en plus divisé et que les mouvements de travailleurs.ses en Europe avaient été progressivement affaiblis par des changements structurels tels que la désindustrialisation. Cela a permis à un « véritable nouvel ordre économique international » de se consolider, fondé sur l’hégémonie étatsunienne et l’Alliance atlantique.
Lorsque la gauche est arrivée au pouvoir en France en 1981, les idées néolibérales commençaient déjà à s’imposer. L’expérience des socialistes français semblait confirmer que la gauche était coincée dans le « dilemme européen ». Toute forme de « socialisme dans un seul pays » était de plus en plus limitée dans un monde de plus en plus interdépendant, mais la gauche semblait incapable de créer les formes de coordination nécessaire pour modifier un processus d’intégration européenne construit sur l’expansion des marchés et la facilitation du capital.
Le choix du gouvernement français, et de son ministre des finances de l’époque, Jacques Delors (1925 – ), a été de renoncer au « socialisme dans un seul pays » et d’adopter un processus d’intégration européenne qui renforçait, au lieu de la remettre en cause, la base de la Communauté Européenne axée sur le marché et le capital.
Explications de la défaite
L’accent mis par Andry sur le conservatisme des dirigeants de la « vieille gauche » s’aligne sur un certain nombre d’observations de longue date, sur l’indifférence des dirigeants sociaux-démocrates suédois à l’égard des fonds pour les salarié.es et sur l’incapacité des communistes italiens à intégrer de nouveaux mouvements sociaux dans leur projet, par exemple. Dans le même temps, Andry a également raison de souligner que leurs options étaient devenues plus limitées au début des années 1980, soutenant la littérature qui souligne la dépendance à la voie imposée par les succès de la droite au début des années 1980, ainsi que les taux d’intérêt élevés imposés par la Réserve Fédérale étatsunienne après 1979.
Toutefois, ces explications nous semblent incomplètes. Il n’est pas clair, par exemple, à quel point ce projet d’Europe sociale était cohérent et réalisable. Le flou qu’Andry relève fréquemment trahit une incertitude et un désaccord inéluctables quant à la mise en pratique des principes généraux.
Le groupe socialiste au Parlement européen, qui aurait dû disposer d’un potentiel de coordination efficace et d’action transnationale plus important que les partis et gouvernements nationaux, n’a adopté aucune résolution sur les principaux objectifs du projet d’Europe sociale. Cette omission illustre le chemin qu’il reste à parcourir avant que ces idées ne soient mises en œuvre sous une forme substantielle. C’est particulièrement vrai pour les idées les plus ambitieuses, telles que la planification des investissements au niveau communautaire ou la démocratisation économique. Il n’est pas non plus évident de savoir comment les politiques plus modérées auraient modifié la trajectoire sociale et économique générale de l’Europe.
Andry semble parfois exagérer le potentiel de mobilisation de la base, tout en sous-estimant les divisions qui entourent la question de « l’Europe elle-même ». Elle blâme à juste titre les dirigeant.es de la gauche pour leur réticence à s’engager ou à mobiliser une opinion plus large sur les questions de politique européenne. Le fait que ces dirigeant.es se concentrent sur l’élite reflète également le peu de pression qu’ils subissaient pour agir autrement.
À une époque où de nombreux mouvements appelaient à la « démocratisation » et à une participation accrue aux partis et aux syndicats, une participation et une action plus larges au niveau européen ne semblaient pas susciter beaucoup d’engagement de la part des militant.es. On pourrait ajouter que, même avec un tel engagement, des politiques telles que les nationalisations au Royaume-Uni et les fonds pour les salarié.es en Suède ont encore beaucoup souffert, non seulement du scepticisme des dirigeants que note Andry, mais aussi d’une indifférence générale de la part de la majorité des membres des syndicats et des électeurs et électrices de gauche.
L’Europe alternative
Une exception fréquente à cette image de désengagement des militant.es concerne la participation au processus d’intégration européenne lui-même. L’importance de la question fondamentale de l’intégration européenne, plutôt que du type d’intégration européenne qui pourrait être construit, est évidente dans l’expérience de deux membres importants du « Réseau Europe alternative » d’économistes qui ont poussé à la planification et au contrôle des capitaux au niveau européen : Stuart Holland (1940 – ) et Jacques Delors.
Dans son introduction au livre Beyond Capitalist Planning (1978), Stuart Holland a exprimé un thème dont les aspects sous-jacents se retrouvent dans une grande partie du récit d’Andry, défendant la thèse que les nouveaux projets de rupture avec la logique capitaliste existante transcendaient les clivages traditionnellement compris entre « modérés » et « radicaux » au sein de la gauche européenne. Mais l’expérience personnelle de Stuart Holland met en évidence les limites auxquelles se sont heurtés les efforts visant à transcender un tel clivage, ainsi que les contradictions qui ont émergé lors des tentatives de mise en œuvre de ces politiques alternatives.
Les idées de Stuart Holland concernant un National Enterprise Board (Office National des Entreprises) et des accords de planification ont été adoptées par la gauche travailliste comme base de son programme économique au début des années 1970. Ce faisant, elles ont été rejetées avec une véhémence croissante par les anciens alliés de Holland au sein de la droite travailliste. Cela se passait à une époque où « l’Europe » devenait le marqueur déterminant de la division entre la gauche et la droite au sein du parti travailliste.
Andry suggère que la gauche travailliste « n’était pas aussi résolue à adopter une stratégie nationaliste pour sortir de la crise que ce que l’on peut lire dans la littérature », et cite l’exemple de Stuart Holland. Mais ce dernier a été marginalisé par les éléments les plus influents de la gauche travailliste, en partie à cause de son orientation européenne.
La stratégie économique de la gauche travailliste a également changé de manière discrète mais significative dans la seconde moitié des années 1970. Si les idées de Holland ont continué à faire partie de ce programme de gauche, généralement résumé sous la rubrique de l’Alternative Economic Strategy (l’AES, Stratégie Économique Alternative), l’AES proprement dite qui s’est développée après 1975 a souvent été considérée, par ses opposants comme par ses partisans, comme synonyme de la solution unilatéraliste du contrôle des importations.
Si le sentiment anti-CE était particulièrement fort au sein du parti travailliste britannique, ce type d’approche nationale unilatérale était également une caractéristique récurrente de la politique de gauche dans d’autres pays. La réponse radicale et militante à la domination de l’agenda européen par les élites modérées s’est rarement exprimée par des pressions en faveur d’une plus grande participation à ce processus et de sa démocratisation, mais plutôt par un rejet du projet européen dans son ensemble. Il n’y avait normalement qu’un sens très vague, voire aucun, des versions alternatives de la coopération internationale.
Le projet Delors
D’un autre côté, la trajectoire de Jacques Delors lui-même met en évidence les dangers de l’approche opposée, qui se concentre sur la coopération au niveau européen. Elle suggère également que, même si les partisans de la gauche anti-CE se sont souvent trouvés dans une impasse en ce qui concerne leur politique pratique, ils avaient tout de même raison dans ce qu’ils disaient.
Delors aurait peut-être préféré voir un élément plus « social » dans l’Europe sociale qui s’est développée au cours des années 1980 et 1990. Mais il était également prêt à accepter la version « alibi » qui a accompagné l’intégration intense des marchés et la suppression de l’autonomie au niveau national par le biais du marché unique et de l’UEM (Union Européenne et Monétaire) .
Si la distinction établie par Andry entre les significations de l’Europe sociale dans les longues années 1970 et après 1983 est instructive, le cas de Delors en montre les limites. En tant que principal partisan d’une véritable Europe sociale dans les années 1970, qui est ensuite devenu le principal architecte de la fausse Europe sociale qui a vu le jour, il a fait preuve d’une grande cohérence dans ses opinions, avec une croyance dans les formes de planification et de partenariat social associée à des craintes de l’inflation et du pouvoir de l’État.
Il existe également d’autres indices de l’utilisation de l’Europe sociale comme alibi national au cours de cette période. Par exemple, Andry note que le rôle des sociaux-démocrates allemands dans le lancement de nouvelles discussions sur l’Europe sociale au début des années 1970 était en partie une tentative de compenser leur déradicalisation dans d’autres domaines.
Même si la « fenêtre d’opportunité » pour une Europe sociale plus profonde avait été saisie dans les années 1970, dans quelle mesure aurait-elle été différente, compte tenu de ces continuités et des nombreux changements contextuels auxquels elle aurait probablement été confrontée dans sa construction en cours à partir des années 1980 ?
Un débat contemporain
Si le livre d’Andry fait revivre des idées radicales et oubliées du passé, son langage et ses politiques sembleront familiers à tous ceux et toutes celles qui suivent les débats européens contemporains. Il y a évidemment quelques exceptions à cette règle, comme un rapport de 1975 de députés européens socialistes qui citait le système yougoslave d’autogestion des travailleurs.ses comme modèle de transition vers une « société sans classes ». Cela évoque certainement une autre époque politique, tout comme l’idée d’un président de la Commission Européenne appelant ouvertement à une rupture avec le capitalisme.
Cependant, même les appels à la « planification », qui semblaient très éloignés il y a quelques années, ne le sont plus. Bon nombre des politiques énumérées par Andry dans divers documents trouveraient leur place dans un document 2023 de la CES (Confédération européenne des syndicats) ou du Parti Socialiste Européen. Il en va de même pour les défauts de la politique de gauche au niveau européen : un processus mené par les élites qui marginalise délibérément l’engagement de la base, isolé par le désintérêt au niveau national, et la désunion sur la question de « l’Europe elle-même ».
L’argument principal d’Andry n’est pas tant que les politiques ont changé, mais que le contexte a changé : l’alignement des forces politiques qui a fourni cette « fenêtre d’opportunité » n’existe plus. C’est certainement vrai à bien des égards. Les mouvements ouvriers et les partis de gauche sont généralement plus faibles et les nouvelles tensions géopolitiques n’ont pas les mêmes dimensions idéologiques que celles de la guerre froide.
D’autre part, le défi du changement climatique a présenté un nouvel impératif et une nouvelle base de mobilisation pour la coordination et la planification internationales. Les organisations politiques et de la société civile sont désormais davantage institutionnalisées au niveau européen, et le processus même d’intégration capitaliste mené par le projet européen depuis les années 1980 a rendu la dimension européenne plus difficile à éviter.
L’idée que l’union politique en Europe suivrait inexorablement si la voie était tracée par l’intégration économique était soit naïve, soit cynique et en tout cas imprudente. Mais étant donné que l’UEM (Union Européenne et Monétaire) continue d’exister, la dynamique d’une union politique, bien que loin d’être inévitable, est une nécessité et une possibilité de plus en plus claires.
*
Ce texte est d’abord paru sur Jacobin. Traduit par Christian Dubucq pour Contretemps.
Neil Warner est doctorant à la London School of Economics. Ses recherches portent sur l’échec des plans de socialisation des investissements en Grande-Bretagne, en France et en Suède au cours des années 1970 et 1980.