
La « révolution néolibérale » selon Pierre Bourdieu
Christian Laval, Foucault, Bourdieu et la question néolibérale, Paris, La Découverte, 2018.
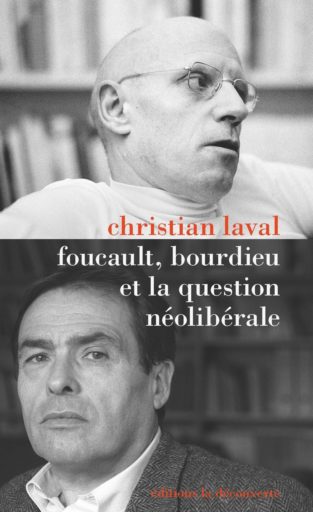
Qu’est-ce que la « révolution néolibérale » ?
Le fait le plus frappant de ces dernières décennies est que la « révolution » a changé de camp. On a assisté à ce qu’il faut bien appeler une « officialisation de la révolution » dans la parole publique, une monopolisation progressive par les élites économiques et politiques de l’idée de « rupture » au nom de la rationalité économique. Ce qui est devenu aujourd’hui assez manifeste a fait l’objet d’analyses sectorielles ou de réflexions éparses tout au long de la trajectoire de Bourdieu. La conception de la « révolution néolibérale », définie comme tentative de réaliser une « utopie » ou une « théorie pure » par des moyens politiques et symboliques, là encore ne vient pas d’un coup. Elle s’appuie sur un ensemble de travaux antérieurs qu’il est utile de relire à partir de la définition du néolibéralisme comme révolution symbolique[1].
Dès 1976, dans « La production de l’idéologie dominante », Luc Boltanski et Pierre Bourdieu mettent en évidence un certain nombre de caractères distinctifs d’une « nouvelle idéologie » des élites au pouvoir. Après 68, celle-ci a sous-tendu certains projets politiques, comme la « nouvelle société » de Chaban-Delmas et Delors, ou encore le « libéralisme avancé » de Giscard d’Estaing. Selon Boltanski et Bourdieu, le nouveau mode de domination a ceci de particulier et d’original qu’il requiert l’emploi intensif des sciences sociales et surtout des sciences économiques, et qu’il s’affirme comme « révolutionnaire », toujours favorable au changement, toujours prêt à la rupture. La « philosophie sociale de la fraction dominante de la classe dominante[2]» se veut non plus une défense, mais une critique de l’état existant des choses, ce qui permet d’accuser de conservatisme tous ceux qui résistent au changement. Le pouvoir ne craint pas la critique ; au contraire, il la mobilise : il faut toujours changer ou faire semblant de changer, dans tous les domaines. Le nouveau mode de domination identifié dès cette époque obéit à un principe simple : le changement est nécessaire et souhaitable. Il n’y a aucune autre solution que de le vouloir et de l’organiser. Et comme ce sont les experts qui connaissent seuls le futur, c’est à eux qu’il revient d’indiquer la voie inéluctable vers le changement. Le conservatisme prend alors un caractère nouveau. Il obéit à la « fatalité du probable », un changement commandé par les lois économiques. Il faut accepter le changement parce que « c’est ainsi ». Boltanski et Bourdieu l’appellent le « conservatisme reconverti », qu’ils opposent au « conservatisme déclaré », c’est-à-dire au vieux conservatisme des fractions déclinantes des classes dominantes. La politique affiche une volonté de changement et organise l’adaptation au changement, elle est une pédagogie du changement et une gestion de l’adaptation.
Ce texte de 1976 est précédé d’une « Encyclopédie des idées reçues et des lieux communs en usage dans les lieux neutres » – par « lieux neutres », il faut entendre les lieux de la technocratie moderniste et planificatrice française –, où Boltanski et Bourdieu montrent comment la classe dominante agence une nouvelle idéologie fondée sur la « fin des idéologies » et la valorisation du changement, sur la « modernisation » au-delà des idéologies et des conflits de classes. Dans ce recueil des lieux communs, il y a une entrée « (néo)libéralisme » accompagnée d’une citation de Giscard que nous avons déjà mentionnée[3]:
« La forme la plus savante de la pensée économique moderne est la pensée libérale. […] Elle comporte des idées très originales telles la théorie de la croissance continue, ou la théorie de la recherche de l’équilibre à un certain niveau économique. C’est donc une théorie très avancée et nouvelle. D’où, à mon avis, la nécessité de lui donner un nom moderne : néo-libéralisme. »
Boltanski et Bourdieu, avant Foucault donc, repèrent que l’idéologie du changement s’inscrit pour certains responsables dans une volonté politique affirmée dès les années 1960. Mais, en même temps, ils ne font pas du néolibéralisme giscardien un objet politique qui se détacherait particulièrement de l’ensemble des lieux communs de la fraction dominante de la classe dominante. On peut même dire qu’il est « noyé » dans le discours de ces « élites » modernisatrices françaises qui aspirent au pouvoir depuis les années 1930.
Le néolibéralisme comme programme politique des nouvelles élites
Si le champ économique a fourni, par le biais de l’univers scolastique de la science économique, le nouveau nomos universel, son extension ne tient pas seulement à sa force acquise dans le champ intellectuel. Elle ne tient pas non plus aux évolutions spontanées du capitalisme, elle relève des transformations dans la formation et dans l’ethos de la noblesse d’État et des nouvelles formes de la domination politique qu’elle met en œuvre. C’est en ce sens que le texte de 1976 a été pour Bourdieu un socle de l’analyse ultérieure du néolibéralisme. Le tournant néolibéral est inséparable d’une mutation dans la formation des élites et dans leur action. Il ne suffit pas de faire de la science économique le modèle à partir duquel fut conçu le projet néolibéral, il convient d’y voir une entreprise de légitimation d’une nouvelle forme de domination politique. Si parfois, dans ses textes les plus militants, Bourdieu semble épouser les interprétations du néolibéralisme les plus stéréotypées qui ont cours dans le mouvement social (retour d’Adam Smith, marchandisation généralisée, offensive des marchés contre l’État, etc), sa conception est autrement plus fine. Certes, le néolibéralisme se présente comme une idéologie libérale classique, c’est-à-dire contre l’État. Mais, d’après Bourdieu, le cœur du néolibéralisme n’est précisément pas là. Il réside dans le rôle joué par l’action publique dans l’extension de la logique économique du marché. L’idéologie néolibérale est un étatisme d’un genre très spécial en ce qu’il se présente comme une idéologie anti-État alors que c’est l’État qui est mobilisé et transformé pour universaliser la raison économique. En réalité, le néolibéralisme est impensable en dehors de l’institution de l’État, qui en tant que détenteur du monopole de la violence symbolique est seul en mesure d’imposer la raison économique à tous les domaines de la société. L’État, à travers les élites qui le contrôlent, impose le nouveau principe de construction du monde légitime et indiscutable, et ceci à l’aide de tous les instruments du pouvoir symbolique à sa disposition : parole autorisée, actes réglementaires et lois du parlement, rapport de la Cour des comptes et commissions d’experts de toutes sortes. C’est l’État qui incorpore et impose à la fois ce qui apparemment le nie en tant qu’instance supérieure, séparée, distincte des intérêts privés. Toute l’analyse de Bourdieu conduit à ce paradoxe. La révolution symbolique néolibérale est conduite « par le haut », c’est-à-dire par l’État parce que c’est au niveau de l’État et de l’État seul – du fait de la concentration de force, à la fois physique et symbolique, qu’il a historiquement accumulée – que pouvait s’imposer un nomos universel. Le fait que le champ économique soit « habité par l’État qui contribue, à chaque moment, à son existence et à sa persistance, mais aussi aux rapports de forces qui le caractérisent » est constitutif des liens historiques entre État et économie[4]. L’État est un grand « constructeur de marché » et un arbitre dans la lutte des entreprises entre elles[5]. Le champ économique autonome, dans sa forme nationale, n’aurait pu voir le jour et fonctionner sans une action de l’État visant à organiser la compétition entre les producteurs et à garantir la domination de ceux-ci sur la population, aussi bien du côté de la circulation que de la production des biens. D’où la lutte des entreprises pour s’assurer la mainmise la plus grande sur le pouvoir d’État ; il s’agit bien d’en tirer des avantages symboliques et matériels. Bourdieu reprend dans leurs grandes lignes les analyses de Polanyi quant à la construction et à l’unification des marchés nationaux. Mais il y ajoute une note d’actualité quand il constate que, loin d’opérer un « réencastrement » de l’économie dans la société, comme Polanyi l’avait cru, les États ont tendu, avec le néo- libéralisme, à se déposséder de tous les moyens d’intervention, d’arbitrage et de régulation qu’ils avaient accumulés en participant, sous l’influence des grandes entreprises des économies dominantes soucieuses de leurs seuls intérêts, à la création d’un champ économique mondial où circulent librement les capitaux. La politique néolibérale « une fois encore, peut-être la dernière, produit le marché qui dépossède l’État de son pouvoir en matière de politique économique[6]». La puissance du néolibéralisme à l’échelle mondiale ne s’explique ainsi que par le pouvoir à la fois matériel et symbolique des États nationaux et des méta-États que sont les organisations internationales, tous coalisés par et pour la cause d’une « mondialisation » qui diminue précisément les moyens d’action de ces États nationaux. Ce paradoxe constitutif du néolibéralisme fait toute la difficulté de sa saisie théorique. La politique néolibérale se présente comme la « démolition de l’idée de service public », explique Bourdieu dans La Misère du monde. Mais il ne s’agit pas de détruire tous les services publics ou de les vendre au privé ; il s’agit de les gérer comme des entreprises au nom de l’efficacité et de la souplesse du secteur privé[7]. Selon Bourdieu, c’est dans ces lieux de formation, dans ces espaces scolastiques très spéciaux que sont l’ENA et Sciences Po, écoles devenues depuis les années 1970 des sortes de business schools, que l’élite de l’État a appris le langage de la rationalité économique et a acquis cette vision néolibérale d’une société qui pourrait être entièrement régulée par des marchés. Cette caste supérieure emploie tous les moyens de l’État pour imposer aux agents subalternes et à l’ensemble de la société le nomos économique. Loin de n’être que l’effet d’une pression extérieure du marché sur le champ étatique et politique, c’est de l’intérieur de l’État, et plus précisément du sein des institutions de formation de l’élite politique et administrative, que s’opère la transformation néolibérale. Le « déclin structural » de l’autonomie des institutions scolaires et intellectuelles a des liens très directs avec la transformation de l’État comme instance « méta-champs ». La sacralisation de la haute culture et le prestige des institutions scolaires qui étaient chargées de sa diffusion étaient étroitement liés à la formation des « robins » dévoués à l’intérêt général et au service de l’État. Il y a une relation tout aussi étroite entre la désacralisation de la culture « à l’ancienne » et la mutation des agents de la haute bureaucratie qui ont rompu avec la longue tradition des « faiseurs d’État ». Tout se passe comme si l’État à l’époque néolibérale pouvait se passer de ce type d’hommes très particuliers qui l’ont servi durant plusieurs siècles et comme s’il pouvait perdurer dans son être avec des agents dont l’habitus les conduirait plutôt à servir les institutions capitalistes.
Avec le néolibéralisme, l’action publique intensifie et étend sa fonction de construction des marchés. En d’autres termes, on a affaire non pas à une extension spontanée du capitalisme qui aurait fait reculer l’État par une force intrinsèque, selon le schème de l’« impérialisme des marchés », mais à une politique délibérée et volontaire de la part des plus hauts « serviteurs de l’État » et des responsables politiques qui ont choisi de mettre en place des marchés dans des domaines qui jusque-là échappaient à leur logique, comme la santé ou l’éducation. Bourdieu, lorsqu’il s’agit d’expliquer les raisons de la « souffrance sociale », prend l’exemple de la politique du logement et du marché immobilier, sujets sur lesquels il revient souvent en s’appuyant sur la grande enquête qu’il a dirigée au milieu des années 1980 sur ce bien à la fois matériel et symbolique qu’est la maison. Il montre que l’« économie de la maison », qui a contribué à la division de l’espace urbain en zones socialement distinctes et même opposées, trouve sa raison d’être dans les politiques du logement mises en place dans les années 1970 fondées sur l’« aide à la personne » plutôt que sur l’« aide à la pierre »[8]. Il s’agissait de permettre à une grande masse d’employés et de cadres moyens d’accéder à la propriété grâce au crédit et de quitter ainsi l’habitat collectif assimilé au « collectivisme ». L’action publique, via les propositions d’une commission ad hoc – la « commission Barre » formée en 1975 –, a construit à la fois la demande et l’offre par le biais d’une série de dispositifs bancaires et réglementaires. Ainsi, ce qui apparaît le plus naturel et le plus inéluctable n’est jamais que le produit d’une volonté publique spécifique de promouvoir une certaine forme de production et d’achat d’un bien symboliquement et affectivement très chargé, en l’occurrence la maison particulière[9]. Cette politique a favorisé la création d’une France de petits propriétaires de pavillons, selon l’expresse volonté présidentielle de Giscard, qui entendait faire respecter le « droit individuel à l’acquisition d’un patrimoine minimum », comme il l’écrivait dans Démocratie française[10]. Mais elle a aussi puissamment contribué à la ségrégation spatiale des banlieues que l’on connaît aujourd’hui. L’enquête permet ainsi de faire voir que la « révolution bureaucratique » menée par un groupe de hauts fonctionnaires dans le domaine du financement bancaire du logement a des effets sociaux considérables et sur le très long terme. Cette politique a conduit à cette « misère petite-bourgeoise » de la famille endettée qui se découvre déçue dans ses espérances de propriétaire, mais elle a aussi mené à ces fractures spatiales entre zones résidentielles « protégées », banlieues ghettoïsées et vaste périphérie « rurbaine », que la géographie sociale a mises en évidence, avec toutes les conséquences politiques que l’on redécouvre à chaque élection. Dans La Misère du mondeBourdieu part des effets du néolibéralisme sur la société et opère une « remontée » des effets aux causes, des souffrances de la société, celles des sidérurgistes de Lorraine, des agents des services publics, des employés de commerce comme des autres catégories de salariés ou d’étudiants, aux facteurs qui les ont déterminées. Et parmi ces facteurs, il y a au premier chef les politiques néolibérales.
La guerre de la main droite contre la main gauche de l’État
La haute fonction publique et les plus hauts responsables des partis politiques, ce qu’il appelle la « noblesse d’État », ont déclaré la guerre à la petite fonction publique chargée de gérer, par le biais des services publics, les populations en matière de santé, d’éducation, de justice, etc. Cette « trahison », ressentie comme telle par les agents subalternes des services publics, a provoqué chez eux un immense désarroi, de multiples effets d’anomie, une désaffection vis-à-vis du monde politique, et en particulier une distance croissante vis-à-vis de la gauche de gouvernement convertie au néo- libéralisme. D’après Bourdieu, le développement du néolibéralisme n’est pas un processus anonyme, il ne relève pas d’une pression du capitalisme sur le champ politique, il est lié à la lutte qui traverse le champ bureaucratique entre deux fractions opposées de la fonction publique, la haute et la basse fonction publique. Cette lutte a pour enjeu la finalité de l’action publique et son impact sur la société.
La politique néolibérale, c’est l’attaque de la « main droite » contre la « main gauche » de l’État selon une opposition empruntée au travail classique de Robert Hertz[11]. La main droite désigne la haute fonction publique, les cabinets, les membres du gouvernement et leurs experts attitrés, qui tirent à vue sur ce que représente et ce que coûte la basse fonction publique. C’est l’expression et la traduction de la rationalité de la noblesse d’État dont la Cour des comptes a fini par devenir l’incarnation la plus dénuée de tout scrupule social. La main gauche de l’État, à l’autre pôle, ce sont les « petits fonctionnaires, et tout spécialement ceux d’entre eux qui sont chargés de remplir les fonctions dites “sociales”, c’est-à-dire de compenser, sans disposer de tous les moyens nécessaires, les effets et les carences les plus intolérables de la logique du marché, policiers et magistrats subalternes, assistantes sociales, éducateurs et même, de plus en plus, instituteurs et professeurs ». Ceux-là ont « le sentiment d’être abandonnés, sinon désavoués, dans leur effort pour affronter la misère matérielle et morale qui est la seule conséquence certaine de la Realpolitik économique légitimée. Ils vivent les contradictions d’un État dont la main droite ne sait plus, ou pire, ne veut plus, ce que fait la main gauche, sous la forme de “doubles contraintes” de plus en plus douloureuses : comment ne pas voir par exemple que l’exaltation du rendement, de la productivité, de la compétitivité ou, plus simplement du profit, tend à ruiner le fondement même de fonctions qui ne vont pas sans un certain désintéressement professionnel associé, bien souvent, au dévouement militant ? »[12].
C’est un processus de « destruction créatrice », selon la formule de Schumpeter : « destruction de l’idée de service public », d’un côté ; introduction, de l’autre, d’un management entrepreneurial empruntant au puritanisme victorien et à l’esprit du capitalisme certains de ses traits les plus caractéristiques. De là, la souffrance des agents subalternes de la fonction publique qui vivent de plus en plus difficilement les contradictions dans lesquelles la haute fonction publique les enferme. Elle les y enferme non seulement en ne leur donnant pas les moyens de remplir leurs missions, alors que les politiques menées provoquent des effets sociaux et économiques de plus en plus négatifs, mais aussi en modifiant leurs fonctions afin de les « adapter », sous prétexte d’efficacité, à la situation engendrée par ces politiques, et plus encore en annihilant encore un peu plus le sens de leur mission. L’attaque contre les « bureaucraties de base » (street-level bureaucracies)[13] conduit à la destruction des corps professionnels porteurs des valeurs du service public, à la transformation des agents en « individus économiques » ne fonctionnant qu’à l’intérêt matériel, n’ayant plus aucune valeur commune avec leurs collègues et avec les usagers. Cet affaiblissement du sens du service public tout comme les politiques de marché conduisent à la fragmentation et à l’atomisation du peuple réduit à une masse informe de pauvres plus ou moins méritants, d’exclus plus ou moins volontaires et d’assistés à qui l’on reprochera bientôt d’être des assistés professionnels, selon une nouvelle charité d’État « responsabilisante », c’est-à-dire culpabilisante. Ces politiques qui créent une population dont les membres devront se sentir satisfaits s’ils jouissent encore d’un emploi permanent entendent « gérer » les problèmes comme s’il s’agissait d’autant de problèmes individuels[14].
Cette analyse du néolibéralisme ne coïncide donc pas entièrement avec les conceptions les plus simplistes de la doxa antinéolibérale, selon laquelle le triomphe du marché se serait soldé par un « recul de l’État ». Certains passages de Bourdieu prêtent certes à confusion, comme ceux où il est question de « retrait de l’État » ou d’« involution de l’État », ou encore lorsqu’il avance dans un entretien que la « main droite de l’État » ne veut pas seulement ignorer la fonction de la « main gauche », mais qu’elle veut tout simplement la couper[15]. En réalité, c’est une conception plus complexe et plus subtile que propose Bourdieu, qui n’est pas sans rapport avec celle de Foucault. Ce dernier insistait aussi, dans son analyse du néolibéralisme, sur le caractère institutionnellement construit des pratiques et des conduites. L’État n’est pas défait ou démantelé de l’extérieur, sous l’offensive du capitalisme financier mondialisé, il est déconstruit et reconstruit de l’intérieur par des agents supérieurs de l’État ayant intériorisé l’idée selon laquelle certaines formes d’intervention étatique étaient nécessairement totalitaires ou systématiquement inefficaces. Le néolibéralisme se présente donc comme une nouvelle logique devant présider à l’action publique. C’est en ce sens que Bourdieu écrit : « L’opposition entre le libéralisme et l’étatisme, qui occupe tant les essayistes, ne résiste pas une seconde à l’observation[16]. » Ne pas comprendre que le néolibéralisme est un étatisme, c’est, ajoute-t-il, ne pas comprendre ce qu’est la « conversion collective à la vision néolibérale qui, commencée dans les années 1970, s’est achevée, au milieu des années 1980, avec le ralliement des dirigeants socialistes[17]». Il s’agit là d’un point essentiel : puisque c’est l’élite au pouvoir qui a changé d’idéologie, il s’agit de se demander comment et quand cette nouvelle caste supérieure s’est délestée des vieux idéaux du service public et de l’inté- rêt général. La réponse est claire : ce n’est pas sous le poids de l’ultralibéralisme anglo-saxon et de la pression matérielle des marchés financiers qu’elle a changé, c’est par l’adoption d’une idéologie d’un nouveau type, dont on pouvait rendre compte dès les années 1970. Bourdieu montre en effet dès cette époque que la science royale de la politique est déjà l’économie, dont les lois relèvent, on l’a vu, d’une « fatalité du probable ». De là découle logiquement, du point de vue dominant, que les résistances au changement ne sont que le fruit de l’ignorance, la manifestation d’intérêts corporatistes ou les vestiges de mentalités archaïques. Car ce n’est plus au nom du passé que l’on gouverne, mais au nom du futur. Et si l’on gouverne « au futur », c’est justement parce qu’il ne s’agit pas tant de prétendre conserver un ordre établi, que de faire advenir un nouvel ordre tout en gérant les « dégâts du progrès ». Il ne s’agit pas encore pour Bourdieu, en 1976, de caractériser le néolibéralisme à proprement parler, mais plutôt un économisme politique empruntant à des sources hétérogènes afin d’imposer un consensus parmi les nouvelles élites. Boltanski, dans le commentaire qu’il fera plus tard de ce texte commun, souligne à juste titre que l’article de 1976 analyse une « idéologie de transition ». Celle-ci regarde d’un côté vers les conceptions plus anciennes de l’économie de l’après-guerre, notamment l’idéologie technocratique et keynésienne du plan et des grandes entreprises publiques, c’est-à-dire l’idéal d’un capitalisme encadré, régulé et redistributeur, et, de l’autre côté, vers l’avenir, anticipant les thématiques néolibérales de la fin des idéologies, de la disparition des classes sociales, de l’individu responsable et autonome[18]. C’est que cette idéologie, dont Boltanski poursuivra de façon originale avec Eve Chiapello l’analyse dans Le Nouvel Esprit du capitalisme, est déjà une réponse à la critique sociale de 68[19]. Elle cherche même à modifier la définition du politique, réduite à une orchestration gestionnaire d’un changement inéluctable dont la science économique peut formuler les lois. Mais Boltanski et Bourdieu donnent surtout la clé d’une étrange qualification que le second appliquera au néolibéralisme : celle de « révolution conservatrice ».
Le néolibéralisme comme « révolution conservatrice »
Dans une intervention prononcée à Athènes en 1996, Bourdieu compare la révolution néolibérale des années 1980 à la révolution conservatrice allemande des années 1930. Il ne les confond pas, insistant au contraire sur ce qui les sépare. La seconde exaltait le sang, la terre et l’origine, tandis que l’autre invoque la raison, le progrès et la science. Bourdieu se rend bien compte du caractère apparemment un peu incongru du terme : « Si cette révolution conservatrice peut tromper, c’est qu’elle n’a plus rien, en apparence, de la vieille pastorale Forêt-Noire des révolutionnaires conservateurs des années trente ; elle se pare de tous les signes de la modernité[20]. » Pourquoi tenir alors à cette caractérisation du phénomène néolibéral ?
Bourdieu remarque que la lutte contre les politiques néolibérales se mène à fronts renversés. Les forces de progrès, de réforme, de mouvement, comme on disait autre- fois, se présentent désormais comme des forces de défense des « acquis sociaux », de « conservation » de la protection sociale et des services publics. Les politiques néolibérales, elles, se présentent comme des politiques de réforme, d’innovation, de changement, de rupture, voire de révolution. Elles ont arraché à la gauche l’imaginaire du changement et du progrès. Elles obéissent même à une logique subversive, mais ce qu’elles subvertissent n’est pas l’ordre existant, ce sont toutes les formes de compromis social imposées par le mouvement ouvrier. Elles veulent les subvertir afin de restaurer une « origine », une situation première et plus pure, un monde où le capital pouvait jouer sa partie en toute liberté. Elles s’inspirent, en somme, d’une « intention paradoxale de subversion orientée vers la conservation ou la restauration[21]». C’est en ce sens qu’elles peuvent être qualifiées de « révolutions conservatrices ». Si cette analyse fait évidemment écho au texte de 1976, « La production de l’idéologie dominante », la référence aux révolutionnaires conservateurs des années 1930 pose problème et mérite en tout cas un certain éclaircissement. Le terme de « révolution conservatrice » (« Konservative Revolution ») est forgé par le poète Hugo von Hofmannsthal en 1927 dans un discours sur les Lettres comme espace spirituel de la nation. Il est ensuite remis en circulation dans la thèse d’Armin Moeler (« La Révolution conservatrice en Allemagne », 1949) pour désigner l’idéologie dominante de la République de Weimar. Selon Louis Dupeux, c’est un mouvement de réaction fondamentaliste qui s’oppose au libéralisme plus encore qu’au marxisme, mais surtout au conservatisme traditionaliste[22]. Selon l’un de ses principaux théoriciens, Artur Moeller Van den Bruck, son objectif est d’« arracher la révolution des mains des révolutionnaires », non pour restaurer des institutions jugées désuètes, « mais pour procéder à un “ressource- ment” radical en utilisant certaines formes de la modernité »[23].
Fondée sur le refus de la « décadence » et de l’invasion des valeurs anglo-françaises, la thématique dite völkish, selon le qualificatif que se donne volontiers ce mouvement, est un véritable programme de régénérescence du peuple allemand et de restauration des valeurs de l’État allemand, de la culture et de la race, mais sans nostalgie pour la tradition. Ce modernisme völkish s’oppose frontalement au libéralisme économique. Il constitue une réaction à la modernisation capitaliste et scientifique et à la démocratie. Nulle place ici pour le marché, le laisser-faire et l’entreprise. L’État est à la première place, l’économie doit être subordonnée au politique. Ce refus du capitalisme et de la démocratie prend un caractère optimiste, affirmatif, à l’opposé du pessimisme des conservateurs attachés à la tradition. La révolution conservatrice est animée par l’idée de la « relève », du « développement », de la « résurrection », de la « Vie » ; il appelle à « surmonter » le capitalisme afin d’établir un avenir meilleur. La marche de l’histoire est cyclique, les valeurs éternelles reviennent, l’utopie d’un âge d’or de la nation et de la culture se fonde sur l’espérance d’une restauration, mieux d’un retour. La révolution est un mouvement volontaire vers un ordre naturel et fondamental. Le peuple doit ainsi « conserver et sauver son essence propre », comme le dira Heidegger à propos du national-socialisme dans son Discours de rectorat de 1933. Dans l’ouvrage que Bourdieu a consacré à Heidegger, il le présente comme le philosophe par excellence de la révolution conservatrice, celui qui veut sauver la « belle totalité » du déclin et du morcellement : « L’aspiration régressive à la réintégration rassurante dans la totalité organique d’une société agraire (ou féodale) autarcique n’est que l’envers d’une peur haineuse de tout ce qui, dans le présent, annonce un avenir menaçant, le capitalisme comme le marxisme, le matérialisme capitaliste des bourgeois comme le rationalisme sans dieu des socialistes. Mais les “révolutionnaires conservateurs” donnent une respectabilité intellectuelle à leur mouvement en habillant leurs idées régressives d’un langage parfois emprunté au marxisme et aux progressistes et en prêchant le chauvinisme et la réaction dans le langage des humanistes[24]. »
La formule de « révolution conservatrice » appliquée au néolibéralisme est certainement utile en ce qu’elle permet d’échapper aux connotations de l’expression « contre-révolution néolibérale » en vigueur notamment dans la mouvance altermondialiste et que Bourdieu d’ailleurs utilise parfois. Une révolution conservatrice n’est pas seulement une « contre-révolution », elle n’est pas seulement une réaction défensive ou une restauration, elle est fondamentalement une action subversive. Ce que Boltanski et Bourdieu avaient déjà mis en valeur dans l’idéologie dominante rénovée et ce qui s’est confirmé par la suite quand les thèmes de la révolution et de la réforme ont été confisqués par les « révolutionnaires » néolibéraux. Est-elle pertinente pour analyser les processus politiques contemporains ?
Néolibéralisme et néoconservatisme
La caractérisation du néolibéralisme comme « révolution conservatrice » permet-elle cependant de rendre compte de l’alliage entre néolibéralisme et néoconservatisme ? Ce que l’on appelle maintenant « néoconservatisme » n’est pas un refus du marché et du capitalisme, comme c’était le cas des mouvements nationalistes et réactionnaires de l’entre- deux guerres. C’est plutôt une manière d’intégrer dans un corpus doctrinal relativement unifié la construction des marchés et le renforcement du contrôle social par une moralisation et une répression accrues des populations. Les gouvernements néoconservateurs « compensent » les effets socialement déstructurants du néolibéralisme par le recours à une rhétorique raciste et identitaire et à des méthodes politiques autoritaires, policières et répressives. N’importe quelle idéologie conservatrice et traditionaliste peut lui servir de référence ultime : nationalisme, catholicisme intégriste, islam fondamentaliste, idéologie grand-russe, ou même « tradition républicaine » confondue avec une idéologie de l’ordre.
Le néoconservatisme américain est peut-être celui qui se rapprocherait le plus de la « révolution conservatrice » telle que l’entend Bourdieu. Il présente le marché comme une réalité naturelle, originaire, de sorte qu’il peut articuler l’expansion capitaliste des grandes entreprises et la nostalgie pour une société stable de petits propriétaires indépendants responsables de leur biens. C’est une manière de rassurer des fractions de la population qui ont les raisons les plus légitimes d’être inquiètes des conséquences destructives des politiques néolibérales sur leur mode de vie. Le marché n’est pas alors conçu comme cet élément de désagrégation qu’il représentait dans la révolution conservatrice allemande, il est une composante d’un mythe d’origine, un mode d’existence fondamental du peuple. La coalition droitière qui s’est constituée aux États-Unis dans les années 1960 a été désignée par l’éditeur de la National Review de « movement conservatism » en 1961[25]. Ce « conservatisme de mouvement », qui va des néolibéraux à la droite chrétienne, prend le contrôle du Parti républicain dans les années 1970 et assure le triomphe de Reagan. Il resurgit avec le « Tea party », expression qui, par elle-même, évoque la naissance de la lutte pour l’indépendance des États-Unis et renvoie donc à l’idée d’une grande boucle historique qui ramènerait à un élan initial de la nation[26]. Il triomphe aujourd’hui avec Trump dans sa prétention à revenir à une « Amérique des origines ».
Ce qui chez Bourdieu peut apparaître au premier abord comme une simple désignation polémique rend compte, au- delà d’une analogie historique problématique, du double caractère des coalitions néoconservatrices modernes, prônant à la fois l’accélération des mutations capitalistes et le retour aux valeurs traditionnelles. La raison de ces coalitions néoconservatrices tient à ce que le néolibéralisme ne peut avancer dans les faits qu’en rassemblant des fractions de la population bien au-delà des seuls privilégiés. La domination économique ne peut se maintenir comme telle sans se constituer comme une forme narrative dotée d’un pouvoir symbolique, « ce pouvoir invisible qui ne peut s’exercer qu’avec la complicité de ceux qui ne veulent pas savoir s’ils le subissent ou même s’ils l’exercent[27]».
Mais il y a certainement une autre dimension qui mérite d’être soulignée et qui donnerait aujourd’hui au concept de « révolution conservatrice » toute sa force pour expliquer les phénomènes politiques contemporains. C’est une chose de désigner le néolibéralisme comme pouvoir symbolique de l’économie, c’en est une autre de comprendre que la croyance dans le nomos économique ne peut s’établir qu’à la condition que ceux qui l’incarnent et le diffusent soient reconnus comme des « autorités » institutionnelles, qu’ils se présentent bien aux yeux de l’opinion dans les habits du pouvoir officiel, c’est-à-dire de l’État. L’État néolibéral qui se dépossède de beaucoup de ses moyens de régulation, d’intervention et d’arbitrage dans le champ économique, en particulier dans le domaine social, ne peut absolument pas se délester de ce qui fait son autorité propre et de ce qui inspire ce respect qui lui est dû par tous ceux qui en sont les sujets, cet obsequium, dont Bourdieu emprunte le concept à Spinoza pour désigner l’hommage à la fois à l’ordre symbolique du groupe et l’État[28]. Le néoconservatisme est un mouvement de restauration des valeurs traditionnelles qui vient réactiver et consolider cette obéissance ordinaire à l’égard de l’État et de ses porte-parole. Plus profondément, c’est un « rappel à l’ordre symbolique » d’autant plus efficace que l’ordre symbolique du groupe semble menacé dans ses fondements par le « changement permanent » invoqué comme loi des sociétés modernes. En somme, le concept de « révolution conservatrice » tel que l’emploie Bourdieu ne peut être pleinement ressaisi aujourd’hui que si on prend en compte la contradiction que l’État néolibéral cherche à surmonter : l’impulsion par le haut d’une subversion des structures sociales et la prétention à incarner l’ordre symbolique de la société et donc à exiger l’obéissance ordinaire que cet ordre appelle. C’est paradoxalement dans les sociétés les plus néolibérales que l’« hypocrisie » que Bourdieu décelait dans les économies archaïques joue pleinement : l’obligation symbolique que le nouveau conservatisme prétend restaurer est l’envers de la destruction du lien social à laquelle conduit le néolibéralisme par la légitimation absolutiste de l’accumulation du capital économique.
Notes
[1]Cf. « Le néo-libéralisme, utopie (en voie de réalisation) d’une exploitation sans limites », in Contre-feux, op. cit., p. 108 et sq.
[2]Actes de la recherche en sciences sociales, n° 2-3, juin 1976. Cet article a été repris in Luc Boltanski, Rendre la réalité inacceptable, Demopolis, 2008.
[3]Cf. ci-dessus, p. 100-101.
[4]Les Structures sociales de l’économie, op. cit., p. 25.
[5]Anthropologie économique, op. cit., p. 222 et sq.
[6]Les Structures sociales de l’économie, op. cit., p. 277.
[7]La Misère du monde, op. cit., p. 340-341
[8]Cette grande recherche a donné lieu à de nombreux comptes ren- dus et commentaires. Parmi eux : Actes de la recherche en sciences sociales, n° 81-82, 1990 ; Sur l’État, op. cit., p. 177 et sq. ; Anthopologie économique, op. cit., p. 221 et sq. ; Les Structures sociales de l’économie, op. cit., p. 113
[9]Les Structures sociales de l’économie, op. cit., p. 30.
[10]Cité in ibid., p. 114.
[11]Robert Hertz, « La prééminence de la main droite. Étude sur la polarité religieuse », Revue philosophique, XXXIV, 1909, repris in Sociologie religieuse et folklore, PUF, 1970.
[12]La Misère du monde, op. cit., p. 222.
[13]Bourdieu emprunte l’expression à M. Lipsky, Street-Level Bureaucracy.
Dilemmas of the Individual in Public Services, Sage, 1980
[14]La Misère du monde, op. cit., p. 223.
[15]La Misère du monde, op. cit., p. 220. 17. Ibid., p. 339.
[16]La Misère du monde, op. cit., p. 220.
[17]Ibid., p. 339
[18]L. Boltanski, Rendre la réalité inacceptable, op. cit.
[19] L. Boltanski et E. Chiapello, Le Nouvel Esprit du capitalisme, op. cit.
[20]Contre-feux, op. cit., p. 41.
[21]« Le néo-libéralisme, utopie (en voie de réalisation) d’une exploitation sans limites », loc. cit., p. 118.
[22]Louis Dupeux (dir.), La « Révolution conservatrice » dans l’Allemagne de Weimar, Kimé, 1992.
[23]Ibid., p. 7.
[24]L’Ontologie politique de Martin Heidegger, op. cit., p. 36-37.
[25]Cf. Paul Krugman, L’Amérique que nous voulons, Flammarion, 2009.
[26]La « Boston Tea Party » de 1774 est le nom donné à un épisode de la révolte des colons américains contre la politique fiscale et douanière de la métropole.
[27]« Sur le pouvoir symbolique », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations,32e année, n° 3, 1977, p. 405.
[28]Le concept d’obsequium est utilisé dans Le Sens pratique, op. cit., note 2, p. 113-114 et dans Sur l’État, op. cit., p. 63-64.








