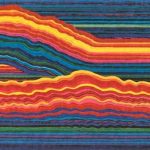Investis de tous les pays, unissez-vous !
Cette contribution se propose de revenir sur le livre Le temps des investis : essai sur la nouvelle question sociale de Michel Feher (La Découverte, 2017) à l’aune de la crise causée par la pandémie de Covid-19 et de ses répercussions sociales et économiques.

Cet essai d’économie et de philosophie politiques, marqué de l’empreinte de la crise financière globale de 2007-2008, avance une proposition théorique et pratique pour desserrer l’étreinte de la finance sur le cours du monde. Aussi paraît-il intéressant par rapport à la conjoncture actuelle, désormais codée dans le discours politico-médiatique comme le « monde d’après ». De nombreuses déclarations ont en effet alimenté l’idée, déjà esquissée par la dimension performative de la formule, que cette pandémie marque une rupture, à l’image d’Emmanuel Macron affirmant dans son « adresse aux Français » du 12 mars dernier qu’« il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors du marché ». Pour autant, les indices du renforcement des marchés financiers à l’occasion et à l’issue de la crise pandémique s’accumulent. Alors que les statistiques sur le chômage ont atteint des records aux États-Unis, l’indice phare de Wall Street, le S & P 500, réalisait en avril dernier ses meilleures performances mensuelles depuis 1987[1]. Afin de financer les plans nationaux de soutien à l’économie, l’Union Européenne a envisagé le recours à une émission obligataire groupée auprès des marchés[2]. En France, le recours aux investisseurs financiers pour le financement de certains services de santé, dans le cadre de contrats à impact social, figure parmi les pistes de réformes esquissées pour la réforme du système hospitalier[3].
Refonder la question sociale en théorie et en pratique à l’ère du capitalisme financiarisé
L’ouvrage vise à relire la question sociale en rapport avec les changements intervenus à l’occasion de la financiarisation du capitalisme depuis les années 1970. Il s’ouvre ainsi sur une discussion de la critique de la gauche, dont le manque de clairvoyance sur ces changements expliquerait les défaites électorales et désillusions militantes. Alors que le projet néolibéral visait à l’avènement d’un « ethos entrepreneurial » (p. 11), la subjectivité capitaliste se caractérise aujourd’hui par la figure des « investis », soit des « agents économiques […] prioritairement habités par le souci de se rendre attractifs aux yeux des investisseurs », et dont la « motivation prioritaire n’est pas tant le profit qu’il espère tirer de leur activité que l’obtention du crédit qu’il permet d’exercer » (p. 15). Autrement dit, les réformes néolibérales n’auraient pas atteint leur but initial, car l’aspiration des investis « à séduire les investisseurs les pousse […] davantage à parier sur le cours des composantes de leur capital qu’à optimiser leurs revenus par le biais du calcul d’utilité » (p. 21).
Il s’ensuit un triple déplacement. En ce qui concerne d’abord le principal terrain où se jouent les rapports des pouvoirs, du marché du travail à celui des capitaux. Ces terrains diffèrent en termes de formes de pouvoir des acteurs dominants (l’évaluation rétrospective de la production versus le regard prospectif des placements financiers), l’identité des groupes dominés (qui négocient leur force de travail versus cherchent à entretenir un crédit financier et moral), et des formes de leur résistance (négociation salariale versus spéculation, au sens que lui donne Feher, soit « s’ingénier à orienter les estimations » des autres [p. 38]). Ensuite, la question de la valorisation du capital à travers l’accréditation prend le pas sur les enjeux de distribution des revenus. Enfin, ce déplacement théorique est aussi stratégique. Il s’agit de « construire un rapport de forces propre à modifier les critères de rentabilisation des investissements », ce qui « suppose de rejoindre les spéculateurs dans l’espace où ils s’adonnent à la titrisation des initiatives de toutes sortes, mais aussi dans l’univers mental où ils forment leurs paris » (p. 47). Autrement dit, de combattre banquiers d’affaires, investisseurs institutionnels et autres gérants de fonds sur leur propre terrain.
Trois figures d’investis et leurs contestations
C’est dans cette perspective que le reste de l’ouvrage aborde successivement trois idéaux-types d’investis et les pistes relatives de contestation, à commencer par les entreprises (chap. 1). En montrant qu’elle consiste à transférer le pouvoir de réglementation et de véridiction aux marchés financiers qui en définissent les critères, Feher repousse d’un revers de la main la responsabilité sociale des entreprises (RSE) comme outil de contre-pouvoir. Il se penche plutôt sur d’autres pratiques militantes, comme les campagnes de désinvestissement, à l’image de « Defund DAPL » qui a abouti au retrait des financeurs initiaux du projet de pipeline dans le Dakota contesté par la tribu amérindienne de Standing Rock. Il esquisse également un projet d’agence de notation citoyenne et alternative, « au sens où leur appréciation repose sur d’autres critères que la rentabilité financière, mais jouant néanmoins sur les mêmes ressorts que leurs modèles, à savoir l’offre de balises censées réduire l’incertitude » des marchés financiers (p. 67).
Le chapitre suivant porte sur les gouvernements, dont le recours aux marchés de capitaux pour financer leurs politiques publiques s’est accru depuis les années 1980. Plutôt que l’hypothèse populiste d’une rénovation de la démocratie représentative dans le cadre de l’État-Nation, cadre « où sa légitimité est le mieux ancrée » (p. 90), Feher privilégie des formes de lutte adoptant la temporalité des marchés financiers pour « rivaliser avec les pourvoyeurs de crédit dans l’art du harcèlement incessant » des dirigeants politiques (p. 92). Il s’intéresse ainsi au mouvement des places né en réaction à la crise financière globale de 2007-2008. C’est par exemple le cas de la plateforme des affectés par les hypothèques (PAH) luttant contre l’endettement et l’expropriation des ménages causés par la bulle immobilière spéculative en Espagne[4], notamment à travers les escraches, rassemblements dans l’espace public devant le domicile des responsables politiques et des banques dont les militant·e·s crient les noms. Ou des tentatives de crowdfunding pour racheter la dette et la détruire, et autres grèves de la dette pratiquées dans le sillage d’Occupy Wall Street aux États-Unis.
Le troisième et dernier chapitre porte sur les individus, affectés par la précarisation du travail et l’endettement pour la consommation. Dans ce contexte, c’est du côté de la croissance des plateformes numériques que Feher guette l’émergence de résistances, certes « très marginales » (p. 156). Outre les luttes pour la requalification en emplois salariés permettant de « précipiter la faillite » d’Uber, Deliveroo et autres Airbnb, il discute les possibilités d’un « coopérativisme de plateforme » (p. 156) proposé par certains[5]. Il s’agit alors de s’emparer des plateformes en retournant leurs systèmes de notation contre les entreprises qui ont recours à leurs services, et de repositionner la puissance publique « comme un incubateur et même une plate-forme de plates-formes coopérations – au sens où elle contribue à renforcer le crédit de chacun mais aussi à construire l’éco-système qu’elles sont susceptibles de former entre elles et dont dépend leur prospérité » (p. 167).
Deux principaux apports ressortent de la lecture du Temps des investis, que les deux années passées depuis la publication n’ont pas amoindri. D’une part, l’ouvrage témoigne d’une ambition certaine, reflétée dans son sous-titre. Cette ambition n’est pas seulement théorique, elle est aussi pratique. Feher est d’une certaine manière fidèle à la célèbre formule de Marx, pour qui « les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c’est de le transformer »[6]. Et cette transformation passe ici par une reformulation des termes du problème, dans une perspective réformiste revendiquée. D’autre part, malgré sa concision, l’ouvrage propose une synthèse accessible des ouvrages de sciences sociales récents, dont l’intérêt pour la financiarisation s’est accru depuis la crise de 2008. Il permet ainsi de se familiariser avec un corpus universitaire principalement anglophone, en puisant dans l’économie politique (Wolfgang Streeck, Greta Krippner), la philosophie politique (Maurizio Lazzarato), ou encore l’anthropologie (David Graeber), mais aussi avec des pratiques militantes.
Inégalités, contradictions et spatialité du rapport d’accréditation
Afin d’enrichir la problématisation de l’accréditation, trois pistes mériteraient cependant d’être approfondies. La première est d’ordre empirique, et tient à l’approche réformiste de Feher qui souhaite « retrouver l’intelligence du syndicalisme de l’époque héroïque » (p. 38), pendant laquelle « les militants syndicaux ont résolument embrassé leur condition de travailleurs libres, tout au moins stratégiquement, comme l’identité collective où le prolétariat devait puiser son pouvoir » (p. 31). L’endossement de la condition d’investi permettrait donc de lutter contre le régime d’accumulation qui la fonde. Au vu de l’échec du réformisme à juguler l’accumulation capitaliste et ses conséquences sociales et environnementales depuis les trois dernières décennies, on peut se demander si cette stratégie est à la hauteur de ces enjeux. D’autres propositions militantes, prenant aussi acte de la financiarisation du capitalisme, revendiquent plutôt l’action directe[7]. Plus fondamentalement, l’approche défendue par Feher achoppe sur l’inégalité des rapports de pouvoir entre finance et investis. Ainsi, les investis peuvent s’engager dans la création d’agences de notation citoyenne, mais comment s’assurer que les marchés suivront leurs recommandations, à la différence des agences « officielles » (Fitch, Moody’s, Standards & Poor’s) qui sont établies sur les places financières, et auprès des responsables politiques ? Autrement dit, comment faire en sorte que le projet initial ne soit pas dissous dans son institutionnalisation ? Ces questions renvoient à l’accueil de ces projets par les acteurs de la finance. Or ces derniers ne sont pas passifs : « quand marché pas content, lui toujours faire ainsi : il vend les titres de dette souveraine, fait baisser ses cours, donc monter ses taux d’intérêt », comme le rappelle Frédéric Lordon au sujet de l’hypothèse d’un gouvernement souhaitant mener une politique en rupture avec le néolibéralisme[8]. Voire proactifs, à l’image des efforts conjoints des grands investisseurs et gouvernements pour le développement du secteur de la « finance verte »[9], que l’on peut interpréter comme une récupération de la critique environnementale à l’issue d’un recodage de l’accumulation financière comme solution au réchauffement climatique.
La seconde objection tient au fait que la financiarisation ne produit pas seulement une condition d’investi chez les différents agents économiques, mais aussi d’investisseur. Les profits financiers des entreprises des secteurs non-financiers se sont accrus dans les pays développés[10]. À travers leurs fonds souverains, les gouvernements qui ont amassé des surplus commerciaux sont également détenteurs d’une multitudes de placements. L’épargne des ménages est aussi placée sur les marchés, par exemple dans le cadre des systèmes de retraite par capitalisation. Bien qu’il existe des inégalités patrimoniales importantes entre les ménages qui accèdent à la condition d’investisseur, la tendance politique est à son développement, à l’image du projet de réforme des retraites du gouvernement d’Édouard Philippe[11]. Cet argument est d’ailleurs souvent mobilisé dans le débat politico-médiatique par la finance et ses promoteurs afin de défendre son utilité sociale, et donc les plans de sauvetage gouvernementaux conduisant à socialiser les pertes. De sorte que les agents économiques peuvent avoir des intérêts contradictoires au fur et à mesure de leur enrôlement dans les marchés financiers en tant qu’investisseurs : certains ménages retraités pourraient par exemple avoir intérêt aux politiques d’austérité préservant la rémunération de leur pension placée en obligations d’État, mais qui, en même temps, diminuent les capacités hospitalières de prise en charge des cas les plus vulnérables en cas de pandémie. Dès lors, lutter contre la financiarisation suppose de contrer les politiques qui visent à développer cette condition, mais aussi de mener une réflexion sur les contradictions internes qui traversent les subjectivités individuelles.
La troisième objection porte sur l’absence de réflexion quant à la dimension spatiale de la financiarisation. Comme son titre l’indique, l’ouvrage insiste sur la temporalité du rapport d’accréditation, interprétant par exemple les mouvements des places comme « une volonté d’installer le mouvement dans la durée ou, plus précisément, de le doter d’une capacité d’expression continue » (p. 93) capable de rivaliser avec l’évaluation continue des politiques gouvernementales par les investisseurs et les analystes financiers. Pourtant, les mouvements occupy ont connu des difficultés notoires à New York et Londres, du fait de la privatisation des espaces publics désormais soumis à des règles différentes. Cette anecdote reflète l’importance du rôle de l’espace dans l’accumulation financière et ses contestations, que les études urbaines questionnent dans le cadre d’un champ de recherche sur l’articulation entre espaces urbains et marchés financiers (le géographe britannique David Harvey, pionnier en la matière, figure parmi les références convoquées par Feher, mais plutôt sur les aspects historiques du processus de financiarisation). La problématique des luttes contre la financiarisation peut ainsi être posée en termes de « distance »[12] que ce processus induit : la globalisation des marchés financiers (et immobiliers) permet aux investisseurs transnationaux de projeter leurs capitaux dans des contextes locaux, et créé des espaces pour une multitude d’intermédiaires assurant leur ancrage. Cette géographie réticulaire pose des difficultés aux mouvements urbains en matière d’imputation des responsabilités.
À ces considérations topologiques s’ajoute une dimension topographique qui renvoie à la spatialité et la matérialité de la finance. Même les innovations financières qui paraissent les plus désincarnées, comme le trading de haute fréquence, s’appuient sur un réseau d’infrastructures par lequel transitent les ordres algorithmiques d’achat/vente[13]. Au-delà de ce secteur de niche, la finance et ses services auxiliaires (juridiques, comptabilité, conseil) se concentrent de longue date dans les « capitales du capital »[14]. À Paris, les sociétés de gestion de portefeuille et les hedge funds sont par exemple polarisées dans le quartier central des affaires[15]. Cette géographie est à mettre en regard de celle des mobilisations sociales et de leurs pratiques de contestation, que le mouvement des gilets jaunes est venu renouveler en déplaçant les manifestations dans l’ouest parisien[16]. Dans le cadre de la mobilisation contre le projet de réforme des retraites et le réchauffement climatique, le siège de Blackrock a été occupé trois fois en l’espace d’un mois par des cheminot·e·s, des enseignant·e·s et des écologistes. Ces pratiques émergentes invitent à une réflexion sur les espaces et les échelles du rapport d’accréditation, et de son urgente remise en cause.
*
Notes
[1] « U.S. Stocks Have Their Best Month Since 1987 », The New York Times, 30 avril 2020.
[2] Annabelle Grelier, « Face au Covid-19, l’Union européenne joue son avenir au corona bond », France culture, 2 avril 2020.
[3] Laurent Mauduit et Martine Orange, « Hôpital public : la note explosive de la Caisse des dépôts », Mediapart, 1er avril 2020. Pour certains investisseurs, cette crise pandémique représente une véritable opportunité dans le développement du marché des obligations à impact social, voir Christopher Wigley, « Social bonds and Covid-19 – The next phase », Environmental Finance, 7 avril 2020.
[4] Voir Quentin Ravelli, Les briques rouges : logements, dettes et luttes sociales en Espagne, Paris : Éditions Amsterdam, 2017.
[5] Trebor Scholz, Le coopérativisme de plateforme. 10 principes contre l’ubérisation et le business de l’économie du partage, Paris, FYP éditions, 2017.
[6] Friedrich Engels & Karl Marx, L’idéologie allemande, Paris : Éditions sociales, 1952 [1845].
[7] Frédéric Donlor, « Black block et croissance – des propriétés économiques de la casse », Lundi matin, n° 190, 6 mai 2019. Ce billet postiche d’un philosophe et économiste célèbre dans les milieux de gauche entend démontrer par l’absurde le raisonnement et la discipline économiques, en expliquant que le bris causé en manifestation permettrait, par le jeu des polices d’assurance, de freiner la spéculation des marchés en forçant les compagnies d’assurance à vendre des titres pour dédommager les frais occasionnés par le remplacement des vitrines et autre mobilier urbain, et ainsi faire fonctionner « l’économie réelle » grâce aux travaux des petits artisans.
[8] « Ils ne lâcheront rien », La pompe à phynance, 5 mai 2020.
[9] Razmig Keucheyan, « Financiariser les catastrophes naturelles : assurance, finance et changement climatique », Actuel Marx, vol. 61, n° 1, 2017, p. 79-94.
[10] Cédric Durand, Le capital fictif. Comment la finance s’approprie notre avenir, Paris, Les prairies ordinaires, 2014, pp. 98-102.
[11] Aux États-Unis, la part des 1% des ménages les plus fortunés dans la détention des titres de dette souveraine est passée de 16% à 40% entre 1970 et 2010, selon Cédric Durand (ibid, p. 111). Dans le cadre de la réforme du système de retraites français, le projet gouvernemental prévoyait de diminuer le plafond de cotisations au régime obligatoire pour les salariés gagnant un revenu annuel brut de 120 000€, soit environ 300 000 personnes alors libres de souscrire à des plans d’épargne-retraite par capitalisation, dont l’attractivité a par ailleurs été améliorée par la loi « Pacte » (voir Maxime Combes, « Axa, AG2R, Amundi, BlackRock : qui seront les grands gagnants du développement de la retraite par capitalisation ? », 16 janvier 2020). Ces inégalités patrimoniales posent aussi la question des contradictions entre groupes sociaux qui peuvent jouer à l’occasion des luttes contre la financiarisation.
[12] Desiree Fields, « Urban struggles with financialization », Geography Compass, vol. 11, 2017, p. 1-13.
[13] Alexandre Laumonier, 4, Zones Sensibles, 2019. [Voir ici un extrait de son livre précédent, 6|5 – NDLR.]
[14] Youssef Cassis, Les capitales du capital: histoire des places financières internationales, 1780-2005, Genève, Éditions Slatkine, 2006.
[15] Yamina Tadjeddine, « Les territoires de la finance, le cas parisien », in Isabelle Chambost, Yamina Tadjeddine, Marc Lenglet (dir.), La fabrique de la finance. Pour une approche interdisciplinaire, 2016, pp. 141-148.
[16] Agnès Stienne, « À Paris, les lieux du pouvoir », La valise diplomatique, 5 décembre 2018.
*
Crédit photo : @l_peillon, 8 décembre 2018.