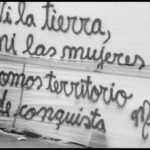Où vont les luttes écologistes en France aujourd’hui ? À propos d’un livre récent
Jean-Baptiste Comby et Sophie Dubuisson-Quellier ont publié récemment « Mobilisations écologiques » (PUF, 2023), un livre qui en moins de 100 pages se donne pour objectif de donner à voir la politisation et la diversité des luttes écologistes dans la France contemporaine. Le sociologue Vincent Gay propose ici une lecture de cet ouvrage.
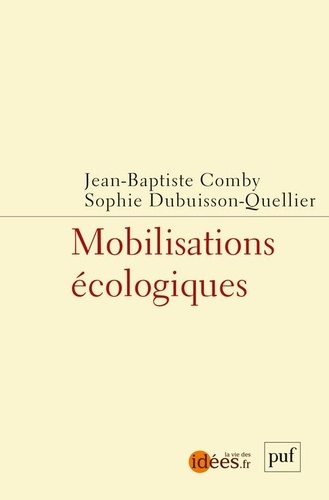
L’ouvrage coordonné par les sociologues Jean-Baptiste Comby et Sophie Dubuisson-Quellier pose dès le titre de l’introduction la question de la politisation des mobilisations écologiques contemporaines en France. Selon eux, on assisterait dans la période actuelle à une dynamique nouvelle des mobilisations écologiques, dynamique qualifiée de politisée, par contraste à une période antérieure, où la question de la politisation ne se posait pas, ou pas de la même façon. Si ce postulat est discutable, dans la mesure où les dynamiques de politisation inhérentes aux mobilisations écologiques ont toujours été présentes, mais sans doute pas dans les mêmes termes qu’aujourd’hui, l’ouvrage permet de saisir quelques points de surgissement, plus que de rupture avec l’ancien, décelables dans les mobilisations écologiques actuelles.
L’ampleur de ces mobilisations n’est plus à démontrer, ce dont témoigne, entre autres, le succès des rencontres militantes Les Résistantes sur le plateau du Larzac en août dernier, qui a réuni plus de 7000 personnes émanant de collectifs opposés à divers projets agro-industriels et routiers (mégabassines, autoroutes, fermes-usines…) ou inscrites dans d’autres luttes écologistes. L’ampleur de ces mobilisations et leur approfondissement explique également la panique étatique face à cette nouvelle écologie militante qui a abouti à la tentative, pour le moment non couronnée de succès, de dissolution des Soulèvements de la Terre…
Impossible donc de résumer dans un livre de moins de 100 pages la diversité de ces mobilisations, d’où le choix par les auteur.ices de cerner quelques aspects de ce renouveau. Ils et elles constatent que ce qui avait été une écologie d’experts, s’appuyant essentiellement sur la science, le droit et l’économie, et traitant des problèmes environnementaux de manière sectorisée, cède peu à peu la place à une écologie militante qui se caractérise à la fois par son hétérogénéité et par sa « conflictualisation ».
Résultant de l’accentuation de la crise environnementale et du peu d’efficacité de l’écologie des experts, ces évolutions interrogent également les caractéristiques sociales des acteur.ices de ces mobilisations. Les évolutions évoquées ici permettent-elles de rallier des groupes sociaux nouveaux, moins dotés en capitaux que les classes supérieures ? Ou s’agit-il de militant.es sensiblement issu.es des mêmes catégories mais qui ont seulement fait évoluer leurs répertoires d’action ? Et assiste-t-on à une transformation même de la cause écologique, qui sort d’un strict environnementalisme pour devenir « un moyen d’améliorer les conditions d’existence des catégories défavorisées » ?
Une partie des associations environnementalistes anciennes, qui ont pu obtenir certaines avancées réglementaires et ont épousé une tactique plus proche du lobbying et du recours à la science que des mobilisations collectives, a été bousculé par l’irruption de nouveaux mouvements au cours des années 2010. Ces derniers se sont caractérisés par le fait qu’ils ont, plus que leurs prédécesseurs, désigné des responsables de la crise environnementale multiforme (les pouvoirs économiques et politiques) et que leurs modalités d’action visaient à mettre en scène une conflictualité avec ces pouvoirs : grèves, blocages, happenings dans des lieux culturels ou sportifs, désobéissance civile, voire sabotage, ou désarmement des infrastructures climaticides.
Cet élargissement du répertoire d’action écologiste ne rompt pas pour autant avec des formes plus institutionnalisées d’action, qui elles aussi se renouvellent comme le montrent les recours à la justice contre divers États ou institutions pour inaction climatique, avec dans le cas français l’expérience de l’Affaire du siècle. On constate donc une évolution des stratégies, des pratiques, des cibles et des cadrages idéologiques de la cause écologique, qu’on peut observer particulièrement dans le cas des mouvements pour le climat, qui après une période centrée autour des conférences annuelles des négociations internationales (les COP), se sont redéployés et redéfinis, notamment en se reterritorialisant, permettant à de nouveaux acteurs de se mobiliser (et non plus seulement aux membres d’ONG environnementalistes et d’organisations altermondialistes), et d’intégrer la question climatique dans d’autres problématiques, sociales comme environnementales[1].
Dans ce processus de territorialisation, la lutte de Notre-Dame-des-Landes a joué un rôle essentiel pour plusieurs raisons : d’une part parce qu’elle a permis d’articuler une défense localisée d’un espace et une critique sociale plus vaste (que résumait le slogan « contre Vinci et son monde ») ; parce qu’elle a offert un surcroît de légitimité en s’appuyant sur des populations locales et notamment des paysans ; parce qu’elle a fait cohabiter différentes sensibilités militantes en articulant une large gamme de répertoires d’action, et d’associer des acteurs pas toujours attendus (syndicalistes locaux ou de l’entreprise Vinci, naturalistes en lutte…) ; parce que la ZAD a été un lieu d’accueil et d’impulsions d’autres luttes, locales, nationales ou transnationales ; enfin, parce qu’elle a été le lieu d’expérimentations, de créations d’imaginaires et de théorisations politiques, qui imprègnent les mobilisations plus récentes, dont, par exemple, les Soulèvements de la Terre constituent un prolongement.
La dimension territoriale de Notre-Dame-des-Landes a donc incarné à maints égards l’inverse d’une tendance NIMBY (not in my backyard) et a contribué à un vaste redéploiement de l’écologie militante. A ce titre, le parallèle régulièrement évoqué avec la lutte du Larzac au cours des années 1970 est pertinent, à la différence près que les effets ultérieurs du Larzac après l’abandon du projet d’agrandissement du camp militaire par Mitterrand en 1981 ont été relativement discrets, tandis qu’on peut estimer que Notre-Dame-des-Landes a joué un rôle de tremplin pour la critique en acte du capitalisme productiviste.
Le renouveau des mobilisations écologistes est donc indéniable depuis une quinzaine d’années ; pour autant, est-ce que cela a permis aux classes populaires de s’emparer de la cause écologique ? Dans leur introduction, les auteur.rices signalent les tensions qui traversent certains projets d’« écologie sociale » ainsi que les tendances à qualifier dans le langage de l’écologie certaines pratiques populaires. Iels mentionnent également des initiatives et évènements récents ayant posé la question de la place des classes populaires face à la cause écologique et ayant parfois tenté d’apporter des réponses, comme la coalition syndicale et associative Plus Jamais Ça (rebaptisée Alliance Ecologique et Sociale)[2], et le mouvement des Gilets Jaunes[3].
Dans ce dernier cas, il est intéressant d’observer les cadrages dont les Gilets Jaunes ont été l’objet quant à leurs rapports à l’écologie. Souvent accusés d’être hostiles à la cause environnementale parce que refusant l’augmentation d’une taxe carbone, les Gilets Jaunes ont partiellement réussi, du fait de la force de leurs mouvements, à produire une réinterprétation mettant l’accent sur les inégalités environnementales et les responsabilités de la crise climatique, interprétation soutenue par quelques chercheurs ayant observé les pratiques écologistes des Gilets Jaunes[4].
L’intérêt de cette introduction, complétée par une courte bibliographie commentée en fin d’ouvrage, est également de donner à voir un aperçu des recherches en sciences sociales à propos des mobilisations écologistes. Longtemps cantonnées à de trop rares travaux, ces mobilisations ont désormais une place importante dans la sociologie des mouvements sociaux en France, parallèlement au développement de travaux en histoire environnementale dont une partie s’intéresse aux protestations[5].
A la suite de l’introduction, le livre se compose de cinq contributions qui peinent à couvrir la largeur du spectre des mobilisations écologistes contemporaines mais permettent de mettre l’accent sur certaines d’entre elles, qui ont pu parfois bénéficier d’un éclairage médiatique et éditorial conséquent, dans le cas notamment des luttes contre les grands projets d’aménagement ou de l’émergence et le développement de l’écoféminisme.
Dans ce dernier cas, la contribution de Geneviève Pruvost offre une synthèse de ses travaux récents, sous un angle moins théorique que dans Quotidien Politique[6], afin de distinguer sept domaines de luttes écoféministes en France : la défense des terres, la justice environnementale, la santé, le sacré, les arts, la consommation, les violences hétérosexistes et sexuelles ; et sept échelles, espaces ou répertoires d’action : des mobilisations sur le terrain des pratiques ordinaires ; des mobilisations à partir de l’organisation d’un collectif de vie ; celles qui privilégient l’échelle locale ; celles qui se situent sur le terrain des pratiques professionnelles ; celles qui agissent au niveau des organisations internationales ; les mouvements protestataires anti-institutionnels, et a contrario les mobilisations au sein des institutions.
Ces distinctions permettent de sortir d’une vision uniforme de l’écoféminisme, dont il est à vrai dire difficile de définir précisément des principes communs, mais qui irrigue pensées et pratiques politiques, certaines marquées par une volonté de transformation sociale radicale quand d’autres nourrissent plutôt une éthique et un mode de vie privés.
Le chapitre de Stéphanie Dechézelles consacré aux luttes contre les projets d’aménagement a le mérite de montrer l’hétérogénéité des répertoires d’action, montrant ainsi que l’occupation de lieux, comme les ZAD, ou les actions de désobéissance qui ont fait l’actualité des derniers mois, ne sont qu’une modalité parmi d’autres dans le registre protestataire, et que les différentes formes d’action sont à relier en partie aux caractéristiques sociales des acteurs de ces protestations ; rien de bien original ici, mais cela reste toujours important de le rappeler.
Plus intéressant est ce qui touche à l’ancrage territorial des luttes, principe souvent avancé mais moins approfondi d’un point de vue sociologique ; l’autrice analyse le rapport différencié aux territoires entre les personnels techniques des institutions chargés de mener à bien un certain nombre de projets, et les opposants à ces projets dont la contestation mêle niveaux local et international, dimensions publique et privée, à partir d’un rapport au territoire qui devient un support de la critique. Elle permet aussi de revisiter à nouveaux frais la notion de capital d’autochtonie, lorsqu’elle parle d’« autochtonie alternative » composée de différentes strates de néo-ruraux, dont l’assemblage et la revendication d’une appartenance sensible agissent comme un puissant support de mobilisation.
A une toute autre échelle, Edouard Morena revient sur la façon dont les mouvements pour le climat ont été modelés par la gouvernance climatique mise en œuvre par la conventions cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1992. Il analyse les évolutions des « mouvements climat », à la fois du fait des changements intervenus au cours des négociations internationales et des débats propres au réseau des ONG environnementales, donnant lieu à une séparation en 2007 entre le climate action network (CAN), privilégiant le dialogue avec les acteurs institutionnels, et Climate Justice Now (CJN), composé d’organisations grassroots, altermondialistes et ayant la volonté de réancrer les mouvements pour le climat dans les luttes concrètes et les revendications des groupes dominés.
Si cette histoire est assez connue, ces rappels permettent de mieux comprendre quel rôle certaines organisations ont pu jouer dans la gouvernance climatique, notamment au moment de l’accord de Paris en 2015 dont les négociateurs avaient besoin d’une caution de la « société civile » pour que sorte une « bonne » interprétation de l’accord. Entre instrumentalisation et coopération bien comprise de la part de différents acteurs, la frontière est mince, ce qui interroge d’autant plus le rôle que peuvent jouer les mouvements sociaux à l’occasion des COP annuelles ou d’autres sommets pour le climat.
Car l’écart de plus en plus grandissant entre l’urgence climatique et ce qui se joue dans ces arènes, incite à délaisser celles-ci pour privilégier d’autres espaces de mobilisation, ce qu’illustrent les mouvements plus récents comme Extinction Rebellion ou Dernière Rénovation. Ce qui se voulait une gouvernance polycentrique, intégrant les voix autorisées de la « société civile » entre désormais en crise, crise qui transforme les cibles, les formes d’action et les modalités d’organisation des mouvements pour le climat.
Les deux autres contributions de l’ouvrage sont sans doute les plus intéressantes car elles traitent de situations qui certes connaissent un intérêt récent dans les milieux militants mais sont relativement discrètes à une large échelle. D’une part la justice environnementale dans les quartiers populaires ; d’autre part le racisme environnemental dans les colonies françaises, à partir du cas des luttes écologiques à la Réunion.
Flaminia Paddeu raconte la lutte contre les pollutions menée par des habitants du Bronx à New-York qui se sont appuyés sur les notions de justice environnementale et de racisme environnemental pour défendre leur cause. Principalement menée par des associations afro-américaines et latinas issues de l’action sociale, en alliance avec des associations environnementalistes animées par des Blancs, cette lutte a permis la fermeture d’une usine polluante en 2010.
Pour autant, ce succès, qui a été suivi d’un réaménagement du quartier, avec de nouveaux usages pour les populations, a conduit à une hausse des prix immobiliers ; d’où ce paradoxe d’une lutte menée d’abord par des groupes racisés issus des classes populaires qui risque de conduire à l’éviction de ces mêmes groupes. Ainsi, malgré l’existence de coalitions, les rapports de domination sont reproduits parmi les acteurs en lutte, notamment dans la captation des financements dédiés à l’action écologique. Cela interroge la façon dont les principes de justice environnementale s’inscrivent durablement dans les mobilisations écologistes, question également posée dans le cas français où les luttes dans les quartiers populaires s’appuient rarement sur une telle exigence.
Concernant le cas français, Marie Thiann-Bo Morel note tout d’abord que les inégalités environnementales ont été peu ou pas pensées sous le prisme du racisme environnemental, malgré le développement récent de travaux sur le colonialisme vert ou l’écologie décoloniale, ou encore la dénonciation des ravages du chlordécone dans les Antilles[7]. L’absence d’énonciation de la question raciale s’explique par de nombreux facteurs propres à la France, mais l’autrice montre, à partir de l’analyse de deux conflits environnementaux à la Réunion, que celle-ci traverse les mobilisations, à travers le langage utilisé, les symboles et les identités mises en avant. L’identification raciale de militants blancs, issus de l’Hexagone, produit une disqualification de leur cause qui apparait comme une domination supplémentaire sur les populations créoles.
Dans un autre conflit, réclamant la fermeture de paillotes sur une plage, les militants sont soumis à l’injonction d’effacer la dimension raciale du phénomène qu’ils dénoncent (l’appropriation d’une grande partie du littoral par les Blancs) afin de se légitimer à travers un discours color-blind. Ces deux exemples montrent à la fois la prégnance de la question raciale et la difficulté à faire du racisme environnemental un cadre légitime d’explication des phénomènes sociaux. La revendication d’égalité entre ultramarins et hexagonaux est bien défendue, mais au prix d’un effacement de la question raciale.
Pour conclure, Mobilisation écologiques offre donc un aperçu utile mais parfois un peu court sur certains enjeux des protestations contemporaines. En privilégiant des articles issus de recherches en sciences sociales, il invite à poursuivre de telles investigations. Le format de la collection « La vie des idées » reste cependant frustrant, particulièrement pour un domaine qui connait des développements rapides et une réelle massification, dont l’ouvrage, du fait de sa taille, peine à rendre compte.
Notes
[1] Sur les stratégies des mouvements pour le climat, voir Attac, Pour la justice climatique, stratégies en mouvement, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2021.
[2] Voir Aurélie Trouvé et Julien Rivoire, « Unité, alliances et alternatives : quelles perspectives pour les mouvements sociaux ?« , Contretemps, juillet 2020 ; Guillaume Mercœur, « Stratégies, perspectives et limites de l’environnementalisme syndical », Les Mondes du Travail n° 29, mars 2023, dossier « Travail et écologie ».
[3] Voir le dossier « Vers de nouvelles écologies populaires ? », Écologie & politique 2021/1 (N° 62).
[4] Maxime Gaborit & Théo Grémion, « Jaunes et verts. Vers un écologisme populaire ? », La Vie des idées, 20 décembre 2019
[5] Voir par exemple Renaud Bécot, Gwenola Le Naour, Vivre et lutter dans un monde toxique. Violence environnementale et santé à l’âge du pétrole, Paris, Le Seuil, 2023.
[6] Geneviève Pruvost, Quotidien politique, Paris, La Découverte, 2021.
[7] Voir Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l’écologie depuis le monde caribéen, Seuil, 2019.