
Le marxisme culturel de Raymond Williams
Fondateur des Cultural Studies et de la New Left Review, Raymond Williams (1921-1988) est une des figures les plus influentes et novatrices de la culture critique anglaise. Très peu connu en France – à part quelques rares articles publiés dans de petites revues – il aura fallu un demi-siècle après la publication de ses premiers livres importants pour qu’il soit enfin traduit en français : Culture et Matérialisme (Paris, Les Prairies Ordinaires, 2009, 246 pages), livre à propos duquel on pourra lire cet article de Thierry Labica.
Dans cet article publié en 2012, Michael Löwy revient sur la trajectoire politique de Raymond Williams pour en détailler les apports, les relations qu’il a entretenues avec le marxisme et la façon dont il a combattu sa déviation vers le dogmatisme. L’apport de Williams est essentiel concernant les approches critiques de la culture, mais son œuvre ne peut être détachée d’un engagement intellectuel né au cœur de l’Angleterre au milieu du 20ème siècle et des débats de la nouvelle gauche qui apparaissent alors.
***
Comment expliquer le retard dans la traduction en français de l’œuvre de Raymond Williams ? La Manche est-elle un abîme infranchissable ? Ou c’est l’Hexagone qui tend à s’enfermer dans un splendide isolément ? Ce retard – et d’autres analogues, concernant des auteurs anglais importants – mériterait une recherche avec les meilleures méthodes analytiques / critiques des « études culturelles »…[1]
En tout cas, on ne peut qu’être reconnaissant aux éditions Les Prairies Ordinaires, et aux deux directeurs de la collection « Penser/Croiser », François Cusset et Rémy Toulouse, d’avoir pris l’initiative de publier ce premier recueil d’essais, permettant ainsi au public de langue française de découvrir un des intellectuels de gauche les plus importants d’Angleterre, dont les œuvres sont connues et discutées depuis longtemps aux USA, en Amérique Latine et ailleurs.
Fils d’un père cheminot du pays de Galles, Williams a toujours été – un peu comme son homologue français Pierre Bourdieu – un outsider dans le milieu de l’élite académique anglaise. Sa double loyauté de classe – fils de famille ouvrière – et communautaire – la culture galloise – va être un des fils conducteurs de sa vie. Certes, il a été étudiant de littérature à Cambridge mais, en adhérant au Parti Communiste Anglais vers la fin des années 1930, il se situait nécessairement en marge de l’establishment universitaire ; ses études ont été interrompues par la Deuxième Guerre Mondiale, où il a combattu comme tankiste. Dans l’après-guerre il va choisir de quitter Cambridge – mais aussi le Parti Communiste – pour enseigner, ensemble avec son ami E.P. Thompson, à la Workers’ Educational Association, un réseau d’extension universitaire lié au mouvement ouvrier anglais. Il ne reviendra à Cambridge, comme enseignant, qu’en 1961.
On peut considérer Raymond Williams, ensemble avec Stuart Hall et ses amis du Center for Contemporary Cultural Studies de Birmingham, comme l’initiateur – grâce à son livre Culture and Society de 1958 – des Cultural Studies, destinées à devenir un des domaines les plus importants de la recherche universitaire anglo-saxonne, mais qui sont, à leur origine, une méthode, inspirée par le marxisme, d’analyse socio-historique des faits culturels (au sens large du terme). Il est aussi, avec E.P. Thompson, John Saville, Stuart Hall, Raphael Samuel – et d’autres intellectuels marxistes ayant rompu avec le PC anglais en 1956 – le fondateur (1960) de la New Left Review, dont le rédacteur en chef allait devenir, peu après, le jeune Perry Anderson.
Au cours des années 1960 il va découvrir le marxisme occidental, de tendance historiciste : Gramsci, Lukacs, Lucien Goldmann (pas d’Althusser !) – avec lequel il sent des affinités évidentes. Son œuvre deviendra, à partir de ce moment, un trait d’union entre la tradition de critique culturelle (romantique) anglaise et le marxisme continental. Intellectuel engagé, il ne cache pas ses convictions socialistes, et publie, avec E.P. Thompson, un retentissant document anticapitaliste, le May Day Manifesto (1968), dénonçant, de façon catégorique, les mythes de la modernisation :
« En tant que modèle de changement social, la modernisation raccourcit brutalement le développement historique de la société. Tout le passé est censé appartenir à la Société “traditionnelle” et la modernisation est un moyen technique pour rompre avec le passé sans créer un avenir. […] C’est un modèle technocratique de société, non-conflictuel et politiquement neutre, dissolvant les authentiques problèmes et conflits sociaux dans les abstractions de la “révolution scientifique”, du “consensus” et de la “productivité ”. »[2]
Auteur de romans, d’ouvrages sociologiques, d’études marxistes de la littérature, d’analyse des médias et d’essais politiques – publiés tantôt par Oxford University Press et tantôt par New Left Books (devenus plus tard les éditions Verso) – il a été aussi un des animateurs de la Campagne pour le Désarmement Nucléaire (CND). Certains de ses ouvrages, comme Keywords. A Vocabulary of Culture and Society (1976), ou Marxism and Literature (1977) ont alimenté la réflexion de plusieurs générations d’intellectuels critiques, des deux côtés de l’Atlantique. Son influence était considérable : il suffit de rappeler qu’à la fin des années 1970 il s’était vendu environ 750 000 exemplaires de ses ouvrages ![3]
Enfin, comme le souligne à juste titre Jean-Jacques Lecercle, dans sa belle introduction au recueil français, Williams, contrairement à tant d’autres, n’a jamais retourné sa veste, et n’a jamais renié son engagement socialiste en défense des opprimés. Cette dimension sera perdue de vue dans une partie des cultural studies anglo-saxons, qui vont interpréter Raymond Williams dans les termes du « tournant linguistique » post-moderne, ou « post-marxiste », en évacuant la pointe critique, anticapitaliste, de ses écrits.
La sensibilité socio-culturelle de Raymond Williams se traduit aussi dans ses romans, qui se situent, pour la plupart, dans les milieux populaires du pays de Galles. C’est le cas des trois livres qu’on désigne comme « la trilogie galloise » : Border Country (1960), Second Generation (1964), The Fight for Manod (1974). La dimension romantique est particulièrement présente dans le roman historique inachevé, publié en deux volumes peu après sa mort, People of the Black Mountains (1989-90), qui raconte des épisodes de la vie du peuple gallois de sa région natale, « les Montagnes Noires », depuis l’époque du néolithique jusqu’à la fin du Moyen-Age.
Le grand livre « inaugural » de Raymond Williams, Culture and Society 1780-1950, (Londres, The Hoggarth Press, 1958), est une tentative ambitieuse de sauver, dans une perspective progressiste, la grande tradition anglaise de critique culturelle – romantique – de la civilisation capitaliste/industrielle, qui va de Coleridge et Wordsworth jusqu’à T.S. Eliot et F.R. Leavis, en passant par William Cobbett, Thomas Carlyle, Matthew Arnold et William Morris.
Ces auteurs sont fort divers, mais ils partagent une sorte de nostalgie d’un passé socio-culturel perdu – la « Vieille Angleterre » – et une féroce critique de la modernité industrielle bourgeoise, et de ses valeurs commerciales et mécaniques. Certains sont profondément conservateurs – Edmund Burke – d’autres luttent pour les intérêts des ouvriers – William Cobbett – et quelques-uns sont d’authentiques révolutionnaires socialistes (W. Morris). Sans ignorer ces différences, l’auteur de Culture and Society s’intéresse à ce qui leur est commun, à cette opposition culturelle radicale à la nouvelle société issue de la Révolution industrielle.
Comme l’observe avec raison J.J. Lecercle, Williams ne va jamais abandonner ses positions, même s’il lui arrive de nuancer ou infléchir son propos. Un exemple de cette continuité est la monographie qu’il dédie en 1983 au publiciste romantique et démocrate William Cobbett :
« S’il est la voix de quelque chose qu’on peut appeler […] la Vieille Angleterre, il est aussi, dans le même mouvement, la voix de la protestation contre le capital financier, l’impérialisme et l’État aristocratique, et la voix de l’encouragement à l’organisation de la classe ouvrière… »[4]
Dans Culture and Society, Williams se livre à une critique en règle du marxisme anglais, passablement réductionniste, des années 1930 (Christopher Caudwell). Mais il n’aspire pas moins à « une interaction entre le romantisme et Marx, entre l’idée de la culture qui est la principale tradition anglaise, et la brillante réévaluation de cette idée que fit Marx » – un objectif qui lui apparaît comme une tâche pour l’avenir : « nous sommes obligés de conclure que l’interaction est jusqu’à présent loin d’être achevée. »[5]
Dans les années 1930, cette tradition anglaise de critique de la civilisation mécanique et son esprit commercial mesquin – au nom de la communauté organique du passé et de la tradition culturelle – a été représentée notamment par F.R. Leavis, auteur du livre Mass Civilisation and Minority Culture (1930), et par son influente revue de critique littéraire, Scrutiny. Tout en rejetant le conservatisme et l’élitisme culturel de ce courant, Raymond Williams s’intéresse à sa dimension critique et à son opposition contre la dégradation mercantile de la culture. Peut-on, pour autant, définir sa position politico-culturelle comme un « leavisisme de gauche », comme le propose J.J.Lecercle ?[6]
Ce n’est pas faux, mais la référence me paraît trop limitée : pourquoi ne pas le définir comme un disciple de William Morris ou un « cobbettiste » moderne ? La formule proposée par Lecercle est d’autant plus problématique que Williams se distancie très explicitement des postures élitistes de Leavis et de Scrutiny. Lecercle utilise une autre expression discutable pour rendre compte de la singularité de l’œuvre de Williams : elle serait « un moyen terme » entre le Cambridge English de Leavis et le marxisme orthodoxe (p. 17). Il me semble que le matérialisme culturel de Raymond Williams n’est pas un « moyen terme » mais plutôt un dépassement dialectique de cette contradiction, au sens de la Aufhebung marxo-hégélienne. En fait, Williams ne peut pas être rattaché de forme exclusive à Leavis ou à tel ou tel autre auteur de ce courant, mais appartient – comme E.P. Thompson – à ce qu’on pourrait désigner comme « marxisme romantique » ; certes, cette terminologie n’apparaît jamais, sous cette forme, dans ses écrits, mais dès 1958, comme nous avons vu, le projet d’une interaction entre les deux est posé.[7]
Aussi bien Thompson que Williams vont s’éloigner de la New Left Review au cours des années 1960, ne partageant pas les options intellectuelles et politiques de sa nouvelle rédaction (Perry Anderson et ses amis). Un des nouveaux rédacteurs, Terry Eagleton, publiera en 1976 un article mettant en question le marxisme de Williams, dont la méthode lui semble « idéaliste ». Cependant, peu d’années plus tard, un rapprochement aura lieu, qui se traduit dans Politics and Letters (New Left Books, 1979), un livre d’entretiens avec Williams, conduit par Perry Anderson et deux autres rédacteurs de la revue, Anthony Barnett et Francis Mulhern. A partir de ce moment on peut dire que Williams deviendra un pont intellectuel et politique entre la « Old New Left » et la « New New Left ».
Un exemple frappant de sa conviction que le marxisme doit être capable d’intégrer l’apport de la critique romantique est un court texte de 1980 : le compte-rendu de la traduction anglaise de mon livre sur Lukacs. Si son jugement est plutôt favorable – notamment en ce qui concerne la première section du livre, qui tente d’analyser les sources romantiques du jeune Lukacs – il ne cache pas son irritation devant le titre de l’ouvrage : Georg Lukacs – from Romanticism do Bolchevism (New Left Books, Londres 1979). En fait, le titre n’est pas celui de l’édition originale, française, du livre, mais avait été choisi par mes amis de la New Left Books – certes, avec mon accord … Ce titre semble mépriser (dismiss) le romantisme anticapitaliste diffus du jeune Lukacs comme une simple étape préparatoire, devant nécessairement être dépassé dans le chemin vers le marxisme et le communisme. Or, fait remarquer Williams, si les romantiques dénonçaient la bureaucratie étatique, le lien entre l’industrialisme et la “quantification de la pensée”, ainsi que le manque de communauté dans la société moderne, il est difficile, « à la fin des années 70, de conclure qu’ils perdaient leur temps ou ne voyaient pas une quelconque vérité simple et fondamentale ».
Le socialisme moderne ne peut pas ignorer les critiques « contre l’état centralisé, l’industrialisme et l’ordre social qui peuvent, de façon informelle, être désignées comme ‘romantiques’ » ; le refus de ces questions – et d’autres analogues, sur l’économie de « croissance », sur les libertés individuelles, sur la démocratie comme processus social – en les traitant de « romantiques » au sens dépréciatif du terme, i.e. « irréalistes », « vagues », « impraticables », est une des causes de la dégradation de la théorie et de la pratique du socialisme au 20ème siècle. L’œuvre principale de Lukacs, Histoire et Conscience de Classe (1923), et notamment son concept de réification, ne sont-ils pas le résultat d’une récupération, pour le marxisme, de la critique, dite « romantique », de la conscience quantitative et instrumentale ? C’est une question centrale pour la « bataille des marxismes » (struggle of marxisms) qui se trouve engagée en ce moment, quand certains, face à la crise de l’époque post-Staline, tentent de rejeter cette problématique comme idéalisme romantique, ou encore, selon une nouvelle rhétorique péjorative, comme humaniste et moraliste[8].
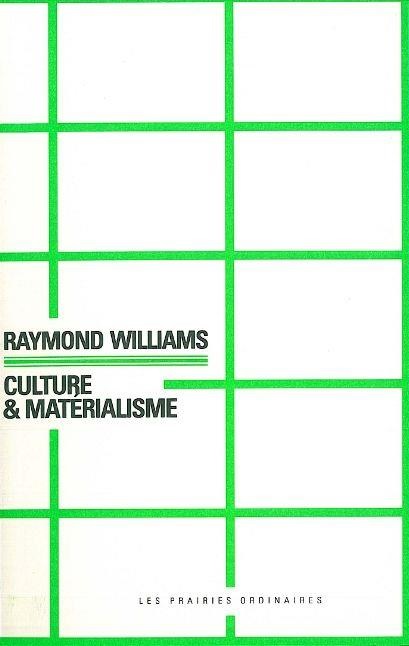
Le recueil qui vient de paraître en français sous le titre Culture & Matérialisme n’est pas la traduction intégrale du livre Culture and Materialism (1980) : plusieurs des essais de ce volume – notamment une passionnante étude sur Lucien Goldmann – ne figurent pas ici. Il s’agit plutôt d’un ensemble d’essais d’origines diverses parus dans ce recueil de 1980, ainsi que dans celui de 1989 intitulé Politics of Modernism : Against the New Conformists, tous les deux parus chez Verso à Londres. On peut critiquer tel ou tel choix, mais l’ensemble permet de se faire une idée – certes partielle – de la richesse de l’œuvre de Raymond Williams.
Les questions analysées vont de la théorie marxiste des superstructures au rôle néfaste de la publicité, en passant par les avant-gardes artistiques, le darwinisme social et les moyens de communication. Comme le souligne Lecercle dans son intéressante préface, ces essais, manifestations d’un marxisme vivant, n’ont pas pris une ride et nous parlent de la conjoncture actuelle. Le concept le plus novateur de Williams, celui de structure de sentiment (structure of feeling), dépasse dialectiquement l’opposition entre expérience personnelle et conception collective du monde ; il est un exemple éclatant de la méthode de l’auteur : une « hybridation faste de la critique littéraire élitiste et de l’analyse culturelle marxiste » (p. 24).
Certains des textes du recueil témoignent de la persistance, sous une forme modifiée, de la sympathie de l’auteur pour la critique romantique – notamment dans ses manifestations modernes. La problématique est abordée dans un article de 1985 sur les origines du modernisme, qui compare la protestation romantique contre la solitude de la foule dans les grandes villes modernes – de Wordsworth à Elisabeth Gaskell et Charles Dickens – avec la critique féroce d’Engels, dans La situation de la classe ouvrière en Angleterre (1844), contre l’indifférence brutale, l’égoïsme borné et surtout la désagrégation de l’humanité en monades isolées, qui semble être le principe fondamental de la société bourgeoise, et avec les inquiétudes des écrivains et poètes modernistes. Ces derniers, observe Williams, en citant un de ses auteurs préférés, T.S. Eliot, vont se référer aux cultures passées ou exotiques contre le monde moderne – c’est à dire bourgeois.
Cette problématique sera abordée, de façon beaucoup plus précise, dans un brillant essai de 1988 – un de ses derniers écrits, rédigé peu avant sa mort – sur « La politique de l’avant-garde ». Williams distingue dans le courant moderniste en général et dans les avant-gardes politico/artistiques deux tendances opposées – au-delà de leur commune dénonciation de la bourgeoisie, de l’académisme et de la religion : ceux qui, comme les futuristes, célèbrent la vitesse, la machine, la grande ville, la guerre, et ceux qui, comme les symbolistes, les expressionnistes ou les surréalistes, sont des héritiers du médiévalisme romantique et s’intéressent aux arts primitifs et exotiques, en opérant une sorte de retour vers un au-delà de l’ordre social existant.
Tandis que les premiers – sauf en Russie (Maiakovsky) – vont se rallier au fascisme, les deuxièmes feront des choix politiques très divers. Mélange de critique aristocratique – le culte du génie artistique comme véritable noblesse – et critique socialiste de la bourgeoisie – l’opposition à la réduction de l’art au commerce et à l’argent – la variante « néo-romantique » de l’avant-garde valorise le royaume indompté du pré-rationnel et de l’inconscient. Les résultats politiques de cette posture sont multiples, mais aboutissent souvent du côté de l’anarchisme, du socialisme révolutionnaire ou du communisme ; c’est le cas notamment des symbolistes, des dadaïstes, des surréalistes et d’une partie des expressionnistes – même si certains, comme Gottfried Benn, finiront dans les rangs du nazisme. En fait le Troisième Reich va condamner en bloc les divers courants modernistes en les accusant de Kulturbolchevismus, tandis que les héritiers du bolchévisme en URSS vont les désavouer à leur tour…
Williams s’intéresse aussi, bien entendu, aux manifestations de l’avant-garde littéraire en Grande Bretagne : tandis qu’une sorte d’expressionisme de gauche va se manifester dans les écrits de Auden et Isherwood, un modernisme de droite, parfois même fasciste, est représenté par Yeats, Wyndham Levis et Ezra Pound. Le cas de T.S. Eliot, le principal poète moderniste et le plus influent de ces auteurs, est plus complexe : d’une part, élitiste et traditionaliste, de l’autre, « effectivement subversif par rapport à un ordre culturel et social intolérable (et en ce sens toujours bourgeois) » (p. 157).
Cet essai passionnant, certes lacunaire et incomplet – par exemple Williams ne semble pas avoir une connaissance précise de la radicalité de l’engagement politique des surréalistes, dont il ne retient que « la résistance active et perturbatrice contre le fascisme » – peut être considéré comme une extension, dans le domaine des avant-gardes, de l’analyse, initiée avec Société et Culture, de la richesse et des ambiguïtés de la critique culturelle – d’inspiration romantique – anti-bourgeoise. Certaines de ses formulations, comme celle qui décrit, au cœur de ce courant culturel, un mouvement de « retour vers un au-delà de l’ordre social existant », captent, avec une intuition extraordinaire, la dynamique singulière de ce phénomène.
Parmi les manifestations les plus inquiétantes de la société bourgeoise moderne, deux font l’objet d’analyses concrètes dans ce recueil : la publicité et le social-darwinisme. Citant avec approbation un ouvrage collectif contre la publicité – et en particulier contre sa manipulation cynique de l’esprit des enfants – rédigé par Huxley, Russel, Leavis et Thompson – un curieux mélange de critiques culturels du capitalisme, de différentes tendances – Raymond insiste sur le besoin de dépasser les critiques superficielles du phénomène – son caractère vulgaire, trompeur et envahissant – pour s’attaquer au fond du problème : la publicité comme « art officiel de la société capitaliste », et comme système hautement organisé de satisfactions « magiques », qui utilise les progrès des sciences humaines pour mener une guerre psychologique contre les personnes – avec un effet destructeur sur les objectifs d’ensemble de la société.
Quant au darwinisme social, cette défense et illustration de l’individualisme concurrentiel implacable de la civilisation industrielle/capitaliste au nom de la doctrine de la « survivance des mieux adaptés », ce n’est pas seulement un phénomène de la fin du 19ème siècle – de Herbert Spencer à Theodore Roosevelt, sans oublier J.D. Rockefeller – mais sert encore aujourd’hui de légitimation aux versions les plus brutales de l’économie de marché et de l’ordre hiérarchique bourgeois. Ces deux études illustrent un aspect essentiel du matérialisme culturel de Raymond Williams : l’analyse socio-politique ne doit pas seulement porter sur la littérature, la poésie et la « haute culture », mais sur toutes les productions culturelles d’une société donnée, et en particulier sur celles qui servent à assurer l’hégémonie des classes dominantes.
Pour comprendre la démarche de Raymond Williams – son matérialisme culturel – l’essai le plus important, du point de vue méthodologique, de ce recueil – et aussi le plus lu et discuté – est celui intitulé « Base et superstructure dans la théorie marxiste » de 1973. Comme nous verrons, les échos de Culture and Society ne sont pas absents ici non plus, même si ce n’est pas la trame de l’argument. Rejetant les lectures économicistes, réductionnistes et déterministes du marxisme, qui conçoivent les ainsi nommées « superstructures » comme un simple « reflet » de la base économique, Williams propose d’aborder les rapports entre productions culturelles et processus socio-économiques à travers la catégorie – lukacsienne – de la totalité, ou du concept – emprunté à Lucien Goldmann – d’homologie structurelle, sans oublier cependant le rôle des idéologies dans l’hégémonie – au sens gramscien – des classes dominantes.
Cependant, au-delà de cette importante révision critique du matérialisme historique « orthodoxe », avec l’aide du marxisme historiciste européen, l’apport le plus novateur de Williams dans cet essai c’est la distinction entre trois types de systèmes culturels : 1/ Les cultures résiduelles, constituées de valeurs d’une formation sociale antérieure, qui résistent à la culture dominante. 2/ La culture dominante, qui impose à la société un système de valeurs et significations hégémoniques. 3/ Les cultures émergentes, qui se réfèrent à des valeurs nouvelles pour s’opposer aux significations établies.
Contrairement à ce que leur nom semble suggérer, les valeurs résiduelles peuvent avoir un rôle critique et oppositionnel important, dans la mesure où elles représentent des domaines de l’expérience, des aspirations et des accomplissements humains que la culture dominante néglige. Une grande partie de la littérature anglaise de ce dernier demi-siècle se réfère, observe Raymond Williams à ces valeurs résiduelles. Certes, grâce à des processus d’incorporation, la culture dominante réussit souvent à intégrer et absorber des valeurs résiduelles ou émergentes ; mais ce n’est pas moins dans ces deux systèmes de valeurs que surgissent des formes véritablement oppositionnelles à l’ordre social établi.
Jusqu’ici nous avons insisté sur les affinités de Raymond Williams avec la critique culturelle romantique de la civilisation capitaliste. Il faut cependant considérer aussi les arguments par lesquels son matérialisme culturel se distingue, de façon tout à fait tranchante, de cette tradition. C’est le cas notamment de ses travaux sur « culture et technologie » et sur les moyens de communication, représentés par deux essais du recueil. Critiquant ce qu’il appelle « l’alliance contre-nature entre le déterminisme technologique et le pessimisme culturel » (p. 184) il se dissocie des sinistres prédictions qui dénoncent, au nom de la culture d’élite, les formes de communication de masse : radio, cinéma, disques enregistrés, et finalement, la véritable Hydre, la télévision.
Certes, observe-t-il, les changements technologiques dans la sphère culturelle se déroulent au sein des rapports sociaux et économiques existants ; par conséquent les innovations techniques découlent essentiellement d’intentions industrielles et commerciales, plutôt que de fins culturelles. L’immense pouvoir de l’argent, lié à l’industrie de la publicité, utilise les nouveaux moyens de communication pour homogénéiser et uniformiser les productions culturelles, au service du commerce transnational.
Cependant, les partisans du pessimisme culturel se trompent en rendant les technologies coupables des contenus méprisables qu’elles transmettent. D’autres usages des nouvelles technologies sont envisageables : pourquoi la télévision par câble et satellite ne pourrait pas, sous propriété publique, être disponible pour un vaste réseau de producteurs autogérés ? Des mouvements sociaux révolutionnaires ne pourraient-ils pas s’approprier collectivement de moyens de production liés à la communication – par exemple des radios locales ?
Dans un autre système économique et social, les nouvelles technologies pourraient favoriser des formes nouvelles et interactives de relations sociales et culturelles, en permettant l’essor de formes de démocratie directe. On peut considérer que Williams pêche par un optimisme excessif, mais ses écrits sur la télévision et sur les moyens de communication de masse sont sans doute un apport original et peu conventionnel à la réflexion critique sur les médias.
En conclusion : espérons que la publication de Culture & Matérialisme ne soit qu’un premier pas, une brèche favorisant la publication d’autres ouvrages d’un penseur qui a profondément rénové la pensée marxiste sur la culture, et dont la « faste hybridation » (Lecercle dixit) entre un matérialisme culturel subtile et la critique romantique de la civilisation bourgeoise n’a rien perdu de son tranchant et de sa puissance.
Notes
[1] Voici un exemple frappant qui contraste avec le retard hexagonal : Raymond Williams a été traduit au Brésil… quarante années avant la France ! Culture and Society a été publié à Sao Paulo en 1969 et The Country and the City en 1989 (Cultura e Sociedade 1780-1950, Sao Paulo, Companhia Editora Nacional, 969 et O campo e acidade, Sao Paulo, Companhia das Lêtras, 1989) ; rappelons que aucun de ces deux livres n’a encore été traduit en français. Il est vrai que les brésiliens n’ont pas continué dans cette voie et les écrits postérieurs de Williams n’ont toujours pas été traduits. Cette lacune a été, au moins partiellement, compensée par la publication, en 2003, du livre Dez Lições sobre Estudos Culturais (Sao Paulo, Editora Boitempo) de Maria Elisa Cevasco , professeur à l’Université de Sao Paulo. Il s’agit d’une remarquable présentation de l’œuvre de Raymond Williams, dans le contexte socio-historique anglais, et en rapport direct avec la création des Cultural Studies et la fondation de la New Left Review. Analysant le matérialisme culturel de Raymond Williams, Cevasco montre qu’il est fondé sur une perception beaucoup plus riche de la culture, incluant non seulement les « grandes œuvres », mais un mode de vie commun à toute la société ; pour Williams, la culture cesse d’être une instance séparée, une sphère autonome – selon la tradition idéaliste – pour être conçue en tant que force productive, une force active dans la vie sociale. Si la dimension romantique est quelque peu marginalisée dans ce livre brésilien, il a le grand mérite de ne jamais séparer l’œuvre théorique de Raymond Williams de son engagement social et politique, et de ses convictions anticapitalistes. L’autre apport intéressant de Cevasco c’est la comparaison qu’elle esquisse entre les études culturelles anglaises et l’école brésilienne de critique culturelle. Il ne s’agit pas ici d’influence, mais plutôt d’un parallèle et d’une certaine affinité. C’est autour de la revue politique et culturelle Clima, (1941-1944) de sensibilité anticapitaliste et marxiste (anti-stalinienne), qui va se former un noyau de pensée critique, dont les deux représentants les plus importants seront le critique de cinéma Paulo Emilio Salles Gomes et le sociologue et historien de la littérature brésilienne Antônio Cândido (j’ai eu la chance d’être son élève à l’Université de Sao Paulo). Leurs travaux deviendront, à partir des années 1950, la principale référence pour la réflexion critique sur la culture au Brésil. Ce qu’ils partagent avec Williams et les Cultural Studies c’est une approche marxiste ouverte, et l’interprétations des processus culturels à partir de la réalité sociale.
La génération suivante des « études culturelles » brésiliennes va se former au début des années 1960, dans un séminaire informel de lecture du Capital de Marx, organisé, hors curriculum, par des jeunes enseignants et étudiants de l’Université de Sao Paulo (entre parenthèses : j’en étais…). La figure la plus importante de cette deuxième génération est un disciple d’Antonio Cândido, le critique littéraire et sociologue de la culture – il s’intéresse aussi au cinéma et à la musique populaire – Roberto Schwarz, dont les travaux sur le grand romancier Machado de Assis et l’analyse critique du « libéralisme » esclavagiste brésilien – ce qu’il appelle « les idées hors de leur place » – sont déjà internationalement connus (Un article sur R. Schwarz a été publié par M.E. Cevasco dans un numéro de la revue Internationale des Livres et des Idées). Au-delà des évidentes différences entre les contextes anglais et brésilien, Maria Elisa Cevasco n’a pas tort de mettre en évidence les analogies entre ces deux écoles d’études culturelles.
[2] May Day Manifesto, éd. R. Williams, Penguin, 1968, p. 45
[3] Voir à ce sujet l’intéressant article de Thierry Labica, “Pourquoi nous avons besoin de Raymond Williams”, Contretemps, Ed. Syllepse, n° 5, mars 2010.
[4] Raymond Williams, Cobbett, Oxford Univ. Press, “Past Masters”, 1983, p. 56. William Cobbett (1763-1835), journaliste, essayiste et polémiste célèbre en son temps. D’abord conservateur, il devint vers 1804 – et resta jusqu’à la fin de sa vie – un démocrate radical et un défenseur de la cause des travailleurs.
[5] Raymond Williams, Culture and Society 1780-1950, Londres, Penguin, 1971, p. 280.
[6] Jean-Jacques Lecercle, « Lire Raymond Williams aujourd’hui », introduction à R.Williams, Culture et Matérialisme, Les Prairies Ordinaires, 2009, p. 12.
[7] Pour une discussion plus détaillée de la dimension « romantique » de Raymond Williams, je renvoie à l’essai « Le courant romantique dans les sciences sociales en Angleterre : Edward P. Thompson et Raymond Williams » par Robert Sayre et moi-même, dans notre livre commun Esprits de feu. Figures du romantisme anticapitaliste, Paris, Editions du Sandre, 2010.
[8] Raymond Williams, “What is anticapitalism ?”, New Society, 24 janvier1980, p. 189-190. La conclusion de la recension, en ce qui concerne mon livre, c’est qu’il a beaucoup de qualités, la principale étant « qu’il peut être lu contre certaines de ces formulations immédiates »… (Soit dit entre parenthèses, la critique de Williams m’a obligé à réfléchir, en termes nouveaux, sur les rapports entre marxisme et romantisme.)









