
Aux origines du capitalisme : retour sur le « Brenner debate »
Dans leur livre récemment publié aux éditions de l’ENS, François Allisson et Nicolas Brisset explorent une controverse intellectuelle majeure qui a eu lieu à la fin des années 1970 : le Brenner Debate.
Nommé d’après Robert Brenner, historien marxiste états-unien, il y est question de l’émergence du capitalisme, et particulièrement de la transition du féodalisme au capitalisme. Les auteurs retracent l’histoire de la controverse, mettant en lumière le rôle central des travaux de Robert Brenner, tout en proposant une contextualisation historique de son développement. Les auteurs éclairent également la manière dont le Brenner Debate a consacré la naissance du « marxisme politique ».
Dans l’extrait du chapitre 2 que nous publions ici, François Allisson et Nicolas Brisset se penchent sur le parcours d’historien de Robert Brenner et ses engagements au sein de la nouvelle gauche états-unienne puis britannique. Ils replacent ainsi la controverse dans le cadre du développement éditorial de la New Left Review britannique, qui est aussi celui de la réception du marxisme dans un environnement marqué par la pensée de E. P. Thompson et l’émergence des cultural studies autour du CCCS (Stuart Hall, Raymond Williams, Richard Hoggart, etc.).
Ce contexte contraste tout particulièrement avec le contexte français, où les travaux de Robert Brenner n’ont été que très peu traduits. L’ouvrage présenté contribue d’ailleurs à combler ce manque par la publication, dans ce deuxième chapitre, de la traduction française de l’article de Brenner qui marque la fin de la controverse.
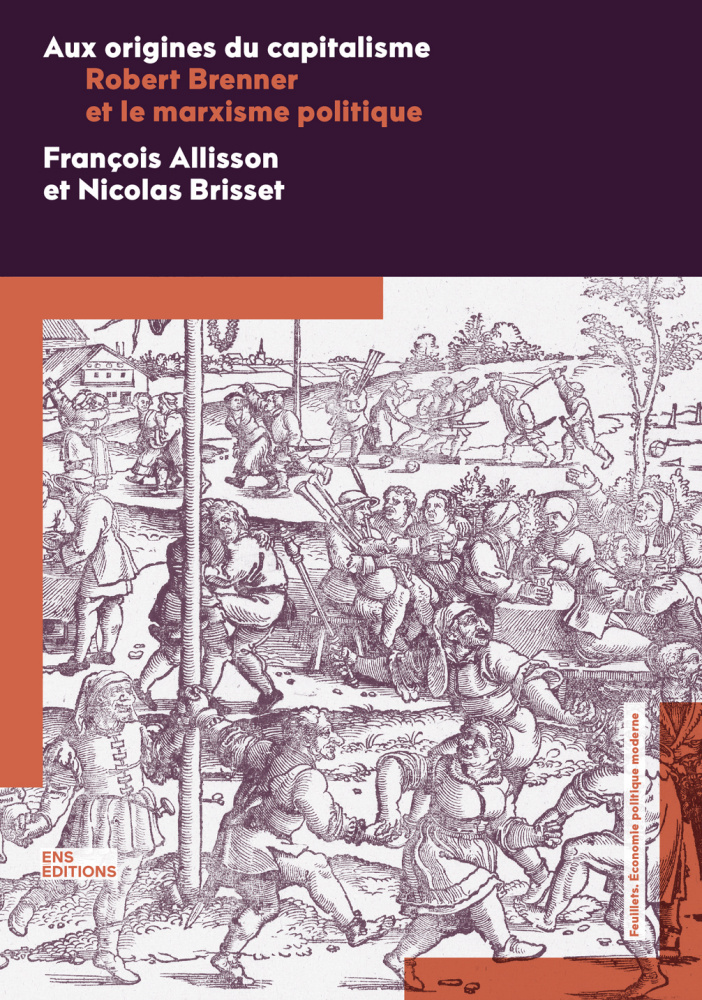
Chapitre 2. Robert Brenner et la transition
La contribution de Robert Brenner au débat sur la « transition » commence en 1976, lorsqu’il publie dans Past and Present son article « Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe ». Elle se termine dans un long article, dont nous offrons une traduction dans ce volume, « Property and Progress: Where Adam Smith Went Wrong » (Brenner 2007), publié dans un ouvrage collectif dirigé par Chris Wickham, Marxist History-Writing for the Twentyfirst Century. Son article de 1976 est aujourd’hui considéré comme central dans la littérature relative à l’histoire économique du Moyen Âge tardif, au moins dans la mesure où, même si les historiennes et historiens médiévistes peuvent se montrer très critiques vis-à-vis de l’historiographie développée par Brenner, il reste un passage obligé (Guerreau 1997).
En 1976, Robert Brenner est un jeune historien de trentetrois ans. Il a déjà publié quelques articles traitant des fondements politiques et sociaux de l’expansion du commerce britannique au xvie siècle (Brenner 1972 ; 1973). C’est sur ce thème qu’il a défendu sa thèse en 1970, Commercial Change and Political Conflict: The Merchant Community in Civil War, et il le développera dans un ouvrage de référence en 1993, Merchants and Revolution (Brenner 2003). L’article de 1976 se donne pour ambition de renvoyer dos à dos deux types d’explications de la transition du féodalisme au capitalisme : les explications démographiques (dites « malthusiennes »), et les explications commerciales (dites « smithiennes »). Dans les deux cas, la transition aurait été le fruit de forces objectives et exogènes aux économies nationales : d’un côté les déséquilibres démographiques, de l’autre l’émergence du commerce. D’une manière ou d’une autre, ces historiographies concurrentes auraient en commun de mettre au centre de l’analyse la loi de l’offre et de la demande. Nous l’avons vu chez Sweezy : les marchés internationaux et l’urbanisation affectent les demandes de bien et de travail, ce qui a pour effet de vider les campagnes et de permettre le développement de l’industrie. Le même genre de mécanisme serait à l’œuvre dans le cadre des approches démographiques, notamment chez Michael Postan, auquel Brenner fait largement référence. Or, conformément à la critique marxiste de l’économie politique, la focalisation sur les mécanismes de marché voilerait les rapports de force sous-jacents à l’échange, des rapports de force qui viennent se nicher dans le processus de production :
L’objectif du présent article est de faire valoir que de telles tentatives de construction de modèles économiques sont nécessairement vouées à l’échec dès le départ, précisément parce que, pour nous exprimer crûment, c’est la structure des rapports de classes, du pouvoir de classe, qui déterminera dans quelle mesure et de quelle façon certains changements démographiques et commerciaux pourront affecter les évolutions à long terme, qu’il s’agisse de la distribution des revenus ou de la croissance économique. (Brenner 1976, p. 31)[1]
Deux volontés, que l’on retrouvera dans l’ensemble des écrits de Brenner, sont ici manifestes : rompre avec l’historiographie libérale, qui part du principe que le marché est partout en puissance, et produire une histoire économique centrée sur les luttes pour l’appropriation des moyens de subsistance. Cette double volonté est en phase avec les supports de publication de Brenner (Past and Present et la New Left Review), dont une analyse rapide nous permettra dans une première section de dresser le paysage intellectuel dans lequel ses idées prennent place. Dans ce chapitre, nous commencerons donc par inscrire le travail de Brenner dans son parcours personnel et au sein de l’histoire marxiste anglaise. Nous reviendrons ensuite de manière plus détaillée sur les thèses qu’il défend, avant de voir les réactions qu’elles ont provoquées.
Le Brenner Debate : du marxisme et de l’histoire en Angleterre
Né en novembre 1943, Robert Brenner est issu d’une famille new-yorkaise dont la mère bibliothécaire et le père éditeur sont tous deux membres du parti communiste. Après une enfance marquée par le maccarthysme (il considère avoir été durablement touché par l’affaire Rosenberg), Brenner entame ses études universitaires au Reed College à Portland. Il y entreprend de travailler sur l’Angleterre médiévale, avant de poursuivre ses études à Princeton. C’est là que Brenner s’engage activement dans le militantisme, notamment en participant à la fondation de l’antenne locale de la Students for a Democratic Society, qui participe activement au mouvement d’opposition à la guerre au Vietnam, et porte le combat antinucléaire. Un mouvement qui marquera le parcours intellectuel de Brenner en raison de son antistalinisme. C’est donc à la fois politiquement et académiquement que Brenner intègre la New Left américaine, ce qui l’amènera à en devenir une figure majeure. Ses thèmes de recherche l’amènent ensuite naturellement à voyager en Angleterre et à se rapprocher des historiennes et historiens venant de la New Left anglaise, ce qui le conduit à publier à la fois dans Past and Present et dans la New Left Review.
L’article de 1976 est publié dans Past and Present, revue fondée en 1952 par de jeunes historiennes et historiens marxistes, pour la plupart proches du parti communiste britannique, bien que critiques vis-à-vis de sa ligne officielle à partir de 1956, année du rapport Khrouchtchev et de l’insurrection de Budapest[2]. Ayant la plupart du temps fait leurs études à Oxford et Cambridge, ils se réunissent depuis la fin de la guerre au sein du Communist Party Historians Group, et comptent notamment dans leurs rangs Christopher Hill, Eric Hobsbawm, Rodney Hilton ou encore Dona Torr. L’objectif affiché de Past and Present est alors d’ouvrir la voie à une histoire « scientifique », émancipée des canons de l’historiographie libérale et événementielle, qui tient alors le haut du pavé (Obelkevich 1981). Nous avons déjà évoqué la critique de Christopher Hill concernant l’histoire anglaise. Celui-ci s’inscrit en faux visà-vis d’une approche événementielle, dominante dans le cadre de l’histoire politique et constitutionnelle, qu’il juge incapable de prendre le recul nécessaire à une véritable compréhension des mécanismes historiques. Il s’attaque également à l’histoire économique naissante, notamment dans le cadre de la revue Economic History Review, fondée en 1927 :
Ils sont devenus obsédés à tel point par les forces économiques, si empêtrés dans les filets de leur érudition, si alourdis de documents poussiéreux, qu’ils arrivent à ne plus voir les hommes et les femmes réels dont la vie fait l’histoire : ils ne peignent ni la grandeur de la forêt, ni l’individualité unique des arbres qui la composent. Si des recherches sur le manoir de Little Puddleton, entre juin et octobre 1933, sont conduites pour elles-mêmes, elles ne feront qu’empiler fait sur fait sans qu’aucune signification ne s’en dégage. (Hill 1948, p. 897)
La volonté affirmée par Hill est de dégager des tendances, des nécessités historiques, tout en évitant le déterminisme historique. L’articulation entre objectivité historique et subjectivité individuelle passe pour lui par une analyse de la lutte des classes. Selon Hill,
« seul le marxisme analyse scientifiquement la lutte des classes comme force motrice de l’histoire et regarde les individus relativement à cette lutte » (Hill 1948, p. 902).
Edward Thompson fut l’un des représentants les plus importants de cette « histoire par le bas » (history from below), terme qu’il a luimême popularisé dans un article publié en 1966 dans le Times Literary Supplement (Thompson 1966)[3]. Thompson fait de la classe un concept central d’une analyse qui entreprend de comprendre et de rendre raison aux combats quotidiens des classes populaires. « Rendre raison » dans la mesure où, audelà des visions convulsives des révoltes populaires, Thompson tente de dessiner les contours normatifs de ce qu’il nomme, dans un célèbre article publié en 1971 dans Past and Present, l’« économie morale » (Thompson 1971). Il s’agit pour lui non seulement d’analyser les systèmes moraux des foules anglaises aux différentes époques avec la même application que le font les anthropologues britanniques avec les cultures lointaines, mais également de rompre avec une certaine ambition sociologique de positionner systématiquement le discours de l’historien en surplomb de celui des acteurs sociaux :
Nous savons tout du tissu délicat des normes et des réciprocités sociales qui règlent la vie des Trobriandais et des énergies psychiques présentes dans les cultes du cargo de la Mélanésie ; mais cette créature sociale infiniment complexe qu’est l’homme mélanésien devient (dans nos histoires) le mineur anglais du xviiie siècle qui convulsivement se frappe le ventre de la main et répond à d’élémentaires stimuli économiques. À la vision convulsive j’opposerai la mienne. Il est possible de déceler une notion de légitimité dans presque toutes les actions de la foule au xviiie siècle. (Thompson 2015a, p. 253-254)
Cette ambition apparaît clairement dans la préface de l’ouvrage considéré comme le plus important de Thompson, La formation de la classe ouvrière anglaise :
Je cherche à sauver de l’immense condescendance de la postérité le pauvre tricoteur sur métier, le tondeur de drap luddiste, le tisserand qui travaille encore sur un métier à main, l’artisan « utopiste », et même le disciple trompé de Joanna Southcott. Il est bien possible que leurs métiers et leurs traditions aient été moribonds ; que leur hostilité à l’industrialisation naissante ait été alimentée par un point de vue passéiste ; que leurs idéaux communautaires aient manqué de réalisme ; que leurs conspirations insurrectionnelles aient été téméraires… Mais ce sont eux qui ont vécu cette période de bouleversement social intense ; ce n’est pas nous. Leurs aspirations étaient justifiées par leur expérience propre. (Thompson 2012, p. 19-20)
Chaque émeute, chaque rébellion s’inscrit dans un contexte moral dont la compréhension permet de mettre les expériences et les comportements collectifs au cœur de la marche de l’histoire, et donc de s’éloigner de l’approche téléologique d’un marxisme structuraliste trop caricatural. Thompson vise principalement Althusser et ses élèves, dont le structuralisme nierait aux classes leur rôle moteur (Thompson 1978 ; 2015b). Dans l’optique d’une démarche rapprochant l’histoire et l’anthropologie, la « nouvelle histoire sociale » de Thompson (inspirée des cultural studies) entend comprendre le processus historique de lutte participant de la formation des classes[4].
Nous remarquons une certaine rupture visà-vis des travaux évoqués précédemment. Une rupture qui aura son importance dans le cas de Brenner. En effet, si Maurice Dobb mettait la dynamique de classes au centre de son analyse conceptuelle, c’était avant tout le mode de production et les tendances économiques qu’il mettait en avant, et plus particulièrement les déséquilibres entre offre et demande de travail. Thompson, au contraire, prend à bras-le-corps la construction sociale des classes en tant que processus irréductible aux forces économiques (Johnson 1978). Comme nous le verrons, malgré leurs différences, Thompson et Brenner partagent des similarités, dont le fait de développer une théorie « relationnelle » des classes, ou, pour reprendre les mots de Fortier et Lavallée, une approche « dont le cœur est la question de la médiation des relations de pouvoir, de domination et d’exploitation » (Fortier et Lavallée 2013, p. 243). Dans ce cadre, le concept de « relations sociales de propriété » sera central pour expliquer les capacités différentielles des dominés à résister, et des dominants à imposer des types particuliers d’exploitation.
Il n’est pas anodin que l’article de Brenner de 1976 soit publié dans Past and Present. Mais avant d’aborder ce point, attardons-nous sur un second vecteur important de la pensée marxiste anglosaxonne, la New Left Review. Brenner entre dans son comité de rédaction à la fin des années 1970. Il y publiera un grand nombre de travaux, tandis que ses livres paraîtront dans la maison d’édition de la revue, Verso (anciennement New Left Books). La New Left Review est aujourd’hui encore l’une des revues anglosaxonnes les plus influentes. Elle voit le jour en 1959 à l’occasion de la fusion des comités de rédaction du New Reasoner, fondé en 1957 par John Saville et Edward Thompson, et de la Universities and Left Review, créée la même année par Stuart Hall, Gabriel Pearson, Ralph Samuel et Charles Taylor. S’il existe des différences notables entre les deux revues, qui seront le socle de débats internes importants (Meiksins Wood 1995), la New Left Review, d’abord dirigée par Stuart Hall, inscrit son programme intellectuel dans une volonté de rupture vis-à-vis des différentes offres politiques. À gauche, il s’agit de rompre à la fois avec le stalinisme et avec la social-démocratie. À droite, 1957 correspond à l’arrivée au pouvoir du gouvernement conservateur d’Harold MacMillan, qui succède à Anthony Eden. Une double rupture qui s’inscrit dans les événements et les combats des années 1950. D’abord, nous l’avons déjà évoqué, 1956 est une année charnière pour les intellectuelles et intellectuels marxistes, celle de la répression de la révolution hongroise par les chars soviétiques ; celle de l’opération militaire franco-britannique visant à reprendre le canal de Suez ; ainsi que celle du « rapport secret » de Khrouchtchev. Dans un article rétrospectif datant de 2010, Stuart Hall considère que ces événements ont participé à la cristallisation de la New Left britannique en gestation (Hall 2010). Dans son autobiographie, Hobsbawm affirme :
Les jeunes militants avaient dorénavant le choix de leur gauche. La plupart des intellectuels critiques réunis au sein du Groupe des historiens [du parti communiste britannique] (qui ne survécut pas à la crise) aspirèrent à construire (ou plutôt tentèrent de construire) une « nouvelle gauche » que les mauvais souvenirs du stalinisme n’entacheraient pas. (Hobsbawm 2005, p. 252)
À partir de là, la New Left se développe intellectuellement et institutionnellement autour de lieux de rencontres, tels que le London New Left Club, de revues et de mobilisations (notamment la Campaign for Nuclear Disarmament). Dans un article de 1959, Thompson fait explicitement le lien entre ces mobilisations et la création de la New Left.
Dans l’ancienne gauche, on trouve notamment dans les rangs du parti travailliste, l’argument selon lequel ce qui « ne va pas » avec les travailleurs et travailleuses, c’est la prospérité liée au plein emploi (généralement attribué aux dépenses d’armement), et que nous ne pouvons pas espérer de nouvelles avancées socialistes avant « la prochaine crise ». Cet argument pernicieux, qui est une insulte aux travailleurs et aux travailleuses (peuvent-ils penser autrement qu’avec leur estomac ?), une insulte au socialisme (les gens n’y seront-ils poussés que par la famine ?) et une cause contribuant à l’apathie, est basé sur une interprétation complètement erronée de l’histoire. Le marasme n’engendre pas nécessairement le militantisme socialiste (il ne l’a pas fait dans les années 1930) : il peut également constituer le terreau de l’autoritarisme. Certaines des périodes où notre mouvement a le plus progressé se sont déroulées dans un contexte de reprise économique (1889 et le nouveau syndicalisme), ou ont été le produit d’une conscience politique accrue découlant de causes non économiques (la guerre antifasciste et 1945). (Thompson 1959, p. 550-551)
Ici se trouvent liés les engagements de la New Left, en tout cas dans sa version thompsonienne, et l’historiographie défendue dans Past and Present : la volonté de remettre les classes sociales au cœur de l’historiographie va de pair avec celle de les remobiliser au cœur des combats politiques, et donc de l’histoire. Cette idée est très clairement exprimée par Thompson dans le même article : l’objectif de la New Left ne doit pas être de proposer des organisations alternatives à ceux qui, dans les faits, sont déjà organisés. Elle doit offrir, nous ditil, ses services en matière de diffusion d’idées ainsi que des supports logistiques, tels que des journaux ou des écoles de formation (Thompson 1959, p. 359). Cette approche, dans laquelle on reconnaîtra une filiation avec Gramsci, est également farouchement opposée à l’élitisme keynésien.
Il ne faut bien entendu pas considérer la New Left comme un mouvement uniforme. Les historiennes et historiens de ce mouvement ont montré la grande pluralité des pensées qui se déploient à l’ombre de l’appellation de « nouvelle gauche » (Chun 1993). D’ailleurs, comme nous verrons par la suite, les dissensions furent grandes dans les années 1960, à tel point qu’il est courant de parler d’un changement de génération en 1962, lorsque Perry Anderson prend les rênes de la revue. En effet, ce dernier critique vertement le caractère « populiste » et peu rigoureux de la « première génération » dont Thompson est à la tête. Cela donnera lieu à un débat très intense entre les deux hommes (Anderson 1965 ; 1980 ; Thompson 1978)[5].
Cette controverse a comme toile de fond la vive opposition de Thompson à l’introduction d’une lecture althussérienne de Marx par la nouvelle génération, représentée par Anderson. Là encore, historiographie et politique s’entremêlent de manière intime. Historiographiquement, ce sont ici deux visions de l’histoire qui s’opposent. Thompson, en héritier de l’histoire sociale développée par les Annales, prône un rapprochement des autres sciences sociales dans le cadre d’études empiriques. Anderson, de son côté, ouvre une critique philosophique de l’histoire sociale insistant sur la naïveté de son empirisme (Anderson 1966).
Comme le souligne Gérard Noiriel, « [l]a réponse d’Anderson constitue une vigoureuse défense de la profession, un réflexe de solidarité avec tous ceux qui, au-delà des différences de points de vue et de génération, pratiquent le même métier » (Noiriel 1996, p. 108). Au-delà, donc, du débat sur la formation des classes, ce qui est en jeu ici est également la nature du métier d’historien. Politiquement, Anderson considère que l’empirisme de Thompson, sa focalisation sur les stratégies individuelles et collectives aux dépens d’une véritable théorie du capitalisme, constitue un frein à la conceptualisation d’une autre transition : celle qui conduira au socialisme (Matthews 2002).
L’histoire, par l’intermédiaire de Thompson, est un élément central de la New Left dans son mouvement d’émancipation visà-vis du parti communiste. Elle est d’ailleurs la discipline universitaire qui a certainement été la plus influencée par le marxisme en Grande-Bretagne. Inversement, « l’histoire par le bas » a été utilisée pour critiquer les lectures considérées comme orthodoxes de l’œuvre de Marx. La mise au centre de la lutte des classes a permis d’inscrire l’historiographie marxiste dans l’histoire du radicalisme britannique. Autrement dit, il s’agissait de comprendre la spécificité de l’histoire anglaise à travers une grille marxiste adaptée à cet objectif, et donc émancipée du déterminisme de la lecture orthodoxe. On voit ici se superposer différents objectifs, répondant simultanément à différentes logiques : politique, idéologique et intellectuelle.
L’article de Brenner de 1976 est publié dans Past and Present et largement discuté dans les cercles de la New Left. Il n’est pas exagéré de dire que le Brenner Debate fait aujourd’hui partie de la mythologie de la New Left Review. Brenner devient d’ailleurs membre de son comité de rédaction dans un processus de rapprochement entre les intellectuelles et intellectuels d’Angleterre et des États-Unis (Keucheyan 2010). En effet, en plus de Brenner, Mike Davis, qui deviendra une référence de la sociologie urbaine, intègre le comité de la revue, tout comme Fredric Jameson, qui publiera un texte devenu classique, Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif (Jameson 2011). Qui plus est, Perry Anderson quitte Londres pour une chaire à l’université de Californie, Los Angeles (UCLA), où enseigne Brenner.
Comment lire l’irruption de Robert Brenner dans les débats historiographiques anglais du milieu des années 1970 ? Nous reviendrons dans le détail sur les contributions de l’auteur dans la prochaine section. Pour le moment, il sera question de resituer Brenner dans le paysage. Nous l’avons évoqué brièvement, le parcours militant de Brenner est en phase avec l’évolution de la New Left anglaise. Qui plus est, l’ambition historiographique de Brenner est de remettre les luttes sociales au cœur de l’histoire du Moyen Âge tardif, en se positionnant contre l’orthodoxie marxiste.
Notons néanmoins que le style de raisonnement de Brenner diffère sensiblement de celui des contributeurs historiques de Past and Present. En effet, Brenner adopte un style beaucoup plus direct et explicitement théorisé. En ce sens, son propos est beaucoup plus détaché des sources primaires, ce qui lui sera reproché par les historiennes et historiens plus classiques. Si, comme l’indique Ellen Meiksins Wood, Thompson insistait sur la nécessité d’une théorie pour organiser les connaissances historiques, il restait, selon elle, « trop allergique » au discours théorique, et plus particulièrement au discours économique (Meiksins Wood 2011a, p. 103). En effet, Thompson rejette la critique de l’économie politique de Marx, dans les Grundrisse et Le capital, là où Brenner et les marxistes politiques mettent ces œuvres au centre :
Cette tendance à rejeter la critique de l’économie politique était peut-être un héritage de ces théories staliniennes qui ont forcé les marxistes à choisir entre un réductionnisme économique grossier ou un abandon complet du « visage » d’économiste politique de Marx. (Meiksins Wood 2011a, p. 103)
En ce sens, il semble que Brenner se rapproche plus d’un Maurice Dobb, lui aussi critiqué pour son rapport aux sources. D’ailleurs, si Dobb a bien fait partie du groupe des historiennes et historiens de Cambridge et a été impliqué dans Past and Present, il ne s’est jamais pleinement intégré, lui l’économiste, à ce petit groupe (Dworkin 1997, p. 30). L’approche de Brenner part d’une question théorique, celle de la définition du capitalisme, pour en arriver, en fin de compte, à un concept central, celui de « relations sociales de propriété », qui marquera fortement l’histoire du marxisme anglosaxon. Brenner se rapproche également de Dobb dans sa façon de manier l’histoire comparative. En effet, comme nous l’avons vu, chez Dobb, la question du second servage est centrale, puisqu’elle permet de départager les différentes explications de la transition. Nous verrons que Brenner généralisera ce genre de raisonnement.
Structure sociale et développement
L’ambition de Brenner dans ses travaux traitant de la transition du féodalisme au capitalisme est claire : remettre la lutte des classes au cœur de l’historiographie, là où la tendance en histoire économique était plutôt la mise en avant de facteurs quantitatifs. Pour ce faire, l’économiste américain se positionne en critique de deux « modèles » utilisés dans le cadre de l’histoire économique médiévale : le « modèle démographique » et le « modèle de la commercialisation ». Il peut sembler légitime de considérer le travail de Brenner comme faisant partie de la tradition que Holton nomme « Dobb-Hilton-Brenner », puisque le recentrage de l’histoire féodale sur les conflits économiques entre producteurs directs et propriétaires terriens est au cœur des travaux de ces trois auteurs (Holton 1981).
Ce rapprochement est souligné par Brenner lui-même, qui commente la thèse de Dobb dans un article datant de 1978. Il reproche néanmoins à l’économiste anglais de n’être pas allé suffisamment loin (Brenner 1978a). Selon Brenner, si Dobb recentre les réflexions sur les relations de production agricoles, aux dépens des villes commerçantes, le lien qu’il fait entre désagrégation du mode de production féodal et capitalisme resterait trop direct, comme si le capitalisme n’attendait qu’une chose pour se manifester : que les barrières féodales tombent. Dans l’optique de Dobb, l’affranchissement de la petite production locale vis-à-vis du pouvoir discrétionnaire des lords permet le développement d’une proto-industrie alimentée par les nouveaux travailleurs libérés, eux aussi, du joug féodal. Ellen Meiksins Wood fait de ce point l’opposition centrale entre Dobb et Hilton d’un côté, et Brenner de l’autre : chez Brenner, le capitalisme n’est jamais latent, mais émerge d’une trajectoire féodale particulière. Dans un style toujours limpide elle affirme :
Bien que Brenner fût influencé par Dobb et par Hilton, la différence entre sa thèse et les leurs devrait maintenant être évidente. Le principe actif de sa thèse n’est pas l’occasion qui s’offre aux agents économiques, mais bien les impératifs auxquels ils sont soumis, ou les contraintes du marché. Car si le petit producteur ou le franc-tenancier joue un rôle essentiel ici, ce n’est plus en tant qu’agent offrant ou saisissant une occasion, mais bien comme un être obéissant à un impératif. (Meiksins Wood 2009, p. 85)
Entrons de manière plus approfondie dans l’élaboration de l’argumentation de Brenner, de 1976 jusqu’à 2007. Il construit en effet progressivement son opposition avec Dobb et Hilton. L’article de 1976 cite abondamment le petit ouvrage de Hilton The Decline of Serfdom in Medieval England (1970) et reprend son ambition de départ : critiquer l’approche démographique de la transition portée par Michael Moissey Postan, qualifiée de « malthusienne », tout en évitant l’autre grande alternative, l’approche de la commercialisation, qu’il nomme « smithienne ». Répétons l’objectif de l’article de 1976 :
L’objectif du présent article est de faire valoir que de telles tentatives de construction de modèles économiques sont nécessairement vouées à l’échec dès le départ, précisément parce que, pour nous exprimer crûment, c’est la structure des rapports de classes, du pouvoir de classe, qui déterminera dans quelle mesure et de quelle façon certains changements démographiques et commerciaux pourront affecter les évolutions à long terme, qu’il s’agisse de la distribution des revenus ou de la croissance économique. (Brenner 1976, p. 31)
Cet objectif restera le même dans ses travaux successifs. Néanmoins, la conceptualisation fine de la transition que l’on trouvera en 2007 n’est pas encore présente en 1976. Nous commencerons par aborder la manière dont Brenner se positionne vis-à-vis des deux grands « modèles » qu’il critique, le rapprochant des travaux de Dobb et Hilton. Puis, nous soulignerons la manière dont son approche de la transition se précise avec le temps. Réduire l’ambition de Brenner à la réintroduction de la lutte des classes dans l’historiographie de la transition n’est en effet pas suffisant pour caractériser son œuvre.
Nous verrons qu’il attache une grande importance analytique aux comportements individuels en ce qu’ils sont pris dans des rapports sociaux de propriété. Le retour à la subjectivité, dont nous avons vu qu’il était un trait important du marxisme anglo-saxon, est effectué de manière particulière chez Brenner, le démarquant franchement non seulement de Dobb et Hilton, mais également de Thompson. En effet, si, comme Thompson, Brenner accorde une grande importance aux relations individuelles et collectives que produisent les relations de classes, son approche est radicalement différente de « l’histoire par le bas », notamment dans la mesure où le rapport de Brenner à la subjectivité est avant tout analytique, terme qu’il nous faudra préciser. C’est ce que nous aborderons dans la dernière partie de cette sous-section, consacrée au rapport de Brenner au « marxisme analytique ».
Modèle smithien et modèle malthusiano-ricardien
Contrairement à ce que la citation ci-dessus pourrait laisser entendre, Brenner ne place pas le modèle de la commercialisation (« smithien ») sur le même plan que le modèle démographique (« malthusien »). Ces deux modèles, selon lui, non seulement se répondent, mais sont chacun inscrits dans leurs contextes respectifs de production et de diffusion. Lorsque Robert Brenner rédige son article de 1976, sa cible première est clairement, tout comme Hilton, l’approche démographique, ou « malthusienne », qui deviendra « malthusiano-ricardienne » en 2007.
Selon Brenner, cette approche historiographique prend le pas sur l’approche « smithienne », dite de la « commercialisation », à partir de l’après-guerre. Ses figures marquantes sont, d’après Brenner, John Habakkuk (1958), Michael Postan (1966) et Emmanuel Le Roy Ladurie (1966), et elles s’opposent notamment aux approches de Marc Bloch (1931) et de Paul Raveau (1926). L’installation progressive, après-guerre, de l’analyse démographique (et plus généralement de l’analyse sérielle) en histoire économique est assez bien documentée, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en France (Dosse 2010).
La grande force, toujours selon Brenner, de l’approche démographique serait d’avoir porté à nu les faiblesses de la thèse de la commercialisation, notamment en soulignant que la montée en puissance du commerce en différents points d’Europe et à différentes époques n’a pas eu partout les mêmes effets. Elle pouvait certes s’accompagner d’un relâchement de la contrainte féodale au profit de la contrainte du marché concurrentiel, impliquant l’obligation des gains de productivité et la concentration progressive des terres, mais tout aussi bien d’un resserrement du féodalisme, voire d’un retour au servage.
En d’autres termes, la place de plus en plus importante du marché dans la production agricole s’est parfois accompagnée non pas d’une croissance économique découlant d’investissements productifs, mais au contraire d’une intensification du travail agricole, d’un morcellement des exploitations, et in fine d’un déclin de la productivité du travail. On retrouve ici l’argument du « nouveau servage », déjà évoqué précédemment, et qui sera le point de départ du travail de Brenner. Selon les tenants de l’approche malthusienne, le facteur d’entraînement des économies féodales, ce qui en détermine les différentes trajectoires, ne saurait donc être l’apparition ou non de réseaux marchands, mais les mouvements démographiques de long terme.
Ces mouvements s’articulent autour de deux phases : d’abord l’accroissement démographique conduisant à des crises majeures en raison de l’abaissement du ratio terre / travail (« crise générale du xive siècle » et « crise générale du xviie siècle »). Ensuite, une phase de déclin des populations, conduisant à une élévation de ce ratio, et à des périodes fastes pour les travailleurs agricoles. Nous sommes en face, comme le défend Le Roy Ladurie dans sa réponse à Brenner, d’un « système homéostatique », reposant sur des mécanismes d’autocorrection par les variables démographiques (Le Roy Ladurie 1985, p. 102).
Brenner considère que cette analyse montre de manière définitive que le développement économique est sous-déterminé par l’existence ou non de marchés. Elle a néanmoins le défaut d’ignorer les relations sociales de propriété et les luttes qui les sous-tendent. L’évacuation de la lutte des classes comme catégorie historiographique pertinente est d’ailleurs entièrement assumée par Le Roy Ladurie dans sa leçon inaugurale au Collège de France, publiée en 1974 :
du dernier cri du marxisme, nous retiendrons surtout une leçon qui ne s’y trouve guère : à savoir que c’est en première analyse dans l’économie, dans les rapports sociaux, et plus profondément encore dans les faits biologiques, beaucoup plus que dans la lutte des classes, qu’il faut chercher le moteur de l’histoire massive, du moins pendant la période que j’étudie et pour l’échantillon qui m’intéresse. (Le Roy Ladurie 1974, p. 674-675)
Dans la mesure où elle ne fait que remplacer la toute-puissance du marché par celle des mouvements démographiques, l’approche malthusienne n’est aux yeux de Brenner pas plus satisfaisante. Le problème est que cette dernière ne permet précisément pas de comprendre comment les grands mouvements démographiques de la période précapitaliste ont été brisés au profit d’une croissance économique auto-entretenue à partir du xixe siècle. Qu’est-ce qui est venu mettre fin à l’équilibre qu’évoque Le Roy Ladurie ? Ainsi, la question smithienne de l’émergence d’une croissance économique auto-entretenue reste intacte. Néanmoins, les deux approches se confrontent à la même limite, dans la mesure où elles se concentrent toutes deux sur des facteurs quantitatifs : quantité et intensité des échanges d’un côté, mouvements démographiques de l’autre. Les facteurs qualitatifs, relayés au second plan, sont liés à ce que Brenner nomme les « relations sociales de propriété » :
Je définirais donc les relations sociales de propriété comme les relations entre producteurs directs, entre exploiteurs, et entre exploiteurs et producteurs directs. Des relations qui, prises ensemble, rendent possible et définissent l’accès régulier des individus et des familles aux moyens de production (terre, travail, outils) et/ou au produit social. L’idée est que de telles relations, propres à chaque société, définissent les contraintes fondamentales encadrant et limitant les comportements économiques individuels.
Elles constituent des contraintes dans la mesure où elles déterminent non seulement les ressources dont disposent les individus, mais également la manière dont ils y ont accès et, plus généralement, leur revenu. Les relations sociales de propriété sont maintenues et reproduites collectivement – en dehors du contrôle de chaque individu – par des communautés politiques constituées précisément à cette fin. Et c’est parce que ces communautés politiques constituent et maintiennent ces relations sociales de propriété collectivement et par la force – en mettant en œuvre des fonctions politiques normalement associées à l’État, comme la défense, la police et la justice – que les acteurs économiques individuels ne peuvent généralement les modifier, et doivent les considérer comme une réalité acquise, à l’instar du cadre à l’intérieur duquel ils effectueront leurs choix. (Brenner, « Propriété et progrès », p. 128)
Brenner reconnaît à Adam Smith le mérite d’avoir insisté sur le fait que le « progrès économique » reposait sur l’émergence de comportements spécifiques. Un facteur qui a été délaissé par les tenants de l’approche malthusiano-ricardienne, de sorte que ces derniers n’auraient pas compris que les mouvements démographiques et leur rupture avec l’émergence du capitalisme étaient conditionnés par la rationalité capitaliste.
L’apport de Brenner est d’avoir théorisé de manière originale l’émergence de ces comportements que, de leur côté, les tenants de la thèse de la commercialisation ont eu tendance à naturaliser en faisant l’histoire du développement économique à travers la simple levée d’obstacles barrant la route à la libre expression de ces comportements. Smith affirme en effet, dans un passage célèbre de La richesse des nations : « le penchant qui porte [les hommes] à trafiquer, à faire des trocs et des échanges d’une chose pour une autre » (Smith 1991 [1776], p. 81). L’article de Brenner de 1976 est précisément écrit à un moment de résurgence de la thèse de la commercialisation, notamment à travers les travaux de Douglass North et de Robert Thomas, qui tendent à considérer les institutions, et notamment la propriété, comme des relations contractuelles entre personnes libres (North et Thomas 1971 ; 1980 [1976])[6]. C’est notamment sous cet angle qu’ils étudient le servage.
Pour Brenner, les marxistes eux-mêmes seraient tombés dans le piège de la thèse de la commercialisation, notamment dans la lignée, comme nous l’avons vu, des travaux de Paul Sweezy. Brenner s’attaque frontalement à ce type d’analyse, qu’il qualifie de « néo-smithienne », et plus particulièrement aux travaux d’André Gunder Frank (2010), d’Immanuel Wallerstein (1980), et dans une moindre mesure ceux de Fernand Braudel (1979). Chacun à leur manière, ils considéreraient le capitalisme uniquement à travers le prisme des relations marchandes (Brenner 1977). Que ce soit pour le théoricien de la dépendance, ou celui du « système-monde », les relations de pouvoir engendrées par le capitalisme entre les différentes zones du globe sont déterminées par l’existence d’un vaste réseau marchand, reléguant les conditions locales de production au second plan. De sorte que ces manières d’aborder l’histoire économique ne seraient pas en mesure de rendre intelligible le bouleversement qu’a constitué l’émergence du capitalisme. Dans une conférence datant de 1979, et traduite en 2014 dans la revue Période, Brenner pose la question suivante :
Quels sont, pour formuler la question encore différemment, les déterminants d’une économie dont les valeurs d’usage constitutives ou les « facteurs de production » (terre, travail, capital) doivent être et sont systématiquement combinés et recombinés comme des valeurs d’échange visant à maximiser les profits et à accumuler sur une échelle élargie ? (Brenner 2014)
En mettant en avant la formation des marchés internationaux selon une division du travail entre le centre et la périphérie, alliant domination économique et domination politique, les théoriciens du système-monde feraient fausse route, notamment parce qu’ils négligent le fait que ce type de hiérarchie peut très bien apparaître dans le cadre d’une économie non capitaliste. Comme le fait remarquer Brenner, à la suite de Domenico Sella (1977), la forme centre-périphérie est présente dans le monde médiéval, notamment autour des cités marchandes, tout en restant intrinsèquement non capitaliste. Brenner avance que, sans organisation capitaliste de la production des moyens de subsistance, la division du travail entre différentes zones ne rendra pas nécessaire l’accumulation du capital par la rationalisation de la production. Le capitalisme n’est ni réductible au commerce international, ni n’est annoncé par ce que Braudel appelle l’« économie-monde ».
Deux stratégies théoriques ont tenté de pallier cette difficulté. Il s’agit dans la première d’ajouter des critères afin de distancier l’« économie-monde » et les systèmes qui l’ont précédée. C’est la stratégie utilisée par Wallerstein lorsqu’il introduit un critère de périmètre : les économies-monde précapitalistes européennes seraient moins englobantes dans la mesure où de grandes parties de l’Europe en auraient été exclues. La seconde, plus conforme au travail de Fernand Braudel, consiste à utiliser le concept de capitalisme de manière plus extensive, et à l’assimiler au développement des échanges marchands. Cette dernière stratégie amène à voir le capitalisme là où il n’y a pourtant pas trace de relations sociales de propriété capitalistes. Ces deux stratégies sont la preuve pour Brenner d’une sous-détermination du concept d’économie-monde.
Notes
[1] Chaque fois que cela sera possible, nous reprendrons la traduction partielle de l’article de 1976 publiée en 1998 (Brenner 1998). Nous indiquerons lorsqu’il s’agira de notre propre traduction.
[2] L’éloignement des historiennes et historiens de l’Angleterre vis-à-vis de la ligne officielle du parti tranche avec la situation française (Matonti 2006). Cette différence sera pointée du doigt des années plus tard par Perry Anderson comme une des raisons du traitement particulier de la pensée marxiste en France à partir des années 1980 (Anderson 2005, p. 5). Rappelons toutefois que la dissidence marxiste vis-à-vis du parti communiste s’organise également en France, où Socialisme ou Barbarie est notamment fondé dès 1949 par Cornélius Castoriadis et Claude Lefort (voir Gottraux 1997). Sur l’histoire du marxisme en France, voir Ducange et Burlaud (2018).
[3] Bien que proche des fondateurs de Past and Present, Thompson ne rejoignit le comité éditorial de la revue qu’en 1968.
[4] L’approche de Thompson, orientée vers l’aspect structurant des expériences vécues, influencera les courants plus contemporains féministes et antiracistes (Martineau 2017). Sur le parcours et les idées de Thompson, voir Lafrance (2013).
[5] Pour une critique toute relative de cette histoire intuitive de la New Left organisée en deux temps, voir Davis (2006).
[6] Voir sur ce point Milonakis et Fine (2007).







