
Chanter et marteler le travail ouvrier. À propos d’un livre de Joseph Ponthus
Joseph Ponthus, À la ligne. Feuillets d’usine, Éditions La Table Ronde, 2019, 18 euros.
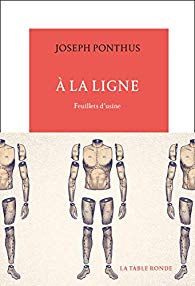
La littérature contemporaine est souvent taxée de nombrilisme. Tournée vers son auteur, son autrice ou sur elle-même plutôt que vers son lectorat, elle aurait remplacé les évènements du monde par les micro-évènements d’un « je » de plus en plus restreint à un petit milieu. Cette critique n’est pas dénuée de toute pertinence. Cependant, les écrits contemporains sont pluriels. Loin des récits autocentrés ou cyniques qui se complaisent dans une lucidité sans débouchés nous voudrions, dans cette chronique, mettre en valeur d’autres littératures : celles qui ne renoncent pas à dire le monde, ses luttes, ses échecs et ses espoirs.
***
« Tant qu’il y aura des missions intérim
Ce n’est pas encore le point final
Il faudra y retourner
À la ligne »
Feuillets d’usine nous dit le sous-titre : chaque chapitre peut se lire comme un feuillet, ou comme un poème en prose, composé de vers libres qui retournent sans cesse à la ligne. Jamais de point, jamais un signe de ponctuation, mais un enchaînement régulier de phrases simples.
Le rythme d’écriture de Joseph Ponthus est celui de la ligne de production, du travail à la chaîne où les gestes sont répétitifs et pressés. Ce choix stylistique n’exprime pas seulement un quotidien mais une nécessité angoissante : le travail ne s’arrête jamais, l’usine ne lâche pas l’ouvrier, la pause est minutée, le week-end n’est qu’un leurre puisqu’il faut souvent travailler le samedi et, le dimanche, se préparer physiquement pour subir à nouveau, durant toute la semaine, les huit ou neuf heures de travail de nuit :
« Frénétiquement/ À mesure que le temps passe/ Ne se rattrape plus/ Allez/ Faut y aller ».
Joseph Ponthus, ancien travailleur social passé par une classe préparatoire littéraire, raconte son quotidien de travailleur intérimaire, enchaîné par le manque d’argent et la peur de perdre son travail. Alors qu’il a conscience de faire partie de « l’armée de réserve de chômeurs » dont parle Marx, qu’il rêve de grève et de black blocks, il doit renoncer à participer aux mouvements de Notre-Dame-des-Landes et rester à la ligne, à fredonner du Carla Bruni.
Il raconte l’épuisement physique et mental, le risque d’accident du travail, les coups de fil reçus à la dernière minute pour prévenir d’un changement d’horaires, l’angoisse de ne pas trouver de solution pour faire les 15 kilomètres qui le séparent de l’usine : ne se retrouve-t-il pas à devoir payer un taxi pour être à l’heure au poste ?
« Le chauffeur me demande si je suis un chef pour aller comme ça à l’usine en taxi / Je lui réponds que suis le fils d’Agnès Saal mais il n’a pas l’air de capter ma vanne[1] »
Ce qui permet de tenir, c’est la littérature. Tout, dans la vie de l’usine, résonne avec la littérature, à commencer par l’angoisse du réveil très tôt, trop tôt : « demain dès l’aube »… « Ca a débuté comme ça », comme disait Céline, ça débute avec l’égouttage de tofu, ça continue avec l’horreur de l’abattoir, qui renvoie aussi bien aux aventures d’Ulysse qu’aux lettres et aux poèmes d’Apollinaire pendant la guerre :
« Et je veux croire que ma guerre est jolie/ Un demi-étage en dessous de la tuerie/ À nettoyer la merde et les mamelles ».
Les références classiques se mêlent à la chanson populaire : Johnny, Brel, et surtout Trénet. Rêver, chanter, jouer avec humour sur les mots permet de survivre, mais la violence de l’usine peut aller jusqu’à empêcher d’écrire, jusqu’à faire taire le chant. Ainsi l’auteur dit-il, à propos de la remarque d’une de ses collègues, qui juge la cadence « trop speed » pour avoir le temps de chanter :
« Je crois que c’est une des phrases les plus belles les plus vraies et les plus dures qui aient jamais été dites sur la condition ouvrière ».
L’écriture d’À la ligne, premier ouvrage de l’auteur[2], bien accueilli par le public comme la critique, oscille entre la colère, la dérision et la tendresse. Mais cette écriture est toujours politique. L’auteur a bien conscience d’appartenir à un collectif, celui des ouvrières et des ouvriers, dans un univers où tout est fait pour briser toute conscience de classe, mais où les rapports de domination, eux, subsistent. Il en veut pour preuve l’existence du livret ouvrier qui, de l’avis de tous, ne sert pourtant à rien :
« Il n’empêche/ J’y vois plus qu’un symbole/ Celui du capitalisme qui jamais n’arrivera totalement à oublier/ Ses racines les plus profondes/ Le patron tout-puissant/ Ayant droit de vie et de mort sur une carrière ouvrière/ Comme aux bons vieux temps de la Troisième République/ Quand les enfants bossaient/ À la mine/ Ou ailleurs ».
Il subit l’isolement. Il voit comment la crainte, toujours tenace, de ne pas voir son contrat renouvelé peut pousser jusqu’à la haine envers un collègue désemparé (« Je ne veux pas perdre mon taf à cause d’un connard alcoolique incompétent/ Je crève d’envie d’aller voir le chef (…) »). Aucune glorification des ouvrières et des ouvriers dans À la ligne : Joseph Ponthus ne tait pas les scènes de racisme qui suivent l’attentat du 14 juillet à Nice ni les insultes sexistes hurlées dès qu’une ouvrière a les talons tournés. Mais la solidarité ouvrière demeure, malgré tout :
« Et puisse le temps qui efface tout ne pas me faire oublier trop vite vos visages vos voix/ Vos noms et la noblesse de votre travail/ Mes camarades/ Mes héros ».
Plus qu’un simple témoignage, À la ligne est un poème contemporain qui donne voix à toutes celles et ceux auxquels on dit qu’il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Un ouvrage qui jette un regard cru et poétique sur un univers, celui de l’usine agro-alimentaire, peu connu[3] et a priori étranger à toute forme de lyrisme. Chanter et marteler tout à la fois, comme le fait Joseph Ponthus, le travail dans le sang et la merde de l’abattoir, c’est exhiber le rôle politique de la littérature.
Notes
[1] Agnès Saal, ex patronne de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) a été condamnée pour « détournements de fonds publics », suite à des notes de taxis indus dans l’exercice de ses fonctions d’un montant de 40 à 50 000 euros. Après six mois d’exclusion, elle a fait son retour comme haute fonctionnaire au ministère de la Culture… pour piloter des programmes sur l’égalité.
[2] Premier ouvrage individuel. Joseph Ponthus a co-signé, en 2012, l’ouvrage Nous, la cité, aux éditions La Découverte.
[3] Sur ce point, voir l’article de Sebastian Carbonell, « “J’écris comme je travaille”. À propos de À la ligne de Joseph Ponthus ». Aux travaux qui ont « commencé à jeter de la lumière sur le travail dans ces usines » cités, on peut ajouter celui de Catherine Rémy, La fin des bêtes. Une ethnographie de la mise à mort des animaux, Paris, Economica, 2009 et le témoignage de Stéphane Geffroy, À l’abattoir, Seuil, collection « Raconter la vie », 2016.









