
Aux origines de la Révolution portugaise. Un extrait du livre de Raquel Varela
Raquel Varela, Un peuple en révolution. Portugal 1974-1975, Marseille, Agone, 2018.
On pourra lire sur notre site un entretien avec Raquel Varela sur la Révolution portugaise. On trouvera également sur le site de la revue Période un texte de Raquel Varela sur la question du contrôle ouvrier dans la Révolution portugaise.
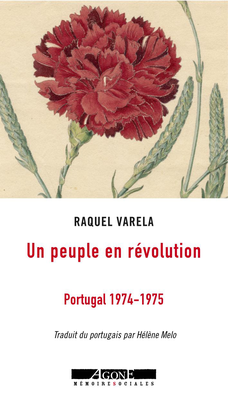
Présentation du livre
« C’est une surprise pour le monde entier de voir que ce pays que les caricatures présentent comme peuplé de petites mamies tristes et moustachues, vêtues de noir et édentées, est désormais un pays où les pauvres occupent l’ancienne maison de maître dans tel quartier de Porto, de Lisbonne ou de Setùbal, afin d’y installer une crèche où les menuisiers fabriquent les lits, où l’électricien installe l’électricité, ce que les militaires viennent cautionner après coup en déclarant presque toujours : “C’est très bien.” »
La révolution des Œillets commence par un putsch d’officiers qui, las de la guerre coloniale qu’ils savent perdue, font le choix de renverser la dictature. S’attendent-ils alors à ce que le peuple prenne autant au sérieux la promesse d’une liberté nouvelle ? Pendant dix-neuf mois, il prend en main ses propres affaires : travail, logement, relations entre les genres, culture. La situation finit par être « normalisée » par l’établissement d’une démocratie parlementaire ; mais entre avril 1974 et novembre 1975, le peuple semble en plusieurs occasions proche de renverser l’ordre capitaliste.
Extrait – 1er chapitre : le 25 avril 1974
Le poste de commandement du Mouvement des forces armées constate que la population civile reste sourde aux appels qui lui ont été faits à plusieurs reprises de ne pas sortir.
Communiqué du MFA, 25 avril 1974
« Le peuple, c’est nous, le peuple, c’est nous, le peuple, c’est nous ! » entend-on sur la place de São Bento, le 13 novembre 1975, dix-neuf mois après le début de la révolution portugaise [on peut voir cette scène ici à partir de 1’20]. Depuis plusieurs heures, les députés de l’Assemblée constituante et les membres du gouvernement se trouvent séquestrés à l’intérieur du palais de São Bento, assiégé par une foule de près de cent mille personnes, principalement des ouvriers du bâtiment. La scène est presque irréelle : nous sommes en Europe, sous le soleil de Lisbonne, capitale hypertrophiée du Portugal, dernier empire colonial de l’histoire. Rien, pas même nourriture ou couvertures, n’arrive autrement que par hélicoptère au palais de São Bento ou à la résidence du Premier ministre. Dehors se tient une gigantesque manifestation de travailleurs qui se bousculent et se hissent littéralement les uns au-dessus des autres sur les escaliers du bâtiment, brandissant drapeaux rouges et banderoles, criant des mots d’ordre. Soudain une bétonnière surgit et traverse la place. Le véhicule se fraie un chemin au milieu de la foule de manifestants assiégeant l’Assemblée. En souriant et en levant le poing, ils reculent pour le laisser passer. Deux hommes se tiennent debout sur le camion. L’un d’eux, vêtu d’un jean, chemise ouverte et cigarette aux lèvres, adresse à la foule un sourire triomphant. Une main accrochée à la bétonnière, l’autre en l’air, il scande avec les manifestants : « Le peuple, c’est nous, le peuple, c’est nous, le peuple, c’est nous ! » [1]
Une semaine plus tard, le 20 novembre 1975, l’amiral Pinheiro de Azevedo, Premier ministre du sixième gouvernement provisoire (depuis le début de la révolution, cinq gouvernements sont déjà tombés !), décide de démettre le gouvernement de ses fonctions. Avec son air débonnaire et son franc-parler déplaisant, il reconnaît le discrédit de l’État en répondant, visiblement agacé, à une journaliste qui l’interroge sur la situation militaire dans le pays :
« Pour autant que je sache, la situation n’a pas changé : on organise d’abord des assemblées générales, et ensuite on obéit aux ordres [2] ! »
Il s’agit d’un cas classique de double pouvoir qui se traduit par le discrédit de l’autorité de l’État, alors politiquement et même physiquement assiégé. C’est sans doute le moment où la révolution portugaise se trouve le plus près de l’insurrection, c’est-à-dire cette phase des révolutions où le transfert de l’autorité de l’État, la prise du pouvoir par les travailleurs devient possible [3].
Robert Kramer a filmé le siège de São Bento de novembre 1975 dans Scenes from the Class Struggles in Portugal (scènes de la lutte des classes au Portugal). Appartenant à un courant politique trotskiste, ce cinéaste américain s’est rendu au Portugal en 1975 pour observer la révolution, à l’instar de milliers de jeunes militants de diverses obédiences, maoïstes, anarchistes, guévaristes et autres courants tiers-mondistes, engagés dans les révolutions anticoloniales. La révolution portugaise se déroulait de manière pacifique et, de ce fait, passionnait le monde entier. « Ami, je sais que tu es en fête », chantait Chico Buarque, le plus célèbre auteur-compositeur de musique populaire brésilienne, dans un pays qui vivait alors encore sous la botte d’une dictature militaire [4]. C’est cette fête qui a amené de nombreuses personnes à parler un peu vite et a posteriori d’une « révolution sans morts », oubliant que treize années d’horreur dans les colonies avaient été le prix à payer pour la fête en métropole.
La chute de l’ultra-colonialisme portugais
Selon l’historien britannique Perry Anderson, la caractéristique principale de l’empire portugais est de reposer sur le travail forcé, raison pour laquelle il utilise pour le décrire le terme d’« ultra-colonialisme ». En effet, le Portugal est l’empire qui a eu le plus recours à différentes formes de travail forcé, de manière systématique et sur une longue période. L’historien Basil Davidson estime à plus de deux millions le nombre total de travailleurs forcés dans l’empire portugais, répartis entre condamnés, employés et travailleurs migrants [5]. Largement dénoncé par les journaux et les agences de presse internationales [6], le travail forcé entraînait divers problèmes sociaux, tels que la pauvreté, l’absence d’ascension sociale, l’éloignement du noyau familial et de l’agriculture de subsistance, des inégalités salariales très importantes.
Salaires au Mozambique (1969)
| Salaires dans l’industrie (journaliers) | Salaires dans l’agriculture (annuels) |
| Blancs : 100 escudos minimum | Blancs : 47 723 escudos |
| Mulâtres : 70 escudos maximum | Mulâtres : 23 269 escudos |
| Africains (semi-qualifiés) : 30 escudos | Africains (citoyens) : 5 478 escudos |
| Africains (non qualifiés) : 5 escudos | Africains (non-citoyens) : 1 404 escudos |
Source : Annuaire statistique, 1970.
Près de 60 % des salaires des Mozambicains soumis au travail forcé dans les mines d’or en Afrique du Sud étaient remis directement en or à l’État portugais. Une partie était reversée aux travailleurs en monnaie locale, tandis que le reste allait tout droit dans les coffres de la métropole [7]. En outre, la police politique du régime, la PIDE (Police internationale et de défense de l’État) était particulièrement brutale et raciste dans les colonies : comme le souligne l’historienne Dalila Cabrita Mateus, « la PIDE ne s’en prenait pas aux blancs, elle ne s’en prenait qu’aux noirs [8] ». Une telle polarisation a conduit les populations colonisées, majoritairement paysannes, à devenir des défenseurs tenaces des mouvements de libération, que ce soit en Guinée-Bissau, au Mozambique ou en Angola, les trois principales colonies portugaises d’Afrique.
Le 3 août 1959, en Guinée-Bissau, une grève de dockers éclate dans le port de Pidjiguiti [9] et s’étend très rapidement. Parmi les grévistes se trouvent les marins du service de cabotage et ceux de l’entreprise Casa Gouveia, rattachée au puissant groupe CUF (Companhia União Fabril), le plus important conglomérat industriel portugais. Les autorités répondent à la grève par une violente répression, comme le rapporte le père franciscain Pinto Rema :
Les insurgés disposent de rames, de bâtons, de barres en fer, de pierres et de harpons. Les deux parties opposées ne cèdent pas, ne dialoguent pas. Lors du premier accrochage, les chefs de la police, Assunção et Dimas, sont violemment attaqués, après avoir tiré en l’air. Dix-sept agents sont blessés au cours du face-à-face. Les forces de l’ordre perdent leur sang-froid et se mettent à tirer sur la foule, sans aucun état d’âme. À l’issue de l’affrontement, entre treize et quinze morts gisent dans le port de Pidjiguiti. D’autres cadavres de mariniers et de dockers sont entraînés par les eaux du Geba, on ignore combien [10].
Cette grève est à l’origine des décisions qui conduisent le PAIGC (Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert) à la lutte armée, soutenue par les paysans.
À Mueda, au nord du Mozambique, le 12 juin 1960 à l’aube, des représentants d’une association de Makondés I sollicitent une nouvelle fois les autorités portugaises afin de négocier le retour de leur communauté qui, du fait de la répression coloniale, a émigré au Tanganyika (l’actuelle Tanzanie), où ils ont obtenu davantage de droits. Ils n’ont qu’une seule revendication : « L’uhulu, c’est-à-dire pouvoir vivre librement sans travail forcé. » Pendant quatre jours, la délégation fait pression sur les autorités portugaises. Elle est ralliée par un nombre croissant d’hommes, de femmes et d’enfants, à pied ou à bicyclette. Tous se dirigent vers les bureaux de l’administration coloniale. Ils sont déjà cinq mille dans la matinée du 16 juin. Ce jour-là, aux aspirations des Makondés, les autorités portugaises ripostent par une rafale de tirs, faisant quatorze morts selon le rapport officiel, cent cinquante d’après le Frelimo (Front de libération nationale du Mozambique). À la suite de cet événement, connu sous le nom de « massacre de Mueda », les Makondés rejoignent les rangs des partisans de la guerre, décidés à suivre le Frelimo, qui la déclenche le 25 septembre 1964 [11].
En février 1961, dans le nord de l’Angola, l’armée portugaise répond à la grève des travailleurs du coton de Baixa de Cassanje en bombardant les populations au napalm. La monoculture de coton, dont la société portugo-belge Cotonang détient le monopole, domine alors la région. D’après l’historienne Aida Freudenthal, « la révolte [avait été] ouvertement déclenchée le 4 janvier, le jour où deux contremaîtres de Cotonang furent attachés à la sanzala [hutte] du soba [chef] Quivoto à 10 kilomètres du district de Milando [12] ». La population menace alors d’attaquer quiconque l’obligerait à travailler dans le coton ou dans les services de l’État, mais aussi à payer l’impôt annuel. L’arrêt de la production dura un mois.
Organisés en groupes importants, raconte l’historienne Dalila Mateus, les insurgés attaquèrent les installations officielles et privées, endommagèrent des véhicules, des ponts et des embarcations, abattirent le mât du drapeau portugais, sans toutefois provoquer de morts parmi les Européens. Dans les zones les plus éloignées, comme dans les districts de Luremo, de Cuango et de Longo, ils multiplièrent les marques d’hostilité, en brûlant des tas de graines de coton, en déchirant des livrets indigènes, etc. Les rassemblements se firent non seulement plus fréquents, mais aussi plus menaçants. […] Cotonang se montra inquiète face aux émeutes et les commerçants européens multiplièrent leurs demandes d’intervention armée afin de réprimer le soulèvement [13].
Il n’est jamais facile de déterminer quand a été tiré le premier coup de feu d’une guerre. Très souvent, le volcan de la colère sociale reste longtemps endormi avant de se réveiller. Nombre d’auteurs situent le début de la guerre coloniale en Angola le 4 février 1961, le jour où le MPLA (Mouvement populaire de libération de l’Angola) attaque les prisons de Luanda. Cependant, les événements du 4 février ne peuvent s’expliquer sans le massacre de Baixa de Cassanje qui, selon Dalila Mateus, constitue la « répétition générale de la guerre coloniale [14] ». Entre dix mille et vingt mille personnes trouvent la mort au cours de cette répression meurtrière. Désormais, rien ne serait plus comme avant. Le Portugal affronterait, treize ans durant, une guerre de résistance.
Le travail forcé a perduré jusqu’à la chute de l’empire portugais en 1974. Étant donné que les travailleurs étaient farouchement attachés à la terre et que la main-d’œuvre manquait, la seule façon de les envoyer travailler dans les mines d’or sud-africaines ou dans les plantations de coton angolaises, loin de leurs moyens d’autosubsistance, était de rendre le travail obligatoire. Selon Perry Anderson, « sans or, il n’y a pas d’Afrique du Sud, et sans Mozambique [c’est-à-dire sans le travail forcé des Mozambicains], il n’y a pas d’or [15] » pour l’État portugais. Et sans Estado Novo – le nom donné à la dictature mise en place par António de Oliveira de Salazar en 1933 –, il n’y a pas de travail forcé. Ce mode d’accumulation du capital n’aurait pu exister sans une dictature qui s’est montrée particulièrement efficace pour gérer la main-d’œuvre et empêcher les arrêts de la production ainsi que les luttes pour des augmentations de salaire. Il s’agit de ce que Marx a appelé dans l’un des chapitres les plus connus du Capital la « soi-disant accumulation primitive [16] », à savoir un processus typique de dépossession des paysans, contraints d’abandonner leurs terres, et d’accumulation de réserves d’or. Ces réserves étaient directement transférées dans les coffres de la métropole et contribuaient à financer les grands conglomérats qui se trouvaient à la tête de la modernisation capitaliste de l’économie portugaise, amorcée sous la dictature salazariste. Après une explosion de conflits sociaux au cours de la période républicaine, entre 1910 et 1926, la dictature avait été instaurée pour accumuler du capital en disciplinant la force de travail [17].
Il s’agit d’une interprétation controversée ; on trouve sur le sujet pléthore d’excellents historiens défendant une thèse différente [18]. Mais nous estimons que les mécanismes d’endiguement mis en place pour sortir de la crise de la fin du xixe siècle, tels que l’émigration massive, les chantiers publics et l’exploitation coloniale, n’allaient permettre d’éviter ni le face-à-face entre la bourgeoisie et la vieille aristocratie, ni, par la suite, les affrontements au sein de la bourgeoisie, ou entre certains de ses secteurs et le mouvement ouvrier. Face à l’incapacité du régime républicain de résoudre cette situation confuse, autrement dit de stabiliser le pays, un secteur important de la bourgeoisie portugaise a décidé de jouer sa carte maîtresse à partir de 1926 : renoncer au pouvoir politique afin de conserver le pouvoir économique en soutenant un régime bonapartiste classique, c’est-à-dire une dictature [19]. Ses objectifs étaient clairs : discipliner la force de travail ; garantir la concentration de la propriété privée entre les mains de quelques groupes économiques (protégés des luttes fractionnelles intestines et des affrontements avec le mouvement ouvrier) en limitant, grâce à l’État, la concurrence ; et, enfin, mettre en place un processus intensif d’exploitation coloniale possédant toutes les caractéristiques typiques de l’accumulation primitive, comme nous l’évoquions à propos de la question du travail forcé.
Mais « tout ce qui avait solidité et permanence s’en va en fumée [20] ». Si l’empire s’est écroulé tardivement, sa structure ankylosée a provoqué la rupture sociale la plus importante de l’Europe d’après-guerre : la révolution portugaise de 1974-1975. Incapable de se réformer, le régime a manqué de s’effondrer, car ses forces armées, en particulier les jeunes officiers supérieurs, qui en constituaient la colonne vertébrale, étaient fragilisées [21]. Et il s’en est fallu de peu que la bourgeoisie portugaise ne perde le contrôle de l’État, le seul instrument qui lui permettait de résister à la révolution. Anachronique et brutal dans ses colonies, bloquant la mobilité sociale et offrant bien peu aux jeunes dans la métropole – un million et demi de travailleurs ont émigré entre 1960 et 1974 [22] –, l’empire portugais a conduit l’État au bord de l’effondrement, jusqu’à ce qu’un mouvement de capitaines mette un terme à la guerre coloniale, le 25 avril 1974.
Comme l’écrivait Basil Davidson, l’un des historiens de l’Afrique les plus brillants, amoureux de ce continent fustigé, qui avait séjourné en Angola dans les années 1950 et observé les terribles conditions du travail forcé :
« Les gens parlaient vraiment d’une “nouvelle Afrique” sans que cette idée paraisse absurde. Tout le continent semblait avoir ressuscité, […] débordant d’une réelle vigueur et d’énergies créatives, réclamant son droit de cité au sein de la famille humaine [23]. »
Sans le réveil de l’Afrique, le peuple de Lisbonne n’aurait jamais pu célébrer le 25 Avril, jour où il s’est libéré de quarante-huit ans de dictature.
Notes
[1]Film de R. Kramer, Scenes from the Class Struggles in Portugal [Scènes de la lutte des classes au Portugal], 1977.
[2]« Governo suspende Governo », archives de la RTP. Disponible sur Youtube.com, consulté le 19 janvier 2012.
[3]Valério Arcary, As Esquinas Perigosas da História. Situações Revolucionárias em Perspetiva Marxista, São Paulo, Xamã, 2004.
[4]Le Brésil fut gouverné par une dictature militaire entre 1964 et 1985.
[5]Cité par Perry Anderson dans Le Portugal et la fin de l’ultra-colonialisme, trad. Fanchita Gonzalez, Paris, Maspero, 1963, p. 96.
[6]Lire par exemple « Forced labour system in Portuguese Africa », Londres, Reuter, 25 octobre, s. d., dans Anti-colonialismo internacional, 1961-1963, Cidac, H34-5.
[7]Dalila Cabrita Mateus, « El Trabajo forzado en las colonias portuguesas », Historia, Trabajo y Sociedad, 2013, no 4, p. 69.
[8]Dalila Cabrita Mateus, A PIDE/DGS e a Guerra Colonial, Lisbonne, Terramar, 2004, p. 396.
[9]Deux ports desservaient la ville de Bissau : celui de Bissau pour les navires de la marine marchande et celui de Pidjiguiti, juste à côté, pour les bateaux de pêche et de cabotage.
[10]Henrique Pinto Rema, História das Missões Católicas da Guiné, Braga, Franciscana, 1982, cité par Dalila Cabrita Mateus dans « Conflitos Sociais na Base da Eclosão das Guerras Coloniais », in Joana Dias Pereira, Ricardo Noronha et Raquel Varela, Greves e Conflitos Sociais em Portugal no Século XX, Lisbonne, Colibri, 2012.
ILes Makondés sont un peuple appartenant au groupe ethnique bantou, vivant pour la plupart au sud-est de la Tanzanie et au nord du Mozambique, en particulier sur le haut plateau de Mueda.
[11]Ibid., p. 183.
[12]Aida Freudenthal, « A Baixa de Cassanje : Algodão e Revolta », Revista Internacional de Estudos Africanos, 1995-1999, no 18-22, p. 260.
[13]Ibid., p. 263.
[14]Dalila Cabrita Mateus, op. cit., p. 185.
[15]Perry Anderson, Le Portugal et la fin de l’ultra-colonialisme, op. cit., p. 61.
[16]Karl Marx, Le Capital (Livre 1) [1867], trad. J. Roy, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, p. 527-529.
[17]Felipe Demier, O Longo Bonapartismo Brasileiro (1930-1964). Um ensaio de interpretação histórica, Rio de Janeiro, Mauad, 2013.
[18]Maria Fernanda Rollo et Fernando Rosas, História da Primeira República Portuguesa, Lisbonne, Tinta-da-china, 2009.
[19]Sur les caractéristiques des régimes politiques dictatoriaux des années 1930, lire Felipe Demier, op. cit.
[20]Célèbre formule de Marx et Engels dans le Manifeste du parti communiste (1847). [ndt]
[21]Fernando Rosas, Pensamento e Acção Política. Portugal Século xx (1890-1976), Lisbonne, Notícias, 2004.
[22]António Barreto, « Mudança Social em Portugal : 1960-2000 », dans António Pinto Costa, Portugal Contemporâneo, Lisbonne, Dom Quixote, 2005.
[23]Basil Davidson, O Fardo do Homem Negro, Porto, Campo das Letras, 1992, p. 193.








