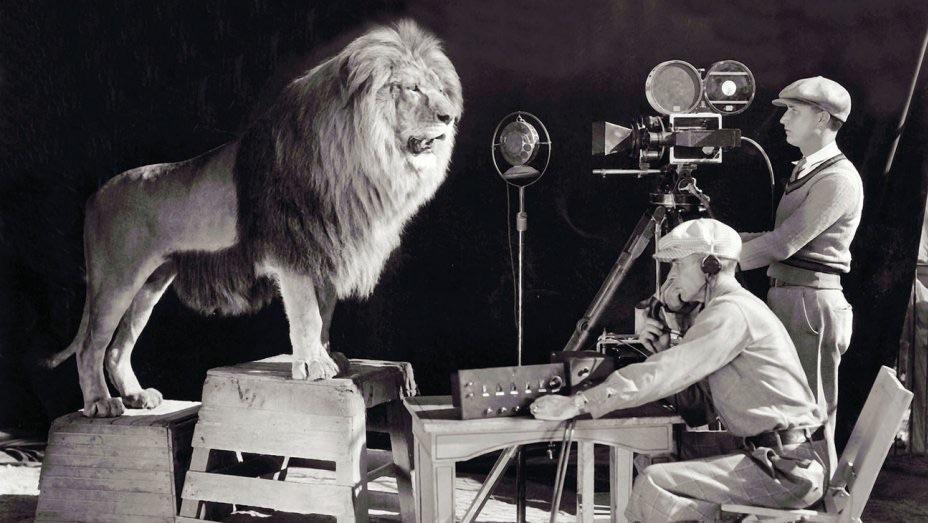
Six thèses politiques sur la pandémie. Expérience collective et perspectives stratégiques en France
Un événement planétaire et pourtant indéchiffrable ? Nous savons que nous sommes en train de vivre des semaines historiques, mais nous ne savons pas exactement jusqu’où s’étendent, et jusqu’à quand s’étendront, les ramifications de la situation nouvelle. Cependant, la confusion qui règne n’est pas totale. Nous vivons une expérience collective très forte, et l’incertitude que nous éprouvons est aussi un signe de l’ouverture d’un champ des possibles assez vertigineux – pour le pire ou le meilleur. Il est donc extrêmement urgent de se demander comment faire face et agir collectivement.
Certes, les mesures sanitaires nécessaires nous contraignent dans certains domaines. La situation nous pousse à en prendre la responsabilité, pour les faire modifier ou les compenser lorsqu’elles peuvent mettre en danger, et bien entendu pour améliorer et étendre leur caractère protecteur. L’application des mesures nécessaires fait partie de la solidarité, et ne nous prive pas de toute autre façon d’agir ensemble.
Ce texte propose donc de réunir quelques idées reprises ou inspirées des débats actuels,[1] pour formuler six thèses visant à poursuivre le débat de stratégie politique. Cela permettra d’une part de préciser un peu les contours de l’expérience collective de la pandémie et du « moment de vérité » politique que nous pouvons en faire ; et d’autre part, de nourrir le débat sur les modalités d’action et les perspectives politiques – celles des classes dirigeantes, et les nôtres.
Thèse 1 – Il faut reconstituer l’expérience collective de la crise
Choc et incertitudes – guerre sans la guerre – mille et un enfers – et pourtant, une intense expérience collective – fausses continuités et angoisse – reconstituer l’expérience et lui donner du sens politique
L’air du temps n’a pas tardé à se cristalliser sur les réseaux sociaux. Dans les échanges de faits et de commentaires, de dessins satiriques et autres « mèmes » humoristiques ou tragiques, on observe partout un mélange d’état de choc et d’incrédulité. C’est l’un des « dénominateurs communs » d’une situation vécue par ailleurs sous des modalités très différentes selon les pays, les régions, les milieux sociaux, etc. Le sérieux du débat sur les mesures sanitaires nécessaires se mêle d’autodérision car il bute sur un certain nombre de doutes et d’incertitudes : faut-il se projeter dans une durée de quelques semaines de confinement, de (nombreux ?) mois de crise sanitaire, voire d’années de crise économique et sociale ? La chloroquine sauvera-t-elle le monde ? Quand et comment peut-on espérer disposer de tout ce qui manque (masques, gel, tests, respirateurs et lits de réanimation et de soins intensifs, traitements plus efficaces, voire vaccins) ? Faut-il craindre des mutations virales qui, à terme, affecteraient de nouvelles populations à risque et relanceraient la pandémie ?
Un bon exemple des contradictions de l’expérience que nous faisons en ce moment est le leitmotiv de « la guerre ». Personne ne confond la situation réelle avec celle d’une guerre mondiale. Et pourtant chacun.e prend des nouvelles d’ami.es ou de proches vivant aux quatre coins du pays ou de la planète en sachant qu’on pourrait apprendre la mort de personnes que l’on connaît. On s’efforce de se raisonner face à la peur d’un futur rationnement de denrées de première nécessité, mais les supermarchés prennent des mesures pour contrôler le volume d’achats de chaque client. Du reste, la pénurie existe déjà : comment qualifier autrement l’absence d’une quantité suffisante de matériel relativement élémentaire (gel hydroalcoolique et masques d’auto-protection), mais manquant cruellement aux soignant.es pour ralentir l’épidémie, et « accessoirement » y survivre ? Dans ces conditions, et déjà forcé.es de renoncer à soigner certain.es patient.es dont l’état n’était pas désespéré, les soignant.es ont tout à fait conscience d’être envoyé.es au front sans armes. Et nous vivons tou.tes cette avancée de « l’ennemi » : de plus en plus près, les services de réanimation sont saturés, et les EHPAD sont en grande difficulté. Sans devoir s’occuper des malades, les autres salarié.es d’activités dites essentielles vivent une situation en partie comparable, des éboueurs aux caissières et aux salarié.es du nettoyage – sans parler des usines qui devraient en grande partie être reconverties ou fermées depuis longtemps. Et même sans obligation d’aller travailler, et même avec les « gestes barrières » : lorsque les hôpitaux débordent et que l’on appartient à une population à risque, n’est-ce pas risquer sa vie que de sortir pour se ravitailler ? Pendant que le gouvernement temporise face à la pénurie de masques, on découvre des stocks ici ou là, certains sont tentés de pratiquer le marché noir. Et la fameuse affaire des fraises marque un étrange retour d’une question classique en temps de guerre : la pénurie de main-d’œuvre. Heureusement, on a suffisamment anticipé les besoins dans certains domaines, comme les stocks d’armes militaires ou policières. Certes, quand Macron nous parle de guerre, nous savons que c’est de la rhétorique, visant à nous faire accepter différentes choses… mais tout cela est sous nos yeux. Ce qu’il s’agit de nous faire accepter, c’est de subir en quelque sorte l’expérience de la guerre sans la guerre – étrangement, partiellement, mais vivement.
Dans la situation inédite que nous vivons, ne pas sortir de chez soi est pénible et sortir est angoissant, un peu comme si une inondation invisible transformait les déplacements quotidiens en dangers atrocement banals. Ici, on se retrouve seul.e dans un minuscule studio, à se demander soudain comment survivent celles et ceux qui sont réellement à l’isolement en prison. À la veille du confinement, certain.es ont vécu le dilemme de se trouver piégé.es ainsi ou d’être hébergé.es ailleurs, loin parfois, au risque de contribuer à aggraver l’épidémie, voire de mettre en danger leurs proches. Là, on rêverait d’un moment de solitude alors qu’on ne dispose pas même d’une petite pièce par personne, ou que l’étau des violences domestiques se resserre à l’intérieur, ou celui des violences policières à l’extérieur. Ici, on est obligé.e de sortir chaque jour risquer sa vie ou celles de ses proches, avec le stress immense des activités essentielles à la vie de nos semblables, ou le profond dégoût de celles qui ne sont essentielles qu’aux profits ou privilèges de quelques-uns. Là, le risque naît de l’enfermement en prison ou centre de rétention, au point de déclencher des mutineries ; de l’assistance à un.e proche âgé.e ou à la santé fragile ; ou de la tension entre les mesures sanitaires nécessaires et la solidarité avec les migrant.es ou les sans-logis. Ailleurs, le télétravail réserve de petits enfers psychologiques concoctés par les hiérarchies professionnelles, sans pour autant maintenir une réelle continuité de l’activité. Et si l’accès aux soins est insuffisant pour ce qui concerne l’épidémie, il est aussi perturbé pour tout le reste, tout comme l’accès à l’IVG. À l’expérience de la guerre sans guerre se mêle celle de la catastrophe environnementale qui n’en est pas exactement une, de formes d’assignation à résidence ou de travail contraint qui sont comme des doubles, des ombres de leurs formes véritables, pas tout à fait vraies, mais bien au-delà de la fiction immersive, induisant une souffrance psychologique réelle, et amplifiant toutes sortes de violences. L’expérience est déjà difficile sans galère particulière, mais la plupart des gens connaissent au moins un ou deux de tous ces facteurs aggravants, et pour celles et ceux qui en cumulent le plus, la situation est proprement infernale.
La confusion ne naît donc pas seulement de l’incurie, des mauvaises priorités et des manœuvres rhétoriques d’un gouvernement déjà connu pour sa contribution historique à la vie de la novlangue. Elle provient aussi du caractère nouveau et critique de la situation, et de la diversité de ses modalités. Pourtant, nous en faisons aussi l’expérience collectivement. Confiné.es ou non, nous pouvons tou.tes voir ces places publiques presque vides, où se pressent quelques salarié.es, un camion poubelle, un ou deux enfants accompagnés, qui s’offrent à nos regards au coin de la rue, dans les reportages télévisés et même en direct via des webcams installées aux quatre coins du globe. Les annonces de « solutions » gouvernementales sont floues et insuffisantes face à l’urgence, ce constat est largement partagé, soutenu par les multiples prises de parole de soignant.es. Les bilans de centaines de morts quotidiens s’accumulent dans de nombreux pays – la pénurie de tests et les limites de leur fiabilité ne peuvent pas effacer toute trace statistique de l’ampleur et de la gravité de la situation. Les « populations à risques » sous-estiment parfois encore les risques qu’elles encourent, et les autres, leur propre contribution à ces risques, mais tout le monde guette les signes qui pourraient annoncer soudain que la survie de nos enfants (quoi de plus concret, quoi de plus symbolique) serait finalement directement en jeu. Et en-deçà des débats cherchant en vain à identifier un sens politique très déterminé dans les applaudissements collectifs aux fenêtres à heure fixe, comment ne pas y voir d’abord l’expression d’une pulsion fondamentalement sociale, d’un besoin de sentir que nous vivons cela ensemble, et d’éprouver momentanément mais directement le caractère collectif de cette expérience d’importance historique ?
Certes, la mauvaise gestion de la situation engendre des formes de continuité (réelles ou fictives) que sa gravité devrait déjà avoir empêchées, mais la confusion conduit aussi des collègues, des proches, à s’y laisser prendre. Cela inclut par exemple la chimère de la « continuité pédagogique » dans l’enseignement, mais aussi la poursuite de nombreuses activités qui n’ont rien d’urgent aujourd’hui et deviennent des facteurs de risque supplémentaires. Tout cela ajoute tout à tour à l’absurdité de la situation et à sa gravité. Mais voilà. On ne sait pas exactement où on en est… mais on y est. Soignant.e ou pas, à l’usine ou en télétravail, au chômage technique ou au chômage tout court, logé.e (bien ou mal), à la rue ou incarcéré.e, avec ou sans enfants ou parents à charge, etc. : on n’échappe pas au sentiment de vivre une situation d’urgence intense et rare. La détresse psychologique et sociale, en partie refoulée, est cependant assez généralisée, mais il est encore difficile de savoir quoi penser de la situation, ce qui ne peut qu’ajouter à l’angoisse.
Notre première tâche est donc de reconstituer cette expérience collective ambivalente mais forte. Nous pourrons alors tenter d’en faire quelque chose : faire émerger de la situation des vérités politiques, et les populariser, afin de donner à la crise une issue solidaire et égalitaire.
Thèse 2 – Dans le feu de la crise, on peut transformer la diversité de situations dans les classes populaires en solidarité politique
Concordance des temps, suspension des routines, catastrophe et moyens de la conjurer – urgence vitale, partage d’expériences, et conscience sociale collective
On l’a dit, la crise nous frappe en partie différemment. Mais elle nous frappe de manière simultanée, beaucoup plus en tout cas que d’autres crises que nous avons connues. La crise économique et sociale déclenchée vers 2007-2008, par exemple, avait déjà entraîné une série de secousses politiques, car elle était déjà une crise à la fois profonde et globale. Mais le degré de simultanéité des événements paraît supérieur aujourd’hui. Des décalages existent mais de nombreux pays occidentaux vivent cette crise sanitaire et sociale à peu près en même temps. Et même à l’intérieur d’un même pays, les conséquences sont plus synchronisées que dans la plupart des événements qui pourraient servir de points de comparaison. Les mesures de confinement contribuent à cette simultanéité, qui s’observe également par d’autres modalités plus proches des effets de crises économiques classiques. Des graphiques spectaculaires circulent concernant le nombre de nouvelles personnes inscrites au chômage aux États-Unis pendant la première semaine de confinement, qui a largement battu tous les records depuis que les données existent (un demi-siècle). Sur ce plan, la différence de synchronisation est un fait objectif : plus de nouveaux.elles chômeurs.euses se sont inscrit.es la semaine du 16 mars que durant toute l’année 2008 – et le double la semaine suivante. Des données liées aux dépenses publiques d’urgence sous forme de « stimulus checks » et de couverture chômage étendue, mais tout de même significatives d’un chamboulement de l’ensemble du marché du travail en un temps record. On pourrait aussi souligner qu’une pandémie encore récemment sous-estimée comme « une grosse épidémie de grippe » fait maintenant plus de victimes chaque jour que les attentats terroristes en plusieurs années dans les grandes puissances mondiales : malgré des statistiques incomplètes, le bilan humain de l’épidémie est élevé et concentré dans le temps. Tout cela ne peut que se manifester dans l’expérience que nous faisons de la crise sanitaire, et dans la possibilité de la politiser (pour le meilleur ou pour le pire, certes).
S’il est dangereux de sous-estimer les disparités de l’expérience et des situations vécues, on aurait bien tort de perdre de vue le potentiel de transformation sociale contenu dans une rupture temporelle. C’est le phénomène observé dans toute mobilisation, toute grève, aussi locale soit-elle : la suspension de la routine ouvre des possibilités insoupçonnées, fait tour à tour figure de moyen vital pour la mobilisation, nécessitant des efforts pour la maintenir, et de fin en soi, dans la force (terrible ou joyeuse) de la prise de conscience et de l’action collectives. Et l’histoire des luttes ouvrières et sociales est également là pour nous rappeler que ces luttes se sont parfois déclenchées pour répondre à de grandes tragédies, même si celles-ci peuvent bien évidemment nous paralyser, en dépolitisant nos expériences ou en les politisant contre la solidarité. Voilà pourquoi il importe d’être sensible aux évolutions politiques, voire aux basculements, que l’on pourra observer dans différents milieux. Plutôt que de chercher à débusquer les hypocrites qui n’auraient pas su se mobiliser dans les grandes grèves de cet hiver, prenons acte des changements qui s’opèrent lorsqu’ils vont dans le bon sens.
Nous sommes frappé.es différemment, mais nous sommes essentiellement frappé.es par des injustices sociales. Les exploité.es sont en danger parce qu’ils doivent travailler sans protection et/ou pour des activités non essentielles et qui fragilisent déjà leur santé et leur vie en temps normal. Iels peuvent craindre pour leurs conditions de travail, leurs horaires, leurs salaires, leurs emplois, leurs logements, leurs craintes sont des craintes de classe, que les classes dirigeantes ne partagent pas – mieux : que les classes dirigeantes alimentent, car elles sont des conséquences concrètes des antagonismes de classe. Les opprimé.es ne peuvent que vivre de façon plus aiguë encore les modalités de leurs oppressions, les inégalités matérielles au sein des rapports de classe, les formes d’extorsion de travail, de violences spécifiques, qui les visent. On semble redécouvrir les conditions de vie depuis les cités HLM délabrées jusqu’aux habitations sans eau courante à Mayotte et ailleurs aux colonies, ou la double charge de travail des mères salariées. On se rend compte qu’il est finalement possible de libérer des prisonniers ou des sans-papiers, d’héberger d’urgence un certain nombre de personnes qui ne l’étaient pas, dans des proportions insuffisantes mais révélatrices. Face à cela, chacun.e sait que l’unité des exploité.es et des opprimé.es n’est jamais gagnée d’avance, mais les situations critiques sont aussi celles où l’activité politique, sous les formes adaptées à chaque situation, peut parfois surmonter de grands obstacles dans leur unification. L’enjeu est aujourd’hui de bien souligner à quel point les dangers de la situation, dans le confinement comme en dehors, retombent sur une diversité d’exploité.es et d’opprimé.es qui constituent une majorité de la société, et la font vivre. En temps normal, cette majorité a la vie dure. Elle vit – nous vivons – en ce moment une situation où la survie est en jeu beaucoup plus directement que dans l’exploitation ou l’oppression « ordinaires », ou dans l’angoisse d’un cataclysme climatique faussement lointain.
On peut même avancer que certains aspects de la crise conduisent, et pourront conduire prochainement, à des partages d’expériences auparavant plus cloisonnées. Depuis au moins 2016 en France on les voit se produire autour des violences policières : de Nuit Debout aux Gilets Jaunes, aux grèves de masse de cet hiver pour les retraites et aux mobilisations pour les droits des femmes ou le climat, différents milieux sociaux dans les classes populaires et la jeunesse ont fait directement l’expérience de degrés et de formes de violence étatique habituellement réservées principalement aux non-blanc.he.s des quartiers populaires et des colonies. Ce phénomène n’a bien évidemment pas aboli les discriminations, la différenciation sociale des violences, mais une certaine prise de conscience bien plus large sur les violences policières s’est produite, rendant possibles des rapprochements qui auraient été presque impossibles autrement. C’est dans ce sens que le slogan « tout le monde déteste la police » a rencontré une certaine efficacité performative. On pourrait voir la crise sanitaire et sociale actuelle comme susceptible de produire les mêmes effets, en mettant des vies en danger dans presque tous les milieux. Là encore, la crise n’abolit pas les inégalités : ce qui tue ou menace nos conditions de vie aujourd’hui, plus que le virus en lui-même, est l’état de nos sociétés qui a ruiné les systèmes publics de santé, de recherche fondamentale, de logement, de protection contre le chômage (et s’attaque aux retraites), et nous ne sommes pas tou.tes égaux.ales devant le capitalisme. Nous ne sommes toujours pas égaux.ales devant les violences policières, comme la répression accompagnant le confinement l’a montré. Mais les exploité.es et les opprimé.es dans leur diversité sont tou.tes pris.es dans ce piège, il n’y a personne parmi nous qui soit entièrement à l’abri. Il est d’ailleurs frappant de constater que la pandémie vient accentuer une autre tendance déjà présente dans nos luttes : le fait que celles-ci abordent souvent les différentes menaces qui nous visent comme des questions de vie ou de mort (non seulement guerre ou violences policières mais féminicides, extinction, surmortalité de race/genre/classe et inégalités d’espérance de vie en bonne santé…). Le monde capitaliste menace tous nos corps, tou.tes nos vies, nous l’éprouvons bien plus intensément tou.tes ensemble aujourd’hui. Cette tragédie laissera des séquelles, et nous pousse d’autant plus fort à chercher ensemble des remèdes politiques. Toute activité politique consiste à construire des solidarités qui ne sont pas données d’avance, et de surmonter des contradictions pour faire bloc contre un système qui joue le même jeu contre nous. Lorsque cela devient possible, il faut battre le fer tant qu’il est chaud.
Thèse 3 – Après les luttes sociales intenses de cet hiver, on peut continuer de mener et gagner la bataille des idées
Scandale sanitaire et social, argent magique pour le CAC 40 : un moment de vérité ? – « activités essentielles » : besoins sociaux, redistribution, écosocialisme
De même que l’unité des exploité.es et des opprimé.es n’est pas donnée d’avance, la vérité sur le présent capitaliste que nous vivons et l’avenir écosocialiste qui nous permettrait de le dépasser n’apparaît pas spontanément. La situation telle qu’elle s’est développée et les interventions du gouvernement tendent à créer différentes formes de confusion, depuis la mauvaise gestion de la crise qui conduit à des comportements dangereux à petite et grande échelle, jusqu’à la volonté de profiter de la crise pour ressouder une majorité du pays en soutien au gouvernement. Mais le gouvernement aura fort à faire pour ne pas avoir à payer (sur un plan financier, politique – et peut-être judiciaire) cette mauvaise gestion, et il nous revient d’intervenir afin que toute la lumière soit faite, et que le rapport de force social s’inverse. Faisons de cette crise un véritable moment de vérité.
Les sondages les plus précis et concrets sont sans appels, et confirment ce que chacun.e peut percevoir dans nos milieux : la majorité de la population est bien consciente de l’absence d’anticipation de cette crise sanitaire par l’État. Absence d’anticipation à moyen terme, au sens où l’épidémie et le risque de pandémie ne datent pas de quelques jours ou semaines. Absence de planification de long terme, ou plutôt politiques délibérées à l’encontre de la santé et de la recherche publiques, désarmées depuis longtemps sur tous les plans : manque de moyens, de locaux, de personnels, de matériel lourd ou léger, et pilotage à courte vue des services publics. Le gouvernement affirme qu’il était impossible de prévoir tout cela et que son action n’a subi aucun retard. Les nombreuses preuves du contraire circulent cependant intensément : si les pénuries déjà évoquées n’étaient pas des preuves suffisantes, on dispose également des nombreux avertissements émanant des mouvements sociaux dans la santé et la recherche, à confronter aux propos présidentiels ou ministériels, anciens comme récents. Sans parler des travaux de prospective de l’OMS, qui soulignaient qu’une épidémie ayant grosso modo les caractéristiques du COVID-19 serait à la fois possible et particulièrement dévastatrice dans le monde tel qu’il est devenu. Non seulement les gouvernements successifs ont retiré au système de santé les moyens de se préparer à des situations bien réelles telle que celle que nous vivons, mais le gouvernement actuel tarde encore à réunir ces moyens aujourd’hui, trahissant que même au milieu de nos mort.es sa vraie guerre est ailleurs. La situation est avant tout un immense scandale de santé et de services publics, nous le savons, et nous continuerons d’agir pour que les faits éclatent au grand jour.
Une autre révélation qui ne s’est pas faite attendre, au gré des allocutions présidentielles, est celle de l’existence du fameux « argent magique », dont Macron niait l’existence pour mieux justifier la destruction des services publics – des propos tenus il y a deux ans presque jour pour jour, en regardant dans les yeux… une infirmière. Mais aujourd’hui les sommes promises par le même Macron dans le cadre de son plan de sauvetage du CAC 40 sont sans commune mesure avec celles que ses réformes successives étaient censées retirer des services publics et de la protection sociale. L’argent qu’il fallait impérativement retirer de nos allocations de chômage, de nos retraites, et bien sûr de nos hôpitaux, réapparaît soudain, démultiplié, pour sauver les grandes entreprises. Nul doute que dans l’esprit de Macron et de ses acolytes, la prochaine étape consistera à nous présenter la facture, mais personne ne semble dupe de ce tour de passe-passe.
Quant à « l’état d’urgence sanitaire », aux ordonnances du 25 mars, et à leurs conséquences sur le droit du travail (temps et horaires de travail et de repos, en particulier), il est sans doute un peu tôt pour juger de l’étendue de leur application réelle, et de leur applicabilité face aux résistances probables. On peut déjà, en revanche, se rendre compte de l’avenir qui se dessine pour nous si nous laissons au pouvoir les casseurs des services publics les plus vitaux, face à de futures catastrophes sanitaires, économiques, ou climatiques. Ils seraient donc prêts à nous tuer au travail (y compris littéralement) « pour sauver l’économie », c’est à dire les profits exorbitants de quelques propriétaires. Ces mesures seraient scandaleuses en temps normal, et le gouvernement espère que la situation extraordinaire nous poussera à les accepter, ou nous empêchera de les refuser. Une fois enclenché l’homicide de masse, après tout… pourquoi pas le chantage affectif, voire la prise d’otage. Commençons par faire jaillir de leur plan d’urgence la vérité des rapports sociaux actuels. Le gouvernement risque de sous-estimer la colère qui couve et de surestimer sa position de force, ce qu’il pourrait payer cher si nous savons nous organiser.
Car si nous sommes en mesure de faire émerger assez vite un certain nombre de vérités sur cette société, c’est que les fortes mobilisations qui ont précédé la crise sanitaire (pas seulement en France d’ailleurs), et leurs victoires dans la bataille des idées, ont préparé le terrain politique. En ce sens, la bataille des idées dans cette crise prolonge celle que les luttes et les grèves ont permis de mener et de gagner ces dernières années et particulièrement cet hiver. Ce passé récent fait partie de ce qui rend possible une bonne lecture politique de masse de la situation nouvelle. Au fond, qui ignorait encore que Macron était le président des riches ? Il n’est alors pas difficile de saisir les preuves définitives que la situation nous apporte de ce fait, et de ses conséquences graves et immédiates dans nos vies. Si la crise sanitaire tend à déchirer pour de bon le rideau de mensonges et de novlangue tiré par la Macronie, c’est qu’il était déjà passablement troué, usé jusqu’à la corde. Le mensonge menace de devenir cette « corde qui soutient le pendu », et l’on panique soudain en haut lieu de devoir « rendre des comptes » (le refoulé par excellence des classes dirigeantes).
Malgré tous les facteurs de confusion évoqués jusqu’ici, les exploité.es et les opprimé.es sont bien moins désorienté.es qu’il n’y paraît – et c’est le fruit des luttes sociales des derniers mois et années. Le « moment de vérité » qui pourrait approcher n’est pas créé de toutes pièces par la pandémie, il est rendu possible par une lecture déjà politisée de la situation. Particulièrement depuis la grande récession il y a douze ans, et le nouveau cycle global de luttes ouvert en 2011, un nouveau bon sens s’est formé contre un ordre du monde qui ne peut plus continuer sans nous mettre en danger à plus ou moins brève échéance, et ce bon sens trouve de nouvelles occasions de s’exprimer aujourd’hui.
Une autre question qui se pose sans cesse dans cette crise est l’occasion de faire avancer nos idées : la question des « activités essentielles », et de celles et ceux dont le travail est essentiel pour les maintenir. Question politique s’il en est ! A fortiori dans un mode de production caractérisé par une prolifération d’activités dont l’utilité est mesurée par la valeur d’échange et l’intérêt économique d’une classe de propriétaires, plutôt que par la valeur d’usage et la gestion collective égalitaire et démocratique des ressources naturelles, du travail et des biens et services produits. A fortiori, dans une société qui met constamment en danger les vies de celles et ceux dont le travail est vital, et celle de la planète.
D’une part, il est particulièrement précieux que la situation mette en valeur toutes les dimensions du célèbre adage socialiste : « de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ». Il est clairement question aujourd’hui d’injustices liées à la mauvaise distribution des richesses et à l’insatisfaction des besoins sociaux prioritaires, mais aussi de l’urgence de limiter le superflu : pour cesser de laisser une minorité de privilégié.es dicter les priorités, et pour éviter que l’organisation générale de l’économie n’entraîne des ravages irréversibles. Ravages sociaux toujours, ravages sanitaires aujourd’hui, ravages environnementaux demain : cette crise est l’occasion de généraliser la conscience des liens entre les trois. On a pu rapprocher l’expérience vécue actuellement de celle d’une grande catastrophe naturelle aggravée par les injustices du monde capitaliste, le virus étant aussi invisible que le CO2 ou la radioactivité, aussi fluide que l’eau des inondations, de la fonte des glaces et de la montée des océans (du reste, les liens sont connus entre plusieurs pandémies des dernières décennies et la destruction globale de l’environnement). Mais on peut aussi envisager les effets de l’étrange « état d’urgence sanitaire » que nous vivons comme une préfiguration de futures mesures répondant à l’urgence environnementale. C’est donc l’occasion de sentir plus concrètement, dès à présent, que cet avenir-là sera bien différent selon qu’il sera organisé dans une société plus juste et plus prévoyante, écosocialiste, ou dans un capitalisme gérant l’urgence après coup et dans l’injustice la plus cruelle.
D’autre part, on voit bien aujourd’hui qui contribue à remplir les fonctions vitales de la société. Ce sont celles et ceux dont on prétend que les régimes spéciaux de retraite n’ont plus lieu d’être, et/ou celles et ceux dont les salaires sont misérables, dont les conditions de travail et d’emploi sont ravagées… et qui doivent maintenant regarder la mort en face, tenter de sauver des vies avec des moyens insuffisants, et risquer les leurs et celles de leurs proches. Pendant ce temps, les riches sont prié.es de s’éloigner du danger et ne se le font pas dire deux fois (quitte – comble de la honte – à contribuer à propager l’épidémie).
Après un hiver du mécontentement, le printemps semble soudain annulé… mais si nous sommes capables de mener ces débats et de populariser nos idées, c’est peut-être pour la Macronie qu’il n’y aura pas de printemps.
Thèse 4 – Il faut tenter d’imaginer les coups d’après, et les options stratégiques des classes dirigeantes
Semi-confinement et choc de la reprise – crise économique gigantesque et potentiellement durable – quasi-fascisme ou capitalisme ultra-autoritaire
On peut et on doit reprocher beaucoup de choses au gouvernement et aux classes dirigeantes, mais il n’est pas certain que l’incompétence ait joué un rôle central dans la mauvaise gestion de la situation en termes de santé publique. Il semble que le gouvernement ait agi dans une large mesure en fonction de priorités qui sont celles d’une minorité de la société – comme d’habitude en somme, quoique de façon peut-être plus flagrante. Peut-être y a-t-il eu trop d’optimisme dans la capacité du capitalisme à poursuivre ses projets malgré l’épidémie qui progressait, mais on a vu que le gouvernement ne se démonte pas et tente maintenant d’en profiter. Le confinement et les autres aspects inédits et dangereux de la situation sont le résultat des priorités des classes dirigeantes, qui expliquent les décisions apparemment contradictoires dans les premières étapes du confinement (maintien des élections municipales…) et dans la différenciation entre activités essentielles ou non. Même les gouvernements qui ont envisagé d’éviter tout confinement, comme celui de B. Johnson en Grande-Bretagne, n’agissaient pas nécessairement par méconnaissance des risques mais peut-être plutôt par mauvais calcul politique sur leur capacité à imposer un bilan humain alourdi. Dans quel but ? On peut penser que l’un des principaux enjeux était de modérer et d’abréger les effets de la pandémie en termes de ralentissement ou d’interruption de l’activité économique (sauver « l’économie », c’est à dire les profits des grands capitalistes, là encore). D’ailleurs, en France, le gouvernement intervient déjà actuellement pour allonger la liste des activités autorisées à se poursuivre ou reprendre, au lieu de donner la priorité absolue à la lutte contre l’épidémie.
Macron a peut-être lui aussi eu sa part de mauvais calcul politique, et la pandémie a peut-être fini par poser quelques limites imprévues à sa volonté d’agir indéfiniment contre la majorité de la société. Il a dû décider de repousser (voire abandonner ?) l’application de la réforme du chômage, mais aussi la réforme des retraites dont il avait d’abord tenté d’accélérer l’adoption par le 49.3, avant d’être rattrapé par l’accélération de l’épidémie en France. Et comme on l’a vu, la situation peut le conduire à une position de faiblesse. Mais Macron et son gouvernement n’ont pas dit leur dernier mot, et la prudence est de mise quand il s’agit d’anticiper la façon dont on pourra « régler les comptes » politiques après le confinement.
Pour commencer, tout laisse penser qu’au confinement actuel, dont la fin n’est pas encore fixée, pourra succéder une autre configuration de confinement, plus sélectif, ou plus lâche, mais peut-être plus durable également, sans retour immédiat aux libertés préexistantes de circulation, de réunion, de rassemblement dans l’espace public, etc. D’un côté, cela pourrait être le résultat d’un opportunisme politique cynique ; mais attention : de l’autre, même au-delà de ce qui sera autorisé ou non, il est possible que des inquiétudes persistent et que des précautions restent nécessaires à la santé publique (comme l’est actuellement le confinement, jusqu’à ce qu’il soit possible de passer à d’autres solutions), et nous aurons peut-être encore à dénoncer les risques inutiles engendrés par certaines décisions. Aux conditions de « semi-confinement » qui nous attendent peut-être, on peut ajouter les pressions de la reprise de l’activité « normale » de travail partout où elle aura été perturbée : accélération/intensification/alourdissement de la charge de travail là où celui-ci aura été ralenti, horaires allongés là où il y avait du télétravail et des gardes d’enfant, effondrements organisationnels et stress post-traumatique chez les salarié.es en « première ligne » (santé, nettoyage, commerce…), etc. Sans oublier tous les problèmes de revenu, de logement, scolaires, familiaux, affectifs, etc. qui surviendront (à des degrés divers en fonction de notre capacité ou non à obtenir les mesures d’urgence nécessaires dès maintenant). Le retour à « la normale » et à des conditions de mobilisation telles qu’on les a connues cet hiver pourrait donc se faire attendre.
Il faut également rappeler que la profonde crise économique qui couvait à l’échelle globale semble bien avoir été déclenchée pour de bon par la crise sanitaire. On peut s’attendre à ce qu’elle dure bien plus longtemps que le confinement. Voilà d’ailleurs ce que le gouvernement a en tête avec ses ordonnances antisociales sur le droit du travail, devant pour l’instant demeurer en vigueur jusqu’à fin 2020. Et l’abandon au moins temporaire des projets antisociaux sur le chômage ou les retraites pourrait en fait être immédiatement suivi de nouveaux projets d’une bien plus grande ampleur. Le gouvernement a dû reculer en partie sur son projet d’urgence concernant les périodes de congés, pour revenir à la charge avec les spectaculaires ordonnances du 25 mars.
Même sans savoir exactement ce que le gouvernement voudra et pourra réellement faire en France, l’une des données de la conjoncture restera sans doute durablement une grande crise économique. Envisager cela nous ramène à certains des thèmes déjà évoqués sur l’expérience de guerre sans guerre : dans les dernières décennies, dans les pays du centre capitaliste, ce sont les situations de crise économique qui ont le plus mis en jeu la survie d’une partie de la population, suscité des craintes de pénurie, etc. Mais tout le monde ou presque se souvient de 2008, et si l’on suit notre raisonnement jusqu’ici, nous avons en ce moment la possibilité de politiser « d’avance » le moment où la crise sanitaire cessera de « masquer » ou de « recouvrir » la crise économique. L’enjeu est donc bien de condenser les expériences politiques accumulées ces douze dernières années pour affronter avec un rapport de force moins dégradé la bataille pour décider qui paiera la crise sociale. Selon certaines analyses, les remèdes de 2008 ne pourraient être reproduits à l’identique, et le chômage de masse pourrait atteindre des niveaux comparables à ceux des années 1930, en l’absence d’interventions étatiques en rupture partielle avec plusieurs décennies de politiques néolibérales. Voilà le genre d’urgence qui compte pour les gouvernements, et qui expliquerait la volonté d’éviter de provoquer tout ralentissement fort et durable de l’activité – donc, d’éviter le confinement ou d’en limiter la durée et la portée, autant que les conditions sanitaires et politiques le permettront.
On le voit, la situation est périlleuse pour les classes dirigeantes, ce qui ne signifie évidemment pas qu’elles aient la partie perdue, notamment à cause des limites des forces sociales et politiques susceptibles de contester leur pouvoir. Cela signifie plutôt qu’elles pourraient être amenées à envisager des solutions plus extrêmes. Depuis des années déjà différents facteurs économiques, sociaux, politiques relancent les débats sur la possibilité de nouveaux fascismes au 21e siècle – éventuellement « écofascismes », ou fascismes ancrés dans la gestion violente de catastrophes à caractère environnemental. Et dans un moindre degré de rupture, après avoir réévalué le rôle fort de l’État dans l’ensemble de la trajectoire du néolibéralisme, on débat depuis longtemps déjà d’une transition future ou en cours vers un capitalisme bien plus franchement autoritaire. On distribue plus d’amendes que de tests de dépistage, et les images de rues quasiment désertes et de drones de surveillance se mêlent à celles de formes plus classiques d’emprise policière sur l’espace public, comme une nouvelle salve d’alertes sur le régime autoritaire qui vient. Sur le plan international enfin, on peut s’attendre à des guerres ou autres interventions impérialistes sur les nouvelles lignes de faille géopolitiques que la pandémie est susceptible de faire apparaître – et bien évidemment, des tentatives d’aggraver la répression des migrations de masse que la crise sanitaire globale pourrait alimenter de plus belle. Après l’expérience de la guerre sans la guerre ou de la catastrophe environnementale à travers la catastrophe sanitaire, faut-il s’attendre à voir apparaître un quasi-fascisme ?
On attribue à Fredric Jameson la formule souvent citée depuis 1989 : « Il est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Mais la fin du monde n’est-elle pas devenue bien plus facile à imaginer ces derniers temps, et ce dans le prolongement même de la dynamique du capitalisme ? Peut-être cela finira-t-il par nous aider à imaginer et construire un avenir au-delà du capitalisme. La grande catastrophe peut encore être conjurée si nous nous saisissons des catastrophes qui sont déjà là. Des millions, des milliards de personnes sont en train, sous diverses modalités, de faire l’expérience concrète de la surprenante fragilité de notre survie dans le cadre du « système » existant. Les conséquences politiques de telles expériences peuvent être tragiques, et nous ramènent une fois encore aux guerres mondiales, mais ces mêmes précédents nous rappellent aussi les expériences révolutionnaires ou réformistes radicales qui ont été conçues à partir des situations les plus sombres du 20e siècle[2].
Thèse 5 – La nouvelle situation appelle de nouvelles modalités d’action immédiate
Faire vivre la solidarité pratique élémentaire – suspendre ou contrôler le travail pour peser sur l’urgence sanitaire – politiser les injustices
Même s’il est (presque trop) facile d’imaginer un scénario nous menant tout droit à la dérive ultra-autoritaire, l’impression que toute intervention politique est impossible sans braver les mesures sanitaires est une illusion.
Les nombreux types de situations difficiles évoqués au début de ce texte signifient que partout des initiatives de solidarité pratique sont nécessaires. Elles présentent toutes sortes de dilemmes, liées notamment à la double nature des mesures de confinement – réelles nécessités sanitaires jusqu’à nouvel ordre, et réels obstacles à certaines formes d’action de solidarité pourtant urgentes. L’une des premières urgences est donc la vigilance sur les mesures sanitaires, appliquées de façon violente et dangereuse dans certains cas, mais aussi insuffisantes à de nombreux titres.
Dans la situation actuelle, il y a également beaucoup à faire pour organiser la solidarité concrète autour de nous. Il ne faut pas sous-estimer la dimension politique de ces tâches, à la fois par leurs effets directs, et parce qu’elles entretiennent des attitudes solidaires contre le chacun-pour-soi, et combattent les tentatives idéologiques de tourner notre colère contre nos voisin.es plutôt que contre les vrais responsables. Ces formes de solidarité s’apparentent à une auto-organisation de la reproduction sociale. Et même dans certains actes plus symboliques, comme les applaudissements aux fenêtres, se jouent certaines dimensions de la reproduction sociale et de la dignité des classes populaires. Nous saurons plus tard si les grandes mobilisations de demain se sont réellement préparées aujourd’hui aux balcons des quartiers populaires, mais nous savons déjà le bien que peut nous faire le soutien mutuel entre voisin.es et le simple fait de crier ensemble notre existence dans un moment de crise et d’injustice.
Ensuite, si l’heure n’est pas aux manifestations de masse, elle pourrait bien être à la grève, dans certaines conditions. On voit bien en quoi la crise sanitaire peut rendre inévitable la mobilisation redoublée du travail dans certains secteurs de première nécessité. Mais on voit tout aussi bien que les classes dirigeantes en profitent pour appliquer le même mécanisme dans d’autres secteurs, sans prendre les mesures nécessaires pour orienter l’activité vers les besoins les plus urgents, ni protéger les salarié.es. Voilà pourquoi des grèves ont bel et bien eu lieu, et continuent d’avoir lieu. Plus généralement, c’est aussi « la grève sans la grève » qui peut viser les mêmes résultats, ou se déclencher « spontanément » par excès de pression sur les salarié.es – droit de retrait, arrêts de travail, absences, grève du zèle, et autres modalités plus ou moins fortes de rétention ou de contrôle du travail par les travailleuses et travailleurs. Le refus de risquer sa vie pour le CAC 40 ou la volonté de réorienter le travail vers ce qui est vraiment essentiel à la sortie de crise peuvent être de puissants ressorts de mobilisation, au même titre que la pénurie de main-d’œuvre d’un côté ou le spectre des licenciements de l’autre. Plus ces formes de mobilisation constitueront une menace réelle pour les classes dirigeantes, moins celles-ci pourront appliquer leurs ordonnances scélérates et se dérober aux revendications concernant la suspension ou la réorientation de l’activité, les conditions de travail ou de chômage technique, les emplois, les revenus, les loyers, etc.
On ne peut avoir la certitude que ces modalités d’action permettront de réellement compenser les effets néfastes de la situation, mais elles constitueront en même temps des interventions dans la bataille des idées qui se poursuit, afin de politiser les expériences difficiles comme des injustices sociales appelant une alternative politique solidaire et égalitaire. Si nous éprouvons déjà notre existence commune d’exploité.es et d’opprimé.es dans l’expérience du confinement et de l’urgence sanitaire, nous l’éprouverons d’autant plus dans l’action pour la solidarité envers les non-confiné.e.s, et pour la suspension, ou la réorientation sécurisée de l’activité.
Thèse 6 – Il faut esquisser des perspectives politiques ambitieuses qui passent par le champ de bataille de l’État
Méfiant.es mais pas pétrifié.es par la puissance étatique – le plan d’urgence, la planification, le contrôle démocratique et ouvrier qui viennent – le haut et le bas : luttes sociales et horizon politique alternatif
La gravité de la crise sanitaire et sociale en cours nécessite déjà des mobilisations qui devront se déployer au-delà de l’urgence actuelle, pour lutter contre les mesures antisociales prises avant, pendant et après la crise, et pour commencer à construire enfin une autre société. C’est bien plus encore le cas si l’on prend en compte les hypothèses ci-dessus concernant la stratégie des classes dirigeantes. Nous terminerons ce texte par quelques remarques sur les perspectives stratégiques de notre camp social, afin d’engager à poursuivre le débat dans certaines directions.
L’inquiétude face aux tentations ultra-autoritaires réelles au sein des classes dirigeantes ne doit pas faire oublier que l’État demeure un champ de bataille essentiel, a fortiori au 21e siècle et dans les pays du centre capitaliste. On peut penser que le gouvernement, en occupant le terrain des plans d’urgence et de « l’État fort », montre qu’il a retrouvé sa puissance. Mais ce gouvernement est obligé d’occuper un terrain qu’il n’a pas choisi (si l’on repense à la fameuse révélation de l’« argent magique », par exemple), et paiera d’autant plus cher ses responsabilités dans la crise s’il ne parvient pas à faire accepter la sortie de crise qu’il aura trouvée (et a fortiori, s’il n’en trouve pas vraiment). La controverse universelle au sujet de la chloroquine, quoi qu’on puisse penser de son contenu, est déjà une manifestation de la volonté générale de se mêler de ce que fait l’État, et de faire rendre des comptes aux dirigeants politiques pour leurs décisions néfastes (dont certaines sont bien réelles). Pendant ce temps, après des années où la répression policière a joué un grand rôle pour maintenir le cap d’un gouvernement de plus en plus impopulaire, les effectifs policiers sont eux aussi mis en danger, et commencent à subir les effets de l’épidémie. À suivre.
Nous ne devons pas rester pétrifié.es devant le fait que les dangers et les injustices mis en évidence par la crise sanitaire favorisent l’appel à de puissantes interventions étatiques pour trouver une issue. Une politique contre les classes dirigeantes n’est possible, dans une telle conjoncture, que par la mise en évidence des grands choix qui sous-tendent l’action de l’État : qui doit être protégé de quel danger, qui doit être mis à contribution et comment ? Comment les moyens matériels et humains doivent-ils être affectés pour résoudre les graves problèmes rencontrés (ou préfigurés), et pour éviter qu’ils se reproduisent (ou produisent) ? Les luttes sociales ne s’interrompent jamais vraiment, et il y a toujours des urgences, mais le sentiment, l’expérience collective de l’urgence est bien plus rare. Les crises telles que celle que nous vivons sont parmi les moments où il devient possible de populariser véritablement la notion de « plan d’urgence », mais pas pour le CAC 40 cette fois : pour l’hôpital, la santé et la sécurité sociale, pour la recherche et l’ensemble des services publics, pour les salaires et les emplois, les droits au chômage, au logement, aux pensions de retraite, sans oublier la lutte contre les oppressions structurelles de longue date et les catastrophes environnementales à venir. Dans tous ces domaines, cette crise sanitaire et toutes les autres crises auxquelles elle fait écho ou qu’elle « recouvre » peuvent être des moments propices à la revendication d’une action à la mesure des enjeux – c’est à dire, jusqu’à nouvel ordre, engageant l’État.
De plus, nous avons aussi vu que la question du contrôle des travailleuses et travailleurs sur la production se pose actuellement de multiples façons (priorités, conditions de travail, grève ou retrait pour les imposer, etc.). Le fait que la crise pousse les classes populaires à réinvestir l’État ne signifie pas inévitablement un retour à une attitude de soumission, mais plutôt pour le moment une volonté de reprendre au moins un peu de contrôle sur certaines questions vitales, après des années de gouvernement anti-démocratique qui ont conduit à une catastrophe désormais incontestable. Sans que cette idée soit sur le point de se réaliser sans combat, l’air du temps est en quelque sorte à la planification sous contrôle démocratique. Si nous parvenons à ce que l’ensemble de notre camp social se projette dans la reprise de contrôle sur le travail et sa planification, ce sera de bon augure aussi bien pour l’environnement que pour l’égalité sociale, ou tout simplement la santé publique, où les personnels mobilisés avaient déjà exprimé ce genre d’ambitions. Pour sauver l’hôpital public, pouvoir aux soignant.es ! (Et ainsi de suite.)
En somme, il est urgent de ne pas choisir entre intervention « par en haut » et « par en bas ». Une autre façon de s’en rendre compte est de partir des difficultés rencontrées par les mouvements « par en bas » dans la période (les dernières décennies), confirmées dans la conjoncture. Nous venons de vivre des grèves d’ampleur historique en France, portant sur des questions susceptibles de réunir pratiquement l’ensemble des exploité.es et des opprimé.es contre la politique des classes dirigeantes. Mais elles se sont heurtées à deux obstacles qu’elles n’ont pas su franchir (même si l’épidémie est ensuite venue bousculer l’avancement des projets gouvernementaux contestés) : la difficulté de convertir la victoire dans la bataille des idées en extension de la grève au secteur privé (industriel notamment) ; et la détermination du gouvernement à ne pas se laisser contenir par la volonté majoritaire.
On soutiendra ici que ces deux obstacles mettent en avant l’importance de la complémentarité et de l’entraînement réciproque entre lutte sociale auto-organisée et « horizons politiques » (ou représentations populaires des possibles politiques). Même si de plus amples développements sur ce point devront être remis à un autre texte, l’un des grands facteurs de la raréfaction depuis des décennies des grandes grèves ouvrières (au sens restreint de cet adjectif, c’est-à-dire précisément dans les secteurs où l’extension de la grève ne s’est pas faite cet hiver) paraît être la perte de confiance politique collective entraînée par la crise de l’idée même d’une alternative au capitalisme. Ce phénomène est évidemment un cercle vicieux car de grandes grèves victorieuses seraient en même temps un élément essentiel à la reconstitution d’horizons politiques alternatifs. Le plus souvent, dans les milieux militants de la gauche radicale, on imagine la rupture à venir de ce cercle comme le résultat de ces grandes grèves, lorsqu’elles finiront par advenir – et on imagine le rôle de cette même gauche radicale comme étant surtout de redoubler d’efforts pour essayer à chaque occasion de les organiser. Il serait pourtant utile d’agir également, de façon complémentaire, pour construire une force politique prête à agir de façon appuyée « par en haut » (donc dans le cadre de l’État), et qui contribuerait ainsi à reconstituer un horizon politique alternatif, force d’entraînement majeure pour des luttes sociales massives et victorieuses. S’il avait existé cet hiver en France une gauche politique assez menaçante à court terme pour le statu quo, c’est-à-dire à la fois assez radicale et assez capable d’une grande victoire électorale, elle aurait pu soit favoriser la confiance en soi et la politisation du salariat ouvrier du privé et son entrée en masse dans la grève, soit pousser le gouvernement à céder, pris en tenaille entre « haut » et « bas » – entre des grèves tout de même déjà fortes et le risque d’une « sanction électorale » profitant à une alternative, disons, réformiste radicale.
Certes, la construction d’une force électorale radicale et large à la fois n’est pas le seul scénario de reconstitution d’un horizon politique alternatif. Il est légitime de s’inquiéter des modalités d’articulation entre ce « haut » et les luttes « d’en bas ». Mais si l’on prend la question des horizons politiques alternatifs au sérieux, on ne peut se replier sur « les luttes » sociales en redoublant de volontarisme pour compenser un horizon bouché par de puissantes dynamiques historiques. Le renouveau de la lutte politique implique de prendre le risque de mener des expériences nouvelles et incertaines, et des décennies consacrées à l’animation d’organisations « révolutionnaires » ultra-minoritaires ont montré les qualités et les limites de celles-ci. Or, si nous n’inventons pas de nouveaux moyens de faire exister un horizon politique écosocialiste, prenant appui sur ce que révèle la crise actuelle pour consolider et unifier ce qui ne semblait plus pouvoir l’être (une gauche un tant soit peu radicale et à la hauteur de toutes les urgences), nous continuerons d’être entraîné.es vers l’horizon opposé, piégé.es par un nouveau duel entre Macron (ou un compétiteur vaguement plus modéré) et Le Pen.
Les risques de récupération par l’État sont toujours réels, mais le risque de la passivité pure et simple, faute de confiance des exploité.es et des opprimé.es dans leur propre capacité à transformer le monde tou.tes ensemble, est plus grand encore. Si les faiblesses de la gauche la poussent à s’unir, elles font en même temps craindre un manque de radicalité ; or la situation actuelle fait pression au contraire pour que la seule gauche viable soit nettement plus radicale que ce qui a existé depuis des décennies. Nous ne sommes probablement pas à la veille d’un 1936, mais nous ne sommes clairement plus aussi politiquement démuni.es qu’en 2008. Le débat doit se poursuivre sur ce point comme sur tous les autres. Il faudra revenir sur les évolutions des perspectives économiques, prendre pleinement en compte la situation internationale, mais aussi tenter de rendre peu à peu plus concrètes les perspectives de la thèse 6 en particulier. Mais la situation ne fait qu’accroître nos responsabilités politiques pour relever le défi.
Notes
[1] Sans nécessairement reprendre à mon compte tout leur contenu, je me suis appuyé en particulier sur la lecture des textes récents suivants : Kate Aronoff, Alyssa Battistoni, Daniel Aldana Cohen, Thea Riofrancos, « We can waste another crisis, or we can transform the economy », Jacobin, 14 mars 2020. Stephen Bouquin, « Une tempête parfaite. Covid-19 et crise du capitalisme », Entre les lignes entre les mots, 21 mars 2020 – disponible depuis sur Contretemps. Alexis Cukier, « Capitalisme, vie et mort à l’heure du coronavirus », Contretemps, 29 mars 2020 (tiré d’une vidéo en ligne, chaîne « Philosopher en temps d’épidémie »). Collectif, « Face à la pandémie, retournons la ‘stratégie du choc’ en déferlante de solidarité », Contretemps, 21 mars 2020. [s.a.] « To our friends all over the world from the eye of Covid-19 storm » [éditorial], DINAMOPress, 14 mars 2020. David Harvey, « Anti-Capitalist Politics in the Time of COVID-19 », Davidharvey.org, 22 mars 2020 (une traduction française d’une autre version de ce texte sera prochainement disponible sur Contretemps). Naomi Klein, « Coronavirus capitalism – and how to beat it », The Intercept, 16 mars 2020. Aurore Koechlin, « Crise du Covid-19 : donner la priorité à la reproduction sur la production », Contretemps, 18 mars 2020. LKP, « Communiqué du LKP sur le Coronavirus en Guadeloupe : Assassins – Criminels ! », Fondation-frantzfanon.com, 19 mars 2020. Frédéric Lordon, « Les connards qui nous gouvernent », La pompe à phynance, 19 mars 2020. [s.a.] « Monologue du virus », Lundi Matin, 21 mars 2020. Jean-Luc Nancy, « Communovirus », Libération, 21 mars 2020. Daniel Tanuro, « L’avertissement du virus », Contretemps, 23 mars 2020.
[2] Une contribution particulièrement stimulante à la réflexion sur les thèmes de ce paragraphe est : Andreas Malm, « Revolutionary Strategy in a Warming World », Climate and Capitalism, 17 mars 2018. Ce texte est paru en français comme dernier chapitre de l’ouvrage : Andreas Malm, L’anthropocène contre l’histoire. Le réchauffement climatique à l’ère du capital, Paris, La Fabrique, 2018.









