
Vaincre Macron… tout seul ? Sur le dernier livre de Bernard Friot
Nous publions une série d’articles sur le dernier livre de Bernard Friot, Vaincre Macron (La Dispute, 2017), auxquels l’auteur répondra ensuite. C’est ici Benoît Borrits, journaliste, co-fondateur et animateur de l’Association Autogestion, qui propose une lecture critique du livre.
On pourra relire l’article de Jean-Marie Harribey et celui de Michel Husson, ainsi qu’un extrait du livre de Bernard Friot.
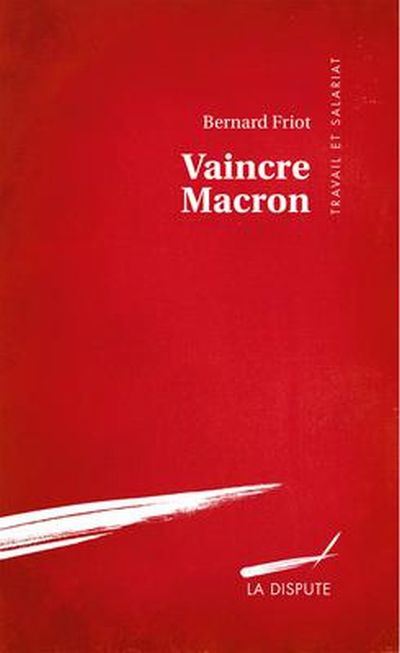
Vaincre Macron est le dernier livre de Bernard Friot. Il y redéveloppe nombre des théories élaborées dans ces livres précédents autour de l’objectif d’actualité énoncé dans le titre. Comme nous le verrons, ces théories ne sont opérationnelles qu’en admettant le postulat de la bonté de l’être humain. Basées sur des affirmations discutables qui ne pourront jamais faire consensus dans la classe salariée, on voit difficilement en quoi ce livre constitue un outil pour Vaincre Macron.
Vaincre Macron : tel est la promesse du dernier livre de Bernard Friot, promesse qui semble particulièrement opportune au moment où celui-ci pousse méthodiquement, et jusqu’à présent avec succès, ses « réformes » les unes après les autres. Nous connaissions Bernard Friot par ses précédents livres sur le concept de salaire à vie. Nous nous rappelons de son succès en librairie sur L’enjeu des retraites au moment de la réforme Fillon en 2010. Il défendait alors l’idée qu’on ne pouvait gagner contre cette réforme que si on considérait la retraite comme un salaire continué et non comme une compensation de contributions passées. Il poursuit aujourd’hui en généralisant son propos bien au-delà de la simple retraite mais en reconsidérant le salaire à vie, la co-propriété d’usage et la subvention de l’investissement comme alternatives aux « réformes » de Macron.
Au menu, deux thèses qui décoiffent
Deux thèses centrales sont développées dès le premier chapitre de son ouvrage. La première porte sur les avancées sociales contenues dans l’apparition du contrat de travail et du salaire au XXe siècle. Il s’agirait, selon lui, de changements majeurs qui en font des « institutions anticapitalistes ». Dans le passé et conformément au Capital de Marx, les travailleurs étaient payés au prix de leur force de travail, « c’est-à-dire à la mesure de leurs besoins pour qu’ils soient aujourd’hui et demain à leur poste. » Selon les trois modalités de contrat qu’il détaille, « les travailleurs sont déniés comme producteurs et considérés comme des êtres de besoin, des mineurs économiques n’ayant droit qu’à du pouvoir d’achat. » Selon Bernard Friot, « lorsque le contrat de travail remplace le contrat de louage d’ouvrage, on assiste aux prémisses d’une institution anticapitaliste du travail. Anticapitaliste au sens où elle rend possible, dans des droits qui s’imposent à des employeurs, la reconnaissance des travailleurs comme contributeurs à la production de valeur économique et donc comme légitime à revendiquer d’en avoir la maîtrise en contradiction avec le monopole de la bourgeoisie. » Bernard Friot assène ici une opinion qu’il nous présente comme une vérité. Que l’apparition du contrat de travail, de la qualification qui apparaît dans les premières conventions collectives de 1919, représentent des conquêtes de la classe ouvrière ou salariée, voilà qui ne fait absolument aucun doute pour qui que ce soit. Que celles-ci représentent « la reconnaissance des travailleurs comme […] légitime à revendiquer d’en avoir la maîtrise en contradiction avec le monopole de la bourgeoisie », voilà qui est une thèse pour le moins osée. La subordination est le principe même du contrat de travail : le salarié est assuré de toucher un salaire et en contrepartie, celui-ci s’engage pendant la durée de son temps de travail à exécuter les ordres de la direction nommée par les propriétaires. Enfreindre ce principe équivaut pour le salarié à la possibilité de se voir licencié et cette décision sera validée par les tribunaux prud’homaux comme « cause réelle et sérieuse ». Le principe même du contrat de travail est la signature entre un employeur et un individu. Il est entendu que l’individu, salarié, n’est embauché que parce que l’employeur le souhaite, que cet employeur est libre de son choix et qu’il peut le licencier à tout moment, moyennant indemnisation. Même si le contrat de travail reconnaît la qualification, les propriétaires des moyens de production restent maîtres de leur décision quant à employer ou ne pas employer et il faut quand même un esprit assez imaginatif pour y voir les prémisses d’une « révolution communiste du travail ».
La seconde concerne le fait que la lutte ne porte pas sur la question de la répartition de la valeur ajoutée : « Ce qui est enjeu, ce n’est pas la répartition de la valeur, ce qui appellerait comme réponse la lutte pour la sécurité des travailleurs et contre l’austérité, terrain qui a été malheureusement choisi par les opposants aux réformes. Mais c’est la production de la valeur, et la réponse à la réforme doit être dans l’extension de la pratique communiste du travail. » Cette approche est pour le moins surprenante. Ce qui fait la finalité du capital est sa valorisation et celle-ci ne peut se faire que par versements de dividendes. La répartition de la valeur ajoutée est donc un enjeu fondamental de la lutte des classes. Si les conditions d’exploitation deviennent plus favorables au salariat, les valorisations des entreprises diminueront et inversement. De ce point de vue, on ne peut impunément dévaloriser les entreprises en laissant les propriétaires aux commandes : le risque est fort qu’ils s’abstiennent d’investir comme réponse à cette nouvelle donne. De ce point de vue, la question de l’expropriation des actionnaires est alors à l’ordre du jour. Celle-ci est aussi à l’ordre du jour chez Bernard Friot et elle l’est parce que les mesures qu’il préconise aboutissent à une hausse de la part des salaires dans la valeur ajoutée réduisant à néant la valeur des entreprises. Pour autant, il existe de multiples façons d’augmenter cette part des salaires et le scénario de Bernard Friot n’en est qu’un… parmi de nombreux autres.
Des approximations qui cherchent à s’imposer comme vérités révélées
On se souvient de la thèse principale de L’enjeu des retraites. Le mouvement social a été défait parce qu’il n’aurait pas su saisir l’enjeu de la bataille. Selon Bernard Friot, pour gagner, il fallait se persuader que la retraite était un salaire continué. Alors que pour tout le monde ou presque, la retraite par répartition exprime la solidarité intergénérationnelle, voilà que désormais la retraite, rebaptisée « salaire », serait la contrepartie du travail que réalisent les retraités, prenant comme exemple le fait que ceux-ci sont actifs dans les associations ou s’occupent des petits enfants. De ce point de vue, il défend un niveau de retraite correspondant au meilleur salaire qui représenterait la reconnaissance par la société de sa qualification et donc de la valeur qu’il apporte par sa simple existence. Loin de nous l’idée que les retraités ne produiraient pas de valeur par du travail concret. Il n’en reste pas moins que la retraite n’est pas un salaire et chaque retraité le sait bien puisqu’il est dorénavant totalement libre de faire ce qu’il veut : il peut choisir de donner son temps pour la collectivité ou de le passer à regarder la télévision. Poursuivons cette logique de la pension comme rémunération du travail concret qu’il fournit de par sa qualification. Comment peut-on soutenir qu’un retraité dépendant et en fin de vie soit producteur de valeur ? Dans la réalité, il est, à son corps défendant, une charge pour la société au sens où des personnes doivent donner du temps pour s’en occuper, que ce soit dans un cadre salarial ou familial. Est-ce à dire que le salaire continué doit alors être remis en cause puisqu’il ne produit plus de valeur ? Nous laisserons Bernard Friot répondre à cette question dont l’absurdité est la conséquence même de la théorie du salaire continué. La retraite n’est pas un salaire et relève de la solidarité intergénérationnelle. La raison pour laquelle nous n’avons pas gagné contre les « réformes » libérales des retraites est beaucoup plus simple : nous n’avons pas su imposer l’idée d’un équilibre des retraites à la charge du patronat.
Cette logique de retraite vue comme un salaire continué l’a amené à définir le salaire à vie et la notion de grade. Selon lui, la fonction publique, dans laquelle les salaires sont déterminés par des grades attribués à la personne, est l’horizon vers lequel tendrait le salariat dans son ensemble qu’il travaille ou non dans le secteur marchand. C’est ainsi que, dans son projet, tout citoyen doit se voir attribuer un salaire à sa majorité – qu’il estime à 1500 euros nets – lequel est irrévocable. Comme pour le retraité, ce salaire est censé représenter sa contribution de producteur et chaque citoyen-ne a la liberté totale de passer un contrat de travail avec une entreprise ou de vaquer à ses propres occupations. Il pourra ensuite monter en grade – ces grades étant attribués par des commissions de citoyen-nes – pouvant donner droit à des salaires jusqu’à un maximum de 6000 euros nets. Ces grades sont irrévocables et attribués à vie, quel que sera le parcours professionnel ultérieur du bénéficiaire. Ce salaire à vie devient alors l’unique source de revenu, les revenus financiers étant prohibés – ce que nous ne saurions qu’approuver – ainsi que toute forme de rémunération attachée à l’occupation d’un poste particulier. Les syndicats qui ont combattu dans le passé pour obtenir des primes de pénibilité n’ont plus qu’à bien se tenir…
Il s’agit ici d’une proposition politique dont nous discuterons plus loin la cohérence. Pour valider celle-ci, Bernard Friot se permet une approximation hasardeuse qui consiste à dire que ce salaire à vie existe déjà, qu’il s’agit d’un « déjà-là » dont il convient de s’inspirer : « si l’on ajoute aux 5,5 millions de fonctionnaires la moitié des retraités qui ont une pension proche de leur salaire (soit environ sept millions), les libéraux de santé, les salariés à statut et ceux des branches avec droit à carrière, c’est environ dix-sept millions de personnes, le tiers des plus de 18 ans, qui ont aujourd’hui, peu ou prou, un salaire à vie, fondé sur une qualification personnelle. » Outre la requalification abusive des pensions de retraite en salaires que nous avons précédemment soulignée, les fonctionnaires et libéraux de santé seront sans doute étonnés d’apprendre qu’ils relèvent « peu ou prou » du « salaire à vie, fondé sur une qualification personnelle ». Si un fonctionnaire dispose d’une rémunération en fonction de son grade, elle est aussi fonction de son temps de travail comme en témoigne la présence de mi-temps dans la fonction publique qui sont rémunérés… moitié moins. De même, tout fonctionnaire sait parfaitement que s’il ne se présente pas au travail lorsqu’il est attendu, son « salaire » risque bien de ne pas être « à vie ». Enfin, assimiler la rémunération de travailleurs payés à l’acte à du salaire à vie – dans la mesure où il est « assuré de patientèle dès l’ouverture de son cabinet et jusqu’à la fin de son exercice » – ne peut que nous laisser rêveur de la soudaine remise en cause du concept de salaire à vie que cet amalgame contient… puisqu’ils sont rémunérés à l’acte. En tout état de cause, prétendre qu’un tiers de la population majeure est entrée dans le salaire à vie relève de la supercherie. La réalité est toute autre : en dépit des dénégations de son concepteur, le premier niveau du salaire à vie constitue, ni plus ni moins, un revenu de base et à ce jour, le revenu de base comme le salaire à vie n’existent pas en France.
La référence à Ambroise Croizat pour justifier le projet du salaire à vie est lui aussi sujet à discussion. Vouloir étendre certains principes de gestion de la sécurité sociale à l’ensemble de l’économie n’était pas vraiment dans la feuille de route de ses concepteurs. Pire, Bernard Friot lui-même nous montre combien Ambroise Croizat était éloigné du concept de salaire à vie : « On l’a vu, Ambroise Croizat augmente fortement les allocations familiales pour contourner l’interdiction de hausse des salaires. […] Ainsi en 1946, le salaire d’une famille de trois enfants (la moyenne des familles populaires) est, pour plus de la moitié, fait des allocations familiales, et donc déconnecté de l’emploi. Ce salaire socialisé reconnaît ainsi comme travail productif l’éducation des enfants par leurs parents, qui pour produire de la valeur se passent d’employeurs et d’actionnaires. » Il ne fait de doute pour personne que l’éducation des enfants est reconnue comme travail productif. Par contre, ce que ne souligne pas ici Bernard Friot est le fait que cette valeur non marchande n’est pas rémunérée par un salaire à vie mais par des allocations distribuées non pas en fonction d’une hypothétique qualification d’éducation des enfants mais tout simplement en fonction du nombre d’enfants à charge et que celles-ci disparaissent une fois que les enfants ont atteint leur vingt ans.
Cet exemple nous montre que contrairement à ce qu’il affirme à longueur de pages, la qualification n’est pas une valeur mais c’est l’usage qu’on fait de celle-ci qui est créatrice de valeur, usage qui doit être validé socialement par le marché ou l’évaluation démocratique. Dans la meilleure société future, il est peu probable qu’on paye les individus pour leur seule qualification mais en essayant de valoriser leur travail concret dans lequel la qualification pourra être un paramètre au même titre que la pénibilité ou d’autres encore…
Une construction pour le moins baroque
Ce livre réaffirme ce qui avait déjà été esquissé dans L’enjeu du Salaire et Émanciper le travail : la subvention des investissements des entreprises de l’économie marchande. Des caisses d’investissement composées de citoyennes et citoyens décideront, en fonction des demandes des entreprises, à qui elles accorderont les équipements de longue durée. Il justifie ce choix par le fait qu’avec la gestion des caisses de sécurité sociale, les salariés ont montré qu’ils ont été capables de financer des hôpitaux, du matériel médical dans une logique de subvention. Sauf que l’on parle ici d’un secteur non marchand : dans un service public et gratuit, il ne saurait y avoir de paiement de la part des patients et donc de retour sur investissement en terme de flux de trésorerie. De fait, tout doit être subventionné, aussi bien les investissements que les achats ou les salaires. Pourquoi, dès lors, vouloir appliquer cette logique de subvention des investissements dans le secteur marchand, c’est à dire un secteur dans lequel les produits et services ne sont pas distribués gratuitement mais contre rémunération ?
Lorsqu’une unité de production dispose d’un équipement de longue durée (un machine, une chaîne de production…), elle va pouvoir augmenter sa production en conséquence. Dans le cadre de l’économie marchande, elle va générer des ventes supplémentaires. Si cet investissement a été fait à bon escient, elle est donc tout à fait en mesure de le rembourser dans le temps. Pourquoi donc l’entreprise à la mode Friot devrait-elle acheter ses intrants de production de courte durée et se voir subventionner ceux qui sont de longue durée ? Il n’y a aucune différence de nature entre les deux : les deux sont des valeurs qui concourent à la constitution d’autres valeurs qui seront vendues. La justification de ce parti pris est surprenante : « l’endettement pour pouvoir travailler (y compris vis-à-vis d’opérateurs publics en cas de prêts à l’investissement par des banques publiques) est une entrave à la liberté et à l’égalité en droits économiques des personnes aussi grave que la soumission de la rémunération aux aléas du marché du travail ou des biens et services. » On se demande bien pourquoi puisque l’opération de remboursement d’un investissement en économie marchande est la simple contrepartie de l’avantage dont a bénéficié l’entreprise. De là, à considérer que cela constitue « une entrave à la liberté et l’égalité en droits économiques des personnes » alors que le salaire est justement garanti, comprenne qui pourra.
Que l’octroi d’un investissement constitue un avantage économique pour l’unité de production n’a évidemment pas échappé à Bernard Friot qui s’est lancé dans une fastidieuse démonstration (page 112 et 113) comme quoi ces investissements, s’ils sont judicieux, rapporteront en retour des flux de trésorerie pour les caisses d’investissements. Évident. Mais alors pourquoi ne pas demander de remboursements aux entreprises qui ont bénéficié des investissements ? On peut, comme Bernard Friot, être opposé à la propriété lucrative. Mais cela n’interdit pas d’envisager de fonctionner par prêts avec remboursements accordés par des structures socialisées. Et si d’aventure, ces remboursements étaient accompagnés de taux d’intérêt qui, dans un système financier socialisé, pourraient aussi bien être positifs (pour réduire les demandes) que négatifs (pour inciter en subventionnant partiellement), ces taux d’intérêt n’enrichiraient personne. Mais cela ne semble pas effleurer Bernard Friot. Par contre, demander le remboursement des investissements a l’immense avantage de mettre en évidence un problème économique qui peut éventuellement résulter d’une mauvaise codécision de l’entreprise et de la caisse d’investissements. Mais Bernard Friot n’aime décidément pas se confronter aux réalités : si on a froid, mieux vaut casser le thermomètre…
Il applique aux investissements la même logique que celle qui a présidé aux paiement des salaires : ceux-ci ne sont plus payés par l’entreprise mais par une caisse qui est alimentée par les cotisations des entreprises. Nous ne pouvons qu’être d’accord avec Bernard Friot sur une nécessaire déconnexion entre la rémunération et la valeur ajoutée produite par l’unité de production si celle-ci est marchande. De ce point de vue, des solutions existent comme celle de la péréquation de la richesse disponible (www.perequation.org) qui permet des déconnexions variables allant de 0 à 100 %. Si le pourcentage de péréquation est de 40 % par exemple, alors 40 % de la rémunération est déterminée hors marché (système d’allocation unique par personne ou grades) grâce à un prélèvement sur la valeur ajoutée des entreprises, les 60 % restants servent à rémunérer les travailleurs de l’entreprise. Ce pourcentage est le résultat d’une délibération politique sur la force du lien entre les rémunérations et le comportement économique de l’unité de production, débat on ne peut plus légitime après expropriation des actionnaires.
C’est bien sûr le droit de Bernard Friot de préconiser une déconnexion totale des rémunérations des travailleurs avec la valeur ajoutée de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. Dès lors, une question évidente se pose : comment les prix pourront-ils se former ? Il ne s’agit pas d’une question annexe mais d’une question essentielle pour ce projet de société. Les citoyennes et citoyens perçoivent toutes et tous des salaires inconditionnels qui vont être dépensés dans les marchandises produites par ces mêmes salarié-es. Mais comme les salariés sont rémunérés de façon totalement indépendante de la valeur ajoutée produite par leur unité de production, quel est leur intérêt de produire de la valeur ajoutée ? Afin de favoriser la diffusion de leurs produits, pourquoi ne se contenteraient-ils pas de vendre au simple prix des intrants de production, mais dans un tel cas, aucune valeur ajoutée ne sera monétairement réalisée ? Cette tendance sera encore plus renforcée si les investissements sont subventionnés et non remboursés. À quoi bon intégrer dans le prix de vente l’amortissement d’une chaîne de production, par exemple ? Mais dans ce cas, si les unités de production ne réalisent aucune valeur ajoutée monétaire, comment générer les cotisations servant à payer les salaires et les investissements ? Ce problème n’avait pas échappé à Patrick Zech qui interviewait Bernard Friot dans son livre Émanciper le travail. Sa réponse était époustouflante : « Supposons, par exemple, qu’aujourd’hui la valeur ajoutée représente en moyenne 20 % du chiffre d’affaires dans l’ensemble des entreprises. [Notons que la valeur ajoutée brute des Sociétés non financières tourne plutôt autour des 40 %] On pourrait décider que tout prix soit la multiplication par 1,25 des consommations intermédiaires, ce qui générerait à l’échelle nationale la valeur ajoutée suffisante sans retour à la formation microéconomique des prix. » Ne va-t-il pas y avoir des distorsions folles entre des secteurs d’activité historiquement à faible valeur ajoutée et ceux à forte valeur ajoutée ? On peut vouloir s’affranchir dans un livre de la « formation microéconomique des prix », il n’en reste pas moins vrai que les prix devront toujours correspondre à ce que les consommateurs sont prêts à payer. Le pire est qu’en séparant artificiellement les actifs de court terme des investissements, les premiers devant s’acheter alors que les seconds sont subventionnés, on réduit encore plus la base sur laquelle établir un prix et on aggrave le problème. Une telle solution administrative est la porte ouverte à toutes les dérives, ce que pressent Bernard Friot lorsqu’il ajoute « Cette réponse n’épuise pas la question, pas plus que bien d’autres : la pratique salariale de la valeur ouvre des questions qu’il faudra résoudre en marchant. » Sauf qu’on ne peut prétendre vaincre Macron en laissant béante une telle question. La solution est pourtant simple : reconnecter partiellement les rémunérations des salariés au comportement de leur unité de production. Mais cela, Bernard Friot s’y refuse… sans trouver de solution alternative. Son dernier livre ne réaborde pas cette question pour le moins gênante.
Une approche théologique
Le thème de la libération des individus des aléas de l’entreprise est récurrent chez Bernard Friot : « L’intervention effective des travailleurs dans leur entreprise suppose qu’ils puissent le faire sans crainte pour leur salaire puisqu’ils en sont les titulaires, sans qu’il soit possible d’invoquer les difficultés de leur entreprise pour les faire taire par le chantage ; la liberté au travail des indépendants suppose que leur salaire ne dépendent pas des aléas de marchés sur lesquels ils n’ont aucune prise ; la dynamique et les choix de l’entreprise ne doivent pas être entravés par l’obsession de rentrer assez d’argent pour payer le personnel. » En deux mots, les individus ne sont jamais comptables de ce qu’ils font et les marchés sont les uniques responsables d’une entreprise qui ne marcherait pas. Il faut donc dégager les salariés de ce souci consistant à faire rentrer de l’argent… pourtant bien utile pour générer les cotisations servant à payer les salaires.
Cela présuppose que l’individu est fondamentalement bon à l’égard de la communauté, qu’il n’y ait jamais aucune rancœur des uns contre les autres qui démotiverait qui que ce soit. Bref une société merveilleuse. Comment Bernard Friot fait-il pour s’appuyer sur une telle hypothèse ? La réponse nous est donnée dans une réunion publique à laquelle il a participé en novembre 2003 et qui a été retranscrite par le site Autisme-economie.org[1] : « Je voudrais préciser au départ que ma formation initiale est théologique. J’avais l’intention d’être prêtre. Et ça n’est pas tout à fait anecdotique dans mon travail : le fait d’être catholique – et d’être toujours catholique pratiquant – introduit un certain optimisme, puisque dans cette optique, “ le monde est bon ”. C’est très différent de la tradition calviniste, où il y a au contraire une rupture entre dieu et l’homme. Dans la tradition catholique d’avant la Réforme calviniste (qui marque une vraie rupture, contrairement à la réforme luthérienne), le fait que “en Jésus, Dieu et l’homme soient Un”, etc., introduit une vision optimiste de l’humanité et de son devenir. Et il s’agit d’un optimisme très concret : là encore, au contraire de la Réforme calviniste, qui a brouillé le message chrétien, la tradition chrétienne pose un verre de vin comme “le sang du Christ”. C’est-à-dire que la théologie sacramentaire pose bien la dimension d’infini et de divinité qu’il y a dans l’humanité même. C’est, je crois, une dimension de postulat de mon existence qui est importante, parce qu’il faut reconnaître que tout ce je raconte suppose un peuple vertueux. » Tout s’éclaircit désormais : le projet de Bernard Friot repose sur un « postulat » qui suppose un « peuple vertueux ». Il n’est, bien sûr, pas question de dénigrer la foi de Bernard Friot qui est parfaitement légitime. Mais, à l’inverse, nous avons parfaitement le droit de ne pas partager cette foi et la perspective émancipatrice de Bernard Friot est alors inopérante. L’émancipation ne passe pas obligatoirement par ce postulat de la bonté naturelle de l’être humain et il est donc nécessaire de l’envisager d’une façon largement plus ouverte que celle de la théorie du salaire à vie.
Nous noterons cependant que, dans son dernier livre, la foi de Bernard Friot semble aujourd’hui s’émousser : « Le salaire pourra progresser, […] mais il ne pourra être ni être suspendu ou supprimé, ni baisser. Ou s’il venait à baisser, du fait […] d’une insuffisante production de valeur à l’échelle macroéconomique, il baisserait dans la même proportion pour tous. » Il s’agit ici d’une remise en cause majeure du salaire à vie qui n’avait jamais été esquissée dans ses livres précédents. Cela traduit sans doute enfin un certain réalisme de sa part qui consiste à dire que les salaires sont déterminés non plus par des grades – car, contrairement à ce qu’il défendait dans L’enjeu du salaire, un grade n’a jamais produit une quelconque valeur en soi – mais par une valeur ajoutée produite. Et si cette valeur ajoutée baisse, ce que Bernard Friot conçoit désormais, cela remet alors en cause le salaire à vie et cette notion de valeur établie par la qualification. Tout l’édifice théorique du projet de salaire à vie s’effondre dans cette phrase.
Vaincre Macron… dans l’unité
En accord avec Bernard Friot, nous ferons le constat que, depuis quelques décennies, la gauche « radicale » s’est montrée extrêmement frileuse dans ses propositions, se contentant généralement de préconiser une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre capital et travail.
Là où le bât blesse est qu’on ne peut pas dire que cette politique ait jusqu’à présent fait recette. Si cette politique était possible sans remise en cause du capitalisme, pourquoi la gauche gouvernementale ne s’y serait-elle pas engagée ? Répondre par la simple traîtrise de la social-démocratie est une explication un peu courte. Qu’est-ce qui nous dit que la gauche « radicale » au pouvoir ne plierait pas non plus face aux exigences d’un patronat qui continuerait de détenir le pouvoir économique ? Les programmes de la gauche radicale sont devenus amnésiques sur l’expropriation des actionnaires, amnésie d’autant plus entretenue que le keynésianisme est devenu le logiciel le plus structurant de cette gauche.
Face à Macron, la seule alternative structurante est celle d’une gauche unifiée dans sa diversité. La gauche ne peut plus et ne doit plus se structurer autour d’une politique plus ou moins offensive sur le terrain de la relance keynésienne. Nous avons vu combien cela a été un ferment de division entre la gauche de Benoît Hamon pour qui la rupture avec l’Union européenne était une ligne rouge à ne pas franchir alors que les partisans de Jean-Luc Mélenchon envisageaient clairement un plan B de sortie de l’euro. L’opposition au capital ne se situe pas sur ce terrain qui relève d’un débat d’économistes, mais sur la part que nous allons reprendre dans le partage de la valeur ajoutée car, n’en déplaise à Bernard Friot, c’est sur ce terrain que se joue la lutte des classes et le patronat n’entend pas que soient remis en cause ses profits d’aujourd’hui.
À partir de là, les opinions divergent entre ceux qui estiment qu’une baisse des profits peut constituer une étape intermédiaire dans laquelle les actionnaires continueront d’investir et ceux qui estiment au contraire que cette situation sera tellement conflictuelle qu’elle posera la question de l’expropriation des actionnaires. L’expropriation des actionnaires n’est pas le résultat d’une décision administrative mais de l’action consciente des salariés qui, dans chaque cas de figure, estimeront s’il faut le faire ou pas. Une gauche unie sur la base de l’augmentation de la part des salaires dans la valeur ajoutée devra donc donner les outils juridiques permettant, là où c’est possible et souhaitable, d’exproprier les actionnaires.
Comme nous l’avons vu, les propositions de Bernard Friot s’inscrivent dans une perspective d’expropriation des actionnaires. Ces propositions touchent des éléments fondamentaux d’une socialisation à venir de l’économie, à savoir la socialisation du revenu et la socialisation de l’investissement. Mais ses propositions ne sont qu’une parmi une multiplicité de solutions.
Comment va-t-on répartir le revenu des unités de production ? Quel niveau de lien entre le revenu des individus et la valeur ajoutée des unités de production ? Comment allons-nous distribuer l’investissement ? Toutes ces questions doivent faire l’objet de débats démocratiques et il est plus que probable que le résultat soit différent des préconisations de Bernard Friot tant celles-ci ne sont opérationnelles que si on croit en la bonté naturelle de l’être humain. Dès lors, Bernard Friot doit répondre à une question essentielle : est-ce que ses propositions sont les seules possibles pour avancer vers l’expropriation des actionnaires ou reconnaît-il une pluralité de chemins vers cet objectif ?
Pour le dire plus clairement, va-t-il continuer à affirmer que ses options sur la retraite comme salaire continué, sur la valeur par la qualification ou la subvention de l’investissement sont les seules qui combattent réellement la bourgeoisie ? Si tel est le cas, il n’aura alors aucune chance d’unir la classe salariée dans sa lutte contre Macron. À l’inverse, ses propositions auront alors toute leur place dans le nécessaire débat démocratique sur les modalités d’une socialisation résultant de l’expropriation des actionnaires.
Notes
[1] http://www.autisme-economie.org/article57.html
Fresque : Pichi & Avo









