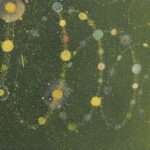Lutter contre le viol par des peines de prison… ou par d’autres formes de lutte ? Le procès du Mans en 1978
Autrice d’un mémoire intitulé Lutter contre le viol en reprenant la rue : les marches féministes de nuit dans la seconde moitié des années 1970, Marie Godo revient sur le procès du Mans de janvier 1978 pour offrir un éclairage historique au procès dit « des viols de Mazan » et notamment sur la façon dont les peines de prison, et plus globalement des approches faisant de la répression d’État la pierre angulaire de la lutte contre les VSS, étaient alors contestées par les féministes.
*
« Porter le débat sur la place publique, là où l’agression est quotidiennement subie : dans la rue ».
Action féministe contre le viol à Toulouse. Rouge, 15 février 1978.
L’affaire des viols de Mazan agite aujourd’hui la société française en jetant une lumière crue sur le viol comme crime systémique contre les femmes. En 1978, dans le sillage de l’historique procès d’Aix contre le viol dans lequel plaide Gisèle Halimi, un autre procès, celui du Mans, a aussi un fort retentissement, et permet alors aux féministes et à la gauche radicale de contester les peines répressives pour proposer d’autres formes de lutte alternatives contre le viol. Retour au Mans en 1978…
Le 25 janvier 1978, au tribunal du Mans, le verdict tombe : André Pasquier est condamné à 5 années de réclusion pour avoir violé trois jeunes femmes qui faisaient du stop et avaient accepté de monter dans son camion. Stupeur et cris dans la salle : les féministes qui se sont mobilisées pendant des mois pour soutenir les trois jeunes femmes, et qui sont venues très nombreuses assister au procès, s’indignent de cette condamnation, et interpellent le président par des « Libérez Pasquier », « la prison n’est pas une solution[1] », qui provoquent un « étonnement […] indicible sur le visage des jurés[2] ».
Ce procès semble donc s’inscrire dans un contexte de lutte qui est aux antipodes de la façon dont une grande partie de la société juge aujourd’hui les affaires de viol. En effet, si le procès dit des viols de Mazan a fait de nouveau apparaitre l’ampleur systémique des violences sexuelles et la façon dont les victimes continuent à faire face au déni des violeurs, il est probable qu’une certaine prise de conscience actuelle de la société se traduira par la condamnation des violeurs à des peines de prison alourdies, et que de nombreuses personnes s’en féliciteront. Cela apparaitra comme un progrès, la reconnaissance d’un crime enfin puni à la hauteur de sa gravité.
Retracer la façon dont de nombreuses féministes se sont battues dans les années 1970 pour inscrire la lutte contre le viol dans une autre perspective que celle de la répression pénale peut permettre de travailler nos analyses dans une direction bien différente de celle du tout répressif et du tout carcéral dont les gouvernements font aujourd’hui la seule base de leur politique.
Une intense mobilisation des mouvements féministes contre le viol dans la seconde moitié des années 1970
Le procès du Mans est emblématique de l’intense mobilisation des mouvements féministes qui, après le vote de la loi Veil en 1975, se recentrent dans la seconde moitié des années 1970 sur la lutte contre les violences faites aux femmes, que ce soit les agressions de rue, le viol, la violence conjugale.
Cette lutte est peu connue, et pourtant une large réflexion fait alors déjà émerger ces violences comme le résultat d’une oppression systémique des femmes. Le viol est pensé, non plus comme une déviance, une aliénation parmi d’autres, mais comme un élément central de la domination patriarcale sur les femmes. Les violences contre les femmes sont désormais analysées dans leur globalité comme un continuum de violences de genre qu’il s’agit d’analyser pour les combattre.
De nombreux événements sont organisés comme la tenue à Bruxelles d’un Tribunal international des crimes contre les femmes en mars 1976, et la journée des « Dix heures contre le viol » à la Mutualité le 26 juin 1976.
Recourir au procès pour en faire une tribune politique contre le viol
Dans ce processus qui fait de la lutte contre le viol un élément désormais central des mobilisations féministes, la question du recours à la justice pénale devient l’un des principaux sujets de questionnement parmi ces mouvements et parmi la gauche en général. Une grande diversité de positions s’exprime, dont la presse et de nombreux documents de l’époque se font le reflet[3].
Ce débat oscille entre la nécessité, d’une part, de lutter contre l’impunité du viol, et la volonté, d’autre part, de ne pas cautionner un système carcéral considéré comme un moyen d’oppression de classe, que le système capitaliste utilise contre les plus faibles, en punissant les violeurs marginaux, pauvres et/ou immigrés bien davantage que ceux issus de la bourgeoisie[4].
Dans ce contexte, les mouvements féministes s’accordent à minima sur la nécessité de recourir à des procédures judiciaires comme tribune d’expression publique contre le viol. Comme aujourd’hui pour le procès des viols de Mazan, leur mobilisation vise à obtenir que le huis clos soit levé afin que les audiences soient publiques et que les témoignages des femmes victimes de viol puissent être entendus par la société et servir de base de réflexion et d’action pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes. C’est ce qui amène Gisèle Halimi lors du procès d’Aix en mai 1978 à vouloir convoquer au tribunal des personnalités de premier plan pour que ce procès devienne un lieu de réflexion sur l’ampleur du viol dans la société, sur ses causes, et sur les mesures qui seraient nécessaires pour endiguer ce fléau.
C’est aussi dans ce but que les féministes ont déjà lutté quelques mois plus tôt pour que le procès d’André Pasquier ait lieu au Mans en audience publique et non à huis clos. Pendant quatre mois elles ont organisé dans les Pays de la Loire comme dans toute la Bretagne, de nombreux événements pour aider les trois jeunes femmes à témoigner et à se défendre tout au long de l’enquête. Elles ont cherché à mobiliser la population, et à faire prendre conscience à la société que le viol est un crime dont les racines sont multiples. Manifestations, soirées débats, affichages, marches de nuit, se sont succédé, mobilisant des milliers de femmes dans de nombreuses villes.
Ne pas collaborer avec une justice de classe
Mais, si Gisèle Halimi fait le choix de réclamer des peines de prison exemplaires, considérant que la société n’est pas encore prête à se remettre en cause et que le recours à une justice répressive reste donc « pathétiquement nécessaire[5] », les mouvements féministes plus radicaux sont eux traversés par de vifs débats au sujet du recours à la répression pénale du viol. La presse nationale relaie aussi assez largement ce débat[6]. La répression pénale du viol est-elle efficace ? L’enfermement peut-il être éducatif ? Quels autres moyens d’action existent-ils pour lutter contre le viol ?
Le journal Rouge (de la Ligue communiste révolutionnaire) relaie ainsi très largement les paradoxes de ces débats :
« comment peut-on éviter de renforcer l’appareil répressif de la bourgeoisie en aidant les femmes à se protéger par tous les moyens y compris ceux de la justice bourgeoise, contre le viol et les violences dont elles sont victimes ?[7] ».
C’est donc dans ce cadre que de nombreuses féministes prennent le parti de refuser de cautionner des peines de prison répressives contre les violeurs et de refuser ainsi de collaborer avec un système judiciaire jugé bourgeois et raciste[8]. Le procès du Mans, qui voit les féministes s’opposer à des peines de prison pour le violeur, est donc emblématique de la position qui consiste à s’exprimer publiquement et massivement contre le viol, tout en refusant sa pénalisation.
Le but des femmes qui se mobilisent alors n’est pas d’obtenir une condamnation, mais de chercher à « poser le viol de manière globale », pour ne pas « en faire porter le poids sur l’accusé[9] ». Pour lutter contre le viol, sans toutefois cautionner la justice répressive, la voie qu’elles adoptent semble être celle qui apparait fréquente parmi les mouvements de femmes dans les années 1970 : utiliser la justice comme tribune, mais
« il ne s’agit pas pour nous d’individualiser, d’en faire le problème d’un seul homme qui devrait payer pour son délit, mais de dénoncer globalement l’aliénation, l’oppression que subissent les femmes[10] ».
Pour ces féministes, la répression n’est pas souhaitable, ou ne peut s’envisager seule. En effet les procédures judiciaires sont jugées trop pénalisantes pour les femmes victimes, et la prison leur semble inefficace pour faire changer les violeurs de comportement. Et surtout la répression pénale combat des effets sans s’attaquer aux causes.
Car, pour ces femmes, si le viol est présenté par certains hommes comme le résultat d’une « misère sexuelle », c’est donc toute la société capitaliste, porteuse d’aliénation, qu’il faut renverser. Et si le viol est un effet de la domination masculine, si « tout homme est un violeur en puissance[11]», en punir quelques-uns n’a pas d’efficacité, et c’est à toute la construction sociale qu’il faut s’attaquer. Pour les franges féministes lesbiennes les plus radicales, c’est même l’hétérosexualité en elle-même qu’il faut remettre en cause[12].
Enfin, défendre la répression risque d’être récupéré par les gouvernements de droite au profit d’une politique répressive contre les immigrés. La fin des années 1970 voit alors en effet ces gouvernements durcir leur politique sécuritaire et anti-immigration, dans le cadre de l’émergence d’un discours autour de la figure de l’Arabe, discours qui traverse alors les grands débats publics, et qui sexualise l’homme arabe, en en faisant un violeur en puissance[13]. Et il est frappant de voir comment, encore récemment, le viol et le meurtre d’une jeune étudiante (Philippine) ont été instrumentalisés par la droite au pouvoir, appuyée sur l’extrême-droite[14].
Les mobilisations autour des marches de nuit, sur lesquelles j’ai particulièrement travaillé, sont alors l’occasion de faire entendre ces positions anti-carcérales : « A bas la justice bourgeoise[15] » entend-on à Paris lors de la marche du 18 octobre 1977. A Angers, le 10 mai 1981, le recours à la police est dénoncé comme étant une privation de la capacité des femmes à s’organiser et à se défendre elles-mêmes. Les femmes mettent alors en avant leur solidarité comme un puissant contre-pouvoir à celui de la police censée les protéger :
« nous ne voulons pas être assignées à domicile ou permettre un déploiement des forces de l’ordre qui serait soi-disant seul capable de nous défendre », elles appellent les femmes à trouver « ensemble leurs moyens de défense en se solidarisant activement avec chaque femme violée[16] ».
Ces positions anti-carcérales s’inscrivent ainsi dans un courant d’analyse encore actuel[17], mais ne sont pas alors générales. Certaines féministes refusent qu’on leur dénie le droit d’obtenir justice par des peines de prison, sous prétexte qu’elles cautionneraient une justice de classe : ainsi, dans un tract qui appelle à soutenir trois femmes violées par un rassemblement boulevard Magenta à Paris, on peut lire ce slogan au dos : « Qu’il soit noir, jaune, bleu blanc rouge, un violeur est un violeur ![18] ».
Les femmes refusent ici qu’ont leur attribue la culpabilité de dénoncer un viol commis par un immigré, sous le prétexte qu’il ne serait pas responsable du système oppressif qui l’a amené à violer. A l’impasse dans laquelle les groupes d’extrême gauche les enferment elles répondent que ces groupes ne refusent pas la délation et la prison quand il s’agit de dénoncer un patron. Mais cette position répressive s’affirme rarement de manière très revendicative et semble plutôt minoritaire parmi les groupes femmes qui s’expriment.
Lutter contre le viol sans recourir à la répression ?
Lors du procès du Mans, les groupes de femmes mobilisés affirment donc haut et fort leur refus de la répression pénale et proposent à la place toute une palette d’autres actions pour lutter contre le viol. Le recours à des peines de sursis ou à des demandes de dommages et intérêts est présenté comme plus éducatif, la publicité des jugements dans les mairies pourrait avoir un effet dissuasif, de meilleures structures judiciaires d’accompagnement des victimes permettraient que de réelles procédures de réparation puissent être mises en œuvre. Enfin elles défendent la nécessité d’une véritable politique d’éducation sexuelle comme le moyen le plus efficace pour endiguer à long terme toutes les violences faites aux femmes.
En parallèle de cette réflexion se créent ainsi des structures associatives pour porter soutien aux victimes de violences : dès 1975 est créée à Paris l’association SOS Femmes Alternatives qui propose une permanence téléphonique, et des lieux d’accueil pour femmes battues comme le centre Flora Tristan qui voit le jour en 1978 à Clichy. Le Collectif féministe contre le viol (CFCV) sera lui crée un peu plus tard, en 1985, à l’initiative de Nathalie Bourdon, Suzy Rojtman et Maya Surduts de la Maison des Femmes de Paris.
Lutter contre le viol par l’action directe ?
Mais pour certaines féministes ces moyens de lutte ne suffisent pas dans l’immédiat, et elles choisissent de mettre en œuvre des formes alternatives de lutte qui puisent dans un répertoire d’actions bien plus directes. Ainsi à Bourges en 1978, les groupes femmes, qui s’inscrivent clairement dans le refus de la répression pénale, cherchent une autre tribune d’expression que le procès qui se tient alors, et se lancent dans une vaste campagne de collage dans les rues, en taguant sur les murs « Ras le viol », « publicité et pornographie, école du viol[19] », et pour dénoncer plus largement « tout ce qui, dans la rue, dans la presse, à la télé, ou au cinéma, est un appel permanent à se servir des femmes comme objets sexuels [et de] mobiliser l’opinion publique contre le viol[20] ».
L’utilisation de l’action directe contre les violeurs en les dénonçant sur les murs des rues est un autre moyen de lutter contre le viol en se faisant justice soi-même. Certaines femmes proposent de « retrouver le violeur, pas seulement pour le dénoncer, mais pour le menacer publiquement ([par des] bombages muraux, tracts, affiches, pourquoi pas des tribunaux de femmes sur les marchés, dans les centres commerciaux)[21] ». A Paris, les femmes du quartier Caulaincourt identifient elle-même un violeur et le dénoncent en bombant le magasin où il travaille[22].
Le 1er juin 1978, c’est pour répondre au viol d’une amie qu’une action de collage massif d’affiches et de bombage dans toute la rue de l’Ouest est réalisée par une vingtaine de femmes, avec des affiches « dont certaines dénonçaient nommément le violeur », et qui ont aussi été collées sur sa propre maison[23]. La marche de nuit de Toulouse du 29 novembre 1977, fait, elle aussi, de la dénonciation publique son action principale. Le choix est alors fait de placarder « des affiches portant les noms et adresse de deux violeurs », comme le rapporte Rouge, qui se fait l’écho des longs débats qui traversent alors les femmes à ce sujet[24].
Utiliser la rue pour se faire justice passe aussi par l’utilisation de la violence physique qui est parfois revendiquée : « faire une action sur le lieu de travail ou d’habitation où habite le mec (dénonciation / appel à la délation) », et « s’organiser collectivement pour aller trouver le violeur… et lui casser la gueule ». Cet article étant accompagné d’un dessin explicite proposant « le coup de latte » comme moyen d’action. À Angers un groupe de « fémiradicales » présente lui aussi la violence physique comme acceptable quand il s’agit de se défendre[25].
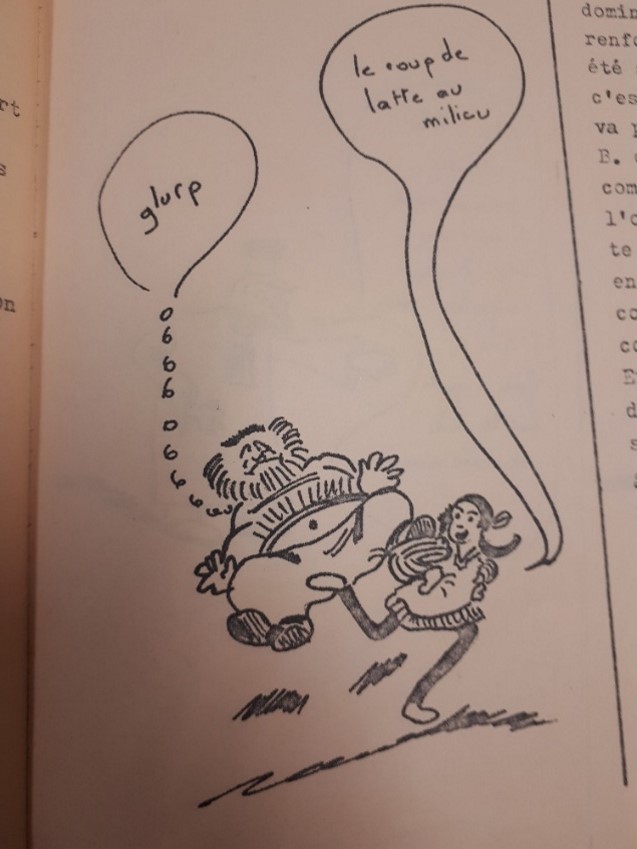
L’idée d’autodéfense des femmes devient ainsi un élément récurrent parmi les groupes femmes car elle permet « d’envisager le corps comme un lieu de prise de conscience où vient s’inscrire la lutte, un « lieu de rage »[26]». Elle est donc fréquemment citée dans les tracts, brochures ou dans la presse, comme l’une des solutions face au viol, et les cours d’auto-défense féminine se multiplient.
Des journaux de premier plan s’emparent dès lors de ce thème, pour dénoncer ces formes d’actions jugées trop radicales : « Œil pour œil, lynch, délation, vindicte, actions sauvages » dénonce le Nouvel Observateur, ce qui montre la fois l’audience qu’ont ces formes de lutte, mais aussi la stupeur ressentie face à l’utilisation de la violence par des femmes[27].
Au final que nous ont légué ces luttes féministes contre le viol ?
Le procès du Mans s’inscrit donc dans le contexte de la seconde moitié des années 1970, qui a vu les mouvements féministes lutter sans relâche pour faire comprendre que les violeurs étaient, non pas des monstres ou des déviants, mais le plus souvent des hommes tout à fait ordinaires, bien insérés socialement, ce qu’on appellerait aujourd’hui des « bons pères de famille[28] ».
Les femmes ont alors cherché à démontrer que le viol n’était pas un simple fait divers, mais une excitation liée au plaisir de dominer, et donc un élément profondément ancré dans notre société patriarcale, et servant à maintenir les femmes dans la peur et la soumission. Elles ont montré que ces valeurs de domination étaient étroitement liées aux valeurs portées par la société capitaliste. Et elles ont contribué à montrer les limites d’une politique de lutte contre le viol basée uniquement sur la répression carcérale, en proposant de multiples autres voies, plus ou moins radicales, pour mettre fin à ce crime de masse.
Le procès des viols de Mazan devrait être lui aussi l’occasion d’analyser le viol dans ce cadre de réflexion global, en faisant le procès, non pas de quelques hommes, mais du système de domination patriarcale et capitaliste dans son entièreté. C’est aussi l’occasion, à la lumière de l’histoire, de questionner nos luttes féministes actuelles, d’interroger la façon dont la violence est mise en jeu dans les rapports de pouvoir genrés[29], et de réfléchir à l’intégration de l’autodéfense féministe dans nos combats[30].
*
Illustratrion : Marche de nuit du 18 octobre 1977 devant les studios d’Antenne 2. © Louis Mesplé / Collection RaDAR
Notes
[1] « La prison n’est pas une solution », Le Monde, 27 janvier 1978.
[2] Histoire d’Elles, n°3, 1978, p.21.
[3] Le journal Rouge de la LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire) se fait largement l’écho de ces débats et devient ainsi un acteur de premier plan dans ces luttes contre le viol.
[4] Voir l’article de Jean BERARD : « Dénoncer et (ne pas) punir les violences sexuelles ? Luttes féministes et critiques de la répression en France de mai 68 au début des années 1980 », Politix, vol. 107, no. 3, 2014, pp. 61-64.
[5] « Tensions au procès du viol à Aix », L’Humanité, 4 mai 1978.
[6] « Un millier de femmes ont participé aux « Dix heures contre le viol » », Le Monde, 29 juin 1976. Et Le Nouvel Observateur, 25 mars 1978.
[7] « Publicité refusée hier au procès de Bobigny », Rouge, 23 septembre 1977.
[8] Voir la longue présentation du sujet dans « III. Comment lutter ? », Le Monde, 20 octobre 1977.
[9] « Un viol aux Assises du Mans. Audience publique et cinq ans de réclusion », Ouest France, éd Angers, 27
janvier 1978.
[10] Tract « 20 000 viols par an ça suffit ! », 1978, dossier viol, 179 VIO, BMD.
[11] Débat que relancera l’affiche « Cet homme est un violeur, cet homme est un homme » publiée par le MLF en 1980.
[12] Ilana ELOIT, « Quand les lesbiennes étaient « séparatistes ». Non-mixité lesbienne et résistances féministes (1970-1980) », 17 mars 2022, in Métropolitques (revue en ligne).
[13] Todd SHEPARD, Mâle Décolonisation, Payot, 2017. Pour lui ce discours traverse à la fois la droite et la gauche, dans un contexte de décolonisation, mais aussi de débat autour des victimes de l’impérialisme.
[14] « Meurtre de Philippine : des féministes et élus de gauche appellent à « ne pas se tromper de débat » », Le Monde, 26 septembre 2024.
[15] « Les femmes ne veulent plus se taire», Rouge, 20 octobre 1977.
[16] « Le groupe femmes d’Angers organisera le 3 février une soirée-débat sur le viol », Ouest France, éd. Angers, 19 janvier 1978.
[17] Voir la réflexion portée par Elsa DECK MARSAULT, Faire justice, Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes, La Fabrique, 2023.
[18] BMD, DOS 179 VIO, dossier viol « Ras le viol, bonjour la lâcheté » Collectif contre le viol, s.d.
[19] « Procès d’un cri des murs contre le viol », Rouge, 31 mai 1978.
[20] « Une lettre du groupe femmes de Bourges », Le Monde, 31 mai 1978.
[21] CAF, 54AF11, fonds Marie-Madeleine Tallineau, « La commission viol violence au stage du 15 octobre », Revue Dévoilée, n°15, novembre 1979.
[22] « Le viol de la rue Caulaincourt », Rouge, 3 novembre 1977.
[23] « Les violeurs et leurs complices », Libération, 13 juin 1978.
[24] « A Toulouse un choix contesté. Faire connaitre les violeurs ? », Rouge, 15 février 1978.
[25] Note du 13 janvier 1981. Cahier avec des notes de réunion tenu par un groupe de lesbiennes d’Angers. Fonds Anne-Marie Charles, 38AF5, CAF.
[26] Anne-Charlotte MILLEPIED, « Le pouvoir des mots et des corps. L’autodéfense féministe, lieu de production de scripts sexuels alternatifs », Itinéraires [Online], 2017-2 | 2018.
[27] Le Nouvel Observateur, 25 mars 1978.
[28] Rose LAMY, En bons pères de famille, Rose LAMY, 2023.
[29] Elsa DORLIN, Se défendre. Une philosophie de la violence, Zones, 2017.
[30] Charlotte BIENAIMEE, « Les femmes contre-attaquent », Un podcast à soi, n°34, 8 mars 2022, Arte radio.